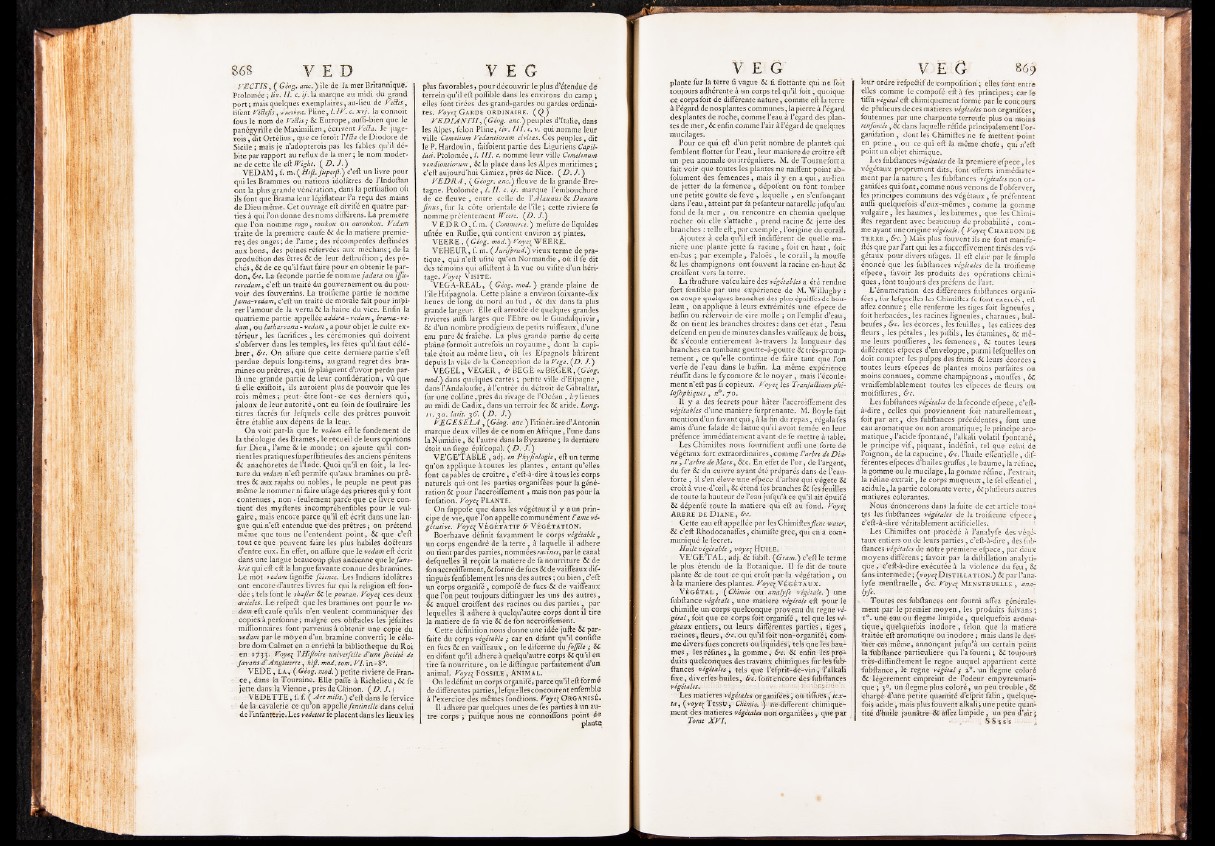
868 V E D
VECTIS, {Géog. <mc.) île de la mer Britannique.
Ptolomée ; liv. IL c. ij. la marque au midi du grand
port; mais quelques exemplaires, au-lieu de Veclis,
lil'ent Viâefis, kikA fk. Pline, LIV. c.xvj. la connoit
fous le nom de Veclis; 6c Eutrope, auffi-bien que le
panégyrifte de Maximilien, écrivent Vecia. Je juge-
rois , dit Ortélius, que ce feroit Vicia de Diodore de
Sicile ; mais je n’adopterois pas les fables qu’il débite
par rapport au reflux de la mer ; le nom moderne
de cette île eft Wight. ( D . /. )
VEDAM, f. m.(Hifl.J'uperß.) c’eft un livre pour
qui les Brammes ou nations idolâtres de l’Indoflan
ont la plus grande vénération, dans la perfuafion oii
ils font que Brama leur légiflateur l’a reçu des mains
de Dieu même. Cet ouvrage eft divifé en quatre parties
à qui l’on donne des noms différens. La première
que l’on nomme rogo, roukou ou ouroukou. Vedam
traite de la première caufe & de la matière première
; des anges ; de l’ame ; des récompenfes deftinées
aux bons, des peines réfervées aux médians; de la
production des êtres 6c de leur deftruCtion ; des péchés
, & de ce qu’il faut faire pour en obtenir le pardon,
&c. La fécondé partie fe nomme jadara ou ijfu-
revedam, c’ eft un traité du gouvernement ou du pouvoir
des fouverains. La troifieme partie fe nomme
fama-vedam, c’eft un traité de morale fait pour infpi-
rer l’amour de la vertu 6c la haine du vice. Enfin la
quatrième partie appellée addera-vedam, brama-vedam,
ou latharvana - vedam, a pour objet le culte extérieur,
les facrifices, les cérémonies qui doivent
s’obferver dans les temples, les fêtes qu’il faut célébrer
, &c. On afliire que cette derniere partie s’eft
perdue depuis long-tems, au grand regret des bra-
mines ou prêtres, qui fe plaignent d’avoir perdu par-
là une grande partie de leur confidération, vu que
fi elle exiftoit, ils auroient plus de pouvoir que les
rois mêmes;;, peut - être font-ce ces derniers qui,
jaloux de leur autorité, ont eu foin de fouflraire les
titres facrés fur lefquels celle des prêtres pouvoit
être établie aux dépens de la leur.
On voit par-là que le vedam eft le fondement de
la théologie des Brames, le recueil de leurs opinions
fur Dieu, l’ame & le monde; on ajoute qu’il contient
les pratiques fuperftitieufes des anciens pénitens
6c anachorètes de l’ indë. Quoi qu’il en foit, la lecture
du vedam n’eft permife qu’aux bramines ou prêtres
6c aux rajahs ou nobles, le peuple ne peut pas
même le nommer ni faire ufage des prières qui y font
contenues, non - feulement parce que ce livre contient'
des myfteres incompréhenfibles pour le vulgaire
, mais encore parce qu’il eft écrit dans une langue
qui n’eft entendue que’des prêtres ; on prétend
même que tous ne l’entendent point, 6c que c’eft
tout ce que peuvent faire les plus habiles dofteurs
d’entre eux. En effet, on affure que le vedam eft écrit
dans une langue beaucoup plus ancienne que le fans-
krit qui eft eft la langue fa vante connue des bramines.
Le mot vedam lignifie fcience. Les Indiens idolâtres
ont encouerd’autres livres fur qui la religion eft fondée
; tels font le shaßer 6c le pour an. Voyer ces deux
. articles.. Le refpeét que les bramines ont pour le ve-
| ■ dam eft caufe qu’ils n’en veulent ■ communiquer des
copies àvperfonne ; malgré ces obftacles les jéfuites
millionnaires font parvenus à obtenir une copie du
. vedam par le moyen d’un bramine converti ; le célébré
dom Calraet en a enrichi la bibliothèque du Roi
en 173.3. Voye^ VHißoire. univerfelle d'une fociété de
■ favans. d'Angleterre , hiß. mod. totn. VI. in - 8°.
V ED E , LA, (.Géog. mod. ). petite riviere deFran-
- c e , d'ans la Touraine. Elle paffe à Richelieu, 6c fe
jette, dansclg Vienne, près de Chinon. ( D. J. )
V ED E T T E , f. f. ( Art milité) c’eft dans le fervice
de la-.cavalerie ce qu’on appelle féntinelle dans celui
de l’infanterie. Les vedettes le placent dans les lieux les
V E G
plus favorables, pour découvrir le plus d’étendue dé
terrein qu’il eft poflible dans les environs du camp ;
elles font tirées des grand-gardes ou gardes ordinaires.
Voye^ G arde o r d in a ir e . (Q )
V ED IAN T II , (Géog. anc.') peuples d’Italie, dans
les Alpes, félon Pline, liv. III. c. v. qui nomme leur
ville Cemelium Vedantiorum civitas. Ces peuples, dit
le P. Hardouin, faifoient partie des Liguriens CapiL
lad. Ptolomée, /. III. c. nomme leur ville Cemelenum
vendiontiorum, 6c la place dans les Alpes maritimes ;
c’eft aujourd’hui Cimiez, près de Nice. ( D . J. )
V E D R A , ( Géogr» anc.) fleuve de la grande Bretagne.
Ptolomée, l.I I . c. ij. marque l’embouchure
de ce fleuve, entre celle de Y Alaunus 6c Dununt
Jinus, fur la côte orientale de l’île ; cette riviere fe
nomme préfentement Weere. (D . J.)
V ED R O , f. m. ( Commerce. ) mefure de liquides
ufitée en Rullie, qui contient environ zç pintes.
V EERE, (Géog. mod.) Voye{ WEERE.
VÉHEUR, f. m. (Jurjfprud.) vieux terme de pratique
, qui n’eft ufité qu’en Normandie, où il fe dit
des témoins qui alîiftent à la vue ou vifite d’un héritage.
Voye^ Vis it e .
VEGA-RÉAL, ( Géog. mod. ) grande plaine de
l’îleHiipagnola. Cette plaine a environ foixante-dix
lieues de long du nord au fud , 6c dix dans fa plus
grande largeur. Elle eft arrofée de quelques grandes
rivières aufli larges que l’Ebre ou le Guadalquivir,
& d’un nombre prodigieux de petits ruiffeaux, d’une
eau pure 6c fraîche. La plus grande partie de cette
plaine formoit autrefois un royaume, dont la capitale
étoit au même lieu, où les Efpagnols bâtirent
depuis la ville de la Conception de la Vega. (D. J.)
VEGEL, VEGER , & BEGÈ ou BEGER, (Géog.
mod.) dans quelques cartes ; petite ville d’Efpagne ÿ
dans l’Andaloufie, à l’entrée du détroit de Gibraltar,
fur une colline,près du rivage de l’Océan, à 7 lieues
au midi de Cadix, dans un terroir fec 6c aride. Long.
/1. j o . latit. jC . ( D . J.)
V E G E S E L A , (Géog. anc.) l’itinéraire d’Antonin
marque deux villes de ce nom en Afrique, l’une dans
la Numidie, 6c l’autre dans la Byzazene ; la derniere
étoit un fiege épifcopal; (D . J .)
VE’GE’TABLE , adj. en Phyjîologîe, eft un terme
qu’on applique à toutes les plantes , entant qu’elles
font capables de cro ître , c’eft-à-dire à tous les corps
naturels qui ont les parties organifées pour la génération
6c pour l’aceroiffement, mais non pas pour la
fenfation. Voye^ P lante'.
On fuppofe que dans les végétaux il y a un principe
de vie, que l’on appelle communément l'ame végétative.
Voye{ VÉGÉTATIF & VÉGÉTATION.
Boerhaaye définit favamment le corps végétable ,
un corps engendré de la terre , à laquelle il adhéré
ou tient par des parties, nommées racines, par le canal
defquelles il reçoit la matière de fa nourriture 6c de
fon accroiffement, &formé de fucs 6c de vaiffeaux distingués
fenfiblement les uns des autres ; ou bien, c’eft
un corps organifé, compofé de fucs & de vaiffeaux
que l’on peut toujours diftinguer les uns des autres,
oc auquel croiffent des racines ou des parties, par
lequelles il adhéré à quelqu’autre corps dont il tire
la matière de fa vie Sc de fon accroiffement.
Cette définition nous donne une idée juftè & parfaite
du corps végétable ; car en difant qu’il confifte
en fucs 6c en vaiffeaux, on le diféerne du fojjilc ; 6c
en difant qu’il adhéré à quelqu’autre corps 6c qu’il en
tire fa nourriture, on le diftingue parfaitement d’un
animal. Voye{ Fo s s il e , An im al . r
On le définit un corps organifé, parce qu’il eft forme
de différentes parties, lefquelles concourent enfemble
à l’exercice des mêmes fondions. Voye^ O rga n is e .
Il adhère par quelques unes de fes parties à un autre
corps ; puifque nous ne connoiffons point de
plante
V E G
planté fur la terre fi vague 6c fi flottànté qui ne Toit
toujours adhérente à un corps te l qu’il fo it, quoique
cq corps foit de différente n a tu re , comme eft la terre
à l’égard de nos plantes communes, la pierre à l’égard
«les plantes de roche, comme l’eau à l’égard des plantes
de m e r, 6c enfin comme l’air à l’égard de quelques
mucilages.
Pour ce qui eft d’un petit nombre de plante^ qui
femblent flotter fur l’eau, leur maniéré de croître eft
un peu anomale ou irrégulière. M. de Tourneforta
fait voir que toutes les plantes ne naiffent point ab-
folument des femences , mais il y en a qui, au-lieu
de jetter de la femence, dépofént ou font tomber,
une petite goutte de feve , laquelle , en s’enfonçant
dans l’eau, atteint par fa pefanteur naturelle jufqu’au
fond de la mer , ou rencontre en chemin quelque
rocher où elle s’attache , prend racine & jette des
branches : telle eft, par exemple, l’origine du corail.
Ajoutez à. cela qu’il eft indifférent de quelle maniéré
une plante jette fa racine , foit en haut, foit
en-bas ; par exemple, l’aloës , le corail, la moufle
6c les champignons ont fouvent la racine en-haut 6c
croiffent vers la terre.
La ftruCture vafculaire d es vcgétables a été rendue
fo rt fenfible par une expérience de M. Willugby :
o n coupe quelques branches des plus épaiffes de bouleau
, on applique à leurs extrémités une efpece de
ballin ou ré fèrvoir de cire molle ; on l’emplit d’e a u ,
6c on tient les branches droites : dans cet é t a t , l’eau
defeend en peu de minutes dans les-vaiffeaux de bois,
6c s’écoule entièrement à-trav e rs la longueur des
branches en tombant goutte-à-goutte 6c très-promptem
e n t, ce qu’elle continue de faire tant que l’on
verfe de l’eau dans le baflin. La même expérience
réufîit dans le fycomore 6c le n o y e r ; mais î’écouleT
ment n’eft pas fi copieux. Voye^ les Tranfaclionsphi-
lofophiques, n°. yo.
Il y a des fecrets pour hâter I’accroiffement des
végétables d’une maniéré furprenante. M. Boylé fait
mention d’un favant qui, à la fin du repas, régala fes
amis d’une falade de laitue qu’il avoit femée en leur
préfence immédiatement avant de fe mettre à table.
Les Chimiftes nous fourniflent aufli une forte de
végétaux fort extraordinaires, comme l'arbre de Diane
, l'arbre de Mars, 6cc. En effet de l’o r , de l’argent,
du fer 6c du cuivre ayant été préparés dans de l’eau-
forte , il s’en éleve une efpece d’arbre qui végété &
croît à vue-d’oeil, 6c étend fes branches 6c fes feuilles
de toute la hauteur de l’eau jufqu’à ce qu’il ait épuifé
6c dépenfé toute la matière qui eft au fond. Voye^
Arb re de D ia n e , & c.
Cette eau eft appellée par les Ghimiftes^/w water,
6c c’eft Rhodocanaffes, chimifte grec, qui etva communiqué
le fecret.
Huile végétable , voyeç Hu il e .
VE’GE’T A L , adj. 6c fubft. (G r am .) c’eft le terme
le plus étendu de la Botanique. Il fe dit de toute
plante 6c de tout ce qui croît par la végétation , ou
à la maniéré des plantes. Voye^ Vé g é ta u x .
VÉGÉTAL, (Chimie ou analyfe végétale.) une
fubftance végétale, une mâtiere végétale eft p our le
chimifte un corps, quelconque ‘provenu du régné végétal,
foit que ce corps foit organifé, tel que les végétaux
en tiers, ou leurs différentes parties ^ tiges i
ra c in e s, fleurs, &c. ou qu’il foi't’non-Organifé^ cfOm-
me divers fues concrets oü'liqùidésy-tels que lès baumes
, les réfines > la gommé ; &c: 6c etints::lë&$r&‘
duits quelconques des travaux ehihïiques fût lfeS fub1-
fiances végétales, te ls que re fp'rit-de-viriy Talkàîi
fixe, diverfes huiles, &c. fofitèWcôte des-fUbftânèès
végétales., ‘ stgn roi a&vseifint6(îtorpp|»ijdpn
Les matières végétales organiféèÿi1 où ti^irëà -//e^-
ta, (vôyeç Tls sV ; Chimie* |)jjtfe'different citimiqüé'-
ment des matières végétales non organifées -, que par
Tome X V I ,
V Ë G 86<>
leur ordre refpeftif de Compofition ; elles font entre
elles comme le compofé eft à fes principes; carie
tiffu végétal eft chimiquement formé par le contours
de plufieurs de ces matières végétales non organifées,'
foutenues par une charpente terreufe plus ou moins
renforcée, 6c dans laquelle réfide principalement Tor-
ganifation , dont les Chimiftes ne fe mettent point
en peine , ou ce qui eft la même chofe ; qui n’eft:
point un objet chimique:
Les fubftances végétales de la première efpece, les
végétaux proprement-dits.;: font offerts immédiatement
par la nature ; les fubftances végétales non organifées
qui font, comme nous venons de l’obferver,
les principes communs des végétaux, fe préfentent
auffi quelquefois d’eüx-mêmes, comme la gomme
vulgaire, les baumes, les bitumes, que les Chimiftes
regardent avec beaucoup de probabilité , comme
ayant une origine végétale. ( Voyeç C harbon de
ter r e , &c. ) Mais plus fouvent ils ne font manife-
ftés que par l’art qui les a fuccefîïvement tirés des végétaux
pour divers ufages. Il eft clair par le fimplé
énoncé que les fubftances végétales de la troifieme
efpece, favoir les produits des opérations chimiques
, font toujours des préfens de l’art.
L’énumération des différentes fubftances organi-
fées, fur lefquelles les Chimiftes fe font exercés, eft
affez connue ; elle renferme les tiges foit ligneufes,
foit herbacées, les racines ligneufes, charnues, bul-
beufes, &c. les écorces, les feuilles , les calices des
fleurs , les pétales , les piftils, les étamines, 6c même
leurs pouflieres, les femences, 6c toutes leurs
différentes efpeces d’enveloppe, parmi lefquelles on
doit compter les pulpes des fruits & leurs écortes ;
toutes leurs efpeces de plantes moins parfaites ou
moins connues, comme champignons , moufles , 6c
vraiffemblablement toutes les efpeces de fleurs ou
moififfures, &c.
Les fubftances végétales de la féconde efpece* c’eft-
à'-dire, celles qui proviennent foit naturellement *
foit par art, des fubftances précédentes, font une
eau aromatique ou non aromatique; le principe aromatique
,d’acide fpontané, l’alkali volatil fpontané,
le principe v if, piquant, indéfini, tel que celui de
l’oignon,, de la capucine, &c. l’huile effentielle , différentes
efpeces d’huiles graffes, le baume, la réfine*
la gomme ou le mucilage, la gomme réfine, l’extrait;
la réfine extrait, le Corps muqueux, le fél effentiel,
acidulé ,1a partie colorante verte, & plufieurs autres
matières colorantes.
Nous énoncerons dans la fuite de cet article -tou-
tes les fubftances végétales de la troifieme efpece*
c’eft-à-dire véritablement artificielles. ;
Les Chimiftes ont procédé à l’analyfé des végé^
taux entiers ou de leurs parties, c’eft-à-dire, des fulv-
ûances végécales de notre première efpece, par deux
moyens différens ; favoir par la diftillation analytir
que > c’éft-à-dire exécutée à la violence du feu, &
fans intermede; (vo^ D ist il la t ion .) &par l’analyfé
menftruelle, &c. Voye^ Menstruelle , ana-
- ■
s . Toutes ces fubftances ont fourni affez générale’-
mènt par le premier m oyen, les produits fuivans ;
i° . unééâuOu flegme limpide, quelquefois arôma^
tique ; quelquefois inôdor'e, félon que la mafierè
traitée eft aromatique ou inodore ; mais dans le der-
ni er-Cas même, annonçant jufqu’à un certain point
:la fubftance 'particulière qui l’a fourni ;. & toujours
très-diftinftement le regne auquel appartient eettè
■ fubftance, le regne végétal ; i ° . un flegme coloré
6c légèrement empreint de l’odeur empyreumati-
que ; 3°. un flegme plus coloré, un peu trouble, 6t
-chargé d’une petite quantité d’efprit falin, quelquefois
a'çide, mais plus fouveiit âlkali; une petite quantité
d’buile jaunâtre 6c- àffez limpide, un peu d’air >