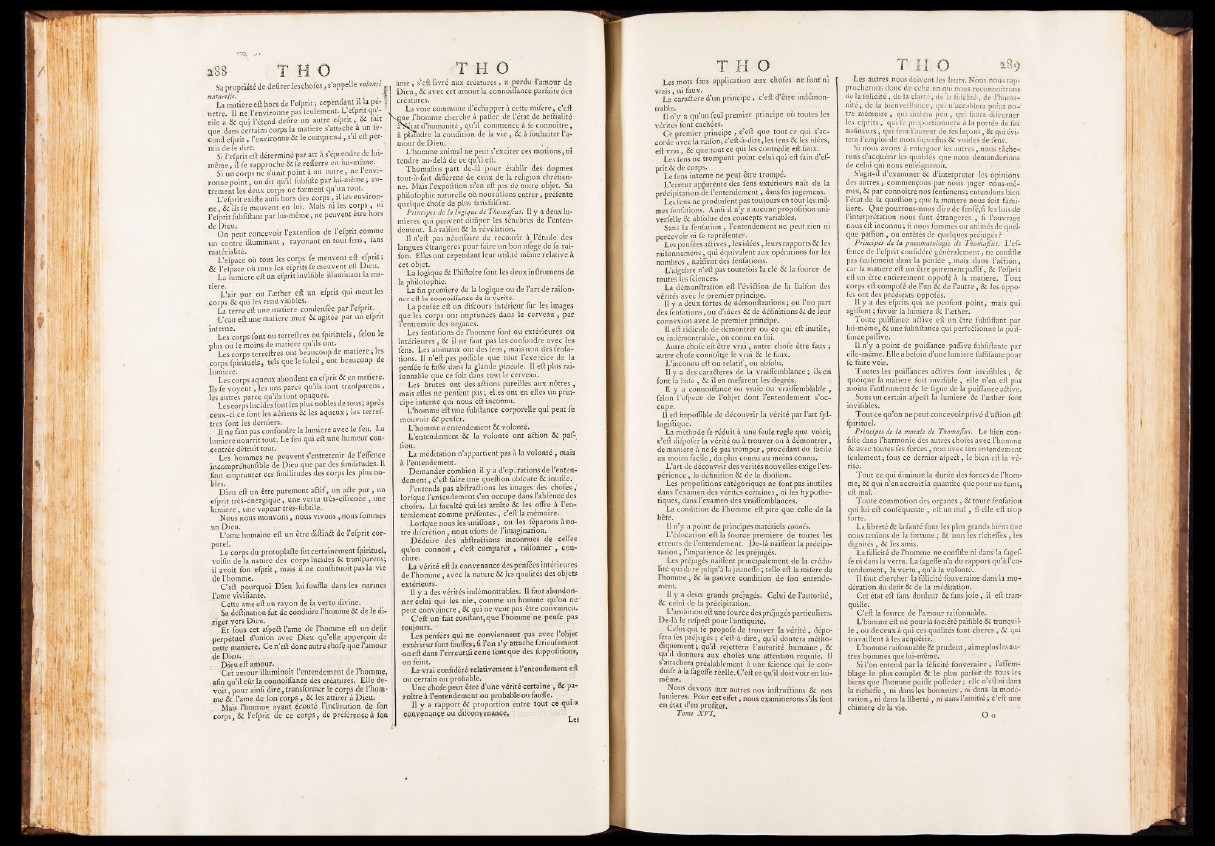
Sa propriété de defirerleschofes, s’appelle volonté
n amM c f , M— B l
La matière eft hors de l’efprit; cependant il la pe- f
tietre. Il ne l’environne pas feulement. L efprit qu - J
elle a 6c qui l’étend déliré un autre efprit, & lait ;
que dans certains corps la matière s attache à un retond
efprit, l’environne 6c le comprend, s u eu permis
de le dire» . , . . ■
Si Pefprit eft déterminé par art à s eprendre ne lui-
même , il lé rapproche 6c le refferre en lui-même.
Si un corps ne s’unit point à un autre , ne 1 envi*-
ronne point, on dit qu’il fubfifte par lui-meme ; autrement
les deux corps ne forment qu’un tout.
L’efprit exifte auffi hors des corps , il les environ-*
n e , 6c ils fe meuvent en lui. Mais ni les corps , ni
l’efprit lùbfiftant par lui-même, ne peuvent etre hors
de Dieu» | , r .
On peut concevoir l’extenfion de 1 elpnt comme
un centre illummant, rayonant en tout fens, lans
matérialité» A f ..
L’efpace où tous les corps le meuvent elt elprit;
& l’efoace où tous les efprits fe meuvent eft Dieu.
La lumière eft un efprit invifible illuminant la matière
» 1 . . . ,
L’air pur ou l’æther eft un elprit qui meut les
corps 6c qui les rend vifibles. . ,
La terre eft une matière condenfée par 1 efprit.
L’eau eft une matière mue 6c agitée par un efprit
m LeTcorps font ou terreftres ou fpirituels, félon le
plus ou le moins de matière qu’ils ont. .
Les corps terreftres ont beaucoup de matière ; les .
corps fpirituels, tels quelefoleil, ont beaucoup de
lumière» . . .
Les corps aqueux abondent en elprit oc en matière.
Us fe voyent*, les uns parce qu’ils font tranfparens,
les autres parce qu’ils font opaques. , ■
Lescorps lucides font les plus nobles de tous ; apres
,çeux-çice font les aériens 6c les aqueux; les terreftres
font les derniers. .
Il ne faut pas confondre la lumière avec k leu. La
lumière nourrit tout. Le feu qui eft une humeur con-
.centrée détruit tout. . , „
Les hommes ne peuvent s’entretenir de leilençe
ineompréhenfible de Dieu que par des fimilitudes. Il
faut emprunter ces fimilitudes des corps les. plus nobles.
. _
Dieu eft un être purement aft.if, un acte pur, un
efprit très-énergique, une vertu tres-effrénee , une
lumière, une vapeur îrès-fubtile.
Nous nous mouvons, nous vivons ,nouslommes
\mDieu. ». .
L’ame humaine eft un être diftinft de l’efprit corporel.
, # . ;
Le corps du protoplafte fut certainement fpintuel,
voifin de la nature des corps lucides 6c tranfparens;
■ il ,avoit fon efprit, mais il ne cpnftituoit pasla vie
de l’homme.
C’ eft pourquoi Dieu lui fouffla dans les narines
J’ame yivifiante.
Cette ame eft un rayon de la vertu divine.
Sa deftination fut de conduire l’homme 6c de le di-
jriger vers Dieu.
jEt fous cet afpett l’ame de l’homme eft un defir
perpétuel d’union avec Dieu qu’elle apperçoit de »
ce^tç maniéré. Ce n’eft donc autre chofe que l’amour
de Dieu.
, Dieu eft ainpvtr.
~ ‘ Cet amour illuminoit l’entendement de l’homme,
- qu’il eut la connoiffance des créatures. Elle de- •
vo it, pour ainfi dire, transformer le corps de l’hoi#- .
pie 6c l’ame de fon corps , 6c les attirer à Dieu.
Mais l’homme ayant écouté l’inclination de fon ;
corps, ôc l’efprit de ce corps, de préférence à foh
âiftè, s'eft livré aux créatures, a perdu l’amoür dè
Dieu, 6c avec cet amour la connoiffance parfaite deà
créatures»
La voie commune d’échapper à cette mifere., c’eft
•>que l’homme cherche à palier de l’état de beftialité
èrSétat d’humanité, qu’i l commence à fe connoître ,
à plaindre la condition de la v ie , 6c à fouhaiter l’amour
de Dieu-.
L’homme animal ne peut s’exciter ces motions, ni
tendre au-delà de ce qu’il eft.
Thomalius part de-là pour établir des dogmes
tout-à-fait differens de ceux de la religion chrétienne.
Mais l’expolition n’en eft pas de notre objet. Sa
philofophie naturelle où nous a lions entrer, préfente
quelque chofe de plus latisfaifant»
Principes de la logique de Thomajîus. Il y a deux lu*
mieres. qui peuvent difliper les ténèbres de l’entendement.
La raifon 6c la révélation.
Il n’eft pas néceffaire de recourir à l’étude des
langues étrangères pour faire un bon ufege de fa raifon
» Elles ont cependant leur utilité même relative à
cet objet.
La logique & l’hiftoire font les deux inftrumens de
la philolophie»
La fin première de la logique ou de l’art de raifon*
ner eft la connoiffance de la vérité.
La penfée eft un difeours intérieur fur les images
que les corps ont imprimées dans le cerveau , par,
i ’entremife des organes.
Les fenfations de l’homme font ou extérieures ou
intérieures, 6c il ne faut pas les confondre avec les
fens. Les animaux ont des fens, mais non des fenfations.
U n’ eft pas poflible que tout l’exercice de la
penfée fe faffe dans la glande pinéale. Il eft plus rai-
fonnable que ce foit dans tout le cerveau,.
Les brutes ont des aérions pareilles aux nôtres ,
mais elles ne penfent pas ; elies ont en elles un principe
interne qui nous eft inconnu.
L’hommé eft une fubftance corporelle qui peut fe
mouvoir 6C penfer.
L’homme a entendement & volonté.
L’entendement 6c la volonté ont aélion 6c paf~
ftom . . , .
La méditation n’appartient pas à la volonté, mais
à l'entendement.
Demander combien il y a d’op:rations de l’entendement
, c’eft faire une queftion obfcure 6c inutile*
J’entends pas abftraérions les images des chofes,'
lorfque l’entendement s’en occupe dansTabfence des
choies. La faculté qui les arrête 6c les offre à l'entendement
comme préfentes , c’eft la mémoire.
Lorf que nous les unifions, ou les leparons à notre
difcrétion, nous ufons de l’imagination.
Déduire des abftra&ions inconnues de celles
qu’on connoît, c’eft comparer , raifonner , con-,
dure. I H H j
La vérité eft la convenance des penfées intérieures
de l’homme, avec la nature 6c les qualités des objets
extérieurs.
Il y a des vérités indémontrables. Il faut abandonner
celui qui les nie, comme un homme qu’on n e '
peut convaincre, 6c qui ne veut pas être convaincu.
C’ eft un fait confiant, que l’homme ne penfe pas
toujours. • > . : ..
Les penfées qui ne conviennent pas avec l’objet
:extérieur font fauffes; fi l’on s’y attache férieufement
oneftdans Perreur;ficene lontque des fuppofitions,
on feint. t n.
Le vrai çonfidëré relativement à f entendement eft
ou certain ou probable.
Une chofe peut être d’une vérité certaine , & pa-
roître à l’entendement ou probdbieoufeuffe.
Il y a rapport & proportion entre tout ce qui a
convenant qu, ^convenance*
L e s
Les mots fans application aux chofes ne font'm
Vrais, ni faux. _ , . ,
Le cara&ere d’un principe, c’ell d etre indémontrable.
. . N
Il n’y a qu’un feul premier principe ou toutes les
■ vérités font cachées.
Ce premier principe » c’ eft que tout ce qui s’accorde
avec la raifon, c’eft-à-dire, les fens 6c les idées,
eft vrai, 6c que tout ce qui les contredit eft faux.
Les fens ne trompent point celui qui eft fain d’ef-
prit 6c de corps.
Le fens interne ne peut être trompé.
L’erreur apparente des fens extérieurs naît de la
précipitation de l’entendement, dans fes jugemens.
Les fens ne produifent pas toujours en tout les mêmes
fenfations. Ainfi il n’y a aucune propofition uni-
verfelle 6c abfolue des concepts variables.
Sans la fenfation, l’entendement ne peut rien ni
percevoir ni fe repréfenter. ^
Les penfées actives, les idées, leurs rapports & les
raifonnemens, qui équivalent aux opérations fur les
nombres , naiffent des fenfations.
L’algebre n’ eft pas toutefois.la clé & la fource de
toutes les fciences.
La démonftration eft l’évi&ion de la liaifon des
vérités avec le premier principe.
Il y a deux fortes de démonftrations ; ou l’on part
des fenfations, ou d’idées & de définitions 6c de leur
connexion avec le premier principe.
. Il eft ridicule de démontrer ou ce qui eft inutile ,
ou indémontrable, on connu en foi.
Autre chofe eft être v r a i, autre chofe être feux ;
«utre chofe connoître le vrai 6c le faux.
L’inconnu eft ou relatif, ou abfolu»
Il y a des caraéteres de la vraiffemblance ; ils eii
font la bafe > 6c il en mefurent\ les degrés.
Il y a connoiffance ou vraie ou vraiffemblable ,
félon l ’efpece de l’objet dont l’entendement s’occupe.
Il eft impolîible de découvrir la vérité par l’art fyl-
logiftique. '
La méthode fe réduit à une feule réglé que voici;
c’eft difpo'fer la vérité ou à trouver ou à démontrer,
de maniéré à ne fe pas tromper, procédant du facile
«u moins facile, du plus connu au moins connu.
L’art de découvrir des vérités nouvelles exige l’expérience
, la définition & de la divifion.
Les propolitions catégoriques ne font pas inutiles
dans l’examen des vérités certaines , ni les hypothétiques,
dans l’examen des vraiffemblànces.
La condition de l’homme eft pire que celle de la
bête.
Il n’y a point de principes matériels cormes.
L ’éducation eft la fource première de toutes les
•erreurs de l’entendement. De-là naiffent la .précipitation
, l’impatience 6c les préjugés.
Les préjugés naiffent principalement de la crédulité
qui dure jufqu’à la jeuneffe ; telle eft la mifere de
l’homme, 6c la pauvre condition de fon entendement.
Il y â deux grands préjugés» Celui de l’autorité,
6c celui de la précipitation.
L’ambition eft une fource des préjugés particuliers»
De-là le refpeél pour l’antiquité.
Celui qui fe propofe de trouver la vérité , dépo-
fera fes préjugés ; c’eft-à-dire, qu’il doutera méthodiquement
; qu’il rejettera l ’aiitorité humaine, &
qu il donnera aux chofes une attention requife. Il
s’attachera préalablement à une fcience qui le con*?
diiife à la fageffe réelle. C’eft ce qu’il doit voir en lui-
meme.
Nous devons aux autres nos inftru&ions & nos
lumières. Pour cet effet, nous examinerons s’ils font
en état d en profiter.
Tome X F I .
Lés autres nous doivent les leurs. Nous nous rapprocherons
donc de celui en qui nous reconnoîtrons
de la folidité, de la clarté'* de la fidélité, de l’humanité,
de la bienveillance * qui n’accablera point notre
mémoire , qui diètera peu , qui feura difeerrier
les efprits, qui fe proportionnera à la portée de (es
auditeurs, qui fera l’auteur de fes leçons, & qui évitera
l’emploi dè mots liiperflus 6c vuides de fens.
Si nous avons à enfeigner les autres, nous tâche-1
r-ons d’acquérir les qualités que nous demanderions
de celui qui nous enleignerbit.
S’agit-il d’examiner 6c d’interpreter les opinions
des autres , commençons par nous juger nous-mê-»
mes, 6c par connoître nos fentimens; entendons bien
l’état de la queftion; que la matière nous foit familière.
Que pourrons-nous dire de fenfé,fi les lois de
l’interprétation nous font étrangères-, fi l’ouvrage
nous eft inconnu ; fi nous .femmes ou anitriés de quel*
que paffiori , ou entêtés de quelques préjugés ?
Principes de la pneumatologie de Tkorriafiüs. L’ef-
fence de l’efprit confidéré généralement, ne confifte
pas feulement dans la penfée ,,mais dans l’a&ion ;
car la matière eft un être purementpaffif, 6c l’efprit
eft un être entièrement oppofé à la matière. Tout
corps eft eompofé de l’un 6c de l’autre, & les oppofé
s ont des prédicats oppofés.
Il y a des efprits qui ne penfent point, mais qui
agiffent ; fevoir la lumière & Pæther.
Toute puiffance attive eft un être fubfiftant par
lui-même, & une fubfiftance qui perfectionne la puiffance
paffîve.
Il n’y a point de puiffance paflive fubfiftante par
élle-même. Elle abeloin d’une lumière fuffifante pour
fé. faire voir.
Toutes les puiffances actives font invifibles ; &
quoique la matière foit invifible , elle n’en eft pas
moins l’inftrùment 6c le ligne de la puiffance aétive.
Sous un, certain afpeCt la lumière & Pæther font
invifibles.
Tout ce qu’on ne peut concevoir privé d’aftion eft
fpirituel.
Principes de la morale de Thomajîus. Le bien confifte
dans l’harmonie des autres chofes avec l’homme
& avec toutes fés forces, non avec fon entendement
feulement ; fous ce dernier afpeCt, le bien eft la vérité
» '
Tout ce qui diminue la durée des forces de l’homme,
ôe qui n’ en accroitla quantité que pour un tems,
eft mal1.
Toute commotion des organes, & toute fenfation
qur lui eft conféquente , eft un mal, fi elle eft trop
forte.
La liberté & la fente font les plus grands biéns que
nous tenions de la fortune ;: ôc non les richeffés , les
dignités , & les amis.
La félicité de l’homme ne confifte ni dans îa fageffe
ni dans la vertu. La fageffe n’a du rapport qu’à l’en*
tendement, la vertu, qu’à la volonté.
Il faut chercher la félicité fouveraine dans'la modération
du defir & de la méditation.’
Get état eft fen§ douleur 6c fens jo ie , il eft tranquille.
C’eft la fource de l’amour raifonnable.
L’homme eft né pour la foeiété paifible & tranquille
, ou de ceux à qui ces qualités font eheres , & qui
travaillent à les acquérir.
L’homme raifonnable & prudent, dimeplusles autres
hommes quelui-même.
Si l’on entend par la félicité fouveraine, l’affem-
blage le plus complet & le plus parfait de tous les
biens que l’homme puifle poffeder; elle n’eft ni dans
la richeffe, ni dans les honneurs, ni dans la modération
, ni dans la liberté, ni dans Pamitié ; c’eft une
chimere de la vie.
O o