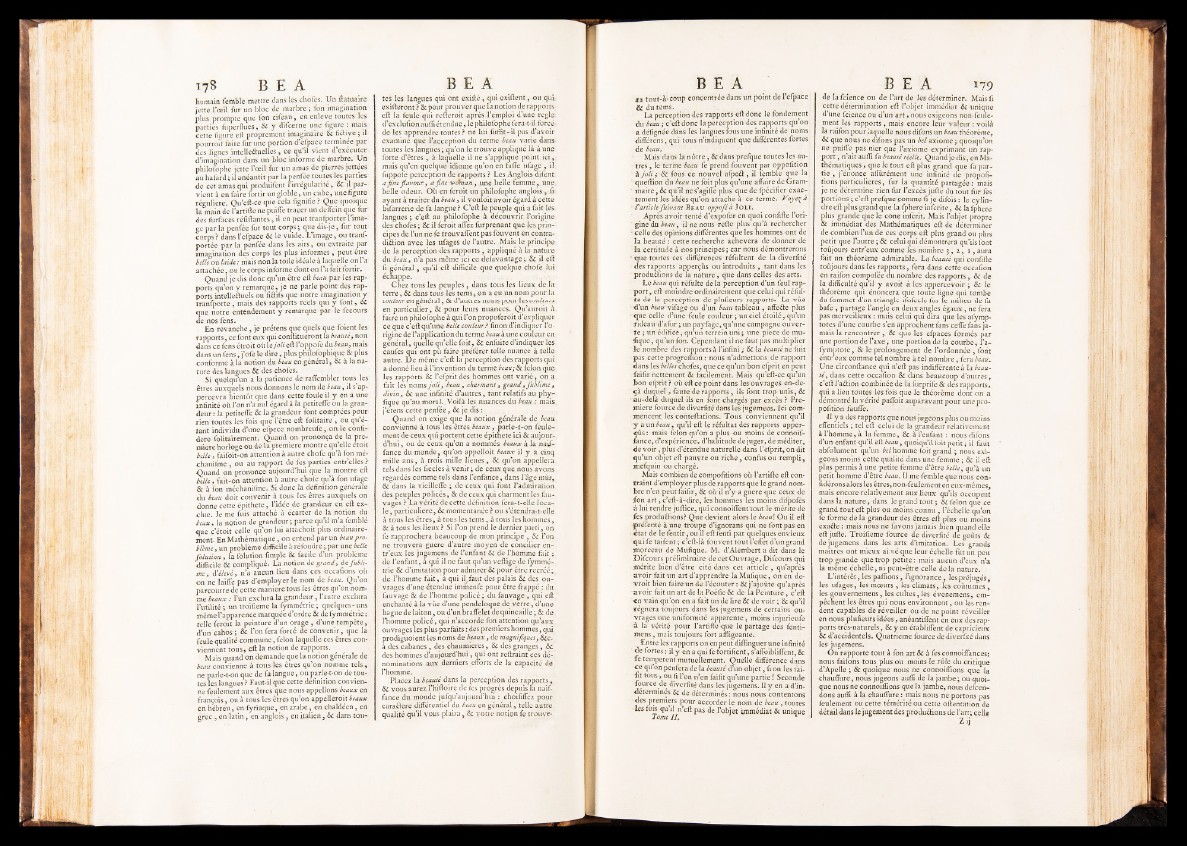
humain femble mettre dans les chofes. Un ftatuaire
jette l’oeil fur un bloc de marbre ; l'on imagination
plus prompte que fon cileau, en enleve toutes les
parties fuperflues, & y difcerne une figure : mais
cette figure eft proprement imaginaire & fiftive ; il
pourroft faire fur une portion d’efpaee terminée par
des lignes intellectuelles, ce qu’il vient d’exécuter
d’ima«ination dans un bloc informe de marbre. Un
philofophe jette l’oeil fur un amas de pierres jettees
au hafard ; il anéantit par la penfée toutes les parties
de cet amas qui produifent l'irrégularité, & il parvient
à en faire fortir un globle, un cube, une figure
régulière. Qu’eft-ce que cela fignifie ? Que quoique
la main de l’artifte ne puiflè tracer un deffein que fur
des furfaces rëfiftantes, il en peut transporter l’image
par la penfée fur tout corps ; que dis-je, fur tout
corps? dans l’efpace & le vuide. L’image, ou transportée
par la penfée dans les airs, ou extraite par
imagination des corps les plus informes , peut être
belle ou laide : mais non la toile idéale à laquelle on l’a'
attachée, ou le corps informe dont on l’a fait fortir.
Quand je dis donc qu’un être eft beau par les rapports
qu’on y remarque, je ne parle point des rapports
intellectuels ou fictifs que notre imagination y
tranfporte, mais des rapports réels qui y font, &
que notre entendement y remarque par le fecours
de nos Sens.
En revanche, je prétens que quels que Soient les
rapports, ce font eux qui conftitueront la beauté, non
dans ce fens étroit oii le joli eft l’oppofé du beau, mais
dans un fens, j’ofe le dire, plus philosophique & plus
conforme à la notion du beau en general, & à la nature
des langues & des chofes.
Si quelqu’un a la patience de raffembler tous les
êtres auxquels nous donnons le nom de beau, il s’ap-
percevra bientôt que dans cette foule il y en a une
infinité où l’on n’a nul égard à la petitefle ou la grandeur:
la petitefle & la grandeur font comptées pour
rien toutes les fois que l’être eft Solitaire , ou qu’étant
individu d’une efpece nombreufe, on le confi-
dere Solitairement. Quand on prononça de la première
horloge ou de la première montre qu’elle etoit
belle, faifoit-on attention à autre chofe qu’à fon mé-
chanifme , ou au rapport de Ses parties entr’elles ?
Quand on prononce aujourd’hui que la montre eft
belle, fait-on attention à autre chofe qu’à fon ufage
& à fon méchanifme. Si donc la définition générale
du beau doit convenir à tous les êtres auxquels on
donne cette épithete, l’idée de grandeur en eft exclue.
Je me fuis attaché à écarter de la notion du
beau , la notion de grandeur ; parce qu’il m’a femblé
que c’étoit celle qu’on lui attachoit plus ordinairement.
En Mathématique, on entend par un beau problème
, un problème difficile à réfoudre ; par une belle
folution, la Solution Simple & facile d’un problème
difficile & compliqué. La notion de grand, àefubli-
me, d’élevé, n’a aucun lieu dans ces occafions oîi
on ne laiffe pas d’employer le nom de beau. Qu’on
parcourre de cette maniéré tous les etres qu on nomme
beaux : l’un exclura la grandeur, l’autre exclura
l’utilité ; un troifieme la fymmétrie; quelques-uns
même l’apparence marquée d’ordre & de fymmétrie :
telle feroit la peinture d’un orage , d’une tempête,
d’un cahos ; & l’on fera forcé de convenir, que la
feule qualité commune, félon laquelle ces êtres conviennent
tous., eft la notion de rapports.
Mais quand on demande que la notion générale de
beau convienne à tous les êtres qu’on nomme tels.,
ne parle-t-on que de fa langue, ou parle-t-on de toutes
les langues? Faut-il que cette définition convienne
feulement aux êtres que nous appelions beaux en
françois, ou. à tous les êtres qu’on appelleroit beaux
en hébreu, en fyriaque, en arabe, en chaldéen, en
g re c , en latin, en anglois, en italien, & dans toutes
les langues qui ont exifté, qui exiftent, ou qui-
exifteront ? & pour prouver que la notion de rapports
eft la feule qui refteroit après l’emploi d’une réglé,
d’exclufion aufli étendue, le philofophe fera-t-ifforcé-
de les apprendre toutes ? ne lui fuffit-il pas d’ayoir
examine que l’acception du terme beau varie dans
toutes les langues ; qu’on le trouve appliqué là à une
forte d’êtres , à laquelle il ne s’applique point,ici,
mais qu’en quelque idiome qu’on en fafle ufage , il
fuppol'e perception de rapports ? Les Anglois difent
a fine fiavour, a fine wâman, une belle femme, .-une;
belle odeur. Où en feroit un philofophe anglois , fi
ayant à traiter du beau , il vouloit avoir égard à cette
bifarrerie de fa langue ? C ’eft Je peuple qui a fait les
langues ; c’eft au philofophe à découvrir l’origine
des chofes ; & il feroit allez furprenant que les principes
de l’un ne fé trouvaffent pas fouvent en contradiction
avec les ufages de l’autre. Mais le principe
de la perception des rapports , appliqué à la nature
du beau, n’a pas même ici ce defavantage ; & il eft
fi général, qu’il eft difficile que quelque chofe lui
échappe.
Chez tous les peuples, dans tous les lieux de la
terre, & dans tous lés tems, on a eu un nom pour la
couleur en général, & d’autres noms pour les couleurs,
en particulier, & pour leurs nuances. Qu’auroit à,
faire un philofophe à qui l’on propoferoit d’expliquer
ce que c’eft qu’une belle couleur ? finOn d’indiquer l’origine
de l’application du terme beau à une couleur en
général, quelle qu’elle foit, & enfuite d’indiquer les
caufes qui ont pu faire préférer telle nuance à telle
autre. De même c’eft la perception des rapports qui
a donné lieu à l’invention du terme beau; & felonque-
les rapports & l’efprit des hommes ont varié , on a
fait les noms jo li, beau , charmant, grand, fublime ,
divin, & une infinité d’autres, tant relatifs au phy-,
fique qu’au moral. Voilà les nuances du beau : mais
j’etens cette penfée, & je dis :
Quand on exige que la notion générale de beau
convienne à tous les êtres beaux , parle-t-on feulement
de ceux qui portent cette épithete ici & aujour-.
d’hui, ou de ceux qu’on a nommés beaux à la naijf-
fance du monde, qu’on appelloit beaux il y a cinq
mille ans, à trois mille lieues, & qu’on appellera
tels dans les fiecles à venir; de ceux que nous avons
regardés comme.tels dans l’enfance, dans l ’âge mûr,
& dans la vieillefîe ; de ceux qui font l’admiration
des peuples policés, & de ceux qui charment les fau-
vages ? La vérité de cette définition fera-t-elle locale
, particulière, & momentanée ? ou s’étendra-t-elle
à tous les êtres, à tous les tems, à tous les hommes,
& à tous les lieux ? Si l’on prend le dernier parti, on
fe rapprochera beaucoup de mon principe , & l’on
ne trouvera guere d’autre moyen de concilier en-
tr’eux les jugemens de l’enfant & de l’homme fait :
de l’enfant, à qui il ne faut qu’un veftige de fymmé-.
trie & d’imitation pour admirer & pour être recréé;
de l’homme fait, à qui il faut des palais & des ouvrages
d’une étendue immenfe pour être frappé : du
fauvage & de l’homme policé ; du fauvage , qui eft
enchanté à la vue d’une pendeloque de verre, d’une
bague de laiton, ou d’un braffelet de quincaille ; & de
l’homme policé, qui n’accorde fon attention qu’aux
ouvrages les plus parfaits : des premiers hommes, qui
prodiguoient les noms de beaux, de magnifiques, &c.
à des cabanes , des chaumières , & des granges , &
des hommes d’aujourd’hui, qui ont reftraint ces dénominations
aux derniers efforts de la capacité de
l’homme.
Placez la beauté dans la perception des rapports ,
ôc vous aurez l’hiftoire de fes progrès depuis la naif-
fance du monde jufqu’aujourd’hui : choififfez pour
caraCtere différentiel du beau en général, telle autre
qualité qu’il vous plaira, & votre notion fe trouvexa
tout-à-coup concentrée dans un point de l’éfpace
& du tems.
La perception des rapports eft donc le fondement
du beau; c ’eft donc la perception des rapports qu’on
a défignée dans les langues tous une infinité de noms
diffcrens, qui tous n’indiquent que différentes fortes
de beau:
Mais dans la nôtre, & dans prefque toutes les autres
, le terme beau fe prend fouvent par oppofition
à joli fous ce nouvel afpé'Ct , il femble que la
• queftion du beau ne foit plus qu’une affaire de Gram-
' maire ,& qu’il ne s’agiffe plus que de fpécifier exactement
les idées qu’on attache à ce terme. Voye^ a
- Varticlefuivant B e a u oppüféæ J o l i .
Après avoir tenté d’expofer en quoi confifte l’ori-
' gine du beau, il ne nous refte plus qu’à rechercher
' celle des opinions différentes que les hommes ont de
la beauté ; cette recherche achèvera de donner de
la certitude à nos principes; car nous démontrerons ■ que toutes ces différences réfultent de la diverfité des rapports àpperçûs ou introduits , tant dans les
productions de la nature, que dans celles des arts.
Le beau'qui réfulte de la perception d’un feul rapport
, eft moindre ordinairement que celui qui réfulte
de la perception de plufieurs rapports. La vue
• d ’un beau vifage ou d’un beau tableau , affeCte plus
• que celle d’une feule couleur ; un ciel étoilé ,• qu’un
rideau dlafur ; un payfage, qu’une campagne ouver-
■ te ; un ëdificê, qu’un terrein uni; une piece de musique,
qu’un fon. Cependant il ne faut pas multiplier
le nombre dès rapports à l’infini ; & la beauté ne fuit
pas cette prqgrelfion : nous n’admettons de rapport
dans 1 es belles chofes, que ce qu’un bon efprit en peut
faifir. nettement & facilement. Mais qu’èft-ce qu’un
bon efprit ? où eft ce point dans les ouvrages en-de-
çà duquel, faute de rapports, ils font trop unis, &
•au-delà duquel ils en font chargés par excès ? Première
fource de diverfité dans les jugemens. Ici commencent
les'Conteftations. Tous Conviennent qu’il
y a un beau, qu’il eft le réfiiltat des rapports apper-
^ûs : mais félon qu’on a plus ou moins de connoif-
fance, d’expérience, d’habitude de juger, de méditer,
de vo ir, plus d’étendue naturelle dans l’efprit, on dit
qu’un objet eft pauvre ou riche, confus ou rempli,
mefquin ou chargé.
Mais combien de compofitions où l’artifte eft contraint
d’employer plus de rapports que le grand nombre
n’en peut faifir, & où il n’y a gùere que ceux de
fon art, c’eft-à-dire, les hommes les moins difpofés
à lui rendre juftice, qui connoiffent tout le mérite de
fes productions? Que devient alors le beau\ Ou il eft
yréfenté à une troupe d’ignorans qui ne font pas en
• -état de le fentir, ou il eft lenti par quelques envieux
qui fe taifent ; c’eft-là fouvent tout l’effet d’un grand
morceau de Mufique. M. d’Alembert a dit dans le
Difcours préliminaire de cet Ouvrage, Difcours qui
mérite bien d’être cité dans cet article , qu’après
• -avoir fait -un art d’apprendre la Mufique, on en de-
vroit bien faire un de l’écouter : & j’ajoûte qu’après
avoir fait un art de la Poëfie & de la Peinture, c’eft
•en vain qu’on en a fait un de lire & de voir ; & qu’il .
régnera toujours dans les jugemens de certains ouvrages
une uniformité apparente, moins injurieufe
à la vérité pour l’artifte que le partage des fenti-
mens, mais toujours fort affligeante.
Entre les rapports on en peut diftinguer une infinité
de fortes : il y en a qui fe fortifient, s’affoibliffent, &
fe temperent mutuellement. Quelle différence dans
ce qu’on penfera de la beauté d’un objet, fi on les lai-
fit tous, ou fi l’on n’en faifit qu’une partie ! Seconde
fource de diverfité dans les jugemens. Il y en a d’in-
determinés & de déterminés : nous nous contentons
des premiers pour accorder le nom de beau , toutes
les fois qu il n’eft pas de l’objet immédiat & unique Tome II.
de la feience ou de l ’art de les déterminer. Maisft
cette détermination eft l’objet immédiat & unique
d’une fcience ou d’un art, nous exigeons non-feulement
leis rapports, mais encore leur valeur:voilà
la raifon pour laquelle nous difons un beau théorème,
& que nous ne difons pas un bel axiome ; quoiqu’on
ne puiffe pas nier que l’axiome exprimant un rapport
, n’ait aufli fa beauté réelle. Quand je dis , en Mathématiques,
que le tout eft plus grand que fa partie
, j’énonce aflûrément une infinité de propofi-
tions particulières, fur la quantité partagée: mais
je ne détermine rien fur l’excès jufte du tout fur fes
portions ; c’eft prefque comme fi je difois : le cylindre
eft plus grand que la fphere infcrite, & la fphere
plus grande que le cône infcrit. Mais l’objet propre
& immédiat des Mathématiques eft de déterminer
de combien l’un de ces corps eft plus grand ou plus
petit que l’autre ; & celui qui démontrera qu’ils font
toûjours entr’eux comme les nombre 3 , 2 , 1 , aura
fait un théorème admirable. La beauté qui confifte
toûjours dans les rapports, fera dans cette occafion
en raifon compofée du nombre des rapports, & de
la difficulté qu’il y a voit à les appercevoir ; & le
théorème qui énoncera que toute ligne qui tombe
du fommet d’un triangle ifofcele fur le milieu de fa
bafe , partage l’angle en deux angles égaux, ne fera
pas merveilleux : mais celui qui dira que les afymp-
totes d’une courbe s’en approchent fans ceflë fans jamais
la rencontrer, & que les efpaces formés par
une portion de l’axe, une portion de la courbe, l’a-
fymptote, & le prolongement de l’ordonnée , font
entr’eux comme tel nombre à tel nombre, fera beau.
Une circonftance qui n’eft pas indifférente à la beauté,
dans cette occafion & dans beaucoup d’autres,
c’eft l’aftion combinée de la furprife & des rapports,
qui a lieu toutes les fois que le théorème dont on a
démontré la vérité paffoit auparavant pour une pro-
pofition faufle.
■ Il y a des rapports que nous jugeons plus ou moins
effentiels ; tel eft celui de la grandeur relativement
à l’homme, à la femme, &; à l’enfant : nous difons
d’un enfant qu’il eft beau, quoiqu’il foit petit ; il faut
abfolument qu’un bel homme foit grand ; nous exigeons
moins cette qualité dans une femme ; & ii eft
plus permis à une petite femme d’être belle, qu’à un
petit homme d’être beau. Il me femble que nous con-
fidérons alors les êtres, non-feulement en eux-mêmes,
mais encore relativement aux lieux qu’ils occupent
dans la nature, dans le grand tout ; & félon que ce
grand tout eft plus ou moins connu , l’échelle qu’on
le forme de la grandeur des êtres eft plus ou moins
exaéte : mais nous ne favons jamais bien quand elle
eft jufte. Troifieme fource de diverfité de goûts &
de jugemens .dans les arts d’imitation. Les grands
maîtres ont mieux aimé que leur échelle fût un peu
trop grande que trop petite : mais aucun d’eux n’a
la même échelle, ni peut-être celle de la nature. .
L’intérêt , les pallions, l’ignorance, lespréjugés,
les ufages, les moeurs , les climats, les coûtumes ,
les gouvernemens, les cultes,les évenemens, empêchent
les êtres qui nous environnent, ou les rendent
capables de réveiller ou de ne point réveiller
en nous plufieurs idées , anéantiffent en eux des rapports
très-naturels, & y en établiffent de capricieux
& d’accidentels. Quatrième fource de diverfité dans
les jugemens.
On rapporte tout à fon art & à fes connoifîances:
nous faifons tous plus ou moins le rôle du critique
d’Apelle ; & quoique nous ne connoiflions que la
chauffure, nous jugeons aufli de la jambe; ou quoique
nous ne connoiflions que la jambe, nous defcen-
dons aufli à la chauffure: mais nous ne portons pas
feulement ou cette témérité ou cette oftentation de
détail dans le jugement des produrions de l’art; celle
Z ij