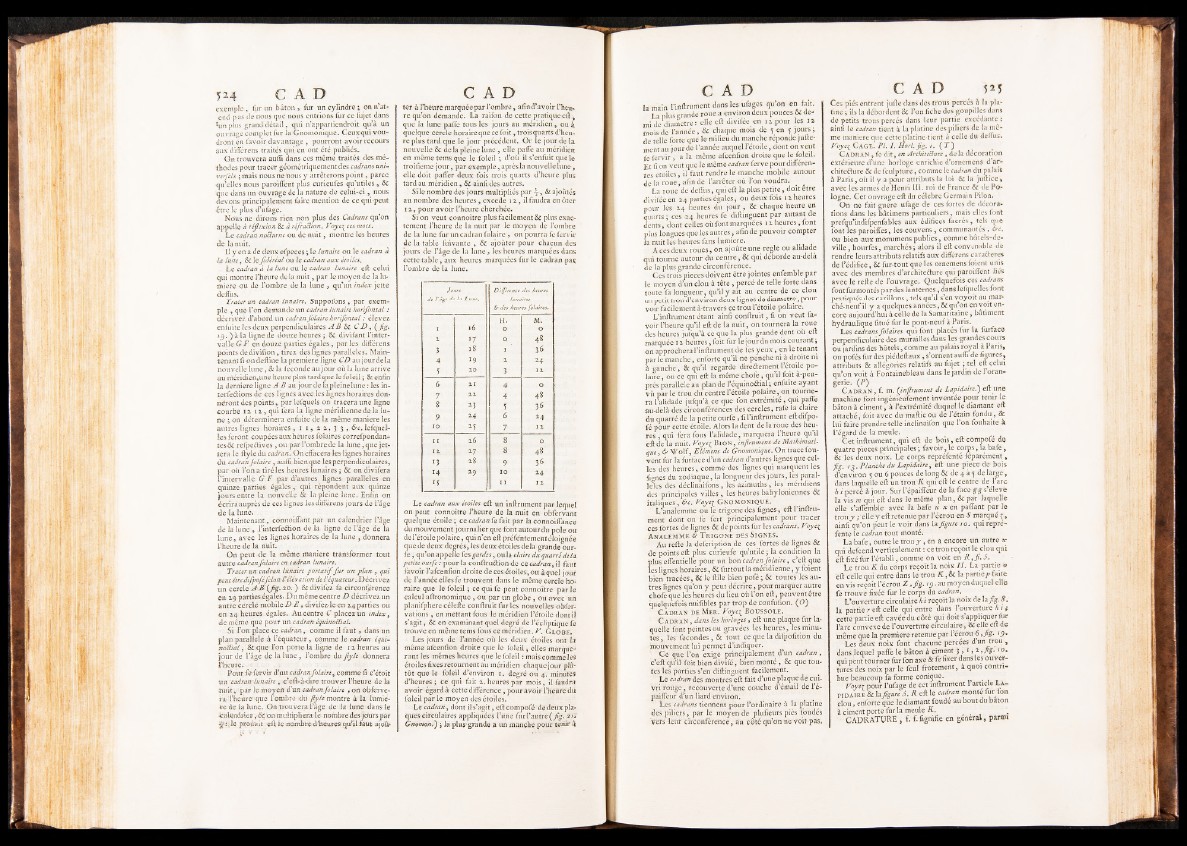
exemple, fur im bâton, fur tin cylindre ; on n’at-
,eruî pas de nous que nous entrions fur ce fujet dans
t^n plus grand détail, qui n’àppartiendroit qu’à un
ouvrage complet fur la Gnomonique. Ceuxqui voudront
en favoir davantage , pourront avoir recours
aux différens traités qui en ont été publiés.
On trouvera aufli dans ces même traités des méthodes
pour tracer géométriquement des cadrans uni-
vcrfch ; mais nous ne nous y arrêterons point, parce
qu’elles nous paroiffent plus eurieufes qu’utiles, &
que dans un ouvrage de la nature de celui-ci, notis
devons principalement faire mention de ce qui-peut
être le plus d’ufage.
Nous ne dirons rien non plus des Cadrans qu’on
appelle à réflexion 8c à réfraction. Voye{ ces mots.
Le cadran nocturne ou de nuit, montre les heures
de la nuit.
Il y en a de deux efpeces ; le lunaire ou le cadran a
la lune, Si le Jidéréal ou le cadran aux étoiles.
Le cadran à la lune ou le cadran lunaire eft celui
qui montre l’heure de la nuit, par le moyen de la lu*
miére ou dé l’ombre de la lune , qu’un index jette
deffus.
Tracer un cadran lunaire. Suppofons , par exemple
, qu,e l’on demande un cadran lunaire horifontal :
décrivez d’abord un cadran folâtre horifontal : élevez
enfuite les deux perpendiculaires A B Si C D , (fig.
*c>. ) à la ligne de douze heures ; Si divifant l’intervalle
G F en douze parties égales , par les différens
points dedivifion, tirez des lignes parallèles. Maintenant
fi on deftine la première ligne CD au jour de la
nouvelle lune, 3e la fécondé au jour où la lune arrive
au méridien,une heure plus tard que le foleil ; 8c enfin
la derniere ligne A B au jour de la pleine lune : les interférions
de ces lignes avec les lignes horaires-donneront
des points, par lefquels on tracera une ligne
courbe 1 2 x 1 , qui fera la ligne méridienne de la lune
; on déterminera enfuite de la même maniéré les
autres lignes horaires , 1 1 , 2 2 , 3 3 , lefquel-
les feront coupées aux heures folaires correfpondan-
tes& refpeûives, ou par-l’ombre de la lune, que jettera
le ftyle du cadran. On effacera les lignes horaires
du cadran Jolaire , aufli bien que les perpendiculaires,
par où l’on a tiré les heures lunaires ; & on divifera
l’intervalle G F par d’autres lignes parallèles en
quinze parties égales., qui répondent aux quinze
jours entre la nouvelle & la pleine lune. Enfin on
écrira auprès de ces lignes les différens jours de l’âge
de la lune.
Maintenant-, connoiflant par un calendrier l’âge
de là lune ., l ’interfeélion de la ligne de l ’âge de là
lune, avec les lignes horaires de la lune , donnera
l’heure de la nuit'.
On peut de la même maniéré transformer tout
autre cadran folaire en cadran lunaire.
Tracer un cadran lunaire portatif fur un plan, qui
peut être difpoféfélon P élévation de l'équateur. D écrivez
un cercle A B (fig. 20. ) 8c divifez fa circonférence
en 29 parties égaleS. Du même centre D décrivez un
autre cdrclé mobile D E , divifez-le en 24 parties ou
en 24 heures, égales. Au centre C placez un index,
de même que pour un cadran équinoclial.
Si l’on: place ce cadran, comme il faut, dans un
plan parallèle, à l’équateur, comme le cadran équinoxial
, 8c que l’on porte la ligrie de 12 heures au
jour de l ’âge de la lune , l’ombre d\x ftyle donnera
l ’heure.
Pour fe fervir d’un cadran folaire, comme fi c’étoit
un 'cadrairlunaire, c’eft-à-dire trouver l’heure de la
nuit, par le moyen d’un cadran folaire , on o'bferve-
râ'l’heure^que l’ombre ;dü. fyde montre à la lumière
de la lune. On trouvera l’âge de. la lune dans- lé
-calendrier i & on multipliera le nombre des jours par
3>|(la produit eft-le nombre d'heures qu’il faut ajofc
ter à l’heure marquée par l’ombre, afin d’avoir l’heu-
re qu’on demande. La raifon de cette pratique efl,
que la lune paffe tous les jours au méridien, ou à
quelque cercle horaire que ce foit, trois quarts d’heure
plus tard que le jour précédent. Or le jour de la
nouvelle 8c delà pleine lune, elle paffe au méridien
en même tems que le foleil ; d’où il s’enfuit que le
troifieme jour, par exemple, après la nouvelle lune ,
elle doit paffer deux fois trois quarts d’heure plus'
tard au méridien, 8c ainfi des autres.
Sile nombre des jours multipliés par 8eajoutés
au nombre des heures, excede 12 , il faudra en ôter
12, pour avoir l’heure cherchée.
Si on veut connoître plus facilement & plus exactement
l’heure de la nuit par le moyen de l’ombre
de la lune fur un cadran folaire , on pourra fe fervir
de la table fuivante , 8c ajouter pour chacun des
jours de l’âge de la lune, les-heures marquées dans
cette table, aux heures marquées fur le cadran pa$
l’ombre de la lune.
de l’âge de la Lune.
Difir'nc, J's.tSw j ,
& des heures folaires.
H. M.
I 16 O 0
2 mm 0 4«
3 1,8 I 36
4 19 2 24
5 20 3 12
6 21 4 O
7 22 4 48
8 *3 5 36
9 24 6 24
10 7 12
11 26 8 0
12 27 8 48'
!3 18 9 36
14 29 10 24
11 12
Le cadran aux étoiles efl un infiniment par lequel
on peut connoître l’heure de la nuit en obfêrvant
quelque étoile ; ce cadrante fait par la conmoiflanee
du mouvement journalier que font autour du pôle ou
de l’étoile polaire, qui n’en efl: préfe'ntement éloignée
que de deux degrés, les deux étoiles delà grande our-
f e , qu’on appelle fes gardes, ou la claire du quarrè dé là.
petite ourfe: pour la conftru&ion de ce càdràn, il faut
favoir l’afoenfion droite de ces étoiles, ou àquel joùf
de l’année elles fe trouvent dans le même'cercle ho-
raire que le foleil ; ce qui fe peut connoître par le
calcul aftronomique , ou par un globe, ou avec un
planifphere célefte eonftruit fur les nouvelles obfer-
vations , en mettant fous le méridien l'étoile dont il
s’agit, &: en examinant quel degré de l’écliptique fe
trouve en même tems fous ce méridien. V. Globe.
Les jours de l’année où les deux étoiles ont la
même afeenfion droite que le foleil, elles marque-1
ront les mêmes heures que le foleil : mais comme les
étoiles fixes retournent au méridien chaque jour plutôt
que le foleil d’environ x. degré ou 4. minutes
d’heures ; fce qui fait 2. heures par mois * il faudra
avoir égard à cette différence, pour avoir l’heure dit
foleil par le moyen des étoiles.
Le cadran, dont il s’agit, efteompofé dedeuxpla-
qttés eireulàires appliquées l’ürie fur l’autre ( fig. 2 Pi
Gnomon.) ; là plus1 grande a un mançhe pour tenir à
la H i’inftrument dans les H S ta fait.
La plus grande roue a environ deux pouces 8C demi
de diamètre : elle efl divifée en 12 pour les 12
mois de l’année, Si chaque mois de 5 en 5 jouts;
de telle forte que le milieu du manche réponde jufte-
ment au jour de l ’année auquel l’étoile, dont on veut
fe fervir, a la même afeenfion droite que le foleil.
Et fi on veut que le même cadran ferve pour différentes
étoiles, il faut rendre le manche mobile autour
de la roue, afin de l’arrêter oîi l’on Voudra.
La roue de deffus , qui efl la plus petite, doit être
divifée en 24 parties égales, ou deux fois 12 heures
pour les 24 heures du jour , & chaque heure en
quarts ; ces 24 heures fe diftinguent par autant de
dents, dont celles où font marquées 12 heures, font
plus longues que les autres, afin de pouvoir compter
la nuit les heures fans lumière.
A ces deux roues, on ajoute une réglé ou alidade
qui tourne autour du centre, & qui déborde au-delà
de la plus grande circonférence..
Ces trois pièces doivent être jointes enfemble par
le moyen d’un clou à tête, percé de telle forte dans
toute fa longueur, qu’il y ait au centre de ce clou
un petit trou d’environ deux lignes de diamètre, pour
voir facilement à-travers ce trou l’étoile polaire.
L’inftrument étant ainfi eonftruit, fi on veut favoir
l’heure qu’il eft de la nuit, on tournera la roue
des heures jufqu’à ce que la plus grande dent où eft
marquée 12 heures, foit fur le jour du mois courant ;
on approchera l’inftrument de fes y e u x , en le tenant
par le manche, enforte qu’il ne penche ni à droite ni
à gauche, 8e qu’il regarde directement l’étoile polaire
, ou ce qui eft la même chofe, qu’il foit à-peu-
près parallèle au plan de l’équinoélial ; enfuite ayant
Vû par le trou du centre l’étoile polaire, on tournera
l ’alidade jufqu’à ce que fon extrémité, qui paffe
au-delà des circonférences des cercles, rafe la claire
du quarré de la petite ourfe, fi l’inftrument eft difpofé
pour cette étoile. Alors la dent de la roue des heures
, qui fera fous l’alidade, marquera l’heure qu’il
èft de la nuit. Voye{ BiON, infiniment-de Mathématique,
& W olf, Elément de Gnomonique. On tracefou-
vent fur la furface d’un cadran d’autres lignes que celles
des heures, comme des lignes qui marquent les
fign.es du zodiaque, la longueur des jours, les parallèles
des déclinaifons , les azxmuths , les méridiens
des principales villes , les heures babyloniennes 8c
italiques, Oc. Voye[ Gnomonique.
L’anâlemme ou le trigone des fignes, eft l ’inftru-
ment dont on fe fert principalement pour tracer
ces fortes de lignes & de points fur les cadrans. Vrye^
Analemmè & T rigone des Signes.
Au refte la defcriptiën de ces fortes de lignes 8c
de points eft plus curieufe qu’utile ; la condition la
plus effentielle pour un bon cadran folaire, c’eft que
les lignes horaires, & furtout la méridienne, y foient
bien tracées, 8c le ftile bien pofé ; 8c toutes les autres
lignes qu’on y peut décrire, pour marquer autre
chofè que les heures du lieu où l’on eft, peuvent être
quelquefois nuifibles par trop dè cônfufion. (Ô)
Cadran de Mer. Voye^ Boussole. Cadran , dans les horloges, eft une plaque fur laquelle
font peintes ou gravées lès heures, les minutes
, les fécondés, 8e tout ce que la difpofition du
mouvement lui permet d’indiquér.
Ce que l’on exige principalement d’un cadran ,
c’eft qu’il foit bien divifé, bien monté, 8c que toutes
les parties s’eh diftinguent facilement.
Le cadran des montres eft fait d’une plaque de cui-
vri rouge, recouverte d’une couche d’émail de l’é-
paiffeur d’un liàrd environ.
Les cadrans tiennent pour l’ordinaire à la platine
des piliers, par le moyen de plufieurs pies foudés
vers leur circonférence, au côté qu’on ne voit pas.
Ces piés entrent jufté dans dés trous percés à la platine
; ils la débordent 8c l’on fiche des goupilles dans
de petits trous percés dans leur partie excédante c
ainfi le cadran tient à la platine des piliers de la mê-
me maniéré que cette platine-tient à celle du deffus.
Foyer C age. PI. I. Horl.fig. /. ( T ) ^ Cadran , fe dit, en Architecture, delà décoration
extérieure d’une horloge enrichie d’ornemens d’ar-
chiteélure & de fculpture, comme lé cadran du palais à Paris, où il y a pour attributs la loi & la juflice ,
avec les armes de Henri III. roi de France & de Pologne.
Cet ouvrage eft du célébré Germain Pilon.
On ne fait guere ufage de ces fortes de décora*-
tions dans les bâtimens particuliers, mais elles font
prefqu’indifpenfables aux édifices facrés, tels que
font les paroiffes, les couvens, communautés, Oc.
ou bien aux monumèns publics, comme hôtels-de-
v ille , bourfes, marchés ; alors il eft convenable de
rendre leurs attributs relatifs aux différens carafteres
de l’édifice, & fur-tout que les ornemens foient unis
avec des membres d’architecture qui paroiffent lies
. avec le refte de l’ouvrage. Quelquefois ces cadrans
font furmontés par des lanternes, dans lefquelles font
pratiqués des carillons, tels qu’il s’en voyoit au marché
neuf il y a quelques a nnées, 8c qu’on en voit encore
aujourd’hui à celle de la Samaritaine, bâtiment
hydraulique fitué fur le pont-neuf à Paris.
Les cadrans folaires qui font placés fur la furface
perpendiculaire des murailles dans les grandes cours
ou jardins des hôtels, comme au palais royal à Paris*
ou pofés fur des piédeftaux, s’ornent aufli de figures,
attributs 8e allégories relatifs au fujet ; tel eft celui
i qu’ on voit à Fontainebleau dans le jardin de l’orangerie.
(P) . . . Cadran, f. m. (inflrument de Lapidaire.) eft une
machine fort ingénieusement inventée pour tenir le
bâton à ciment, à l’extrémité duquel le diamant eft
attaché, foit avec du maftic ou de l’étain fondu, &
lui faire prendre telle inclinaifon que l’on fotihaite à
l’égard de la meule.
Cet inflrument, qui eft de bois, eft compofé de
quatre pièces principales ; favoir, le corps, la bafe ,
& lés deux noix. Le corps repréfènté féparément,
fig. / j . Planche du Lapidaire, eft une pieCe de bois
d’environ 5 ou 6 pouces de long & de 4 à 5 de large|
îlans laquelle eft un trou Æ qui eft le centré de l’arc
h i percé à jour. Sur l’épaiffeur de la face g g s’élevè
la vis m qui eft dans le même plan, & par laquelle
elle s’affemble avec la bafe u x en paflartt par le
trou y ; elle y eft retenue parTéerou en S marqué
ainfi qu’on peut le voir dans la figure 10. qui repréfente
le cadran tout monté.
La bafe, outre le trou y , en à encore un autre )c
qui defeend verticalement : ce trou reçoit le clou qui
eft fixé fur l’établi, comme ôn voit en R , fi. 6.
Le trou K. du corps reçoit la noix II. La partie 0
èft celle qui entre dans le trou K , 8c la partie p faitfe
en vis reçoit l’écrou Z., fig. /çj. au moyen duquel ellè
fe trouvé fixée fur le corps du cadran.
L^ ouverture circulaire hi reçoit la noix de la fig. S.
la partie reft celle qui entre dans l’ouverture h i ;
cette partie eft cavéedu côté qui doit s’appliquer fur
l’afC convexe de l’ouverture circulaire, & elle eft de
même que la première retenue par l’éci OU 6 ,fig. >$)•
Les deux noix font chacune percees d un trou ,
dans lequel paffe le bâton à cimént 3 , 1 > i? fig- / 0*
qui peut tourner fur fon axe 8e fe fixer dans les Ouvertures
des noix par le feul ffotement, a quoi contribue
beaucoup fa forme conique. .
Foyer pour l’ufage de cet infiniment 1 article Lap
id a ir e & la figure 5. R eft le cadran monte fur fon
d ou , enforte que le diamant foudé au bout du bâton
à ciïflênt porte fur la meule K .
CADRATURE, f. f.lignifie en général, parmi