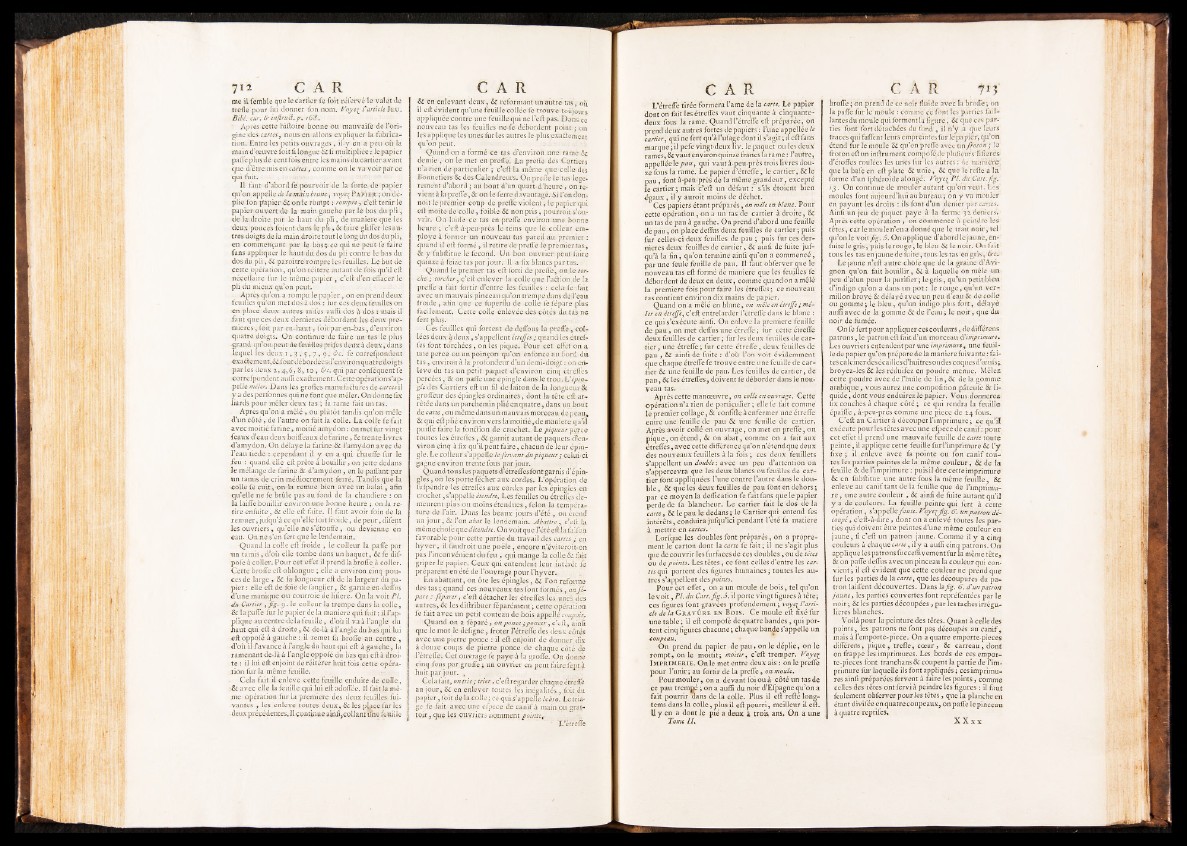
me il femble que l&cartier fe foit réfervé'le valet de
trefle'pour lui donner fon nom. Voyt^ l'article Jeu.
Bill. cur. & inftrucl.p. 1G8.
- Après cette hiftoire bonne ou mau vàife de l’origine
des cartes y nous en allons expliquer la fabrication.
Entre les petits, ouvrages, il:y en a peu oit la
main d’oeuvre foit fi longue 6cfi multipliée : lepapier
paffeplus:dé centfois entre les mains dtvcartier avant
que d’êtreunis en cartes^ comme on le va yoir par ce
qui fuit. - -
11 faut-d’abord fe!'pourvoir de la fortet dé'papier
qu’on appelle de lamàin brune|| voye^ P api er ; on'dé-
plie fon papier &c onrle rbmpt :• rompre, c’eft tenir le
papier;ouvert de la main gauche par lé bas du p li,
tlela-droite par le haut du pli, de maniéré que les
deux-pouce^ foient dans le pif j & -faire gliffeiAesau-
tres doigts de la maiiv.droite tout le long du-dos du pli,
en commençant par le basg-ce qui ne peut fe faire
fans appliquer le haut du.dos du pli contre le bas du
dos du pli, Sc par-oître-1rompre les feuilles. Le but de
cette opération, qu’on réitéré autant de fois qu’il eft
nécelfaire fur le même papier , c’eft d’en effacer le
- pli du mieux qu’on peut.
. Après qu’on a rompu le papier, on en prend deux
feuilles qu’on met dos à. dos : fur ces deux feuilles on
en place deux autres miles aufli dos à dos : mais il
faut que ces deux dernieres débordent les deux premières,
foit par en-haut, foitipar en-bas, d’environ
quatre doigts. On continue-de faire un tas le plus
■ grand qu’on.'peut de feuilles prifes deux à deüA, dans
lequel les deux i , 3 , 5 ,7 , 9,' &c'. fe correfpondent
exa£lement,&.lontdébordéesd’environ quatre doigts
parles deux 2 ,4 ,6 ,8 ,10 , &c. qui par conféquentfe
correfpondent aufli exaûement; Cette opérations’ap-
pelle mêler. Dans les groffes manufactures decartesil
y a des perfonnes qui ne font que mêler. Ondonne fix
liards pour mêler deux tas ; la rame fait un tas.
Après qu’on a mêlé, ou plutôt tandis qu’on mêle
d’un côté, de l’autre on fait la colle. La colle le fait
avec moitié farine, moitié amydon: on met fur vingt
féaux d’eau deux boilfeaux.de farine, & trente livres
d ’amydon. On délaye la farine & l’amydon avec de
l’eau tiede ^-cependant il y en a qui chauffe fur le
feu : quand elle eft prête à bouillir, on jette dedans
le mélange de farine & d’amydon, en le paffant par
un tamis de crin médiocrement ferré. Tandis que la
•colle fé cuit, -on-la. remue.bien avec un balai, afin
qu’elle ne fe brûle pas au fond de la chaudière : on
la laiffe bouillir environ une bonne heure ; on la retire
enfuite, & elle eft faite. Il faut avoir foin de la
remuer, jufqu’à ce qu’elle foit froide, de peur, difent
•les ouvriers, qu’elle ne s’étouffe, ou devienne en
eau. On ne s’en fert que le lendemain.
Quand la colle eft froide , le colleur la paffe par
un tamis, d’oii elle tombe dans un baquet, & fe dif-
pofe à coller. Pour cet effet il prend la broffe à coller.
Cette broffe eft oblongue ; elle a environ cinq pouces
de large , 8c fa longueur eft delà largeur du papier
: elle eft de foie de fangiier, 8c garnie en deffus
d’une manique ou courroie delifiere. On la voit PL
du Cartier ffig. cj. le colleur la trempe dans la colle,
8c la pafle fur le papier de la maniéré qui fuit : il l’applique
au centre delà feuille, d’oh il.va à l’angle du
haut qui eft à droite, & de-là à l’angle du bas.qui lui
eft oppofé à gauche : il remet fa broffe- au centre ,
d’oîi il l’avance à l’angle du haut qui eft à gauche, la
ramenant de-là à l’angle oppofé du bas qui eft à droite
: il lui eft enjoint de réitérer huit fois cette opération
fur la même feuille.
Cela fait il enleve cette feuille enduite de colle,
:8c avec elle la feuille qui lui eft adoflee. Il fait la même
opération fur la première des deux feuilles fui-
•vantes , les enleve toutes deux, & les place fur les
-deux précédentes. Il continue ainfi,collant une feuille
8c en enlevant deux, 8c reformant un autre ta s o ît
il eft évident qu’une feuille collée fe trouve toujours
appliquée contre une feuille qui né l’eft pas. Dans ce
nouveau tas les feuilles ne-fe-débordent point ; on
les applique les unes fur les autres le plus exaClement
qu’on peut.
Quand on a formé ce -tas d’environ une rame ôc
demie , oh le met en preffei La preffe des Carriers
n’a-rien de particulier ; c’eft la même que celle des
BônnetiersSc des Calendreurs. On preffe le tas légèrement
d’abord ; au bout d’un quart-d’heure, on re*
vient à la prefle, & on le ferre davantage..Si Ton don-
noit'le pféiiiier coup de prefle violent, le papier qui
eft rriôite de colle, foible 8c non pris, pourroit s’ou-
vrir. On laiîlc 'ce tas en preffe environ une bonne
heure ; c’eft à-peu-près, le tems que le .colleur employé
à former un nouveau tas pareil au. premier :
quand il eft formé, il retire de preffe lé premier* a s ,
& y fubftitue le fécond. Un bon ouvrier peut faire
quinze à feize tas par jour. Il a lix blancs par tas. ■
• Quand le premier tas eft forti de preffe, on.le ror-
chey torcher, c’eft enlever la colle que Taftion.de la
preffe a fait fortir d’entre les feuilles : -cela- le,-fait
avec un mauvais pinceau qu’on trempedansdé'Teau
froide , afin que ce fuperflu de colle fe fépàre plus
facilement. Cette colle enlevée des côtés du tas ne
fert plus.' ! •
■ Ces feuilles qui fortent de deffous la preffe ,. colr
lées deux à deux, s’appellent étreffes ; quand les étrefi-
fes font torchées, on les pique. Pour ;cet effet? on a
une perce ou un poinçon qu’on enfonce au fiord: du
tas, environ à la profondeur d’un demi-doigt : on enlevé
du tas un petit paquet d’environ cinq étreffes
percées, & on pafle une épingle dans lé trou. U épingle
Aes Gartiers eft un fil de laiton de la longueur 8c
groffeur des épingles ordinaires, dont la-tête -eft arrêtée
dans un parchemin plié enquatre, dans un bout
de carte, ou même dans un mauvais morceau de-peau,
& qui eft plié environ vers la moitié , de maniéré qu’il
puiffe faire la fonction .de crochet. Le piqueur perce
toutes les étreffes, & garnit autant de paquets dlen-
viron cinq à fix qu’il peut faire, chacun de leur épingle.
Le colleur s’appelle lejervant du piqueur ; celui-ci
gagne environ trente fous par jour.
Quand tous les paquets d’é treffes font garnis d’épingles
, on les porte fécher aux cordeSi L’opération de
îufpèndre les étrefles aux cordes par les épingles en
crochet, s’appelle étendre. Les feuilles ou étreffes demeurent
plus.ou moins étendues, félon la température
de l’air. Dans les beaux jours d’été , on étend
un jour, & l’on abat le lendemain. Abattre, c’eft la
même chofe que détendre. On voit que l’été eft la fai ion
favorable pour cette partie du travail des cartes ; en
hyver, il faudroit une poêle, encore n’éviteroit-on
pas l’inconvénient du feu , qui mange la colle Sciait
griper le papier-. Ceux qui entendent leur intérêt le
préparent en été de l’ouvrage pour l’hyver.
En abattant, on ôte les épingles, 8c Ton reforme
des tas ; quand ces nouveaux tas font formés, on fé-
pare : féparer, c’eft détacher les étreffes les, unesAes
autres, Sc les diftribuer féparément ; cette opération
fe fait avec un petit couteau de bois appellé coupoir.
Quand on a feparé , on ponce ■ poncer, c’eft, ainfi
que le mot le defigne, froter Tétreffe des deux côtés
avec une pierre ponce : il eft enjoint de donner dix
à douze coups de pierre ponce de chaque côté de
Tétreffe. Cet ouvrage fe paye à la groffe. On donne
cinq fous par.groffe ; un ouvrier en peut faireiept^
huit par jour. 4
Cela fait, on trie; trier3 c’eft regarder chaque étreffe
au jour, 8c en enlever toutes les inégalités , foit, du
papier, foit de la colle ; ce qui s’appelle le bro. Le triage
fe fait avec une efpece de canif à main pu grattoir
, que les ouvriers nomment pointcr
L’étrefle
L’étreffe tirée formera l’ame de la carte. Le papier
dont on fait les étrefles vaut cinquante à cinquante-
deux fous la rame. Quand Tétreffe eft préparée, on
prend deux autres fortes de papiers : Time appellée le
carder, qui ne fert qu’à l’ufage dont il s’agit ; il eft fans
marque ; il pefe vingt-deux liv. le paquet ou les deux
rames, & vaut environ quinze francs la rame : l’autre,
appellée le pau, qui vaut à-peu-près trois livres douze
fous la rame. Le papier d’étreffe, le cartier, & le
pau, font à-pen-près de la même grandeur, excepté
le cartier ; mais c’eft un défaut s’ils étoient bien
€gaux, il y auroit moins de déchet.
Ces papiers étant préparés, on mêle en blanc. Pour
cette opération, on a un tas de cartier à droite, &
un tas de pau à gauche. On prend d’abord une feuille
de pau, on place deffus deux feuilles de cartier ; puis
fur celles-ci deux feuilles .de pau ; puis fur ces dernieres
deux feuilles de cartier, & ainfx de fuite juf-
qu’à la fin, qu’on termine ainfi qu’on a commencé,
par une feule feuille de pau. Il faut obferver que le
nouveau tas eft formé de maniéré que les feuilles fe
débordent de deux en deux, comme quand on a mêlé
la première fois pour faire les étreffes ; ce nouveau
tas contient environ dix mains de papier.
Quand on a mêlé en blanc , on mêle en étrejje; mêler
en étrejfty c’eft entrelarder Tétreffe dans le blanc :
ce qui s’exécute ainfi. On enleve la première feuille
de pau, on met deffus une étreffe ; fur cette étreffe
deux feuilles de cartier ; fur les deux feuilles de cartier
, une étreffe ; fur cette.étreffe, deux feuilles de
pau , & ainfi de fuite : d’ott Ton voit évidemment
que chaque étreffe fe trouve entre une feuille de cartier
& une feuille de pau. Les feuilles de cartier, de
pau, & les étreffes, doivent le déborder dans le nouveau
tas.
Après cette manoeuvre, on colle en ouvrage. Cette !
opération n’a rien de particulier ; elle fe fait comme '
le premier collage, & conufte à enfermer une étreffe
entre une feuille de pau & une feuille de cartier.
Après avoir collé en ouvrage, on met en preffe, on
pique, on étend, & on abat, comme on a fait aux
étreffes, avec cette différence qu’on n’étend que deux
des nouveaux feuillets à la fois ; ces deux feuillets
s’appellent un double', avec un peu d’attention on
s’appercevra que les deux blancs ou feuilles de cartier
font appliquées Tune contre l’autre dans le double
, & que les deux feuilles de pau font en dehors ;
par ce moyen la déification fe fait fans que le papier
perde de fa blancheur. Le cartier fait le dos de la
carte, & le pau le dedans ; le Cartier qui entend fes
intérêts, conduira jufqu’ici pendant Tété fa matière
à mettre en cartes.
Lorfque les doubles font préparés, on a proprement
le carton dont la carte fe fait ; il ne s’agit plus
que de couvrir les furfaces de ces doubles, ou de têtes
ou de points. Les têtes, ce font celles d’entre les cartes
qui portent des figures humaines ; toutes les autres
s’appellent des points.
Pour cet effet, on a un moule de bois, tel qu’on
le voit, PL du Cart.fig.5. il porte vingt figures à tête;
ces figures font gravées profondément ; voyç{ l'article
de la Gravure en Bois. Ce moule eft fixé fur
une table ; il eft compofé de quatre bandes, qui portent
cinq figures chacune ; chaque bande s’appelle un
coupeau.
On prend du papier de pau, on le déplie, on le
rompt, on le moitit; moitir, c’eft tremper. Voye^
Imprimerie. On le met entre deux ais : on le preffe
pour l ’unir; au fortir de la preffe, on moule.
Pour mouler, on a devant foi ou à côté un tas de
ce pau trémaé ; on a aufli du noir d’Efpagne qu’on a
fait pourrir dans de la colle. Plus il eft refté long-
tems dans la colle, plus il eft pourri, meilleur il eft.
U y en a dont le pié a deux à trois ans. On a une
Tome II,
broffe ; On prend de ce noir fluide avec la broffe ; otl
la paffe fur le moule : comme ce fönt les patries fail-
lantesdu moule qui forment la figure, & t(ué ces parties
font fort détachées du fond , il n’y .a que leurs
traces qui faflènt leurs empreintes fur lepapier, qu’on
étend fur le moule & qu’on preffe avec tin ffoton ; le
froton eft un infiniment compofe.de plufiè'tîrs'lifteres
d’étoffes roulées les unes fur les autres: de maniéré,
que la bafe en eft plate & unie, & que le fefte a la
forme d’un fphéroide alongé: Voye%_ Pl. du,Cart.fig.
iß. On continue de mouler autant qu’ori vèut. Lès
moules font aujourd’hui ati bureau ; on y va mouler
en payant les droits : ils font d’un denier par cartes,
Ainfi un jeu de piquet paye à la ferme 32 deniers.'
Après cette opération , oh commence à peindre les
têtes, car le moule n’en a donné que le trait noir, tel
qu’on le voit fig: 6. On applique d’abord le jaune, èn-
fuite le gris , puis le rouge, le bleu & le noir. On fait
tous les tas en jaune de fuite , tous les tas en gris,'(ère,'
Le jaune n’eft autre chofe que de la graine d’Avignon
qu’on fait bouillir, & à laquelle on mêle un
peu d’alun pour la purifier ; le gris, qu’un petit bleu
d’indigo qu’on a dans un pot : le rouge, qu’un vermillon
broyé & délayé avec un peu'd’eau & de colle
ou gomme; le bleu, qu’un indigo plus fort, délayé
aufli avec de la gomme & de l’eau ; le noir, que du
noir de fumée.
On fe fert pour appliquer ces couleurs, de différens
patrons, le patron eft fait d’un morceau à'imprimure.
Les ouvriers entendentpar une imprimurt, une feuille
de papier qu’on prépare de la maniéréfuiVante : faites
calciner des écailles d’huîtres ou des coques d’oeufs;
broyez-les & les réduifez en poudre menue. Mêlez
cette poudre avec de l’huile de lin, & de la gomme
arabique, vous aurez une compofition pâteufe & liquide,
dont vous enduirez le papier. Vous , donnerez
fix couches à chaque côté ; ce qui rendra la feuille
épaiffe, à-peu-près comme une pieçe de 24 fous.
C’eft au Cartier à découper l’imprimure ; ce qu’il
exécute pour les têtes avec une efpece de canif: pour
cet effet il prend une mauvaife feuille de carte toute
peinte, il applique cette feuille fur Timprimure Sc l’y
fixe; il, enleve avec fa pointe ou fon canif toutes
lés parties peintes de la même couleur, & de la
feuille & de Timprimure : puis il ôté cette imprimure
& en fubftitue une autre fous la même feuille, &
enleve au canif tant de la feuille que de Timprimu-
r e , une autre couleur , & ainfi de fuite autant qu’il
y a de couleurs. La feuille peinte qui fert à cette
opération, s'appelle faute. Voyt^fig. G. un patron découpé
, c’eft-à-dire, dont on a enlevé toutes les parties
qui doivent être peintes d’une même couleur en
jaune, fi c’eft un patrofi jaune. Comme il y a cinq
couleurs à chaque carte, il y a aufli cinq patrons. Orï
applique les patrons fucceflivement fur la même tête,
& on paffe deffus avec un pinceau la couleur qui convient
; il eft évident que cette couleur ne prend que
fur les parties de la carte 3 que les découpures du patron
Iaiffent découvertes. Dans la fig. 6. d'un patron
jaune, les parties couvertes font repréfentées par le
noir ; & les parties découpées , par les taches irrégulières
blanches.
Voilà pour la peinture des têtes. Quant à celle des
points, les patrons ne font pas découpés au canif,
mais à l’emporte-piece. On a quatre emporte-pieces
différens, pique, trefle, coeur, & carreau , dont
on frappe les imprimures. Les bords de ces emporte
pieces font tranchans & coupent la partie de'l’im-
primure fur laquelle ils font appliqués ; ces imprimures
ainfi préparées fervent à faire les points, comme
celles des têtes ont fervi à peindre les figures : il faut
feulement obferver pour les têtes, que Ta planche en
étant di vifée en quatre coupeaux, on paffe le pinceau
à quatre reprifes.
X X x x