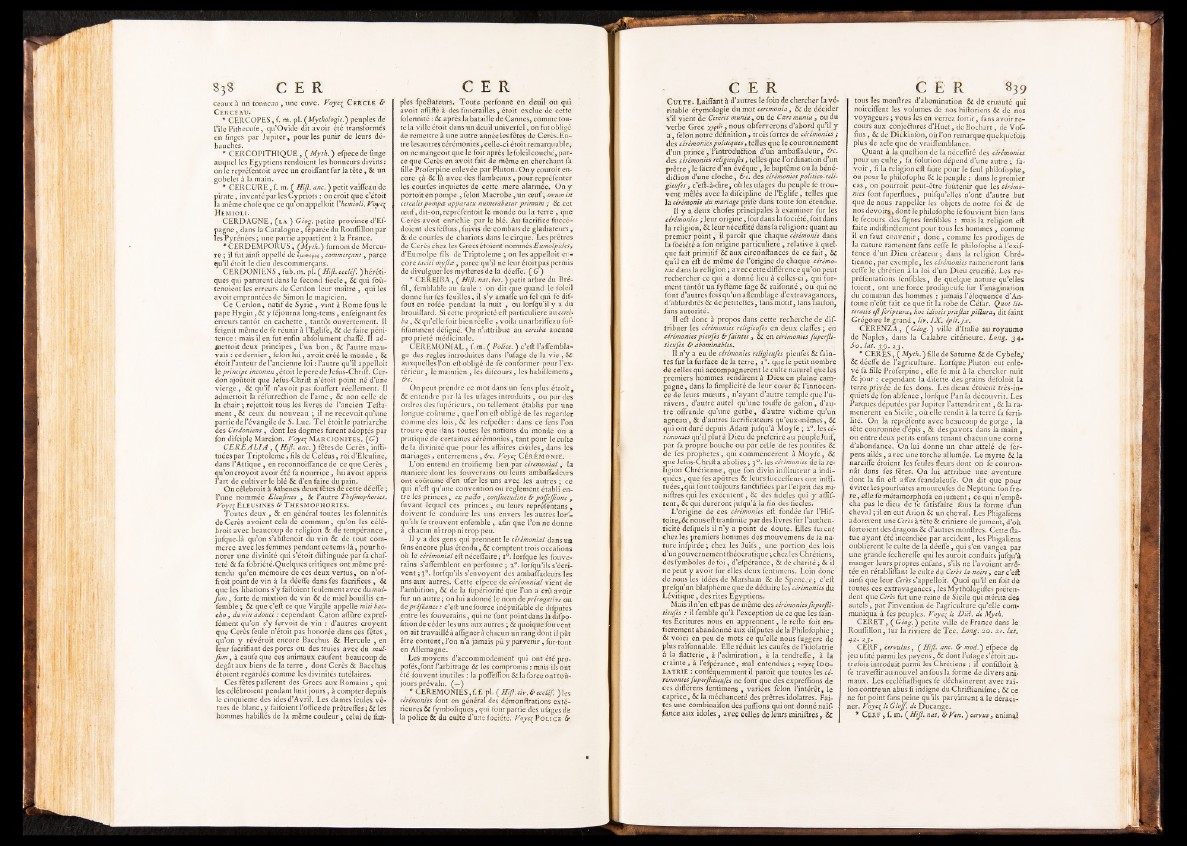
ceau x à un to n n e a u , u n e cu v e . V oye^ C e r c I e &
C e r c e a u .
* CERCOPES, f. m. pl. (Mythologie.) peuples de
Plie Pithecufe, qu’Ovide dit avoir été transformés
en linges par Jupiter, pour les punir de leurs débauches.
* CERCOPITHIQUE, ( Myth. ) efpecede finge
auquel les Egyptiens rendoient les honneurs divins:
on le repréfentoit avec un croiffant fur la tête, & un
gobelet à la.main.
* CERCURE, f. m. ( Hijl. anc. ) petit vaiffeau de
pirate, inventé par les Cypriots : on croit que c’étoit
la même chofe que ce qu’on appelloit Yhemioli.Voye{
H e m io l i .
CERDAGNE, ( l a ) Géog. petite province d’Ef-
pagne, dans la Catalogne, féparéedu Rouflillonpar
les Pyrénées ; une partie appartient à la France.
* CERDEMPORUS, (Myth.') furnom de Mercure
; il fut ainfi appelle de »//■ oe-opo?, commerçant, parce
qu’il étoit le dieu des commerçans.
CERDONIENS , fub. m. pl. ( Hß . eccléf. ) hérétiques
qui parurent dans le fécond fiecle, 6c qui foû-
tenoient les erreurs de Cerdon leur maître , qui les
avoit empruntées de Simon le magicien.
Ce Cerdon, natif de Syrie , vint à Rome fous le
pape Hygin, & y féjourna long-tems, enfeignant fes
erreurs tantôt en cachette , tantôt ouvertement. Il
feignit même de fe réunir à l’Eglife, 6c de faire pénitence
: mais il en fut enfin abfolument chaffé. Il ad-
jnettoit deux principes, l’un bon , & l’autre mauvais
: ce dernier, félon lu i, avoit créé le monde , 6c
étoit l’auteur de l’ancienne loi : l’autre qu’il appelloit
le principe inconnu 9 étoit Iepere de Jefus-Chrift. Cerdon
ajoûtoit que Jefus-Chrift n’étoit point né d’une
vierge , & qu’il n’avoit pas fouffert réellement. Il
admettoit la réfurreâion de l’ame , & non celle de
la chair ; rejettoit tous les livres de l’ancien Tefta-
ment, & ceux du nouveau ; il ne recevoit qu’une
partie de l’évangile de S. Luc. Tel étoit le patriarche
des Cerdoniens , dont les dogmes furent adoptés par
fon difciple Marcion. Voye{ Ma r c i o n i t e s . (G )
CEREAL1A , ( Hiß. anc.) fêtes de Cerès, infti-
tuées par Triptoleme, fils de Celéus, roi d’Eleufine,
dans l’Attique, en reconnoiffance de ce que Cerès ,
qu’on croyoit avoir été fa nourrice, lui avoit appris
l’art de cultiverle blé & d’en faire du pain.
On célebroit à Athènes deux fêtes de cette déeffe ;
l’une nommée Eleufines , & l’autre Tkefmophories.
Voye{ E l e u s in e s & T h e s m o p h o r i e s .
Toutes deux , & en général toutes les folennités
de Cerès avoient cela de commun, qu’on les célé-
broit avec beaucoup de religion & de tempérance,
jufque-là qu’on s’abftenoit du vin 6c de tout commerce
avec les femmes pendant ce tems-là, pour honorer
une divinité qui s’étoit diftinguée par fa chaf-
teté & fa fobriété.Quelques critiques ont même prétendu
qu’en mémoire de ces deux vertus, on n’of-
froit point de vin à la déeffe dans fes facrifices, &
que les libations s’y faifoient feulement avec du mul~
Jum, forte de mixtion de vin & de miel bouillis en-
femble ; 6c que c’eft ce que Virgile appelle miti bac-
cho, du vin adouci : cependant Caton allure expref-
fément qu’on s’y fervoit de vin : d’autres croyent
que Ceres feule n’étoit pas honorée dans ces fêtes ,
qu’on y révéroit encore Bacchus 6c Hercule , en
leur facrifiant des porcs ou des truies avec du mul-
fum, à caufe que ces animaux caufent beaucoup de
dégât aux biens de la terre , dont Cerès & Bacchus
étoient regardés comme les divinités tutélaires.
Ces fêtes pafferent des Grecs aux Romains , qui
les célébroient pendant huit jours, à compter depuis
le cinquième des idesd’Avril. Les dames feules vêtues
de blanc,y faifoient l’office de prêtreffes ; & les
hommes habillés de la même couleur, celui de fim~
pies fpe&ateurs. Toute perfonne en deuil ou qui
avoit affilié à des funérailles, étoit exclue de cette
folennité : 6c après la bataille de Cannes, comme tonte
la ville était dans un deuil univerfel, on fut obligé
de remettre,à une autre année les fêtes de Cerès.Entre
les autres cérémonies, celle-ci étoit remarquable,
on nemangeoit que le foir après lefoleilcouché, parce
que Cerès en avoit fait de même en cherchant fa
fille Proferpine enlevée par Pluton. On y couroit encore
çà & là avec des flambeaux,-pour repréfen'ter
les courfes inquiétés de cette mere alarmée. On y
portoit en pompe , félon Macrobe, un oeuf, ovum in
cerealispompa apparatu numerabatur primum ; 6c cet
oeuf, dit-on. repréfentoit le monde ou la terre , que
Cerès avoit enrichie par le blé. Au facrifice fuccé-
doient des feftins, fuivis de combats de gladiateurs,
& de courfes de chariots dans le cirque. Les prêtres
de Cerès chez les Grecs étoient nommés Eumolpides,
d’Eumolpe fils de Triptoleme ; on les appelloit encore
taciii myfla , parce qu’il ne leur étoit pas permis
de divulguer les myfteres de lâ déeffe. (G )
* CEREIBA, ( Hiß. nat.bot.) petit arbre du Bre-
fil, femblablë au faule : on dit que quand le foleil
donne fur fes feuilles, il s’y amaffe un fel qui fe dif-
fout en rofée pendant la nuit , ou lorfqu’il y a du
brouillard. Si cette propriété eft particulière au cerei-
ba, & qu’elle foit bien réelle , voila unarbriffeau fufr
fifamment défigné. On n’attribue au cereiba aucune
propriété médicinale.
CEREMONIAL, f. m. ( Police. ) c’eft l’affembla-
ge des réglés introduites dans l’ufage de la vie , 6c
auxquelles l’on eft obligé de fe conformer pour l ’extérieur
, le maintien , les difeours, les habillemens ,
&c.
On peut prendre ce mot dans un fens plus étroit»
& entendre pnr-là les ufages introduits , ou par des
ordres des fupérieurs, ou tellement établis par une
longue coutume , que l’on eft obligé de les regarder
comme des lois, 6c les refpeâer : dans ce fens l’on
trouve que dans toutes les nations du monde on a
pratiqué de certaines cérémonies, tant pour le culte
de la divinité que pour les affaires civiles, dans les
mariages, enterremens , &c. Voye{ C é r é m o n i e .
L’on entend en troifiemç lieu par cérémonial, la
maniéré dont les fouverains ou leurs ambaffadeurs
ont coutume d’en ufer les uns avec les autres ; cê
qui n’eft qu’une convention ou reglement établi entre
les princes, ex paclo , confuetudine & poffejjione ,
fuvant lequel ces princes , ou leurs reprefentans,
doivent fe conduire les uns envers les autres lorfi.
qu’ils fe trouvent enfemble , afin que l’on ne donne
à chacun ni trop ni trop peu.
Il y a des gens qui prennent le cérémonial dans un
fens encore plus étendu, 6c comptent trois occafions
où le cérémonial eft néceffaire; i°. lorfque les fouverains
s’affemblent en perfonne ; 2°. lorfqu’ils s’écrivent
; 3°. lorfqu’ils s’envoyent des ambaffadeurs les
uns aux autres. Cette efpece de cérémonial vient de
l’ambition, 6c de la fupériorité que l’un a crû avoir
fur un autre ; on lui a donné le nom de prérogative ou
depréféance : c’eft unefource inépuifable de difputes
.entre les fouverains, qui ne font point dans la clifpo-
fitionde céder les uns aux autres ; & quoique fou vent
on ait travaillé à affigner à chacun un rang dont il pût
être content, l’on n’a jamais pu y parvenir, fur-tout
en Allemagne.
Les moyens d’accommodement qui ont été pro-
pofés,font l’arbitrage & les compromis : mais ils ont
été fou vent inutiles : la poffeffion 6c la force ont toujours
prévalu. (—)
f * CEREMONIES, f. f. pl. ( Hiß. civ. & eccléf. ) les
cérémonies font en général des dém on ftrations e x té rieu
res 6c fym b o liq u es, qui fo n t p artie des ufages dè
la police & du cu lte d ’une fociété. Voye^ P o l ic e &
C u lte. Laiffant à d’autres le foin de chercher la véritable
étymologie du mot ceremonia, 6c de décider
S’il vient d e Certris munia, ou de Carc munia , ou du
Verbe Grec W î f , nous o.bferverons d’abord qu’il y
a , félon notre définition, trois forte* de cérémonies ;
des cérémonies politiques, telles que le couronnement
d’un prince , ‘1’introduâion d’un àmbaffadeur, &c.
des cérémonies rtligieufes , tellés que l’ordination d’un
prêtre ; le fàcïe d’un évêque, le baptême ou la béné-
diélion d’une cloche, &c. dès cérémonies politico-reli-
gieufes, c’eft-à-dire, où les ufages du peuple fe trouvent
mêlés avec la difcipline de l’Eglife, telles que
la cérémonie du mariage prife dans toute fon étendue.
Il y a deux Chofes principales à examiner fur les
cérémonies ; leur origine, foit dans la fociété, fôit dans
la religion, & leur néceffité dans la religion : quant au
premier point, il paroît què chaque cérémonie dans
la fociété a fon origine particulière , relative à quelque
fait primitif & aux circonftances de ce fait, &
qu’il en eft de même de l’origine de chaque cérémonie
dans la religion ; avec cette différence qu’on peut
rechercher ce qui a donné lieu à celles-ci, qui forment
tantôt un fyftème fage & raifonné, ou qui ne
font d’autres fois qu’un affemblage d’extravagances,
d’abfurdités & de petiteffes, fâns motif, fans liaifon,
fans autorité.
Il eft donc à propos dans cette recherche de dif- ,
tribuer les cérémonies rtligieufes en deux claffes ; en
cérémonies pieufes & Jointes , 6c en cérémonies fuperfi- .
tieufes & abominables.
Il n’y a eu de cérémonies rtligieufes pieiifes & fain-
tes fpr la furface de la terre, i° . que le petit nombre
<le celles qui accompagnèrent le culte naturel que les
premiers hommes rendirent à Dieu en plaine campagne
, dans la fimplicité de leur coeur & l’innocence
de leurs moeurs, n’ayant d’autre temple que l’univers
, d’autre autel qu’une touffe de gafon, d’autre
offrande qu’une gerbe, d’autre viftime qu’un
agneau, & d’autres facrificatéurs qu’eux-mêmes, & ;
qui ont duré depuis Adam jufqu’à Moyfe ; z°. les cérémonies
qu’il plut à Dieu de preferire au peuple Juif, ;
par fa propre Bouche ou par celle de fes pontifes &
de fes prophètes, qui commencèrent à Moyfe, &
que Jefus-Chrift a abolies ; 30. les cérémonies de la religion
Chrétienne, que fon divin inftituteur a indiquées
, que fes apôtres & lelirs' fuc'ceffeurs Ont infti-
tuées,qui font toûjours fanârifiées par l’elprit des mi-
niftres qui les exécutent, & des fideles qui y affif-
tent, & qui dureront jufqu’à la fin des liecles.
L’origine de ces cérémonies eft fondée fur l’Hif-
toire, & nous eft tranfmife par des livres fur l’authenticité
defquels il n’y a point de doute. Elles furent
chez les premiers hommes des mouvemens de la nature
infpirée ; chez les Juifs, une portion des lois
d’un gouverne ment théocratique ; chez les Chrétiens,
des fymboles de fo i, d’efpérance, & de charité ; & il
ne peut y avoir fur elles deux fentimens. Loin don^
de nous les idées de Marsham & de Spencer ; c’eft
prefqu’un blafphème que de déduire les cérémonies du
Lévitique, des rites Egyptiens.
Mais il n’en eft pas de même des cérémonies fuperjli-
tieufes : il femble qu’à l’exception dé ce que les fain-
tes Ecritures nous en apprennent, le refte foit entièrement
abandonné aux difputes delà Philofophie ;
& voici en peu de mots ce qu’elle nous fuggere de
plus raifonnable. Elle réduit les caufes de l’idolâtrie
à la flatterie, à l’admiration, à la tendreffe, à la
crainte, à l’efpérance, mal entendues; voye^ Idol
â t r i e : conféquemment il paroît que toutes les cérémonies
fuperjlitieufes ne font que des expreffions de
ces différens fentimens , variées félon l’intérêt, le
caprice, & la méchanceté des prêtres idolâtres. Fai- I
tes une combinaifon des pallions qui ont donné naif- j
(ance aux idoles, avec celles de leurs miniftres, & J
tous les monftres d’abomination Sc de cruauté qui
noirciffent les volumes de nos hiftoriens & de nos
voyageurs ; vous les en verrez fortir, fans avoir recours
aux conje&ures d’Huet, deBochart, de Vof-
fius, & de Dickinfon, où l’on remarque quelquefois
plus de zcle que de vraiffemblance.
Quant à la queftion de la néceffité des cérémonies
pour un culte, fa folution dépend d’une autre ; fa-
v o ir , fi la religion eft faite pour le feul philofophe,
ou pour le philofophe & le peuple : dans le premier
cas, on pourroit peut-être foûtenir que les cérémonies
font fuperflues, puifqu’elles n’ont d’autre but
que de nous rappeller les objets de notre foi & de
nos devoira, dont le philofophe fe fouvient bien fans
le fecours dés lignes fenfibles : mais la religion eft
faite indiftinélement pour tous les hommes , comme
il en faut convenir ; donc , comme les prodiges de
la nature ramènent fans ceffe le philofophe à l’exif-
tence d’un Dieu créateur; dans la religion Chrétienne
, par exemple, les cérémonies ramèneront fans
ceffe le chrétien à la loi d’un Dieu crucifié. Les re-
préfentatiohs fenfibles, de quelque nature qu’elles
foient, ont une force prodigieufe fur l’imagination
du commun des hommes : jamais l’éloquence d’Antoine
n’eût fait ce que fit la robe de Céfar. Quoi Lit-
teratis efl feriptura, hoc idiotisprajlat picluraa dit faint
Grégoire le grand , liv. IX . èpît.jx.
CERENZA, ( Géog. ) ville d’Italie au royaume
de Naples, dans la Calabre citérieure. Long. 34 . 5 o . lût. 3$. 23.
* CERÈS, ( Myth. ) fille de Saturne & de Cybele,’
6 déeffe de l’agriculture. Lorfque Pluton eut enlevé
fa fille Proferpine, elle fe mit à la chercher nuit
6c jour : cependant la difette des grains défoloit la
terre privée de fes dons. Les dieux étoient très-inquiets
de (on àbfence, lorfque Pan la découvrit. Les
Parquçs députées par Jupiter l’attendrirent, & la ramenèrent
en Sicile, où elle rendit à la terré fa fertilité.
On la repréfente avec beaucoup de gorge, la
tête couronnée d’épis , & des paybts dans la main ,
ou entre deux petits enfans tenant chacun une corne
d’abondance. On lui donne un char attelé de fér-
pens ailés, avec une torche allumée. Le myrte & la
narciffe étoient les feules fleurs dont on fe couronnât
dans feS‘ fêtes. On lui attribue Une aventure
dont la fin eft affez fcandaleufe. On dit que pour
éviter les pourfuites amoureufes de Neptune fon frère,
elle fe métamorphofa en jument ; ce qui n’empêcha
pas le dieu de fe fatisfaire fous la forme d’un
cheval ; il en eut Arion & un cheval. Les Phigaliens
adorèrent une Cerès à tête & crinière de jument, d’où
fortoient des dragons 6c d’autres monftres. Cette fta-
tue ayant été incendiée par accident, les Phigaliens
oublièrent le culte de la déeffe, qui s’en vangea par
une grande fechereffe qui les auroit conduits jufqu’à
manger leurs propres enfans, s’ils ne l’avoient arrêtée
en rétabliffant le culte de Cerès la noire , car c’eft
ainfi que leur Cerès s’appelloit. Quoi qu’il en foit de
toutes ces extravagances, les Mythologiftes prétendent
que Cerès fut une reine de Sicile qui mérita des
autels, par l’invention de l’agriculture qu’elle communiqua
à fes peuples. Voye^ le Dicl. de Myth.
CERET, ( Géog. ) petite ville de France dans le
Rouffillon, lur la rivière de Tec, Long. 2.0. z i. lac.
42- 23.
CERF, cervulus, ( Hijl. anc. & mod. ) efpece de
jeu ufité parmi les payens, 6c dont l’ufage s’etoit autrefois
introduit parmi les Chrétiens : il confiftoit à
fe traveftir au nouvel an fous la forme de divers animaux.
Les eccléfiaftiques fe déchaînèrent avec rai-
fon contre un abus fi indigne du Chriftianifme ; & ce
ne fut point fans peine qu’ils parvinrent â le déraciner.
VoyelleGlojf. de Ducange.
* Cerf , f. m. {Hijl. nat, & Ven, ) cervus, animal