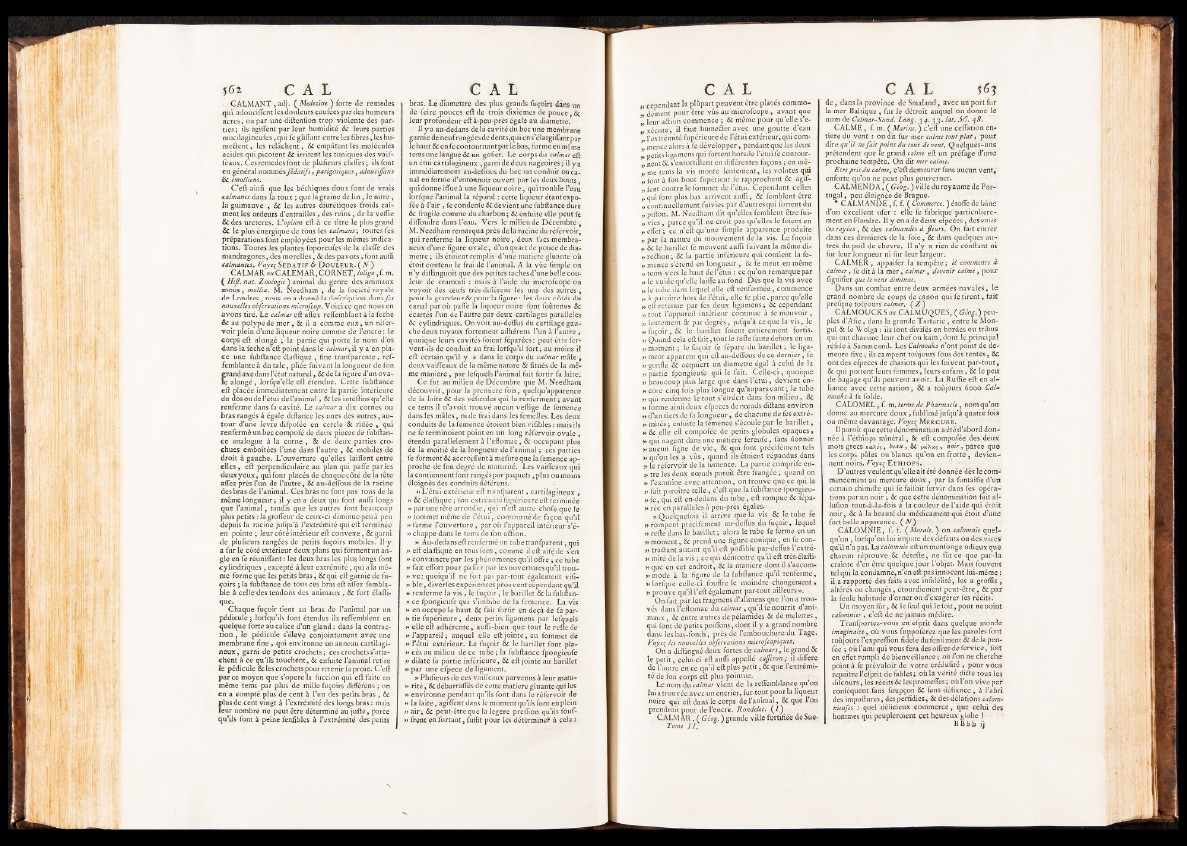
CALMANT , adj. ( Médecine ) forte de remedes
qui adouciffent les douleurs caufées par des humeurs
acres, ou par une diftenfion trop violente des parties;
ils agiffent par leur humidité Ôc leurs parties
mucilagineufes ,qui fe gliffant entre les fibres, les hu-
meé fentles relâchent, ôc empâtent les molécules
-acides qui picotent ôc irritent les tuniques des vaif-
feaux. Ces remedes fönt de plufieurs claffes; ils font
en général nommés fédatifs, parégoriques, adouciffans
Sc emolüens.:
C ’eft ainfi que les béchiques doux font de vrais
calmants dans la toux ; que la graine de lin, le nitre,
Ja guimauve , ôc les autres diurétiques froids calment
les ardeurs d’entrailles, des reins, de la ve-ffie
ôedes ureteres, Vopium eft à ce titre: le plus grand
ôc le plus énergique de tous les caïmans ; toutes fes.
préparations font employées pour les mêmes indications.
Toutes les plantes foporeufes de la claffe des
mandragores, des morelles, & des pavots, font auffi
calmantes, Hoye^ Sédatif & Douleur. (A )
CALMAR ouCALEMAR, CORNET, loügo ,f. m.
( Hiß. nat. Zoologie ) animal du genre des animaux
mous, mollia. M. Needham , de la fociêté royale
de Londres, nous en a donné la defeription dans fes
nouvelles obfervations microfcop. Voici ce que' nous en
avons tiré. Le calmar eft affez reffemblant à la feche
& au polype de mer , & il a comme eux, un réfervoir
plein d’une liqueur noire comme de l’encre : le
corps eft alongé ; la partie qui porte le nom d’os
dans la feche n’eft point dans le calmar ; il y a en place
une fubftance élaftique , fine tranfparente, ref-
femblante à du talc, pliée fuivant la longueur de fon
grand axe dans l’état naturel, & delà figure d’un ovale
alongé , lorfqu’elle eft étendue. Cette fubftance
eft placée immédiatement entre la partie intérieure
du dos ou de l’étui de l’animal, ôcles inteftins qu’elle
renferme dans fa cavité. Le calmar a dix cornes ou
bras rangés à égale diftance les unes des autres, autour
d’une levre difpofée en cercle & ridée , qui
renfermé un bec compofé de deux pièces de fubftance
analogue à la corne , & de deux parties crochues
emboîtées l’une dans l’autre , ôc mobiles de
droit à gauche. L’ouverture qu’elles laiffent entre
elles , eft perpendiculaire au plan qui paffe par les
deuxyeux, qui font placés de chaque côté de la tête
affez près l’un de l’autre, ôc au-deffous de la racine
des bras de l’animal. Ces bras ne font pas tous de la
même longueur ; il y en a deux qui font auffi longs
que l’animal, tandis que les autres font beaucoup
plus petirs : la groffeur de ceux-ci diminue peu à peu
depuis la racine jufqu’à l’extrémité qui eft terminée
en pointe ; leur côté intérieur eft convexe, ôc garni
de plufieurs rangées de petits fuçoirs mobiles. Il y
a fur le côté extérieur deux plans qui formentun angle
en fe réunifiant : les deux bras les plus longs font
cylindriques , excepté à leur extrémité, qui a la même
forme que les petits bras, ôcqui eft garnie de fuçoirs
; la fubftance de tous ces bras eft affez fembla-
ble à celle des tendons des animaux , ôc fort clafti-
que.
Chaque fuçoir tient au bras de l’animal par un
pédicule ; lorfqu’ils font étendus ils reffemblent en
quelque forte au calice d’un gland : dans la contraction
, le pédicule s’élève conjointement avec une
membrane fine, qui environne un anneau cartilagineux
, garni de petits crochets ; ces crochets s’attachent
à ce qu’ils touchent, & enfuite l’animal retire
le pédicule & les crochets pour retenir fa proie. C ’eft
par ce moyen que s’opère la fuccion qui eft faite en
même tems par plus de mille fuçoirs différens ; on
en a compté plus de cent à l’un des petits bras , ôc
plus de cent vingt à l’extrémité des longs bras : mais
leur nombre ne peut être déterminé au jufte, parce
qu’ils font à peine fenfibles à l’extrémité des petits
bras. Lé diamettre des plus grands fuçoirs dans un
de feize pouces eft de trois dixièmes de pouce ôc
leur profondeur eft à-peu-près égale au diamètre.
Il y a au-dedans delà cavité du bec une membrane
garnie de neuf rangées de dents,qui ens’élargiffant par
le haut ôc enfe contournant par le bas, forme en même
tems une langue ôc un gofier. Le corps du calmar eft
un étui cartilagineux., garni de deux nageoires ;-il y a
immédiatement au-deflôus du bec Un conduit ou canal
en forme d’entonnoir ouvert par les deux bouts ,
qui donneiffueà une liqueur noire, qui trouble l’eau
lorfque l’animal la répand : cette liqueur étant expo-
fée à l’air , fe condenlè & devient une fubftance duré
ÔC fragile comme du charbon ; de enfuitë elle peut fe
diffoudre dans l’eau. Vers’ le milieu de Décembre »
M. Needham remarqua près de la racine du réfervoir*
qui renferme la liqueur noire, deux facs membraneux
d’une figure ovale, d’un quart de pouce de diamètre;
ils étoient remplis d’uné-mâtiere gluante dit
étoit contenu le frai de l’animal. A la vue firriple on
n’y diftinguoit que des petites taches d’une bellecou*
leur de cramoifi : mais à'Taide du microfcope on
voyoit des Oeufs très-différens les uns des autres ,
pour la grandeur ôc pour la figure : les deux côtés dii
canal par où paffe la liqueur noire font foutenus ôc
écartés l’un de l’autre par deux cartilages parallèles
ôc cylindriques. On voit au-deffus du cartilage gauche
deux tuyaux fortement adhérens l’un à l’autre ,•
quoique leurs cavités foient féparées: peut-être fervent
iis de conduit au frai lorfqu’il fort; au moins il
eft certain qu’il y a dans le corps du calmar mâle j
deuxVaiffeaux de la même nature & fitués de la même
maniéré, par lefquels l’animal fait fortir fa laite.
Ce fut au milieu de Décembre que M. Needham
découvrit, pour la première fois, quelqu’apparence
de la laite ôc des véficules qui la renferment ; avant
ce tems il n’avoit trouvé aucun veftige de femence
dans les mâles, ni de frai dans les femelles. Les deux
conduits de la femence étoient bien vifibles : mais ils
ne fe terminoient point en un long réfervoir ovale ,
étendu parallèlement à l ’eftomac, & occupant plus
de la moitié de la longueur de l’animal ; ces parties
fe forment ôc accroiffentà mefureque la femence approche
de fon degré de maturité. Les vaiffeaux qui
la contiennent font rangés par paquets, plus ou moins
éloignés des conduits déférens. ;
« L’étui extérieur eft tranfparent, cartilagineux ,
» ôc élaftique ; fon extrémité fupérieure eft terminée
» par une têre arrondie, qui n’eft autre chofe que le
» fommet même de l’étui, contourné de façon qu’il
» ferme l’ouverture, par où l’appareil intérieur s’é-
» chappe dans le tems de fon aéfion.
» Au-dedans eft renfermé un tube tranfparent, qui
» eft elaftique en tousfens , comme il eft aiféde s’en
» convaincre par les phénomènes qu’il offre ; ce tube
» fait effort pour paffer par les ouvertures qu’il trou-
» v e: quoiqu’il ne foit pas par-tout également vifi-
» ble, diverfes expériences prouvent cependant qu’il
» renferme la v is , le fuçoir, le barillet ôc la fubftan-
» ce fpongieufe qui s’imbibe de la femence. La vis
» en occupe le haut ôc fait fortir en-deçà de fa par-
» tie fupérieure, deux petits ligamens par lefquels
» elle eft adhérente, auffi-bien que tout le refte de
» l ’appareil; auquel elle eft jointe, au fommet de
» l*étui extérieur. Le fuçoir Ôc le barillet font pla-
» cés au milieu de ce tube ; la fubftance fpongieufe
» dilate fa partie inférieure, ôc eft jointe au barillet
» par une efpece de ligament.
» Plufieurs de ces vaiffeaux parvenus à leur matu-
» rité, ôc débarraffés de cette matière gluante qui lés
» environne pendant qu’ils font dans le réfervoir de
» la laite, agiffent dans le moment qu’ils font en plein
» air; & peut-être que la legere preffion qu’ils fouf-
» frçnt en fortant, fuffit pour les détermine? à cela :
» cependant la plupart peuvent être placés commo-
» dément pour être vus au microfcope, avant que
» leur aftion commence ; ôc même pour qu’elle s’e-
wxécute, il faut humeûer avec une goutte d’eau
y> l’extrémité fupérieure de l’étui extérieur, qui com-
„ mence alors à fe développer, pendant que les deux
„ petits ligamens qui fortent hors de l’étui fe contour-
» nent ôc s’entortillent en différentes façons ; en mê-
» me tems la vis monte lentement, les volutes qui
„ font à fon bout fupérieur fe rapprochent 6c agif-
,> fent contre le fommet de l’étui. Cependant celles
t> qui font plus bas arrivent auffi, 6c femblent être
„ continuellement fuivies par d’autres qui fortent du
„ pifton. M. Needham dit qu’elles femblent être fui-
„ vies , parce qu’il ne croit pas qu’elles le foient en
» effet ; ce n’eft qu’une fimple apparence produite
» par la nature du mouvement de la vis. Le fuçoir
» 6c le barillet fe meuvent auffi fuivant la même di-
» reftion ; 6c la partie inférieure qui contient la fe-
» mence s’étend en longueur , 6c fe meut en même
» tems vers le haut de l’étui : ce qu’on remarque par
» le vuide qu’elle laiffe au fond Dès que la vis avec
„ le tube dans lequel elle eft renfermee, commence
» à paroître hors de l’étui, elle fe plie, parce qu’elle
» eft retenue par fes deux ligamens ; 6c cependant
» tout l’appareil intérieur continue à fe mouvoir ,
» lentement & par degrés, jufqu’à ce que la vis, le
» fuçoir, 6c le barillet foient entièrement fortis.
» Quand cela eft fait, tout le refte faute dehors en un
» moment ; le fuçoir fe fépare du barillet ; le liga-
» ment apparent qui eft au-deffous de ce dernier, fe
» gonfle 6c acquiert un diamètre égal à celui de la
» partie fpongieufe qui le fuit. Celle-ci, quoique
» beaucoup plus large que dans l’étui, devient en-
»core cinq fois plus longue qu’auparavant ; le tube
» qui renferme le tout s’étrécit dans fon milieu, 6c
» forme ainfi deux efpeces de noeuds diftans environ I
» d’un tiers de fa longueur, de chacune de fes extré-
» mités ; enfuite la femence s’écoule par le barillet,
» 6c elle eft compofée de petits globules opaques,
» qui nagent dans une matière fereufe, fans donner.
» aucun ligne de v ie, 6c qui font précifément tels
»qu’on les a vus, quand ils étoient répandus dans
» le réfervoir de la lemence. La partie comprife en-
» tre les deux noeuds paroît être frangée ; quand on
» l’examine avec attention, on trouve que ce qui la
» fait paroître telle, c’eft que la fubftance fpongieu-
» fe, qui eft en-dedans du tube, eft rompue 6c fépa-
» rée en parallèles à-peu-près, égalés.
» Quelquefois il arrive que la vis Ôc le tube fe
»rompent précifément au-deffus du fuçoir, lequel
» refte dans le barillet ; alors le tube fe ferme, en un
» moment, 6c prend une figure conique, en.fe con-
» traçant autant qu’il eft poffible par-deffus l’extré-
» mité de la vis ; ce qui démontre qu’il eft très-elafti-
» que en cet endroit, & la maniéré dont il s accom-
» mode à la figure de la fubftance qu’il renferme,
»lorfque celle-ci fouffre le moindre changement,
» prouve qu’il l’ eft également par-tout ailleurs ».
On fait par lesfragmens d’alimens que l’on a trouvés
dans l’eftomac du calmar, qu’il fe nourrit d’animaux
, 6c entre autres de pélamides & de melettes,
qui font de petits poiffons, dont il y a grand nombre
dans les bas-fonds, près de l’embouchure du Tage.
Foye^ les nouvelles obfervations microfcopiques, • '
On a diftingué deux fortes de calmarsle grand &
le petit, celui-ci eft auffi appellé cajferon j il diffère
de l’autre en ce qu’il eft plus petit, 6c que 1- extrémité
de fon corps eft plus pointue.
Le nom du calmar vient de la reffemblance qu on
lui a trouvée avec un encrier, fur-tout pour la liqueur
noire qui eft dans, le corps de l’animal, 6c que l’on
prendroit pour de l’encre. Rondelet. ( / )
CALMAR, ( Géog. ) grande ville fortifiée deSue-
Torne I I ,
d e, dans la province de Smaland, avec un port fur
la mer Baltique , fur le détroit auquel on donne le
nom de Calmar-Sund. Long. 3 4 .33 » lat. à G. 48.
CALME, f. m. ( Marine. ) c’eft une ceffatiôft en*
tiere du vent : on dit fur mer calme tout plat > pouf
dire qu'il ne fait point du tout de vent> Quelques-uns
prétendent que le grand calme eft un préfage d’une
prochaine tempête. On dit mer calme.
Etre pris du calme, c’eft demeurer fans aucun vent*'
enforte qu’on ne peut plus gouverner.
CALMENDA, ( Géog. ) ville duroyaume de Portugal
, peu éloignée de Brâgue.
* CALMANDE, f. f. ( Commerce. ) étoffe de laine
d’un excellent ufer : elle fe 'fabrique particulièrement
en Flandre. Il y en a de deux efpeces, des unies
ou rayées, 6c des calmandes à fleurs. On fait entrer
dans ces dernieres de la foie, 6c dans quelques autres
du poil de chèvre. Il n’y a rien de confiant ni
fur leur longueur ni fur leur largeur.
CALMER, appaifer la tempête ; il commence à
calmer, fe dit à la mer, Calmer, devenir calme, pour,
lignifier que le vent diminue.
Dans un combat entre deux armees navales, le
grand nombre de coups de canon qui fe tirent, fait
prefque toujours calmer. ( Z f
CALMOUCKS ou CALMUQUES, ( Géog:) peuples
d’Afie, dans la grande Tartarie , entre le Mon-
gul & le Wôlga : ils font divifés en hordes ou tribus
qui ont chacune leur chef ou kam , dOnt le principal
réfide à Samarcand. Les Calmouks n’ont point de demeure
fixe ; ils campent toujours fous des tentes, ôc
ont des efpeces de chariots qui les fuivent par-tout,
8c qui portent leurs femmes, leurs enfans, & le peu
de bagage qu’ils peuvent avoir. La Ruffie eft- en alliance
avec cette nation, ÔC a toujours 6000 Calmouks
à fa folde.
CALOMEL, f. m. terme de Pharmacie, nom qu’on
donne au mercure doux, fublimé jufqu’à quatre fois
ou même davantage. Hoye^ Mercure.
Il paroît que cette dénomination a été d’abord donnée
à l’éthiops minéral, 8t eft compoféé des deux
mots grecs xaAoç, beau, ÔC , noir, parce que
les corps, pâles ou blancs qu’on en frotte, 'deviennent
noirs. Hoye{ EthiopSi
D ’autres veulent qu’elle ait été donnée dès le commencement
au mercure doux, par la fantaifie d’un
certain chimifte qui fe faifoit fervir dans fes opérations
par un noir ; & que cette dénomination fait al-'
lufion tout-à-la-fois à la couleur de l’aide qui étôit
noir, ôc à la beauté dmimédicament qui étoit d’unè
fort belle apparence. ( A ) -
CALOMNIE, f. f. (Morale.) on calomnie quelqu’un
, lorfqu’on lui impute des défauts ou des vices
qu’il n’a pas. La calomnie eft un menfonge odieux que
chacun réprouve ôc dételle ; ne fut ce que par-la
crainte d’en être quelquejour L’objet. Mais fouvent
tel qui la condamne, n’én eft pas innocent lui-même :
il a rapporté des faits avec infidélité, les a grôffis *
altérés du changés, étourdiement peut-être, ôc par
la feule habitude d’orner ou d’exagérer fes récits.
Un moyen fur, ôc le feul qui le foit, pour ne point
calomnier, c’eft de ne jamais médire.-
Tranfportez-vous en efprit dans quelque monde
imaginaire, où vous fuppoferez que les paroles font
toujoursTexpreffion fidele du fentiment ôc de la pen-
fée ; où l’ami qui vous fera des offres de fervice, foit
en effet rempli de bienveillance ; -où l’on ne cherche
point à fe prévaloir de votre crédulité » pour vous
repaître l’efprit de fables; où la vérité difte tous les;
difcoürs, les récits ôc les promeffes ; où l’on v i ve par
conféquent fans foupçon ôc fans défiance , à l’abrî
des impoftures, des perfidies, & des délations calom*
rùeufes : quel.-délicieux commerce, que celui des
hommes qui peupleroient çet heureux globe ! ■*
B B b b ij