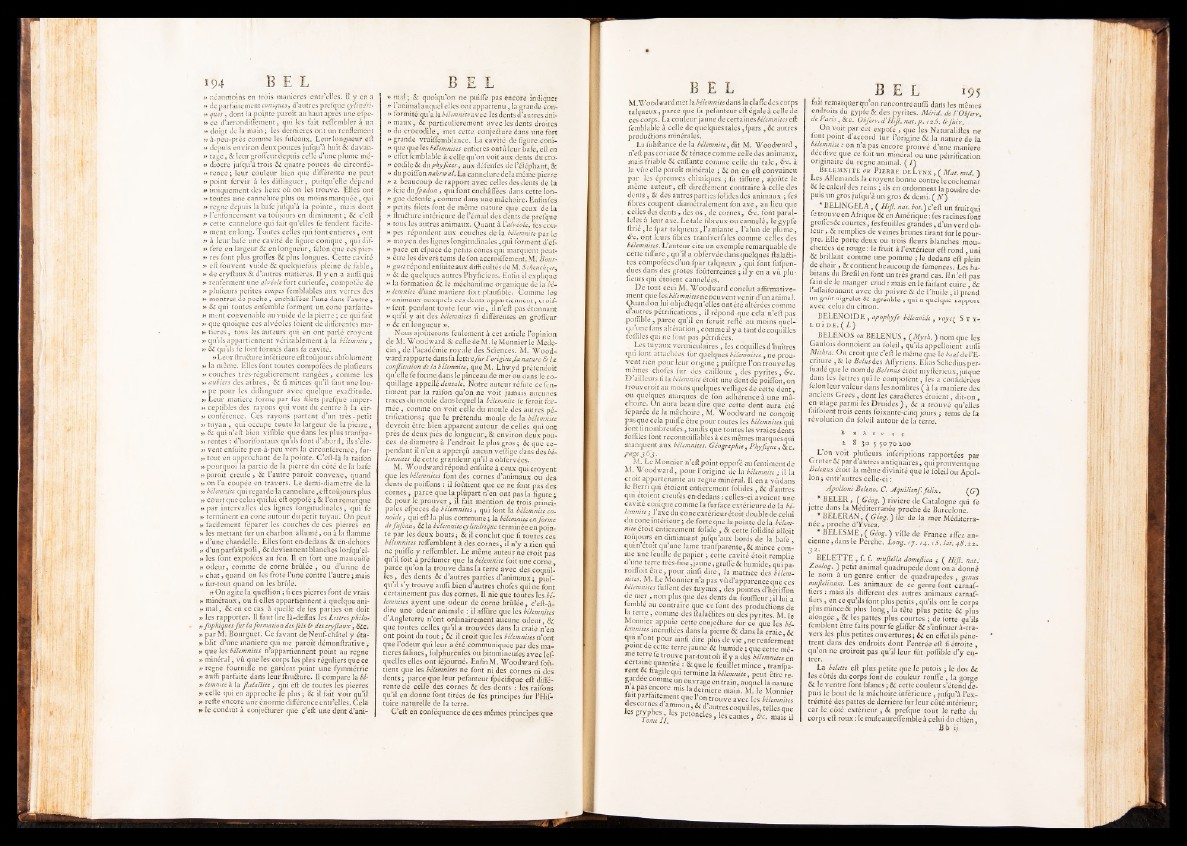
■ P H
» néanmoins en trois maniérés entr’elles. Il y en a
» de parfaitement coniques, d’autres prelque cylindri-
» ques, dont la pointe paroît au haut après une efpe-
» ce d’arrondiflement, qui les-fait reffembler à un
» doigt de la main; les'aernieres ont un renflement
» à-peu-près comme les.fufeaux. Leur longueur eft
» depuis environ deux pouces jufqu’à huit & davan-
» tage, & leur groffeur depuis celle d’une plume mé-
» diocre jufqu’à trois & quatre pouces de circonfé-
» rence ; leur couleur bien que différente ne peut
»point fervir à les diftinguer, puifqu’elle dépend
» uniquement des lieux pii on les trouve. Elles ont
» toutes une cannelure plus ou moins marquée, qui
» régné depuis la bafe jufqu’à la pointe, mais dont
» l’enfoncement va toujours en diminuant ; & c’eft
» cette cannelure qui fait qu’elles fe fendent facile-
» ment en long. Toutes celles qui font entières, ont
» à leur bafe une cavité de figure conique , qui dif-
» fere en largeur & en longueur, félon que ces pier-
» res font plus greffes & plus longues. Cette cavité
» eft fouvent vuide &c quelquefois pleine de fable,
» de cryftaux& d’autres matières. Il y en a aufîi qui
» renferment une alvéole fort curieufe, compofée de
» plufieurs petites coupes femblables aux verres des
» montres de poche, enchâffées l’une dans l’autre,
» & qui toutes enfemble forment un cône parfaite-
» ment convenable au vuide de la pierre ; ce qui fait
» que quoique ces alvéoles foient de différentes ma-
» tieres, tous les auteurs qui en ont parlé croyent
» qu’ils appartiennent véritablement à la bélemnite,
» 6c qu’ils fe font formés dans fa cavité.
» Leur ftruâure inférieure eft toujours abfolument
» la même. Elles font toutes compofées de plufieurs,
» couches très-régulierement rangées , comme les
» aubiers des arbres, 6c fi minces qu’il faut une Iou-
» pe pour les diftinguer avec quelque exadtitude.
» Leur matière forme par fes filets prefque imper-
» ceptibles des rayons qui vont du centre à la cir-
» conférence. Ces rayons partent d’un très-petit
» tuyau , qui occupe toute la largeur de la pierre,
» 6c qui n’eft bien vifible que dans les plus tranfpa-
» rentes : -d’horifontaux qu’ils font d’abord, ils s’éle-
» vent enfuite peu-à-peu vers la circonférence, fur-
» tout en approchant de la pointe. C ’eft-là la raifon
» pourquoi la partie de la pierre du côté de la bafe
»paroît creufe, & l’autre paroît convexe, quand
» on l’a coupée en travers. Le dçmi-diametre de la
» bélemnite qui regarde la cannelure, eft toujours plus
» court que celui quilùi èft oppofé ; & l’on remarque
» par intervalles des lignes longitudinales, qui fe
» terminent en cône autour du petit tuyau. On peut
» facilement féparer les ■ couches de ces pierres en
» les mettant fur un charbon allumé, ou à la flamme
» d’une chandelle. Elles font en-dedans & en-dehors
» d’un parfait poli, & de viennent blanches lorfqu’el-
» les font expofées au feu. Il en fort une mauvaife
» odeur, comme de corne brûlée , ou d’urine de
» chat, quand on les frote l’une contre l’autre;mais
» fur-tout quand on les brûle.
» On agite la queftion ; fi ces pierres font de vrais
» minéraux, ou fi elles appartiennent à quelque ani-
» mal, & en ce cas à quelle de fes parties on doit
» les rapporter. Il faut lire là-defliis les Lettres philo-
» fophiques fur la formation des fels & des cryfaux , &c.
» par M. Bourguet. Ce favant de Neuf-châtel y éta-
» blit d’une maniéré qui me paroît démonftrative ,
» que les bélernnites n’appartiennent point au régné
» minéral, vû que les corps les plus réguliers que ce
» régné fourniffe ne gardent point une fymmétrie
» aufîi parfaite dans leur ftrutture. Il compare la bé-
» lemnite à la flalaclite , qui eft de toutes les pierres j
» celle qui en approche le plus ; & il fait voir qu’il 1
» refte encore une énorme différence entr’elles. Cela j
» le conduit à conje&urer que ç’eft une dent d’ani-
»> mal; & quoiqu’on ne pififïe pas encore indiquer
» l’animal auquel elles ont appartenu, la grande con-
» formité qu’a la b é lem n ite a v e c les dents d’autres ani-
» maux, 6c particulièrement avec les dents droites
» du crocodile, met cette conjecture dans une fort
»grande vraiffembiance. La cavité défiguré coni-
» que que les bé le rn n ite s entières ont à leur bafe, eft en
» effet femblable à celle qu’on voit aux dents du cro-
» codile & d u p h y f e t e r , aux défenfes de l’éléphant, &
v du poiffon n a h rw a l. La cannelure delà même pierre
» a beaucoup de rapport avec celles des dents de la
» feie du f p a d o n , qui font enchâffées dans cette lon-
» gue défenfe, comme dans une mâchoire. Enfin fes
» petits filets font de même nature que ceux de la
» ftruûure intérieure de l’émail des dents de prefque
» tous les autres animaux. Quant à l'a lv é o le , l'es cou-
» pes répondent aux couches de la b é lem n ite par le
» moyen des lignes longitudinales, qui forment d’ef-
» pace en efpace de petits cônes qui marquent peut-
» être les diverà tems de fon accroiffement. M. B out-
» guet répond enfuite aux difficultés de M. Scheuchçer,
» & de quelques autres Phyficiens. Enfin il explique
» la formation 6c le méchanifme organique de la bé-
» lem n it e d’une maniéré fort plaufible. Comme les
» animaux auxquels ces dents appartiennent, croif-
» fent pendant toute leur v ie , il n’eft pas étonnant
» qu’il y ait des bélernnites fi différentes en groffeur
» & en longueur ».
Nous ajouterons feulement à cet article l’opinion
de M. Voodward & celle de M. leMonnier le Médecin
, de l’académie royale des Sciences. M. V o od -
ward rapporte dans fa lettre fur l'origine,la nature & la
conjlitution de la bélemnite, que M. Lhwyd prétendoit
qu’elle fe forme, dans le pinceau de mer ou dans le coquillage
appelle dentale. Notre auteur réfute cefen-
timent par la raifon qu’on ne voit jamais aucunes
traces du moule dans lequel la bélemnite le feroit formée
, comme on voit celle du moule des autres pétrifications
; que le prétendu moule de la bélemnite
devroit être bien apparent autour de celles qui ont
près de deux piés de longueur, & environ deux pouces
de diamètre à l’endroit le plus gros ; 6c que cependant
il n’en a apperçû aucun veftige dans des bé«
lemnites de cette grandeur qu’il a obfervées.
M. "Woodward répond enfuite à ceux qui croyent
que les bélernnites font des cornes d’animaux ou des
dents de poiffons : il foûtient que ce ne font pas des
cornes, parce que la plûpart n’èn ont pas la fi<mre ;
& pour le prouver, il fait mention de trois, princi-!
pales efpeces de bélernnites, qui font la bélemnite co-
noïde, qui eft la plus commune ; la bélemnite en forme
defufeau, & la belemnitecylindrique terminée en pointe
par les deux bouts ; & il conclut que fi toutes ces
bélernnites reffemblent à des cornes, il n’y a rien qui
ne puiffe y reffembler. Le même auteur ne croit pas
qu’il foit à préfumer que la bélemnite foit une corne
parce qu’on la trouve dans la terre avec des coquilles
, des dents 6c d’autres parties d’animaux ;. puif-
qu’il s’y trouve aufli bien d’autres chofes qiiine font
certainement pas des cornes. Il nie que toutes les bé-
lemnites ayent une odeur de corne brûlée, c’eft-à-
dire une odeur animale : il affûre que les bélernnites
d’Angleterre n’ont ordinairement aucune odeur 6c
que toutes celles qu’il a trouvées dans la craie n’en
ont point du tout ; 6c il croit que les bélernnites n’ônt
que l’odeur qui leur a été communiquée par des matières
falines, fulphureufes ou bitumineufes avec lef-
quelles elles ont féjourné. Enfin M. Woodward foûtient
que les bélernnites ne font ni des cornés ni des
dents ; parce que leur pefanteur fpécifique eft différente
de celle des cornes 6c des dents : les raifons
qu’il en donne font tirées de fes principes fur l’Hif-
toire naturelle de la terre.
C ’eft eh conféquence de ces mêmes principes que
M.VoodwardmètlaÆé/emratiedail!) îaclaffcdes cOfps
talqueux, parce que fa pefanteur eft égale à celle dé
ces corps. La couleur jaune de certaines bélefnnites eft
femblable à celle de quelques talcs ,fpars , 6c autres
productions minérales.
Lafubftance de la bélemnite, dit M. Woodward ,
n’eft pas coriace 6c ténace comme celle des animaux,
mais friable & caffante comme celle du talc, &c. à
la vûe elle paroît minérale ; 6c on en eft convaincu
par les épreuves chimiques ; fa tiffure, ajoute le
même auteur, eft directement contraire à celle des
dents, & des autres partiesfolides des animaux ; fes
fibres coupent diamétralement fon axe, au lieu que
. celles des dents, des o s , de cornes, &c. font parallèles
à leur axe. Létale fibreux ou cannelé, legypfe
ftrié ,1e fpar talqueux,l’amiante , l ’alun de plume,
&c. ont leurs fibres tranfverfales comme celles des
bélernnites. L’auteur cite un exemple remarquable de
cette tiffure, qu’il a obfervée dans quelques ftalaCti-
tes compofées d’un fpar talqueiix , qui font fufpen-
dues dans des grotes foûterreines ; il y en a vû plu-
fleurs qui étoient cannelées.
De tout ceci M. AVoodward conclut affirmativement
que les Æé/eOT/2/r« ne peuvent venir d’un animal.
Quand on lui objefte qu’elles ont été altérées comme ,
d’autres pétrifications , il répond que cela n’eft pas
polfible, parce qu’il en feroit refté au moins quelqu’une
fans altération, comme il y a tant de coquilles
foffiles qui ne font pas pétrifiées.
Les tuyaux vermiculaires , les coquilles d’huîtres
qui font attachées fur quelques bélernnites, ne prouvent
rien pour leur origine ; puifque l’on trouve les
memes chofes fur des cailloux , des pyrites, &ct
D ailleurs fi la belemnite étoit une dent de poiffon, on
trouveroit au moins quelques veftiges de cette dent,
ou quelques marques de fon adhérence à une mâ-
choire. On aura beau dire que cette dent aura été
feparee de la mâchoire, M. Woodward ne conçoit
pas que cela puiffe être pour toutes les bélernnites qui I
font fi nombreufes, tandis que toutes les vraies dents 1
foffiles font reconnoiffables à ces mêmes marques qui
manquent aux bélernnites. Géographie, Phyfique ,6lc.
PaSe 3^3 - ‘ ;
M. Le Monnier n’eft point oppofé au fentiment de
M. Woodward, pour l’origine de la bélemnite ; il la
croit appartenante au régné minéral. II en a vûdans
le Berri qui étoient entièrement folides , & d’autres
qui étoient creufes en-dedans : celles-ci avoient une
cavité conique comme la furface extérieure de la bélemnite
; l ’axe du cône extérieur étoit double de celui
du cône intérieur ; de forte que la pointe de J a bélem-
nite étoit entièrement folide , & cette folidité alloit
toujours en diminuant jufqu’aux bords de la bafe ,
qui n’étoit qu’une lame tranfparente, & mince com-
iue une feuille de papier ; cette cavité étoit remplie
d’une terre très-fine, jaune ,graffe & humide, quipa-
roiffoitetre, pour ainfi dire, la matrice des bélem-
nites. M. Le Monnier n’a pas vû d’apparence que ces
belèmnites fuffent des tuyaux, des pointes d’hériffon
de mer, non plus que des dents du fouffleur ;il lui a
fembîe au contraire que ce font des productions de
la terre, comme des ftalaûites ou des pyrites. M. le
Monnier appuie cette conjecture fur ce que les bé-
lemmtes incruftées dans la pierre & dans la craie, &
qui n ont pour ainfi dire plus de vie , ne renferment
point de cette terre jaune & humide ; que cette même
terre fe trouve par-tout oii il y a des bélernnites en
certainè quantïté : & que le feuillet mince, tranfpa-
ren j , ragflc qui termine la bélemnite, peut être regardée
comme un ouvrage en train, auquel la nature
n a pas encore mis la derniere main. M. le Monnier
dpsrnr 31 j™ent ^ue ^’0n trouve avec les bélernnites
{ H B B j i O ■ autres coquilles, telles que
g S // pet0ncles >les «m e s , le. tnail il
fait remarquef qu’on rencontré aufîi dails les mêmes
endroits du gypfe & des pyrites. Mérid. de l'Obferv.
de Paris, &c. Obferv.d'HiJl. nat.p. ,%5.&fuiv. .
On voit par cet expofé , que les Naturaliftes ne
lont point d’accord lur l’origine & la nature de la
belemnite : on n’a pas encore prouvé d’une maniéré
decifive que ce foit un minéral ou une pétrification
originaire du régné animal. ( /)
B e l e m n i t e ou P ie r r e d e L y n x , ( Mat.med. )
Les Allemands la croyent bonne contre le cochemar
oc le calcul des reins ; ils en ordonnent la poudre depuis
un gros jufqu’à un gros & demi. ( N )
BELINGELA, ( Hi(l. nat. bot.') c’eft un fruit qui
fe trouve en Afrique & en Amérique : fes racines font
groffes &: courtes, fes feuilles grandes, d’un verd ob-
lcur, & remplies de veines brunes tirant fur le pourpre.
Elle porte deux ou trois fleurs blanches mouchetées
de rouge : le fruit à l’extérieur eft rond , uni
& brillant comme une pomme ; le dedans eft plein
de chair , & contient beaucoup de femences. Les ha-
bitans du Brefil en font un très grand cas. Il n ’eft pas
fain de le manger crud : mais en le faifant cuire , &
l’affaifonnant avec du poivre & de l ’huile , il prend
un goût aigrelet & agréable , qui a quelque rapport
avec celui du citron.
B ELENOIDE , apophyfe bélenoide , voyez S T Y-
L O ï d e . ( Z ) x . •
BELENOS du BELENUS, (Myth. ) nom que les
Gaulois donnoient au loleil, qu’ils appelloient aufli
Mithra-. On croit que c’eft le même que le de l’Ecriture
,& le Belusdes Affyriens. Elias Schedius persuade
que le nom de Belenus étoit myftérieux, julque
dans les lettres qui le eompofent, les a confédérées
félon leur valeur dans les nombres ( à la maniéré des
anciens Grecs , dont les caraéleres étoient, dit-on ,
en ul'àge parmi les Druides ) , & a trouvé qu’elles
faifoiént trois cents foixante-cinq jours ; tems de là
révolution du foleil autour de la terre.
B H \ i v . 0 ç
2 8 30 5 5070200
L’on voit plufieurs infcriptiOns rapportées par
Gruter & par d autres antiquaires, qui prouvent que
Belenus étoit la même divinité que le foleil ou Apollon
; entr’autres celle-ci :
Apolloni Beleno. C. Aquilienf. felix. (G)
* BELER, ( Géog. ) riviere de Catalogne qui fe
jette dans la Méditerranée proche de Barcelone.
* BELERAN, ( Géog. ) île de la mer Méditerranée
, proche d’Yvica.
* BELESME, ( Géog. ) ville de France aflëz ancienne,
dans le Perche. Long. iy. 14. ,S. lat.48.zz.
3 z.
BELETTE , f. f. mufiella domejiica } ( Hifi. nat;
Zoolog. ) petit animal quadrupède dont on a donné
le nom à un genre entier de quadrupèdes , genus
mujlelinum. Les animaux de ce genre font carnaf-
fiers : mais ils different des autres animaux carnaf-
fiers, en ce qu’ils font plus petits, qu’ils ont le corps
plus mince & plus long, la tête plus petite & plus
alongée , & les pattes plus courtes ; de forte qu’ils
femblent etre faits pourfe gliffer & s’infinuer à-travers
les plus petites ouvertures ; & en effet ils pénètrent
dans des endroits dont l’entrée eft fi étroite ,
qu’on ne croiroit pas qu’il leur fût polfible d’y entrer.
La belette eft plus petite que le putois ; le dos &
les côtés du corps font de couleur rouffe , la gorge
& le ventre font blancs ; & cette couleur s’étend depuis
le bout de la mâchoire inférieure , jufqu’à l’extrémité
des pattes de derrière fur leur côté intérieur:
car le côté extérieur , & prefque tout le refte du
corps eft roux : le mufeaureffemble à celui du chien,
B b ij