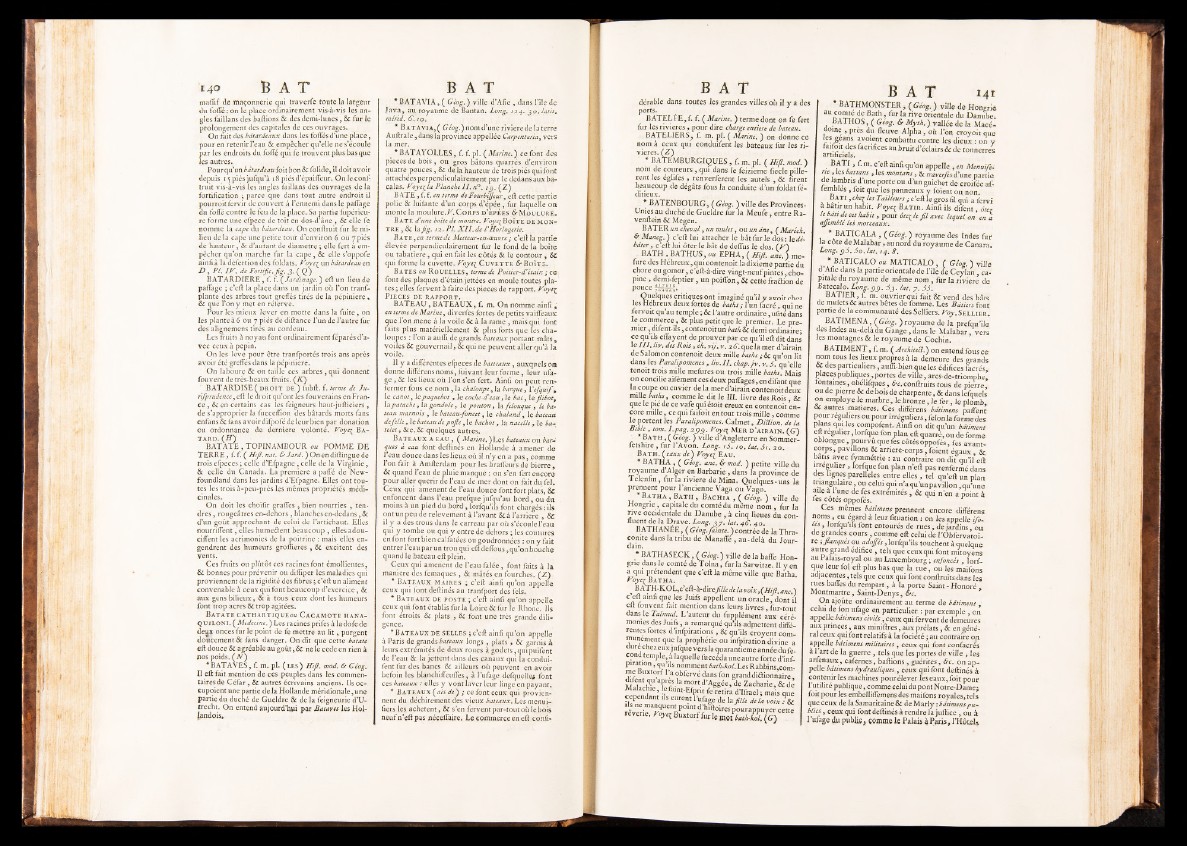
1 4 0 B A T
maflif de maçonnerie qui traverse toute la largeur
du fofTé: on le place ordinairement vis-à-vis les angles
faillans des basions & des demi-lunes, & fur le
prolongement des capitales de ces ouvrages.
On fait des batardeaux dans les folles d’une place,
pour en retenir l’eau & empêcher qu’elle ne s’écoule
par les endroits du fofTé qui fe trouvent plus basque
les autres.
Pour qu’un batardeau foit bon Bc fohde, il doit avoir
depuis 1 5 pies jufqu’à 18 piés d’épaifleur. On le confi
truit vis-à-vis les angles laillans des ouvrages de la
fortification ; parce que dans tout autre endroit il
pourroitfervir de couvert à l’ennemi dans le paffage
du fofl'é contre le feu de la place. Sa partie fupérieu-
re forme une efpece de toît en dos-d’âne , & elle fe
nomme la cape du batardeau. On conftruit fur le milieu
de la cape une petite tour d’environ 6 ou 7 piés
de hauteur, & d’autant de diamètre ; elle fert à empêcher
qu’on marche fur la cape, & elle s’oppofe
ainfi à la defertion des foldats. Voyeç un batardeau en
D , PL IV. de Fortifie.fig. J . (Q )
BATARDIERE, f. f. ( Jardinage. ) eft un lieu de
paffage ; c’eft la place dans un, jardin où l’on tranf-
plante des arbres tout greffés tirés de la pépinière,
& que l’on y met en réferve.
Pour les mieux lever en motte dans la fuite, on
les plante à 6 ou 7 piés de diftance l’un de l’autre fur
des alignemens tirés au cordeau.
Les fruits à noyau font ordinairement féparés d’avec
ceux à pépin.
On les leve pour être tranfportés trois ans après
avoir été greffés dans la pépinière.
On labourç & on taille ces arbres, qui donnent
fouvent de très-beaux fruits. (X)
BATARDISE ( droit de ) lùbft. f. terme de Ju-
rifprudence,eû le droit qu’ont les fouverains en France
, & en certains cas les feigneurs haut-jufticiers ,
de s’approprier la fucceflion des bâtards morts fans
enfans & fans avoir difpofé de leur bien par donation
ou ordonnance de derniere volonté. Voye{ Bâtard.
(ET)
BATATE , TOPINAMBOUR ou POMME DE
TERRE, f. f. ( H fi. nat. & Jard. ) On en diflingue de
trois efpeces ; celle d’Efpagne, celle de la Virginie,
& celle du Canada. La première a paffé de New-
foundland dans les jardins d’Efpagne. Elles ont toutes
les trois à-peu-près les mêmes propriétés médicinales.
On doit les choifir graffes , bien nourries , tendres
, rougeâtres en-dehors , blanches en-dedans, &
d’un goût approchant de celui dé l’artichaut. Elles
nourriffent, elles humedent beaucoup , elles adou-
ciffent les acrimonies de la poitrine : mais elles engendrent
des humeurs grofîieres , ôc excitent des
vents.
Ces fruits ou plutôt cès racines font émollientes,
& bonnes pour prévenir ou difîiper les maladies qui
proviennent de la rigidité des fibres ; c’efl: un aliment
convenable à ceux qui font beaucoup d’exercice, &
aux gens bilieux, & à tous ’ceux dont les humeurs
font trop acres & trop agitées. Batate cathartique ou Cacamote hana-
quiloni. ( Mtdecine. ) Les racines prifes à la dofe de
de^x onces fur le point de fe mettre au l i t , purgent
doucement & fans danger. On dit que cette batate
efl douce & agréable au goût>& ne le cede en rien à
nos poids. ( N )
*BATAVES, f. m. pl. ( les) Hifi. mod. & Géog.
Il efl fait mention de ces peuples dans les commentaires
de Céfar, & autres écrivains anciens. Ils oc-
cupoient une partie de la Hollande méridionale, une
partie du duché de Gueldre & de la feigneurie d’U-
trecht. On entend aujourd’hui par Bataves les Hol-
jandois.
B A T
* BAT AVI A , ( Géog. ) ville d’Afie »dans l’île de
ja v a , au royaume de Bantan. Long. 124. 3 o .latit.
mérid. G.10.
* Ba t a v ia , ( Géog.') nom d’une riviere de la terre
Auftrale, dans la province appellée Carpentaria, vers
la mer.
* BATAYOLLES, f. f. pl. ( Marine. ) ce font des
pièces de bois, ou gros bâtons quarrés d’envi,ron
quatre pouces, & de la hauteur de trois piés qui font
attachées perpendiculairement par le dedans aux ba-
calas. Voye^la Planche II. n°. ig . (Z )
BATE, f. f. en terme deFourbfieur, efl cette partie
polie & luifante d’un corps d’épée, fur laquelle ou
monte la moulure./5'. Corps d’épées & Moulure.
Bâte d'une boîte de montre. Voyeç Boîte de MONTRE
, & la fig. 12.Pl. X I I . de l'Horlogerie. Bate,*/z terme de Metteur-en-oeuvre ; c’efl la partie
élevée perpendiculairement fur le fond de la boîte
ou tabatière, qui en fait les côtés & le contour , Bc
qui forme la cuvette. Voyeç Cuvette 6* Boîte.
Bâtes ou Rouelles, terme de Poitier-d'ètain ; ce
font des plaques d’étain jettées en moule toutes plates^
elles fervent à faire des pièces de rapport. Voye^ PIECES DE RAPPORT.
BATEAU, BATEAUX, f. m. On nomme ainfi ;
en terme de Marine, diverfes fortes de petits vaifleaux
que l’on mene à la voile & à la rame , mais qui font
faits plus matériellement & plus forts que les chaloupes
: l’on a auflî de grands bateaux portant mâts,
voiles & gouvernail, & qui ne peuvent aller qu’à la
voile.
Il y a différentes efpeces de batteaüx, auxquels on
donne différens noms, fuivant leur forme, leur ufa-
g e , & les lieux où l’on s’en fert. Ainfi on peut renfermer
fous ce nom , la chaloupe^ la barque, l'efquif%
le canot, le paquebot , le coche-deau ,1e bac, le fiibot,
la patache, la gondole , le ponton , la felouque , le bateau
marnois , le bateau-foncet, le chaland, le bateau
defelle, le bateau de pofie, le bachot, la nacelle , le ba-
telet, &c. &quelques autres. Bateaux A eau , ( Marine. )Les bateaux ou barques
a eau font deflines en Hollande à amener de
l’eau douce dans les lieux où il n’y en a pas, comme
l’on fait à Amfterdam pour les brafleurs de bierre ,
& quand l’eau de pluie manque : on s’en fert encore
pour aller quérir de l’eau de mer dont on fait du fel.
Ceux qui amènent de l’eau douce font fort plats, Sc
enfoncent dans l’eau prefque jufqu’au bord, ou du
moins à un pied du bord, lorfqu’ils font chargés : ils
ont un peu de relèvement à l’avant & à l’arriere , &
il y a des trous dans le carreau par où s’écoule l’eau
qui y tombe ou qui y entre de dehors ; les coutures
en font fort bien calfatées ou goudronnées : on y fait
entrer l’eau par un trou qui efl deflous, qu’on bouche
quand le bateau efl plein.
Ceux qui amènent de l’eau falée, font faits à la
maniéré des femaques , & mâtés en fourches. (Z )
* Bateaux maires ; c’eft ainfi qu’on appelle
ceux qui font deftinés au tranfport des fels.
* Bateaux de poste ; c’eft ainfi qu’on appelle
ceux qui font établis fur la Loire & fur le Rhône. Ils
font étroits & plats , & font une très grande diligence.
* Bateaux de selles ; c’efl ainfi qu’on appelle
à Paris de grands bateaux longs , plats , & garnis à
leurs extrémités de deux roues à godets, qui puifent
de l’eau & la jettent dans des canaux qui la condui-
fent fur des bancs & ailleurs où peuvent en avoir
befoin les blanchiffeuffes, à Tufage defquelle^ font
ces bateaux : elles y vont laver leur linge en payant.
* Bateaux ( ais de ) ; ce font ceux qui proviennent
du déchirement des vieux bateaux. Les menui-
fiers les achètent, & s’en fervent par-tout où lebois
neuf n’eft pas néçeffaire. Le commerce en efl confi-
B A T
durable dans toutes les grandes villes où il y a des
ports.
BATELÉE, f. f. ( Marine. ) terme dont on fe fert
fur les rivières, pour dire charge entière de bateau.
BATELIERS, f. m. pl. ( Marine. ) on donne ce
nom à ceux qui conduifent les bateaux fur les riv
iè r e s .^ )
* BATEMBURGIQUES , f. m. pl. ( Hifi. mod. )
nom de coureurs , qui dans le feizieme fiecle pillèrent
les églifes, renverferent les autels , & firent
beaucoup de dégâts fous la conduite d’un foldat fé-
ditieux.
* BATENBOURG, ( Géog. ) ville des Provinces-
Unies au duché de Gueldre fur la Meufe, entre Ra-
venftein & Megen.
BATER un cheval, un mulet, Ou un âne, ( Maréck.
&Maneg. ) c ’eft lui attacher le bât fur le dos: le débâter
, c ’eft lui ôter le bât de deflùs le dos. (V )
BATH , BATHUS, c« EPHA, ( Hifi. anc. ) me-
fure des Hébreux, qui contenoit la dixième partie du
chore ou gomor, c ’eft-à-dire vingt-neuf pintes, cho-
pine, demi-feptier, un poiflbn, & cette fraftion de
pouce
: Quelques eritiqùes ont imaginé qu’il y avoitchez
les Hébreux deux fortes de haths; Tun laqré, qui ne
fervbit qu’au temple ; Sc l ’autre ordinaire ,ufite dans
leeommerce, & plus petit que le premier. Le premier
, difent-ils, contenoitun bath & demi ordinaire;
ce qu’ils effayent de prouver par ce qu’il eft dit dans 1 &IJI.liv.dcs Rois, ch. v ij.v. ad', que la mer d’airain
de Salomon contenoit deux mille haths ; & qu’on lit
dails les ParaUpommcs , liv. JJ. chap.jv. v. S. qu’elle
tenoit trois mille rnefures ou trois mille haths. Mais
on concilie aifénjent ces deux paffages, en difant que
la coupe ou cuvier delà mer d’airain contenoitdeux
mille haths, comme le dit le III. livre des Rois &
que le pié de ce vafe qui étoit creux en contenoit encore
mille, ce qui faifoit en tout trois mille , comme
le portent les Paralipomenes. Calmet, Diction, dt la
Bible, tau. I.pag. a g ÿ . Voyc^ Mer d ’air a in .,(C).
■ * Bath , ( Géog. ) ville d’Angleterre en Sommer-
fetshire , fur l ’Avon. Long. tS. i o. lot. 6c. zo. Bath. {eauxde) Voyt^ Eau.
* BATHA , ( Géog. anc. & mod. ) petite ville du
royaume d Alger en Barbarie . dans la province de
Telenfin, ftu la riviere de Mina. Quelques-uns la
prennent pour l ’ancienne Vaga ou Vago. ‘ Batha, Bath , Bachia , ( Géog. ) ville de
Hongrie , capitale du comté du même nom , fur la
rive occidentale du Danube , à cinq lieues du confluent
de là Drave. Long. gy. lot. 46'. 40.
B ATHANÉE, ( Géog. fainte. ) contrée de la Thra-
conite dans la tribu de Manafle , au-delà du Jourdain.
* BATHASÈCK, {Gtoge ) ville de la baffe Hon-
grie dansle comté de Tolna, furlaSarwitze. Il yen
a qui prétendent que c’eft la même ville que Batha.
Poyei Batha.
_ B ATH-ICOL,c’eft-à-dire fille de la voix,{Hifi. ancé)
c’eft ainfi que les Juifs appellent un oracle, dont il
eft fouvent fait mention dans leurs livres, fur-tout
dans lé Talmud. L ’auteur du fupplément aux cérémonies
des Juifs, a remarqué qu’ils admettent différentes
fortes d’infpirations , & qu’ils croyent communément
que la prophétie ou infpiration divine a
dure chez eux jufque vers la quarantième année du fécond
temple, à laquelle fuccéda une autre forte d’inf-
piration , qu’ils nomment bathékol. Les Rabbins,comme
Buxtorf l'a obfervé dans fon granddiftionnaire
difent qu après la mort d’Aggée, de Zacharie, & de
Malachm lefamt-Efprit fe retira d’Ifrael ; mais que
cependant fis eurent l’ufage de la filU de la voix? Si
fis ne manquent point d’hfftoires pourappuver cetm
rêverie. ^ Buxtorf lurlc n c J h a c h t T f )
B A T i4t
* BATHMONSTER,.( Géog. ) ville de Hohgrle
au comte de Bath, fur la rive orientale du Danube*
BATHOS, ( Géog. & Myth. ) vallée de la Macédoine
, près du fleuve Alpha, où l’on croyoitque
les^geans avoient combattu contre les dieux : on y
.®lf. ^es O rifices au bruit d’éclairs & de tonnerres
artificiels.
• c e^ a‘nSi qu’on appelle , en Menuiferie,
lesbattans , les montans, & traverfes d’une partie
de lambris d’une porte ou d’un guichet de croifée af-
, iembles, foit que les panneaux y foient ou non.
. ’ chei {es P ff j j p ; e a bâtir un habit. ’efl le gros fil qui a fervi Voye^ Bâtir. Ainfi ils difent, ôter
le bâti de cet habit, pour ôte[ le fil avec lequel on en a
afiemblé lei morceaux.
\BATICALA , ( Géog. ) royaume des Indes fur
la cote de Malabar, au nord du royaume de Canara.
Long. y 5. 5 o. lat. 14, 8.
„ * BATICALO ou MAT1C A LO , ( Géog. ) ville
d ’Afie dans la partie orientale de l’île de Ceylan, capitale
du royaume de même nom , fur la riviere de
Batecalo. Long. y y .'5g. lat. y. 53;
BATIER, f. m. ouvrier qui fait & vend des bâts
de mulets & autres bêtes de fomme. Les Bâticrs font
partie de la communauté des Selliers, Sellier*
BATIMENA, ( Géog. ) royaume de la prefqu’île
des Indes au-delà du Gange, dans le Malabar, vers
les montagnes & le royaume de Cochin.
BATIMENT, f. m. ( Architeci.) on entend fous ce.
nom tous les lieux propres à la demeure des grands
& des particuliers, aufli-bien que les édifices làcrés,
places publiques, portes de ville , arcs-de-triomphe,
fontaines, obélifques, &c.conftruits tous de pierre,
ou de pierre & de boisde charpente, & dans lefquels
on employé le marbre, le bronze, le fer, le plomb,
oc autres matières. Ces différens bâtimens paffent
pour réguliers ou pour irréguliers, félon la forme des
plans qui les compofent. Ainfi on dit qu’un bâtiment
eft régulier, lorfque fon plan eft quarré, ou de forme
omongue, pourvu que fes côtés oppofés, fes avant-
çorps, pavillons & arriere-corps, foient égaux &
bâtis avec fymmétrie : au contraire on dit qu’il*eft:
irrégulier, lorfque fon plan n’eft pas renfermé dans
des lignes parelleles entre elles , tel qu’eft un plan
Agi» airC ’ OU celui S n’a qu’un pavillon »qu’une
aile à l une de fes extrémités, & qui n’en a point à
les cotes oppofés*
Ces mêmes bâtimens prennent encore différens
noms j eu égard à leur fituation : on les appelle ifo-
les, lorfqu’ils font entourés de rues, de jardins, ou
de grandes coûts , comme eft celui de l ’Obfervatoi-
re flanques ou adojfés , lorfqu’ils touchent à quelque
autre grand édifice , tels que ceux qui font mitoyens
au Palais-royal ou au Luxembourg ; enfoncés , lorfque
leur fol eft plus bas que la rue, ou les maifons
adjacentes »tels que ceux qui font conftruits dans les
rues baffes du rempart, à la porte Saint - Honoré ,
Montmartre, Saint-Denys, &c.
On ajoute ordinairement au terme de bâtiment ,
celui de fon ufage en particulier : par exemple , on.
appelle bâtimens civils, ceux qui fervent de demeures
aux princes, aux miniftres, aux prélats, & en général
ceux qui font relatifs à la fociété ; au contraire on
appelle bâtimens militaires , ceux qui font confacres
à 1 art de la guerre , tels que les portes de ville , les
arfenaux, cafernes, baftions , guérites, &c. on appelle
bâtimens hydrauliques., ceux qui font deftinés à
contenir les machines pour élever les eaux, foit pour
l ’utilité publique, comme celui du pont Notre-Dame;
foit pour les embelliffemens des maifons royales, tels
que ceux de la Samaritaine & de Marly : bâtimens publics
, ceux qui font deftinés à rendre la juftice , ou à
l ’ufage du public f çOmme lç Palais à Paris, l’HôteU