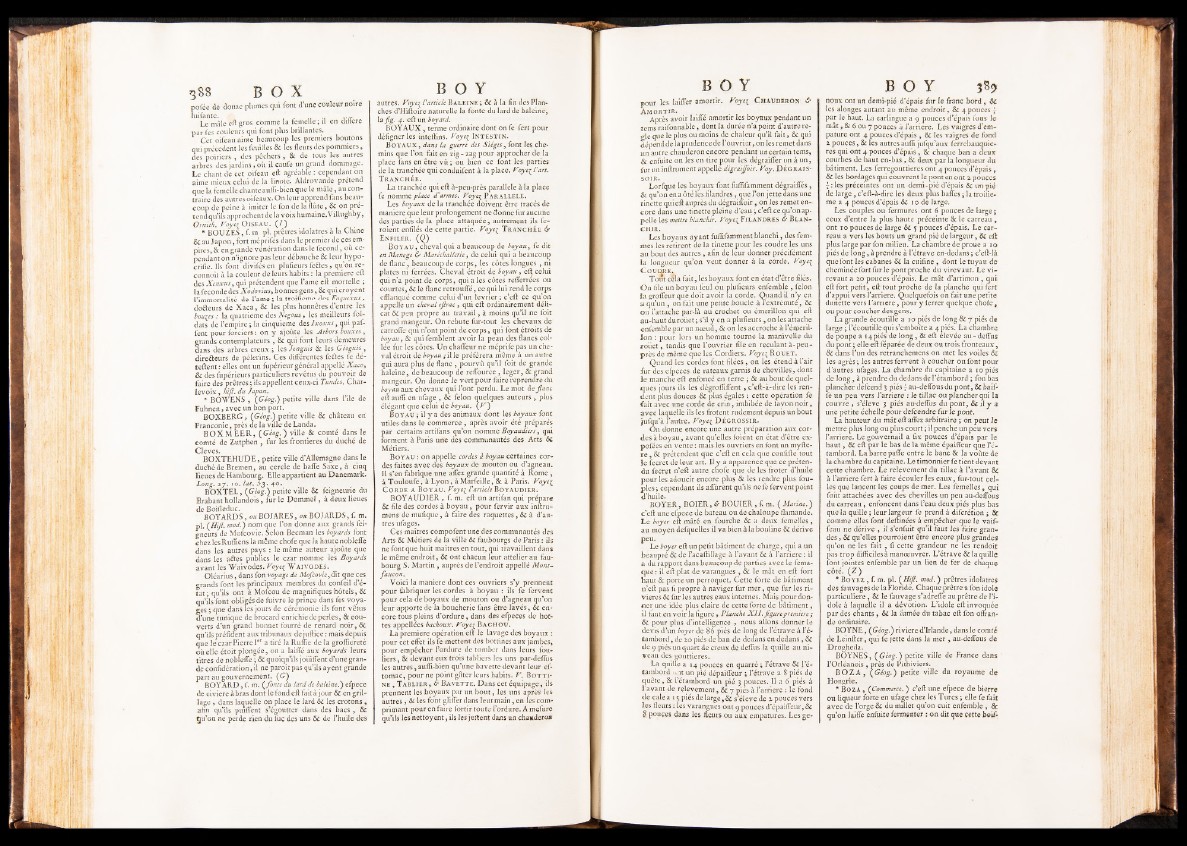
pofée de douze plumes qui font d’une couleur noire
luifante.
Le mâle eft gros comme la femelle ; il en dittere
par les couleurs qui font plus brillantes.
Cet oifeau ainue beaucoup les premiers boutons
qui precedent les feuilles & les fleurs des pommiers,
des poiriers , des pêchers , & de tous les autres
arbres des jardins » oit il caufe un grand dommage.
Le chant de cet oifeau eft agréable : cependant on
aime mieux celui de la linote. Aldrovande prétend
que la femelle chante aufli-bien que le mâle, au contraire
des autres oifeaux. On leur apprend fans beaucoup
de peine à imiter le fon de la flûte, & on prétend
qu’ils approchent de la voix humaine. Villughby,
Ornith. Voye^ O lS E AU . . ( / )
* BOUZES, f. m pl. prêtres idolâtres'à la Chine
& au Japon, fort méprifés dans le premier de ces empires,
& en grande vénération dans le fécond, où cependant
on n’ignore pas leur débauche & leur hypo-
erifxe. Ils font divifés en plufieurs feétes, qu’on re-
connoît à la couleur de leurs habits : la première eft
des Xenxus, qui prétendent que l’ame eft mortelle ;
la fécondé des Xodovius, bonnes gens, & qui croyent
l’immortalité de l’ame; la troifieme des Foquexus,
do&eurs de Xaca, &c les plus honnêtes d’entre les
bouges : la quatrième des Negous,, les meilleurs fol-
dats de l’empire ; la cinquième des Ixoxus, qui paf-
fent pour forciers : on y ajoûte les Arbors bouxes,
grands contemplateurs , & qui font leurs demeures
dans des arbres creux ; les Jenguis & les Géoguis,
direûeurs de pèlerins. Ces différentes feftes fe détellent
: elles ont un fupérieur général appellé Xaco,
& des fupérieurs particuliers revêtus du pouvoir de
faire des prêtres ; ils appellent ceux-ci Tundes. Char-
levoix , hijl. du Japon.
* BOWENS , ( Géog.) petite ville dans l’île de
Fuhnen, avec un bon port.
BOXBERG, ( Géog.) petite ville & château en
Franconie, près de la ville de Landa.
B O X M E E R , (Géog.) ville & comté dans le
comté de Zutphen , fur les frontières du duché de
Cleves.
BOXTEHUDE, petite ville d’Allemagne dans le
duché de Bremen, au cercle de baffe Saxe, à cinq
lieues de Hambourg. Elle appartient au Danemark.
Long. 27. to.'lat. J j . 40.
BOXTEL, (Géog.) petite ville & feigneune du
Brabant hollandois, fur le Dommel, à deux lieues
de Boifleduc.
BOYARDS, ou BOJARES, on BOJARDS, f. m.
pl. (Hijî. mod.) nom que l’on donne aux grands fei-
gneurs de Molcovie. Selon Becman les boyards font
chez lesRufliens la même chofe que la haute nobleffe
dans les autres pays : le même auteur ajoûte que
dans les a&es publics le czar nomme les Boyards
avant les "Waivodes. Voye^ "Waivodes.
Oléarius, dans fon voyage de Mofcovie, dit que ces
orands font les principaux membres du confeil d’état
; qu’ils ont à Mofcou de magnifiques hôtels, &
qu’Us font obligés de fuivre le prince dans fes voyages
; que dans les jours de cérémonie ils font vêtus
d’une tunique de brocard enrichie de perles, & couverts
d’un grand bonnet fourré de renard noir, &
qu’ils préfident aux tribunaux de juftice: mais depuis
que le czar Pierre Ier a tiré la Ruflie de la grofliereté
où elle étoit plongée, on a laiffé aux boyards leurs
titres de nobleffe ; & quoiqu’ils joiiiffent d’une grande
confidération,il ne paroît pas qu’ils ayent grande
part au gouvernement. (G)
BOYARD, f. m. (fonce du Lard de baleine.) efpece
de civiere à bras dont le fond eft fait A jour & en grillage
, dans laquelle on place le lard & les crotons ,
afin qu’ils puiffent s’égoutter dans des bacs , &
gu’on ne perde rien du lue des uns ôc de l’huile des
autres. Voye^ Varticle B a l e in e ; & à la fin des Plan-
chcs’d’Hiftoire naturelle la fonte du lard de baleine,
la fig. 4. eft un boyard.
BOYAUX, term e o rd in a ire d ont o n fe fe r t p o u r
d é f ig n e r le s in teftins. Voye^ In t e s t i n .
B o y a u x , dans la guerre des Sièges, font les chemins
que l’on fait en zig - zag pour approcher de la
place fans en être vû ; ou bien ce font les parties
de la tranchée qui conduifent à la place. Voye£ l'art.
T r a n c h é e .
La tranchée qui eft à-peu-près parallèle à la place
fe nomme place d'armes. Voye[ P a r a l l è l e .
Les boyaux de la tranchée doivent être tracés de
maniéré que leur prolongement ne donne fur aucune
des parties de la place attaquée, autrement ils fe-
roient enfilés de cette partie. Voye^ T r a n c h é e 6*
E n f i l e r . (Q )
B o y a u , cheval qui a beaucoup de boyau, fe dit
en Manege & Marèchallerie, de celui qui a beaucoup
de flanc, beaucoup de corps, les côtes longues , ni
plates ni ferrées. Cheval étroit de boyau, eft, celui
qui n’a point de corps, qui a les côtes refferrées ou
courtes, & le flanc retrouffé, ce qui lui rend le corps
efflanqué comme celui d’un levrier ; c’eft ce qu’on
appelle un cheval ejlrac , qui eft ordinairement délicat
& peu propre au travail, à moins qu’il ne foit
grand mangeur. On rebute fur-tout les chevaux de
carroffe qui n’ont point de corps, qui font étroits de
boyau, & quifemblent avoir la peau des flancs collée
fur les côtes. Un chaffeur ne méprife pas un cheval
étroit de boyau ; il le préférera même à un autre
qui aura plus de flanc , pourvû qu’il foit de grande
haleine, de beaucoup de reffource , leger, & grand
mangeur. On donne le vert pour faire reprendre du
boyau aux chevaux qui l’ont perdu. Le mot de flanc
eft aufli en ufage , & félon quelques auteurs , plus
élégant que celui de boyau. (V )
B o y a u ; il y a des animaux dont les boyaux font
utiles dans le commerce, après avoir été préparés
par certains artifans qu’on nomme Boyaudiers, qui
forment à Paris une des communautés des Arts &
Métiers.
B o y a u : on appelle cordes à boyau certaines cordes
faites avec des boyaux de mouton ou d’agneau.
Il s’en fabrique une affez grande quantité à Rome ,
à Touloufe, à Lyon, à Marfeille, & à Paris. Voye^
C o r d e a B o y a u . Voye^ l'article B o y a u d i e r .
BOY AUDI ER , f. m. eft un artifan qui prépare
& file des cordes à boyau, pour fervir aux inftru-
mens de mufique, à faire des raquettes, & à d’autres
ufages.
Ces maîtres compofent une des communautés des
Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris : ils
ne font que huit maîtres en tout, qui travaillent dans
le même endroit, & ont chacun leur attelier au faubourg
S. Martin , auprès de l’endroit appellé Mont-
fauconK
Voici la maniéré dont ces ouvriers s’y prennent
pour fabriquer les cordes à boyau : ils fe fervent
pour cela de boyaux de mouton ou d’agneau qu’on
leur apporte de la boucherie fans être lavés, & encore
tous pleins d’ordure, dans des efpeces de hottes
appellées bachoux. Voye^ B a c h o u .
La première opération eft le lavage des boyaux :
pour cet effet ils fe mettent des bottines aux jambes,
pour empêcher l’ordure de tomber dans leurs fou-
liers, & devant eux trois tabliers les uns par-deffus
les autres, aufli-bien qu’une bavette devant leur ef-
tomac, pour ne point gâter leurs habits. V. B o t t i n
e , T a b l i e r , & B a v e t t e . Dans cet équipage, ils
prennent les boyaux par un bout, les uns après les
autres, & les font gliffer dans leur main, en les comprimant
pour en faire fortir toute l’ordure. A mçfure
qu’ils les nettoyent, ils les jettent dans un chawderoa
pour les laiffer amortir. Voye1 C b a u d e r o n &
A m o r t i r . .
Après avoir lamé amortir les boyaux pendant un
tems raifonnable, dont la durée n’a point d’autre réglé
que le plus ou moins de chaleur qu’il fait, & qui
dépend de la prudence de l’ouvrier, on les remet dans
un autre chauderon encore pendant un certain tems,
& enfuite on les en tire pour les dégraiffer un à un,
fur un inftrument appellé dégraijfoir. Voy. PÉGRAIS-
SOIR.
Lorfque les boyaux font ftiffifamment dégraiffés,
& qu’on en a ôté les filandres, que l’on jette dans une
tinette qui eft auprès du dégraiffoir, on les remet encore
dans une tinette pleine d’eau; c’eft ce qu’onap-
pelle les mettre blanchir. Voye^ F i l a n d r e s & B l a n c
h i r .
Les boyaux ayant fuffifamment blanchi, des femmes
les retirent de la tinette pour les coudre les uns
au bout des autres , afin de leur donner précifément
la longueur qu’on veut donner à la corde. Voye^
C o u d r e «.
Tout cela fait, les boyaux font en état d’être filés.
On file un boyau feul ou plufieurs enfemble , félon
la groffeur que doit avoir la corde. Quand il n’y çn
a qu’un , on fait une petite boucle à l’extrémité, Sc
on i’attache par-là au crochet ou émerillon qui eft
au-haut du roiiet ; s’il y en a plufieurs, on les attache
enfemble par un noeud, & on les accroche à l’émeril-
lon : pour lors un homme tourne la manivelle du
roiiet, tandis que l’ouvrier file en reculant à-peu-
près de même que les Cordiers. Voye^ Rouet.
Quand les cordes font filées, on les étend à l’air
fur des efpeces de rateaux garnis de chevilles , dont
le manche eft enfoncé en terre ; & au bout de quelques
jours ils les dégrofliffent , c’eft-à-dire les rendent
plus douces & plus égales : cette opération fe
fait avec une corde de crin, imbibée de fa von noir,
avec laquelle ils les frotent rudement depuis un bout
jufqu’à l’autre. Voyeç D é g r o s s i r .
On donne encore une autre préparation aux cordes
à boyau, avant qu’elles foient en état d’être ex^
pofées en vente : mais les ouvriers en font un myfte-
r e , & prétendent que c’eft en cela que confifte tout
le fecret de leur art. Il y a apparence que ce prétendu
fecret n’eft autre chofe que de les froter d’huile
pour les adoucir encore plus & les rendre plus fou-
pies ; cependant ils affûrent qu’ils ne fe fervent point
d’huile.
BOYER, BOIER, & BOUIER, f. m. ( Marine. )
c’eft une efpece de bateau ou de chaloupe flamande.
Le boyer eft mâté en fourche & a deux femelles,
au moyen defquelles il va bien à la bouline & dérive
peu.
Le boyer eft un petit bâtiment de charge, qui a un
beaupré & de l’acaftiüage à l’avant & à l'arriéré : il
a du rapport dans beaucoup de parties avec le fema-
que : il eft plat de varangues , & le mât en eft fort
haut & porte un perroquet. Cette forte de bâtiment
n’eft pas fi propre à naviger fur mer, que fur les rivières
& fur les autres eaux internes. Mais pour donner
une idée plus claire de cette forte de bâtiment,
il faut en voir la figure, Planche X II. figure première}
& pour plus d’intelligence , nous allons donner le
devis d’un boyer de 86 piés de long de l’étrave à l’é-
tambord, de 20 piés de ban de dedans en dedans , &
de 9 piés un quart de creux de deffus la quille au niveau
des gouttières.;; v
La quille a 14 pouces en quarré ; l’étrave & l ’étambord
a it un pié dépaiffeur ; l’étrave a 8 piés de
quête, & l’étambord un pié 3 pouces. Il a 6 piés à
l ’avant de relèvement, & 7 piés à l’arriere : le fond
de cale a 15 piés de large, & s’élève de 2 pouces vers
les fleurs : les varangues ont 9 pouces d’épaiffeur,&
$ pouces dans les fleurs ou aux empatures. Les genoux
ont un demi-pié d’épais fur le franc bord , &
les alonges autant au même endroit, & 4 pouces -
par le haut. La carlingue a 9 pouces d’épais fous le
mât, & 6 ou 7 pouces à l’arriere. Les vaigres d’em-
pature ont 4 pouces d?épais , &c les vaigres de fond
2 pouces, & les autres aufli jufqu’aux ferrebauquie-
res qui ont 4 pouces d’épais, & chaque ban a deux
courbes de haut en-bas, & deux par la longueur du
bâtiment. Les ferregouttieres ont 4 pouces d’épais,
& les bordages qui couvrent le pont en ont 2 pouces
| :le s préceintes ont un demi-pié d’épais & un pié
de large, c’eft-à-dire les deux plus baffes ; la troifie*
me a 4 pouces d’épais & 10 de large.
Les couples ou fermures ont 6 pouces de large ;
ceux d’entre la plus haute préceinte & le carreau ,
ont 10 pouces de large & 5 pouces d’épais. Le carreau
a vers les bouts un grand pié de largeur, & eft
plus large par fon milieu. La chambre de proue a 10
piés de long, à prendre à l’étrave en-dedans ; c’eft-là
que font les cabanes & la cuifine , dont le tuyau de
cheminée fort fur le pont proche du vire vaut. Le vi-
revaut a 20 pouces d’épais. Le mât d’artimon , qui
eft fort petit, eft tout proche de la planche qui fèrt
d’appui vers l’arriere. Quelquefois on fait une petite
dunette vers l ’arriere, pour y ferrer quelque chofe ,
ou pour coucher des gens.
La grande écoutille a 10 piés de long & 7 piés de
large ; l’écoutille qui s’emboîte a 4 piés. La chambre
de poupe a 14 piés de long, & eft élevée au - deffus
du pont ; elle eft féparée de deux ou trois fronteaux,
& dans l’un des retranehemens on met les voiles &
les agrès ; les autres fervent à coucher ou font pour
d’autres ufages. La chambre du capitaine a 10 piés
de long, à prendre du dedans de l’étambord ; fon bas
plancher defeend 3 piés { au-deffous du pont, & baif-
fe un peu vers l’arriere : le tillac ou plancher qui la
couvre , s’élève 3 piés au-deffus du pont, & il y a
une petite échelle pour defeendre fur le pont. *
La hauteur du mât eft affez arbitraire ; on peut le
mettre plus long ou plus court ; il penche un peu vers
l’arriere. Le gouvernail a fix pouces d’épais par le
haut, & eft par le bas de la même épaiffeur que l’c-
tambord. La barre paffe entre le banc & la voûte de
la chambre du capitaine. Le timonnier fe tient devant
cette chambre. Le relèvement du tillac à l’avant &ç
à l’arriere fert à faire écouler les eaux, fur-tout celles
que lancent les coups de mer. Les femelles, qui
font attachées avec des chevilles un peu au-deffous
du carreau, enfoncent dans l’eau deux piés plus bas
que la quille ; leur largeur fe prend à diferétion ; Sc
comme elles font deftinées à empêcher que le vaifi-
feau ne dérive , il s’enfuit qu’il faut les faire grandes
, & qu’elles pourraient être encore plus grandes
qu’on ne les fa it , fi cette grandeur ne les rendoif
pas trop difficiles à manoeuvrer. L’étrave & la quille
font jointes enfemble par un lien de fer de chaque
côté. ( Z )
* B o y e z , f. m. pl. (Hifi. mod. ) prêtres idolâtres
des fauvages de la Floride. Chaque prêtre a fon idole
particulière, & le fauvage s’adreffe au prêtre de l’idole
à laquelle il a dévotion. L’idole èft invoquée
par des chants , & la fumée du tabac eft fon offrande
ordinaire.
BOYNE, (Géog.) riviere d’Irlande, dans le comté
de Leinfter, qui fe jette dans la mer , au-deffous de
Drogheda.
BOYNES, ( Géog. ) petite ville de France dans
l’Orléanois, près de Pithiviers.
B O Z A , (Géog.) petite ville du royaume de
Hongrie.
* B o z a , (Commerce. ) c’eft une efpece de bierrç
ou liqueur forte en ufage chez les Turcs ; elle fe fait
avec de l’orge & du millet qu’on cuit enfemble , 8ç
qu’on laiffe enfuite fermenter ; on dit que cette b©ifi*.