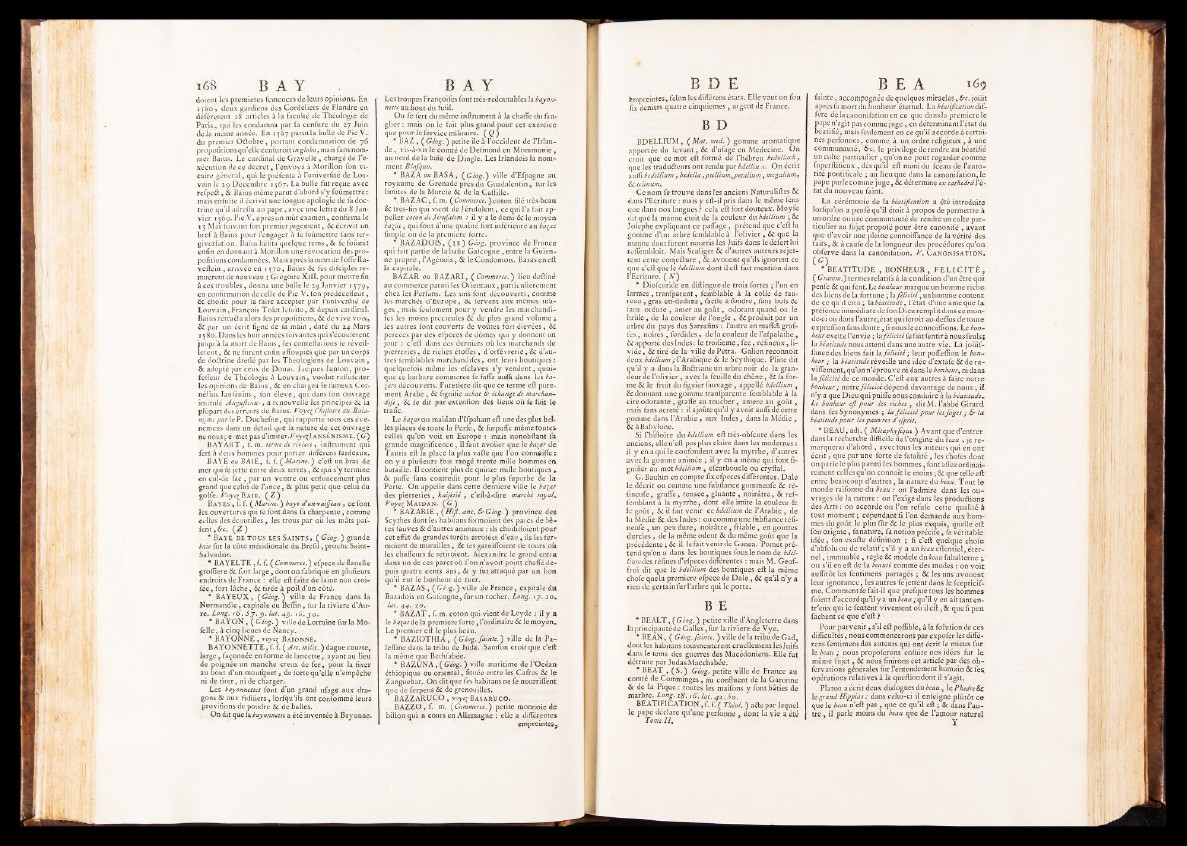
doient lés premières femences de leurs opinions. En
1 560 > deux gardiens des Cordeliers de Flandre en
déférèrent 18 articles à la faculté de Théologie de
Pâtis, qui lès condamna par fa cenfure du 27 Juin
delà meme année. En 1 567 parut la bulle de Pie V .
du premier Oftobre, portant condamnation de 76
propofitions qu’elle cenfuroit inglobo, mais fans nommer
Baïus. Le cardinal de Gravellc , chargé de l’exécution
de ce decret, l’envoya à Morillon fon v icaire
général, qui le préfentà à Tuniverfité de Louvain
le 29 Décembre 1567. La bulle fut reçue avec
refpeû, & Baïus même parut d’abord s’y foîimettre :
mais enfuite il écrivit une longue apologie de fa doctrine
qu’il adrefl'a au pape, avec une lettre du 8 Janvier
1569. Pie V . après un mûr examen, confirma le
13 Mai fuivant fon premier jugement, & écrivit un
bref à Baïus pour l’engager à le foîimettre lans ter-
giverfation. Baïus héfita quelque tems , & fe fournit
enfin en donnant à Morillon une révocation despro-
politions condamnées. Mais après la mort de J offe Ra-
veftein , arrivée en 1 570, Baïus ôc les difciples remuèrent
de nouveau : Grégoire XIII. pour mettre fin
à ces troubles, donna une bulle le 19 Janvier 1579,
en confirmation de celle de Pie V. Ion prédéceffeur,
ôc choifit pour la faire accepter par l’univerlité de
Louvain, François Tolet Jélïiite, & depuis cardinal.
Baïus rétraéla alors fes propofitions, ôc de vive voix,
ôc par un écrit ligné de la main , daté du 24 Mars
1580. Dans les huit années l'uivantes qui s’écoulèrent
jufqu'à la mort de Baïus, les conteftationS 1e réveillèrent
, Ôc ne furent enfin affoupies que par un corps
de do&rine drelié par les Théologiens de Louvain ,
& adopté par ceux de Douai. Jacques Janlon, pro-
feffeur de Théologie à Louvain, voulut refful'citer
les opinions de Baïus, ôc en chargea le fameux Cornélius
Janfénius, fon éleve, qui dans fon puvrage
intitulé Augufiinus, a renouvellé les principes ôc la
plupart des erreurs de Baïus. Voyt{ l ’hijtoire du Baïa-
nijnu par le P. Duchefne, qui rapporte tous ces éve-
nemens dans un détail que la nature de cet ouvrage
ne nous permet pas d’imiter J a n s é n i s m e . (G)
BAYART, 1. m. terme de rivière, infiniment qui
fert à deux hommes pour porter différens fardeaux.
BAYE ou BAIE, 1’. f. ( Marine. ) c’eft un bras de
mer qui fe jette entre deux terres, ôc qui s’y termine
en cul-de lac , par un ventre ou enfoncement plus
grand que celui de l’ance, & plus petit que celui du
golfe. Voye^Baie. ( Z )
B a y e s , f . f. ( Marine. ) baye d’unvaijfeau , ce font
les ouvertures qui fe font dans fa charpente, comme
celles des écoutilles, les trous par où les mâts paf-
fent,£c. ( Z )
* B a y e d e t o u s l e s S a i n t s , ( Géog. ) grande.
baie fur la côte méridionale du Brefil, proche Saint-
Salvador.
* BAYELTE , f. f. ( Commerce.') efpece de flanelle
grolïiere Ôc fort large, dont on fabrique en plufieurs
endroitsde France : elle eft faite de laine non croi-
fé e , fort lâche, & tirée à poil.d’un côté.
* BAYEUX, ( Géog. ) ville de France dans la
Normandie, capitale du Beflïn, fur la rivière d’Au-
re. Long. 16. 5y . 9 . lat. 49. iC .jq .
* B A Y O N , ( Géog. ) ville de Lorraine fur la Mo-
felle , à cinq lieues de Nancy.
* BAYONNE , voye^ B a i o n n e .
BAYÔNNETTE, f. f. ( Art. milit. ) dague courte,
large, façonnée en forme de lancette, ayant au lieu
de poignée un manche creux de fer, pour la fixer
au bout d’un moufquet, de forte qu’elle n’empêche
ni de tirer, ni de charger.
Les bayonnettes font d'un grand ufage aux drar
.gons & aux fufiliers, lorfqu’ils ont confommé leurs
.provifions de poudre ôc de balles.
On dit que la bayonnette a été inventée à Bayonne.
Les troupes Françoifes font très-redoutables la bayon*
nette au bout du fufil.
On fe fert du même inftrument à la chafle du fan-
glier : mais on le fait plus grand pour cet exercice
que pour le fervice militaire. ( Q )
* BAZ , ( Géog. ) petite île à l’occident de l’Irlande
, vis-à-vis le comté de Defmond en Mommonie,
au nord de la baie de Dingle. Les Irlandois la nomment
Blafquo.
* BAZA ou BASA, (Géog.) ville d’Efpagne au
royaume de Grenade près du Guadalentin, fur les
limites de la Murcie & de la Cafiille.
* BAZ A C , f. m. ( Commerce. ) coton filé très-beau
ôc très-fin qui vient de Jérufalem, ce qui l’a fait ap-
peller coton de Jérufalem : il y a le demi ôc le moyen ba\ac, qui font d’une qualité fort inférieure au ba\ac
fimple ou de la première forte.
* BAZADOIS, ( l e ) Géog. province de France
qui fait partie de la balle Gafcogne, entre la Guien-
ne propre, TAgénois, & le Condomois. Bazas en efi
la capitale.
BAZAR ou BAZARI, (Commerce.) lieu deftiné
au commerce parmi les Orientaux, particulièrement
chez les Perfans. Les uns font découverts, comme
les marchés d’Europe, ôc fervent aux mêmes uCages
, mais feulement pour y vendre les marchandi-
les les moins précieufes & dé plus grand völume ;
les autres font couverts de voûtes fort élevées, ôc
percées par des efpeces de dômes qui y donnent un
jour : c ’eft dans ces derniers où les marchands de
pierreries, de riches étoffes , d’orfèvrerie, ôc d’autres
fcmblables mafchandifes, ont leurs boutiques ï
quelquefois même les efclaves s’y vendent, quoique
ce barbare commerce fe faffe aufli dans les bazars
découverts. Furetiere dit que ce terme eft purement
Arabe , ÔC lignifie achat & échange de marchandai
, ôc fe dit par extenfion des lieux où fe fait le
trafic.
Le ba^ar ou maidan d’Ifpaham efi une des plus belles
places de. toute la Perfe, & furpaffe même toutes
celles qu’on voit en Europe : mais, non.obftant fa
grande magnificence, il faut avoüer que le ba^ar de
Tauris eft la place la plus vafte que l’on conivpiffe :
on y a plûfie.urs fois rangé trente mille hommes en
bataille. Il contient plus de quinze mille boutiques >
& paffe fans contredit pour le plus fuperbe de la
Perfe. On appelle dans cette derniere ville le ba^ar
des pierreries, kaijerié , c’eft-à-dire marché royal.
V'oye^ M a i d a n . ( G )
* BAZAR1E , (Hiß. anc. & Géog. ) province, des-
Scythes dont les habitans fbrmpient des parcs de bêtes
fauves & d’autres animaux : ils choififfoient pour
cet effet de grandes forêts arroiées d’eau., ils les fer-
moient de murailles, .& lesgarnjffoient de tours où
les chaffeurs fe rétiroient. Alexandre le grand entra
dans un.de ces parcs où Ton n’a voit point çhaffé de-
puis quatre cents ans, & y fut attaqué par un lion
qu’il eut- le bonheur de tuer.
* BAZAS-, (Géog.) ville de France, capitale du
Bazadois.en Gafcogne, fur unrpcher. Long. \y. 20,
lat. 44. .20.
* BAZAT, f. m. coton qui vient de Leyde : il y a
le ba^at de la première forte, l’ordinaire Ôc le moyen.
Le premier eft le plus beau..
* BAZIOTHIA, (Géog. faintc.) ville de la Pa-
leftijie .dans la tribu de Jüda, .Samfon croit que c’eft
la même que Bethfabée.
* BAZ(JNA, (Géog. ) ville maritime de l ’Océan
éthiopique ou oriental, fit-uée entre les Cafres ôc le
Zanguebar. On dit que fes habitans ne fe nourriffent
que de ferpens ôc de grenouilles.
BAZZARUCO, voyei B a s a r u c o .
.. BAZZO, f. m. (Commerce.) petite monnoie de
billon qui a cours en Allemagne ; elle a différentes
empreintes.
Empreintes, félon les différens états,. Elle vaut un fou
fix deniers quatre cinquièmes, argent de France.
B D
BDELLÎUM, ( Hat. med. ) gomme aromatique
apportée du levant, ôc d’ufage en Medecine. On
croit que ce mot eft formé de l’hébreu bedollacli,
que les tradufteurs ont rendu par bdelliu n. On écrit
aufli bedellium , bedella }pteUium}petalium, megalium,
&: telinum.
Ce nom fe tfouve dans les anciens Naturaliftes ôc
dans l’Ecriture : mais y eft-il pris dans le même fens
que dans nos langues ? cela eft fort douteux. Moyfe
dit qué la manne étoit de la couleur du bdellium ; ôc
Jofephe expliquant ce paffage, prétend que c’eft la
gomme d’un arbre femblable à l’olivier , & que la
maqne dont furent nourris les Juifs dans ledefertlui
reffembloit. Mais Scaliger ôc d’autres auteurs rejettent
cette conjecture , ôc avouent qu’ils ignorent ce
que c’eft que le bdellium dont il eft fait mention dans
l’Ecriture. (H )
* Diofcoride en diftingue de trois fortes ; l’un en
larmes , tranfparent, femblable à la colle de taureau
, gras en-dedans, facile à fondre, fans bois ôc
fans ordure , amer au goût*, odorant quand on le
brûle, de la couleur de l’ongle , & produit par un
arbre du pays des Sarrafins : l’autre en mafféS graf-
fe s , noires , fordides , de la couleur de l’afpalathe,
& apporté des Indes : le troifieme, fe c , réfineux, livide
, & tiré de la ville de Petra. Galien reconnoît
deux bdellium ; l’Arabique & le Scythique. Pline dit
qu’il y a dans la Baûriane un arbre noir de la grandeur
de l’olivier , avec la feuille du chêne, & la forme
& le fruit du figuier fauvage, appellé bdellium ,
& donnant une gomme tranfparente femblable à la
•cire odorante , graffe au toucher, amere au goût,
mais fans acreté : il ajoûte qu’il y avoit aufli de cette
gomme dans l ’Arabie, aux Indes, dans la Médie ,
&àBabylone..
Si l’hiftoire du bdellium eft très-obfcure dans les
anciens, ellen’eft pas plus claire dans les modernes :
il y en a qui le confondent avec la myrrhe, d’autres
avec la gomme animée ; il y en a même qui font lignifier
au mot bdellium , efcarboucle ou cryftal.
G. Bauhin en compte fix efpeces différentes. Dale
le décrit ou comme une fubftance gommeufe & ré-
fineufe, graffe, tenace, gluante , noirâtre, & ref-
femblant a la myrrhe, dont elle imite la couleur &
le goût, & il fait venir ce bdellium de l’Arabie , de
la Médie & des Indes : ou comme une fubftance réfi-
neufe , un peu dure, noirâtre , friable, en gouttes
durcies , de la même odeur & du même goût que la
précédente ; ôc il le fait venir de Ganea. Pomet prétend
qu’on a dans les boutiques fous le nom de bdel-
lium des réfines d’efpeces différentes : mais M. Geof-
froi dit que le bdellium des boutiques eft la même
chofe que la première efpece de D a le , & qu’il n’y a
rien de .certain fur l’arbre qui le porte.
B E
* BE ALT, ( Géog. ) petite ville d’Angleterre dans
la principauté de Galles, fur lariviere de Vye.
* BEAN, ( Gèog.fainte. ) ville de la tribu de Gad,
dont les habitans tourmentèrent cruellement les Juifs
dans le tems des guerres des Macédoniens. Elle fut
détruite par Judas Macchabée.
BEAT , ( S .) Géog. petite ville de France au
comte de Comminges, au confluent de la Garonne
& de la Pique : toutes les maifons y font bâties de
marbre. Long. 18. tG. lat. 42.60.
BEATIFICATION, f. f. ( Théol. ) a&epar lequel
le pape déclare qu’une perfonne , dont la yie a été
Tome ƒƒ.
famte, accompagnée de quelques miracles, &c. joiiit
a près fa mort du bonheur éternel. La béatification différé
dela canonifationen ce que dans la première le
pape n’agit pas comme juge, en déterminant l’état du
béatifié, mais feulement en ce qu’il accorde à certaines
perfonnes, comme à un ordre religieux, à une
communauté, &c. le privilège de rendre au béatifié
un culte particulier, qu’on ne peut regarder comme
fuperftitieux , dès qu’il eft muni du fceau de Tauto-
rité pontificale ; au lieu que dans la canonifation, le
pape parle comme juge, & détermine ex cathédral’é-
tat du nouveau faint.
La cérémonie de la béatification a été introduite
lorfqu’on a penfé qu’il étoit à propos de permettre à
un ordre ou une communauté de rendre un culte particulier
au fujet propofé pour être eanonifé , avant
que d’avoir une pleine connoiffance de la vérité des
faits, & à caufe de la longueur des procédures qu’on
obferve dans la canonifation. V . C a n o n i s a t i o n .
(G) ■
BEATITUDE . BONHEUR, F É L I C I T É ,
( Gramm.) termes relatifs à la condition d’un être qui
penfe & qui fent. Le bonheur marque un homme riche
des biens de la fortune ; la félicité, un homme content
de ce qu’il en a ; la béatitude, l’état d’une ame que la
préfence immédiate de fon Dieu remplit dans ce monde
ci ou dans Tautrejétat quiferoit au-deffus de toute
expreflion fans doute, fi nous le connoiflions. Le bonheur
excite l’envie ; la félicité fe fait fentir à nous feuls ;
la béatitude nous attend dans une autre vie. La joiiif-
fancedes biens fait la félicité ; leur poffeflion le bonheur
j la béatitude réveille une idée d’extàfe Ôc de ra-
viffement, qu’on n’éprouve ni dans le bonheur, ni dans
la félicité de ce monde. .C’eft aux autres à faire notre
bonheur ; notre félicité dépend davantage de nous ; il
n’y a que Dieu qui puiffe nous conduire à la béatitude.
Le bonheur efi pour les riches , dit M. l’abbé Girard
dans fes Synonymes ; la félicité pour les fages ; & la
béatitude pour les pauvres d'efprit.
* BEAU, adj. ( Métaphyfique.) Avant que d’entrer
dans la recherche difficile de l’origine du beau , je remarquerai
d’abord , avec tous les auteurs qui en ont
écrit, que par une forte de fatalité , les chofes dont
on parle le plus parmi les hommes, font affez ordinairement
celles qu’on connoît le moins ; ôc que telle eft
entre beaucoup d’autres, la nature du beau. Tout le
monde raifonne du beau : on l’admire dans les ouvrages
de la nature : on l’exige dans les produftions
des Arts : on accorde ou Ton refufe cette qualité à
tout moment ; cependant fi Ton demande aux hom*
mes du goût le plus fûr & le plus exquis, quelle eft
fon origine, fa nature, fa notion précité, fa véritable
idée, fon exaûe définition ; fi c’eft quelque chofe
d’abfolu ou de relatif ; s’il y a un beau effentiel , éternel
, immuable, réglé ôc modèle du beau fubalterne ;
ou s’il en eft de la beauté comme des modes : on voit
auflitôt les fentimens partagés ; & les uns avouent
leur ignorance, les autres fe jettent dans le fcepticif^
me. Comment fe fait-il que prefque tous les hommes
foient d’accord qu’il y a un beau ; qu’il y en ait tant en*
tr’eux qui le fentent vivement où il eft, & que fi peu
fâchent ce que c’eft ?
Pour parvenir, s’il eft poflïble, à la folution de ces
difficultés, nous commencerons par expofer les différens
fentimens des auteurs qui ont écrit le mieux fur
le beau ; nous propoferôns enfuite nos idées fur le
même fujet, ôc nous finirons cet article par des ob-
fervations générales fur l’entendement humain ôc fes
opérations relatives à la queftiondont il s’agit.
Platon a écrit deux dialogues du beau, le Phedre &
le grand Hippias : dans celui-ci il enl'eigne plûtôt ce
que le beau n’eft pas , que ce qu’il eft ; & dans l’autre
, il parle moins du beau que de l’amour naturel
I