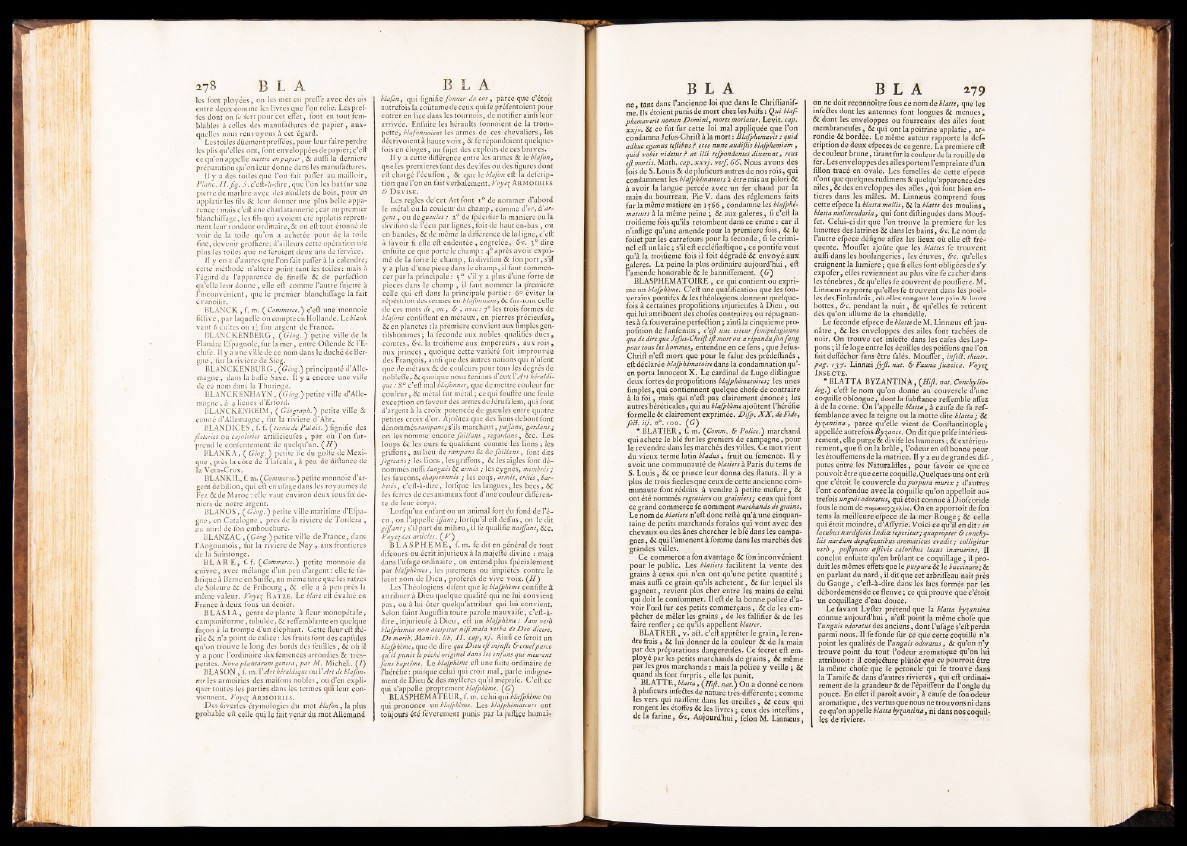
les font ployëes, on les met en prefie avec des aïs
entre deux comme les livres que l’on relie. Les prel-
fes dont on Te fert pour cet effet, font en tout fem-
blables à celles des manufactures de papier, auxquelles
nous renvoyons à cet égard.
Les toiles dûementpreffées, pour leur faire perdre
les plis qu’elles ont, font enveloppées de papier; c’eft
ce qu’on appelle mettre en papier, & aufli la derniere
préparation qu’on leur donne dans les manufactures.
Il y a des toiles que l’on fait paffer au mailloir,
Plane. Il.fig. i . c’eft-à-dire, que l’on les bat fur une
pierre de marbre avec des maillets de bois, pour en
applatir les fils 8c leur donner une plus belle apparence
: mais c’eft une charlatannerie ; car au premier
blanchiffage, les fils qui avoient été applatis reprennent
leur rondeur ordinaire, & on eft tout étonné de
voir de la toile qu’on a achetée pour de la toile
fine, devenir grofliere; d’ailleurs cette opération ufe
plus les toiles que ne feroient deux ans de fer vice.
Jl y en a d’autres que l’on fait paffer à la calendre;
cette méthode n’altere point tant les toiles : mais à
l’égard de l’apparence de fineffe 8c de perfection
qu’elle leur donne , elle eft comme l’autre fujette à
l’inconvénient, que le premier blanchiffage la fait
évanoiiir.
BLANCK, f. m. ( Commerce.') c’eft une monnoie
fictive, par laquelle on compte en Hollande. Le blank
vaut 6 Cluites ou i~ fou argent de France.
BLANCKENBERG, ( Géog. ) petite ville de la
Flandre Efpagnole,fur la mer, entre Oftende & l’E-
clufe. Il y a une ville de ce nom dans le duché de Ber-
gue , fur la riviere de Sieg.
BLANCKENBURG, (Géog.) principauté d’Allemagne
, dans la baffe Saxe. Il y a encore une ville
de ce nom dans la Thuringe.
BLANCKENHAYN, (Géog.) petite ville d’Allemagne
, à 4 lieues d’Erfbrd.
BLANCKENHEIM, (Géograph.) petite ville &
comté d’Allemagne , fur la riviere d’Ahr.
BLANDICES, f. f. ( terme de Palais. ) lignifie des
flateries ou cajoleries artificieufes , par oii l’on fur-
prend le confentement de quelqu’un. (H )
BLANKA, ( Géog. ) petite île du golfe de Mexique
, près la côte de Tlafcala, à peu de diftance de
la Vera-Crux.
BLANKIL, f. m. (Commerce.) petite monnoie d’argent
de billon, qui eft en ufage dans les royaumes de
Fez 8c de Maroc : elle vaut environ deux lous fix deniers
de notre argent.
BLANOS, ( Géog. ) petite ville maritime d’Efpa-
gne, en Catalogne , près de la riviere de Tordera ,
au nord de fon embouchure.
BLANZAC, (Géog.) petite ville de France, dans
l’Angoumois, fur la riviere de Nay , aux frontières
de la Saintonge.
B L A R E , f. f. ( Commerce. ) petite monnoie de
cuivre, avec mélange d’un peu d’argent : elle le fabrique
à Berne en Suiffe, au même titre que les ratzes
de Soleure 8c de Fribourg , 8c elle a à peu près la
même valeur. Voyes^ R a t z e . Le blare eft évalué en
France à deux fous un denier.
BLAS I A , genre de plante à fleur monopétale,
campaniforme, tubulée, & reffemblante en quelque
façon à la trompe d’un éléphant. Cette fleur eft fté-
j-ile 8c n’a point de calice : les fruits font des capfules
qu’on trouve le long des bords des feuilles, 8c oii il
y a pour l ’ordinaire dix femences arrondies & très-
petites. Nova plant arum généra, par M. Micheli. (I)
BLASON , f. m. Y Art héraldique o u Y Art de blafon-
n e r le s arm o ir ie s des ma ifon s n o b le s , o u d’en e x p liq
u e r to u te s le s p a r tie s dans les termes q u i leu r co n v
ien n en t . Poye^ A r m o i r i e s .
Des diverfes étymologies du mot blafon, la plus
probable eft celle qui le Fait venir du mot Allemand
blafen, qui lignifie fonder du cor, parce que c’étoit
autrefois la coutume de ceux qui fe préfentoient pour
entrer en lice dans les tournois, de notifier ainfi leur
arrivée. Enfuite les héraults fonnoient de la trom-
pette, blafonnoient les armes de ces chevaliers, les
décrivoient à haute voix, & fe répandoient quelquefois
en éloges, au fujet des exploits de ces braves.
Il y a cette différence entre les armes & le blafon,
que les premières font des de vifes ou des figures dont
eft chargé l’écuffon , & que le blafon eft la deferip-
tion que l’on en fait verbalement. Voye£ A r m o i r i e s
& D e v i s e .
Les réglés de’cet Art font i ° de nommer d’abord
le métal ou la couleur du champ, comme d’or, à.'argent
, ou de gueules : z° de fpécifier la maniéré ou la
divifion de l’écu par lignes, foit de haut en-bas , ou
en bandes, 8c de même la différence de la ligne, c’eft
à favoir fi elle eft endentée , engrelée, &c. 30 dire
enfuite ce que porte le champ : 40 après avoir exprimé
de la forte le champ, fa divifion & fon port, s’il
y a plus d’une piece dans le champ, il faut commencer
par la principale : 50 s’il y a plus d’une forte de
pièces dans le champ , il faut nommer la première
celle qui eft dans la principale partie : 6° éviter la
répétition des termes en blafonnant, 8c fur-tout celle
de ces mots de, ou, & , avec : 70 les trois formes de
blafons confiftent en métaux, en pierres précieufes,
& en planètes :1a première convient aux fimples gentilshommes;
la fécondé aux nobles qualifiés ducs,
comtes, &c. la troifieme aux empereurs , aux rois ,
aux princes , quoique cette variété foit improuvée
des François, ainfi que des autres nations qui n’ufent
que de métaux 8c de couleurs pour tous les degrés de
nobleffe, 8c quoique nous tenions d’eux Y Art héraldique
: 8° c’eft mal blafonner, que de mettre couleur fur.
couleur, 8c métal fur métal ; ce qui fouffre une feule
exception en faveur des armes de Jérufalem, qui font
d’argent à la croix potencée de gueules entre quatre
petites croix d’or. Ajoutez que des lions debout font
dénommés rampans;'.s’ils marchent, paffans, gardans;
on les nomme encore faillans, regardans, 8tc. Les
loups &c les ours fe qualifient comme les lions ; les
griffons, au lieu de rampans 8c de faillans, font dits
J'egreans; les lions, les griffons, 8c les aigles font dénommés
aufli langués 8c armés ; les cygnes, membres ;
les faucons, chaperonnés ; les coqs, armés, crêtés, barbelés,
c’eft-à-dire, lorfque les langues, les becs, 8c
les ferres de ces animaux font d’une couleur différente
de leur corps.
Lorfqu’un enfant ou un animal fort du fond de l’écu
, on l’appelle iffant; lorfqu’il eft deffus, on le dit
gifjant; s’il part du milieu, il fe qualifie naiffant, 8cc.
Voye^ ces articles. ( V )
B L A S PH EM E , f. m. fe dit en général de tout
difeours ou écrit injurieux à la majefté divine : mais
dans l’ufage ordinaire, on entend plus fpécialement
par blafphïmes, les juremens ou impiétés contre le
faint nom de Dieu, proférés de vive voix. (H)
Les Théologiens difent que le blafphïme confifte à
attribuer à Dieu quelque qualité qui ne lui convient
pas, ou à lui ôter quelqu’attribut qui lui convient.
Selon faint Auguftin toute parole mauvaife, c’eft-à-
dire, injurieufe à D ieu, eft un blàfph'èmt : Jam ver à
blafphemia non accipitur ni(i mala verba de JDeo dicere.
De morib. Munich, lib. II. cap, xj. Ainfi ce feroit un
blafphïme, que de dire que Dieu ejl injure & cruelparce
qu'il punit le péché originel dans les enjans qui meurent
fans baptême. Le blajphïme eft une fuite ordinaire de
l’héréfie: puifque celui qui croit mal, parle indignement
de Dieu 8c des mÿfteres qu’il méprife. C ’eft ce
qui s’appelle proprement blafphïme. (G)
BLASPHÉMATEUR, f. m. celui qui blafphïme ou
qui prononce un blafphïme. Les blajphèmateurs ont
toujours été féverement punis par la juftice humaine
tant dans l’ancienne loi que dans le Chriftianif-
me. Ils étoient punis de mort chez les Juifs : Qui blaf-
phtmaverit nomen Domini, morte moriatur, Levit. cap.
xxjv. 8c ce fut fur cette loi mal appliquée que l’on
condamna Jefus-Chrift à la mort : Blafphemavit : quid
adhuc egemus teftibus? ecce nunc audifiis blafphemiam ,
quid vobis videtur ? at illi refpondenteS dixerunt, reus
eß mortis. Math. cap. xxvj. verf 66. Nous avons des
lois de S. Louis 8t de plufieurs autres de nos rois, qui
condamnent les blafphémateurs à être mis au pilori 8c
à avoir la langue percée avec un fer chaud par la
main du bourreau, Pie V. dans des réglemens faits
fur la même matière en 1566, condamne les blafphé-
mateurs à la même peine ; 8c aux galères, fi c’eft la
troifieme fois qu’ils retombent dans ce crime : car il
n’inflige qu’une amende pour la première fois, 8c le
fouet par les carrefours pour la féconde, fi le criminel
eft un laïc ; s’il eft eccléfiaftique, ce pontife veut
qu’à la troifieme fois il foit dégradé 8c envoyé aux
galères. La peine la plus ordinaire aujourd’hui, eft
l’amende honorable 8c le banniffement. (G)
BLASPHEMATOIRE , ce quijcontient ou exprime
un blafphïme. C ’eft une qualification que les fou-
yerains pontifes & les théologiens donnent quelquefois
à certaines propôfitions injurieufes à Dieu, ou
qui lui attribuent des chofes contraires ou répugnantes
à fa fou veraineperfe&ion ; ainfi la cinquième pro-
pofition de Janfenius, c'eß une erreur femipelagienne
que de dire que J.eßis-Chriß eß mort ou a répandu fon fang
pour tous Us hommes y entendue en ce fens, que Jefus-
Chrift n’eft mort que pour le falut des predeftirtés,
eft déclarée blafphématoire dans la condamnation qu’en
porta Innocent X . Le cardinal de Lugo diftingue
deux fortes de propofitions blajphématoires; les unes
fimples, qui contiennent quelque chofe de contraire
à la fo i, mais qui. n’eft pas clairement énoncé ; les
autres héréticales, qui au blafphïme ajoutent l’héréfie
formelle 8c clairement exprimée. Difp. X X . deFidey
fect. iij. n°. 100. (G)
. * BLATIER, f.,m. (Comm. & Police.) marchand
qui acheté le blé fur les greniers de campagne, pour
le revendre dans les marchés des villes. C e mot vient
du vieux terme latin bladus, fruit o.u femence. Il y
avoit une communauté de blatiers à Paris du tems de
S. Louis, 8c ce prince leur donna des ftatuts. Il y a
plus de trois fiecles que ceux de cette ancienne communauté
font réduits à vendre à petite mefure, 8c
ont été nommés regratiers ou grainiers; ceux qui font
ce grand commerce fe nomment marchands de grains.
Le nom de blatiers n’eft donc refté, qu’à une cinquantaine
de petits marchands forains qui vont avec des.
chevaux ou des ânes chercher le blé dans les campagnes
, 8c qui l’amenent à fomme dans les marchés des
grandes villes.
Ce commerce a fon avantage 8c fon inconvénient
pour le public. Les blatiers facilitent la vente des
grains à ceux qui n’en ont qu’une petite quantité ;
mais aufli ce grain qu’ils achètent, 8c fur lequel ils
gagnent, revient plus cher entre les mains de celui
qui doit le confommer. Il eft de la bonne, police d’avoir
l’oeil fur ces petits commerçans, 8c de les empêcher
de mêler les grains , de les falfifier & de les
faire renfler ; ce qu’ils appellent blatrer.
BLATRER, v. aft. c’eft apprêter le grain, le rendre
frais, 8c lui donner de la couleur & de la main
par des préparations dangereufes. Ce fecret eft employé
par les petits marchands de grains, 8c même
par les gros marchands : mais la police y veille ; 8c
quand ils font furpris, elle les punit.
BLATTE, blatta, (Hiß. nat.) On a donné ce nom
à plufieurs infeâes de nature très-différente ; comme
les vers qui naiffent dans les oreilles , 8c ceux qui
rongent les étoffés 8c les livres ; ceux des inteftins,
de la farine,. &c. Aujourd’hui, félon M. Linnseus,
on ne doit reconnoître fous ce nom de blatte, que les
infeâes dont les antennes font longues 8c menues ;
8c dont les enveloppes ou fourreaux des aîles font
membraneufes, 8c qui ont la poitrine applatie, arrondie
8c bordée. Le même auteur rapporte la def-
cription de deux efpeces de ce genre. La première eft
de couleur brune, tirant fur la couleur de la rouille de
fer. Les enveloppes des aîles portent l’empreinte d’un
fillon tracé en ovale. Les femelles de cette efpece
n’ont que quelques rudimens 8t quelqu’apparence des
aîles, 8c des enveloppes des aîles, qui font bien entières
dans les mâles. M. Linnæus comprend fous
cette efpece la blatta mollis, 8c la blatte des moulins ,
blatta molinendaria , qui font diftinguées dans Mouf-
fet. Celui-ci dit que l’on trouve la première fur les
lunettes des latrines 8c dans les bains, &c. Le nom de
l’autre efpece défigne affez les lieux où elle eft fréquente.
Mouflet ajoute que les blattes fe trouvent
aufli dans les boulangeries, les étuves , &c. qu’elles
craignent la lumière ; que fi elles font^bligées-dè s’y
expofer, elles reviennent au plus vite fe cacher dans
les ténèbres, 8c qu’elles fe couvrent de pouflîere. M .
Linnæus rapporte qu’elles fé trouvent darts les poël-
les des Finlandois, où elles rongent leur pain & leurs
bottes, &c. pendant la nuit, 8c qu’elles fe retirent
dès qu’on allume de la chandelle.
Le fécondé efpece de blatte de M. Linnæus eft jaunâtre
, 8c les enveloppes des ailes font tachées dé
noir. On trouve cet infette dans les cafés dès Lap-
pons ; il fe loge entre les écailles des poiffons que l’on
faitdeffécher fans être falés. Mouflet, infect, theatr.
pag. ig y. Linnæi fyfi.nat. & Fauna fuacica. Voyeç
lNSECT£.
* BLATTA BYZANTINA, (Hijt. nat. Conchylio-
log-) c’eft le nom qu’on donne au couvercle d’une
coquille oblongue, dont la fubftance reffemble affez
à de la corne. On l’appelle blatta , à caufe de fa ref-
femblance avec là teigne ou la motte dite blatta; 8c
by^antina , parce qu’elle vient de ConftantinOpIë \
appellée autrefois Byzance. On dit que prife intérieurement
, elle pürge & divife les humeurs ; 8c extérieurement
, que fi on la brûle, l’odeur en eft bonne pour
les étoüffemens de la matrice. Il y a eu de grandes difi \
putes entre.les Naturàliftes, pour favoir eé.quë cé
pouvoit être que cette coquille.Quelques-uns ont Crû
que c’étoit le couvercle du purpura murex ; d’autres
l’ont confondue avec la coquille qu’on appelloit autrefois
unguis odoratus, qui etoit connue à Diofcoride
fous le nom de TrajjMiioyxoxioç. On en apportent de foii
tems la meilleure efpece de la mer Roüge ; 8c- celle
qui étoit moindre, d’Affyrie. Voici ce qu’il én dit : in
lacubus hardiferis Indice reperituf; quapropter & conchy-
liis nardum depafçentibus aromaticus evadit; côlligitur
verb , poftquam eejtivis caloribus lacus inaruerïni. Il
conclut enfuite qu’en brûlant ce coquillage, il produit
les mêmes effets que le purpura 8c le buccinum; 8c
en parlant du nard, il dit que cet arbriffeau naît prèis
du G ange, c’eft-à-dire dans les lacs formés par les
débordemens de ce fleuve ; ce qui prouve que c’étoit
un coquillage d’eau douce.
Le lâvânt Lyfter prétend que la blatta byçantina
connue aujourd’hui, n’eft point la même ehofe que
Yunguis odoratus des anciens, dont l’ufàge s’eft perdu
j parmi nous. il fe fonde fur ce que cette coquille n’a
point les qualités de Yunguis odoratus, & qu’on n’y
trouve point du tout l’odeur aromatique qu’on lui
attribuoit : il conjecture plutôt que ce pourroit être
la même chofe que le pétoncle qui fe trouve dans
la Tamife 8c dans d’autres rivières, qui eft ordinairement
de la grandeur 8c de l’épaiffeur de l’ongle du
pouce. En effet il paroît avoir, à caufe de fon odeur
aromatique, des vertus que nous ne trouvonis ni dans
ce qu’on appelle blatta fyçantina, ni dans nos coquilles
de riviere.