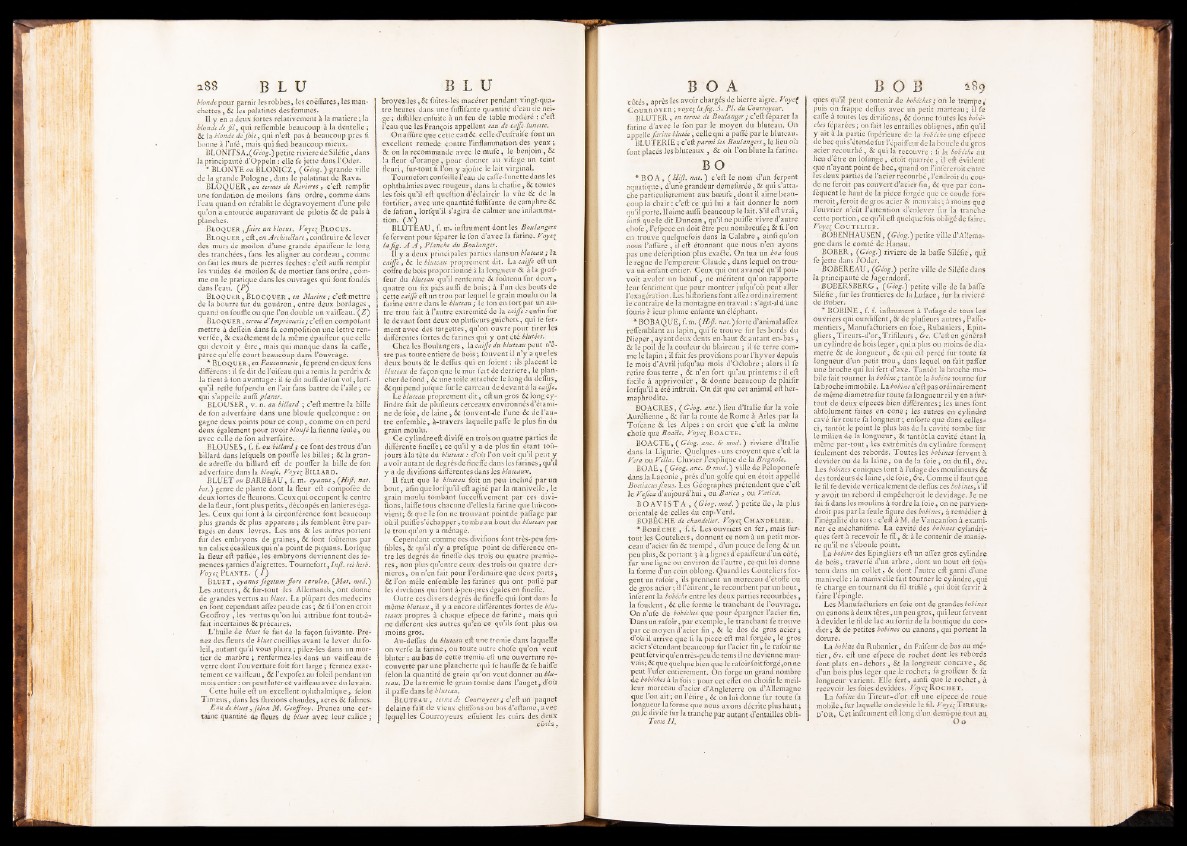
blonde pour garnir les robbes, les coëffures, les manchettes
, 6c les palatines des femmes.
Il y en a deux fortes relativement à la matière ; la
blonde de f l , qui reffemble beaucoup à la dentelle ;
& la blonde de foie, qui n’eft pas à beaucoup près fi
bonne à l’u fé, mais qui fied beaucoup mieux.
BLONlTSA^Geog.) petite riviere de Siléfie, dans
la principauté d’Oppeln : elle fe jette dans l’Oder.
* BLONYE ou BLONICZ, ( Géog. ) grande ville
de la grande Pologne, dans le palatinat de Rava.
BLOQUER, en termes de Rivières, c’eft remplir
une fondation de moilons fans ordre * comme dans
Peau quand on rétablit le dégravoyement d’une pile
qu’on a entourée auparavant de pilotis 6 c de pals à
planches.
B l o q u e r ,.faire un blocus. Voyei B l o c u s .
B l o q u e r , eft, en Architecture, conftruire 6 c lever
des murs de moilon d’une grande épaifleur le long
des tranchées, fans les aligner au cordeau , comme
on fait les murs de pierres feches : c’eft aufli remplir
les vuides de moilon 6 c de mortier fans ordre, comme
on le pratique dans les ouvrages qui font fondés
dans Peau. (P)
B l o q u e r , B l o c q u e r , en Marine ; c’eft mettre
de la bourre fur du goudron, entre deux bordages ,
quand on fouffle ou que l’on double un vaiffeau. (Z )
B l o q u e r , terme d’Imprimerie; c’eft en compolant
mettre à deffein dans fa compofition une lettre ren-
verfée, & exactement delà même épaifleur que celle
qui devoit y être, mais qui manque dans la caffe,
parce qu’elle court beaucoup dans l’ouvrage.
* B l o q u e r , en Fauconnerie, fe prend en deux fens
différens : il fe dit de Poifeau qui a remis la perdrix &
la tient à ion avantage : il le dit aufli de fon vol, Iorf-
qu’il relie fufpendu en Pair fans battre de Paîle ; ce
qui s’appelle aufli planer.
BLOUSER, v. n. au billard ; c’eft mettre la bille
de Ion adverfaire dans une bloufe quelconque : on
gagne deux points pour ce coup, comme on en perd
deux également pour avoir bloufé la fienne feule, ou
avec celle de fon adverfaire.
BLOUSES, f. f . o u billard ; c e fo n t des t ro u s d ’un
b illa rd dan s le fq u e ls o n p o u ffe le s b ille s ; & la g r an d
e a d re ffe d u b illa rd e ft de p o u ffe r la b ille d e fo n
a d v e r fa ir e dan s la bloufe. Voyeç B i l l a r d .
BLUET ou BARBEAU, f. m. cyanus, (Hijî. nat.
bot.) genre de plante dont la fleur eft compofée de
deux fortes de fleurons. Ceux qui occupent le centre
de la fleur, font plus petits, découpés en lanières égales.
Ceux qui font à la circonférence font beaucoup
plus grands & plus apparens ; ils femblent être partagés
en deux levres. Les uns & les autres portent
fur des embryons de graines, 6c font foûtenus par
un calice écailleux qui n’a point de piquans. Lorfque
la fleur eft paflée, les embryons deviennent des fe-
mences garnies d’aigrettes. Tournefort, Injl. rei herb.
V o y t^ P l a n t e . ( / )
B l u e t , cyanus fegetum flore coeruleo. (Mat. med.)
Les auteurs, 6c fur-tout les Allemands., ont donné
de grandes vertus au bluet. La plûpart des médecins
en font cependant affez peu de cas ; 6c fi l ’on en croit
Geoffroy , les vertus qu’on lui attribue font tout-à-
fait incertaines 6c précaires.
L’huile de bluet fe fait de la façon fuivante. Prenez
des fleurs de bluet cueillies avant le lever du fo-
leil, autant qu’il vous plaira ; pilez-les dans un mortier
de marbre ; renfermez-les dans un vaiffeau de
verre dont l’ouverture foit fort large ; fermez exactement
ce vaiffeau, & l’expofez au foleil pendant un
mois entier : on peutluterce vaiffeau avec du levain.
Cette huile eft un excellent ophthalmique, félon
Timaeus, dans les fluxions chaudes, acres & falines.
Eau de bluet, félon M. Geoffroy. Prenez une certaine
quantité de fleurs de bluet avec leur calice ;
broyez-les, 6c faites-les macérer pendant vingt-quatre
heures dans une fuflifante quantité d’eau de neige
; diftillez enfuite à un feu de fable modéré : c’eft
l’eau que les François appellent eau de caffe-lunette.
Onaffûreque cette eau& celle d’eufraife font un
excellent remede contre l’inflammation des yeux ;
& on la recommande avec le mufe, le benjoin, 6c
•la fleur d’orange, pour donner au vifage un teint
fleuri, fur-tout fi l’on y ajoûte le lait virginal.
Tournefort confeille l’eau de cafle-lunette dans les
ophthalmies avec rougeur, dans la chaflie, 6c toutes
-les fois qu’il eft queftion d’éclaircir la vue & de la
fortifier, avec une quantité fuflifante de camphre 6c
de fafran, lorfqu’il s’agira de calmer une inflammation.
(AQ
BLUTEAU, f. m. infiniment dont les Boulangers
fe fervent pour féparer le fon d’avec la farine. Voye\
la fig. A A y Planche du Boulanger.
Il y a deux principales parties dans un bluteau ; la
caiffe y 6c le bluteau proprement dit. La caiffe eft un
coffre de bois proportionné à la longueur & à la grof-
feur du bluteau qu’il renferme & foûtenulur deux,
quatre ou fix piés aufli de bois; à l’un des bouts de
cette caiffe eft un trou par lequel le grain moulu ou la
farine entre dans le bluteau ; le fon en fort par un autre
trou fait à l’autre extrémité de la caiffe : enfin fur
le devant font deux ou plufieurs guichets, qui fe ferment
avec des targettes, qu’on ouvre pour tirer les
différentes fortes de farines qui y ont été blutées.
Chez les Boulangers , la caiffe du bluteau peut n’ê-
tre pas toute entière de bois ; fouvent il n’y a que lés
deux bouts 6c le deffus qui en foient : ils placent le
bluteau de façon que le mur fert de derrière, le plancher
de fond, 6c une toile attachée le long du deffus,
6c qui pend jufque furie carreau de devant à la caiffe.
Le bluteau proprement dit, eft un gros 6c long cylindre
fait de plufieurs cerceaux environnés d’étamine
de foie, de laine, 6c fouvent-de l’une 6c de l ’autre
enfemble, à-travers laquelle paffe le plus fin du
grain moulu.
Ce cylindre eft divifé en trois ou quatre parties de
différente fineffe ; ce qu’il y a de plus fin étant toujours
à la tête du bluteau : d’oii l’on voit qu’il peut y
a voir autant de degrés de fineffe dans les farines, qu’il
y a de divifions différentes dans les bluteaux.
Il faut que le bluteau foit un peu incliné par un
bout, afin que lorfqu’il eft agité par la manivelle, le
grain moulu tombant fucceflivement par ces divifions
, laiffe lous chacune d’elles la farine que lui*con-
vient; & que le fon ne trouvant point de paffage par
où il puiffe s’échapper, tombe au bout du bluteau par
le trou qu’on y a ménagé.
Cependant comme ces divifions font très-peu fen-
fibles, & qu’il n’y a prefque point de différence entre
les degrés de fineffe de$ trois ou quatre premières,
non plus qu’entre ceux des trois ou quatre dernières,
on n’en fait pour l’ordinaire que deux parts,
6c l’on mêle enfemble les farines qui ont paflë par
les divifions qui font à-peu-près égales en fineffe.
Outre ces divers degrés de fineffe qui font dans le
même bluteau, il y a encore différentes fortes de bluteaux
propres à chaque efpece de farine, mais qui
ne different des autres qu’en ce qu’ils font plus ou
moins gros.
Au-deffus du bluteau eft une tremie dans laquelle
on verfe la farine, ou toute autre chofe qu’on veut
bluter : au bas de cette rremie-eft une ouverture recouverte
par une planchette qui fe hauffe 6c fe baiffe
félon la quantité de grain qu’on veut donner au bluteau.
De la tremie le grain tombe dans l’auget, d’où
il paffe dans le bluteau.
B l u t e a u , terme de Courroyeur} c’eft un paquet
delaine fait de vieux chiffons ou bas d’eftame, avec
lequel les Courroyeurs efîuient les cuirs des deux
côtés,
1T
B O A
côtés, après les avoir chargés de bierre aïgrë. Voye^
CoURROYER ; voye{ la fig. 5. PL du Courroyeür.
BLUTER , en terme de Boulanger ; c’eft féparer là
farine d’avec le fon par le moyen du bluteau. Oh
appelle farine blutée, celle qui a paffé par le bluteau.
BLUTERIE ; c’eft parmi les Boulangers, le lieu où
font placés les bluteaux , 6c où l’on blute la farine*
B O
* B O A , (Hift. nat. ) c ’eft le nom d’un ferpent
aquatique-, d’une grandeur demefurée, & qui s’attache
particulièrement aux boeüfs, dont il aime beaucoup
la chair : c’eft ce qui lui a fait donner le nom
qu’il porte. Il aime aufli beaucoup le lait. S’il eft vrai,
ainfi que le dit Duncan, qu’il ne puiffe vivre d’autre
chofe, l’efpece en doit être peu riombreufe ; & fi l’on
en trouve quelquefois dans la Calabre , ainfi qu’on
nous l’affûre * il eft étonnant que nous n’eri ayons
pas une defeription plus exaCte. On tua un boa fous
le régné de l’empereur Claude, dans lequel on trouva
un enfant entier. Ceux qui ont avancé qu’il pou-
voit avaler un boeuf, rie méritent qu’on rapporte
leur feritimerit que pour montrer jufqu’où peut aller
l’exagération. Les hiftoriens font affez ordinairement
le contraire de la montagne en travail : s’agit-il d’une
fouris ? leur plume enfante un éléphant*
* BOB A QUE, f. m. (fïifl. nat.) forte d’animal affez
reffemblaht au lapin, qui fe trouve fur les bords du
Nieper, ayant deux dents en-haut 6c autant en-bas,
& le poil de la couleur du blaireau ; il fe terre comme
le lapin ; il fait fes provifions pour l’hy ver depuis
le mois d’Avril jufqu’au mois d’OCtobre ; alors il fe
retire fous terre , 6c n’en fort qu’au printems : il eft
facile à apprivoifer , & donne beaucoup de plaifir
lorfqu’il a été inftruit. On dit que Cet animal eft hermaphrodite.
BOACRËS, (Jrèog. anc.) lieu d’Italie fur la voie
Aurélienne, 6c iur la route de Rome à Arles par la
Tofcane & les Alpes : on croit que c’eft la même
chofe que Boacte. Voye^ B o a c t e .
BOACTE, ( Géog. anc. & mod.) riviere d’Italie
dans la Ligurie. Quelques-uns croyent que c’eft la
Ver a ou Vella. Cluvier l’explique de la Brignole.
BOAE, ( Géog. anc. & mod. ) ville de Peloponefe
dans la Laconie, près d’un golfe qui en étoit appellé
BdetiacusJinus. Les Géographes prétendent que c’eft
le Vajica d’aujourd’hui, ou Batica , ou Vttica.
B O A V I S T A , ( Géog. mod. ) petite île, la plus
orientale de celles du cap-Verd.
BOBÈCHE de chandelier. Voye%_ C h a n d e l i e r .
* B o b è c h e , f. f. Les ouvriers en fer, mais fur-
tout les Couteliers, donnent ce nom à un petit morceau
d’acier fin 6c trempé, d’un pouce de long 6c un
peu plus, 6c portant 3 à 4 lignes d’épaiffeur d’un côté,
fur une ligne ou environ de l’autre, ce qui lui donne
la forme d’un coin oblong. Quand les Couteliers forgent
un rafoir, ils prennent un morceau d’étoffe ou
de gros acier ; il l’étirent, le recourbent par un bout,
infèrent la bobèche entre les deux parties recourbées,
la foudent, 6c elle forme le tranchant de l’ouvrage*
On n’ufe de bobèches que pour épargner l’acier fin.
Dans un rafoir, par exemple, le tranchant fe trouve
par ce moyen d’acier fin , & le dos de gros acier ;
d’où il arrive que fi la piece eft mal forgée, le gros
acier s’étendant beaucoup fur l’acier fin, le rafoir ne
peut fervir qu’en très-peu de tems il ne devienne maiu
vais; & que quelque bien que le rafoir foit forgé*on ne
peut l’ufer entièrement. On forge un grand nombre
de bobèches à la fois : pour cet effet on choifit le meilleur
morceau d’acier d’Angleterre ou d’Allemagne
que l’on ait ; on l’étire, 6c on lui donne fur toute fa
longueur la forme que nous avons décrite plus haut ;
on le divife fur la tranche par autant d’entailles obli-
Tome II,
B O B 4S9
qiies qu’il peut contenir de bàbéches,* ôri le trempe*
puis on frappe deffus avec un petit martèau ; il fé
caffe à toutes les divifions-, & donne toutes les bobè-t
ches feparées ; on fait les entailles obliques, afin qu’il
y ait à la partie fnpérieure de la bobèche une efpécë
de bec qui s’étende fur l’épaiffeur de la boucle du gros
acier recolirbé, & qui la recouvre : fi là bobèche au
lieu d’être en lofarigé * étoit quarrée , il eft évident
que ri’ayant point de bec, quand on l’infereroit entré
les deux parties de l’acier recourbé, l’endroit dii coude
ne feroit pas couvert d’acier fin, 6c que par con-
féqueht le haut de la pièce forgée que ce coude for-
meroit, feroit de gros acier & mauvais ; à moins que
l’ouvrier n’eut l’attention d’enlever fur la tranche
cette portion * ce qu’il eft quelquefois obligé de faire*.
Voye£ C o u t e l i e r .
BOBENHAUSEN, (Géog.) petite ville d’AUemai
gne dans le comté de Hanau.
BOBER, ( Géog.) riviere de la baffe Siléfie, qur
fe jette dans l’Oder.
BOBEREAU, (Géog.) petite ville de Siléfie dans
la principauté de Jagerndorff.
BOBERSBERG, (Géog.) petite ville de la baffe
Siléfie, fur les frontières de la Lufaee* fur la riviere
de Bober*
* BOBINE , f. f. infiniment à l’ufage de tous les?
ouvriers qui ourdiffent, & de plufieurs autres, Paffe-
mentiers, Manufacturiers en foie, Rubaniers, Epin-
gliers,Tireurs-d’o r,Trifileurs, &c. C’eft en général
un cylindre de bois leger, qui a plus ou moins de diamètre
6c de longueur, 6c qui eft percé fur toute fit
longueur d’un petit trou, dans lequel ori fait paffer
une broche qui lui fert d’axe. Tantôt la broche mobile
fait tourner la bobine; tantôt la bobine tourne fur
la broche immobile. La bobine n’eft pas ordinairement
de même diamètre fur toute fa longueur : il y en a fur-
tout de deux efpeces bien différentes ; les. Unes font
abfolument faites en cône ; les autres en cylindre
cavé fur toute fa longueur ; enforte que dans celles-
ci , tantôt le point le plus bas de la cavité tombe fur
le milieu de la longueur, & tantôt la cavité étant la
même par-tout * les extrémités du cylindre forment
feulement des rebords. Toutes les bobines fervent à.
devider ou de la laine, ou de la foie, Ou du fil, &c±
Les bobines coniques font à l’ufage des moulineurs 6c
des tordeurs de laine, de foie, &c. Comme il faut que
le fil fe dévidé verticalement de deffus ces bobines, s’il
y a voit un rebord il empêcheroit le devidage. Je ne
fai fi dans les moulins à tordre la foie, on ne parvien-
droit pas par la feule figure des bobines, à remédier à
l’inégalité du tors : c’eft à M. de Vaucanfon à examiner
ce méchanifme. La cavité des bobines cylindri*
ques fert à recevoir le fil, & à le contenir de maniéré
qii’il ne s’éboule point.
La bobine des Epingliers eft Un affez gros cylindre
de bois, traverfé d’un arbre, dont un bout eft foui
tenu dans un collet, & dont l’autre eft garni d’une
manivelle : la manivelle fait tourner le cylindre, qui
fe charge en tournant du fil trifilé , qui doit fervir à
faire l’epingle*
Les Manufacturiers en foie ont de grandes bobines
ou canons à deux têtes, un peu gros, qui leur fervent
à devider le fil de lac au fortir de la boutique du cor-
dier ; & de petites bobines ou canons* qui portent la
dorure.
La bobine du Rubanier, du Faifeur de bas au métier,
&c. eft une efpece de rochet dont les rebords
font plats en-dehors, 6c la longueur concave, 6c
d’un bois plus leger que le rochet ; fa groffeur & fa
longueur varient. Elle fert, ainfi que le rochet, à
recevoir les foies dévidées. Voye^R o c h e t .
La bobine du Tireur- d’or eft une efpece de roue
mobile, fur laquelle on dévidé le fil. Voyè[ T i r e u r *
d ’o r . Cet infiniment eft long d’un demi-pié tout au.
O o