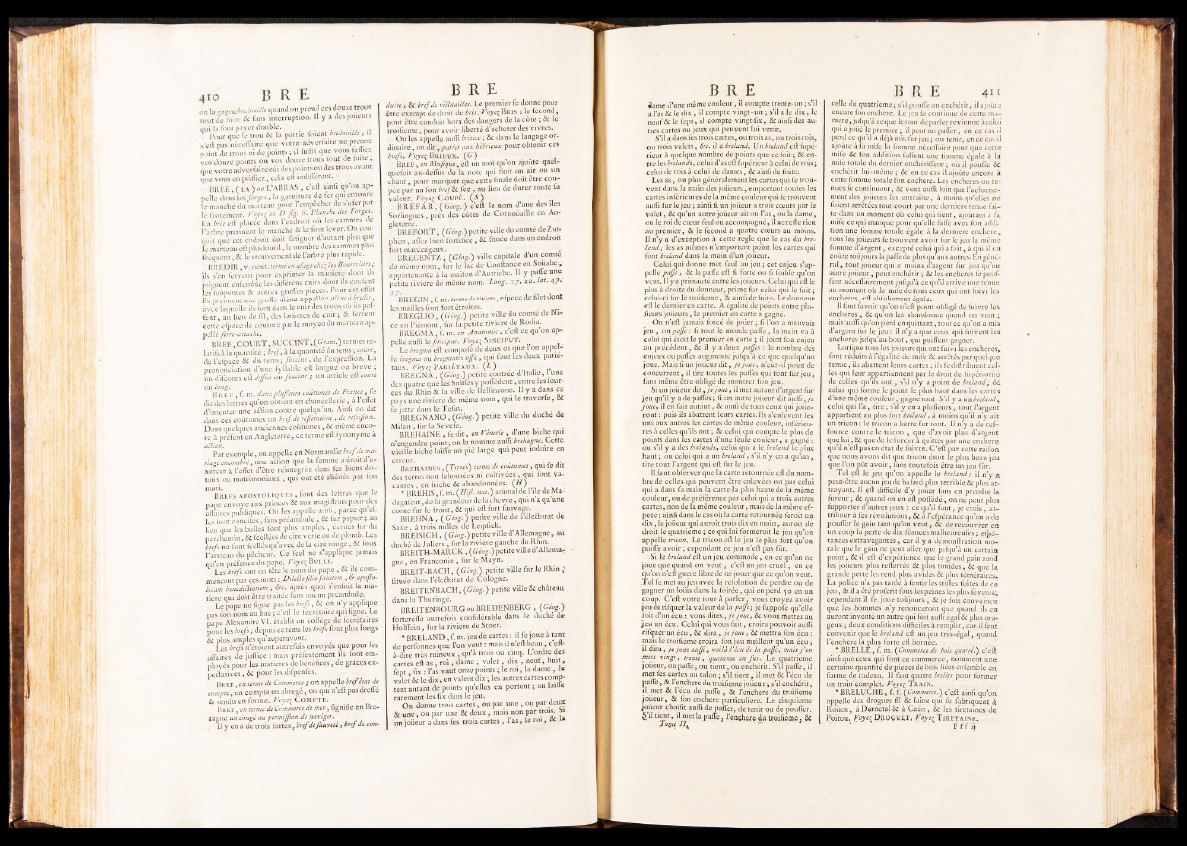
on la «apnebredouille quand on prend ces douze trous
tout de luire 6c fans interruption. Il y a des joiieurs
qui la font payer double. -
l Pour que le trou & la parue {oient tndamlle, il
n’eft pas néceflaire que votre .aclverfaire ne prenne
point de trous ni de points ; il fuHit fîue TOUS M ie z
Vos douze points ou vos douze trous tout de nute,
que votre adverfaire eftt despoints ou des trousavant
que vous en priffiez, cela eft indifférent...
a BiiÉE ( l'a Y o k L ’A B R A S , c’eft iûnfrqn’on appelle
dans les forges, la .garniture de fer qui entoure
le manche du marteau pour l'empêcher de s ulerpar
le frotement. ® » D fig■ S. Planche des Forges
La trie ell placée dans l'endroit ou les cantines de
l’arbre prennent le manche & te font lever. On conçoit
que cet endroit doit W d’autant rilus que
le marteau eftpluslourd, le nombre desdamnies pins
Frequent, & le mouvement de l’arbre plus rapide.
' BREDIR, v. ncut. termeenufiage chc-lesBourreliers;
ils s’en fervent pouf exprimer In manière: dont ils
joignent enfefflble lesdifférens cuirs dont îls-çoulent
les foupentes & autres groflès pièces. Pour cet efiet
ils prennent une groffe alêne appellee aliéné d keehr,
avec laquelle ilsf ont dans le cuir des trous ou us pal-
fent, au jieu de fît, des lanières de cuir ; & ferrent
cette éfpece de couture par le moyen du marteau apyeellêferre
altackc.
BREF., CO U R T , SUCCtNT, ( & • ) termes relatifs
à la quantité ; bref, à la quantité dûtes»*®*«,
de l’efpace Sc.dü teins; fuccim,,&efeupreffion. La
prononciation d’u n e , fyllabje eft longue ou b;eve ,
un difeonrs eft diffus oufiiccim ; un article elt. eau«
OU long. .
B R E F F. m. dans plufieurs coutumes de France , le
d it des le tt res q u ’ o n o b t ien t en c h a n c e lle r ie , à l ’ effet
d’ in tente r u n e a& io n co n tr e q u e lq u ’un. A in fi o n d it
dans ce s co û tum e s un bref de rejlitution , de refcijion.
D a n s qu elq u e s an c ien n e s c o û tum e s , & même e n c o r
e à p ré fen t e n A n g le t e r r e , c e te rm e e ft f y n o n ym e à
Action. .
Par exemple, on appelle en Normandie bref de mariage
encombré, une aâion que la femme a droit d'exercer
à l’effet d’être réintégrée dans fes biens dotaux
ou matrimoniaux , qui ont été-aliénés par fon
mari. ' , ' ,
Brefs a f o s t o l i q u e s , font des lettres que le
pape envoyé aux princes 8c aux magiftrats pour des
affaires publiques. On les appelle amfi, parce qu elles
font conciles, fans préambule , 6c fur papier ; au
lieu que les bulles font plus amples I écrites fur du
parchemin, 8c fcellées de cire verte ou de plomb. Les
brefs ne fçnt fcellés qu’avec de la cire rouge, 8c fous
l ’anneau du pêcheur, Ce fçel ne s’applique jamais
.qu’en préfence du pape. Voye{ B u l l e .
Les biefs ont en tête le nom du pape , ce ils commentent
par CCS mots : Dimofibofalutcm , & apofto-
Ucam bemdiclionem, éw. après quoi s’enfuit la matière
qui doit être traitée fans aucun préambule.
Le pape ne ligne pas les brefs, 6c on n’y applique
pas fon nom au bas ; c’eft le fecrétaire qui ligne. Le
pape Alexandre VI. établit un collège de feçrétaires
pour les brefs; depuis cetems les brefs font plps longs
& plus amples qü’auparavant. I .
Les brefs n’étoient autrefois envoyés cpie pour les
affaires de juftice : mais préfentement ils font employés
pour les matières de bénéfices, de grâces ex-
peftatives, & pour les difpenfes.
B r e f en terme de Commerce ; o n a p p e lle bref état de
compte, un com p te en a b r é g é , o u q u i n ’ eft pas d reffé
& ren du en forme» V o y e { C o m p t e .
B r e f , en terme de Commerce de mer, lig n ifie e n Bretagne
un congé ou permifjîon de naviger.
Il y en a de trois fortes, bref de fauyeté , bref de conduite,
& bref de victuailles. Le premier fe donne pour
être exempt de droit de bris. Vsye^BRis : le fécond,
pour être conduit hors des dangers de la cote ; oc le
troifieme, pour avoir liberté d’acheter des vivres.
On les appelle aufîi brieux ; & dans le langage ordinaire
on d i t parler aux hébrieux pour obtenir ces
■ brefs. Voye{ B r i e u x . (G ) *
B r e f , en Mujîque, é ft un m o t qu’o n ajo u te quel-,
q u e fo is a u -d e ffu s d e la n o te q u i fin it .un a u o u u n
c h a n t , p o u r m a rqu e r q u e c e t te fin ale d o it e tr e c o u p
é e p a r u n fo n bref te f e c , a u lie u d e d u r e r to u te la
v a le u r . V o y e^ C o u p é * ( S )
B R E F A R , (Géog.) c’ell le nom d’une des îles
Sbrlingues, près des côtes de Cemeüaille en An,,
gleterre. .
BREFORT (Géog.) petite ville du comte de Zut-
phen , affez bien fortifiée, 8c limée dans un endroit
fort marécageux. . , „
RREGENTZ (Géog.') ville capitale d un comte
de même nom, for le fac de Confiance en 1
appartenante à la maifon d’Autriche. Il y paffe une
petite riviere de même nom. Long. zy. zo. lat. 47*
27BREGIN, f. m. terme de riviere, efpece de filet dont
les mailles font fort étroites. ,
BREGLIOf (Géog.) petite ville du comte de Nice
en Piémont, fur la petite riviere de Rodia.
BREGMA, f. m. en Anatomie, c’eft ce qu on appelle
aufli le finciput. Voye{ SlNClPUT.
Le bregma eft compofé de deux os que 1 on appelle
bregma ou bregmatis ojfa, qui font les deux pariétaux.
Voye7 PAR IÉ T AU X . ( Z ) v . . .
BREGNA , (Géog.) petite contrée d Italie, l une
des quatre que les Suiffes y poffedent, entre les four-
ces du Rhin & la ville de Bellinzone. Il y a dans ce
pays une riviere de même nom, qui le traverfe, oC
fe jette dans le Tefin. ... , , , , ,
BREGNANO, (Géog. ) petite ville du duché de
Milan, fur la Sevele. .
BREHAINE , fe dit, en Veneric , d une biche qux
n’engendre point; on la nomme aufli brehagne. Cette
vieille biche laiffe un pié large qui peut induire en
eUB R F II Ai N ES, (Terres) terme de coutumes , qui fe dit
des terres non labourées ni cultivées , qui font vacantes
, en friche & abandonnées. (H ) MÊÊÊ
* BREHIS f. m. (Hifl. nat.) animal de l’ile de Ma-
dagafear, de la grandeur de la chevre, qui n’a qu’une
corne fur le front, & qui eft fort fauvage.
BREHNA, (Géog.) petite ville de l’élettorat de
Saxe, à trois milles de Leipfick. :
BREISICH, (Géog.) petite ville d’Allemagne, au
duché de Juliers, fur la riviere gauche du Rhin.
BREITH-M A R CK , (Géog.) petite ville d Allema-:
gne, en Franconie , fur le Mayn.
BREIT-B ACH, (Géog.) petite ville fur le Rhin ;
fituée dans l’éleftorat de Cologne.
BREITENBACH, (Géog.) petite ville & château
dans la Thuringe.
BREITENBOURG ou BREDENBERG , (Géog.)
fortereffe autrefois confidérable dans le duché de
Holftein, fur la riviere de Stoer.
* BRELAND, f. m. jeu de cartes : il fe joue à tant
de perfonnes que l’on veut : mais il n eft beau, c eft-
à-dire très ruineux , qu’à trois ou cinq. L °£dre des
cartes eft a s , ro i, dame , v a le t , dix , neuf, huit,
fept fix : l’as vaut onze points ; le roi, la dame , le
valet & le dix, en valent dix ; les autres cartes comptent
autant de points qu’elles en portent ; on laiffe
rarement les fix dans le jeu.
On donne trois cartes, ou par une , ou par deux
& une, ou par une & deux, mais non par trois. 01
un joueur a dans fes trois cartes , l’as, le roi, oc &
dame d’une même couleur, il compte trente-un ; s’il
a l’as & le dix , il compte vingt-un ; s’il a le dix, le
neuf & le fept, il compte vingt-fix, &ainfides autres
cartes ou jeux qui peuvent lui venir.
S’il a dans fes trois cartes, ou trois as, ou trois rois,
ou trois valets, &c. il a breland. Un breland eft Supérieur
à quelque nombre de points que ce foit ; & entre
les brelands, celui d’as eft fupérieur à celui de rois ;
celui de rois à celui de dames, & ainfi de fuite.
Les as, ou plus généralement les cartes qui fe trouvent
dans la main des joiieurs, emportent toutes .les
cartes inférieures de la même couleur qui fc trouvent
aufli fur le jeu ; ainfi fi un joiieur a trois coeurs par le
valet, & qu’un autre joiieur ait ou l’as, ou la dame,
ou le roi de coeur feul ou accompagné, il ne refte rien
au premier, & le fécond a quatre coeurs au moins.
Il n’y a d’exception à cette réglé que le cas du brelandj
les as mêmes n ’emportent point les cartes qui
font breland dans la main d’un joiieur.
Celui qui donne met feul au jeu ; cet enjeu s’appelle
paffe y & la paffe eft fi forte ou fi foible qu’on
veut. Il y a primauté entre les joiieurs. Celui qui eft le
plus à droite du donneur, prime fur celui qui le fuit ;
celui-ci fur le troifieme, & ainfi de fuite. Le donneur
eft le dernier en carte. A égalité de points entre plu-
fieurs joiieurs, le premier en carte a gagné.
On n’eft jamais forcé de joiier ; fi l’on a mauvais
jeu , on paffe : fi tout le monde paffe , la'main va à
celui qui étoit le premier en carte ; il joint fon enjeu
au précédent, & il y a deux paffes : le nombre des
enjeux ou paffes augmente jufqu’à ce que quelqu’un
joue. Mais fi un joiieur dit, je joue, n’eût-il point de
concurrent, il tire toutes les paffes qui font fur jeu,
fans même être obligé de montrer fon jeu.
Si un joiieur dit ,/e joue, il met autant d’argent fur
jeu qu’il y a de paffes ; fi un autre joiieur dit aufli y je
joue y il en fait autant, & ainfi de tous ceux qui joiie-
ront : puis ils abattent leurs cartes. Ils s’enlevent les
uns aux autres les cartes de même couleur, inférieures
à celles qu’ils ont ; & celui qui compte le plus de
points dans les cartes d’une feule couleur, a gagné :
ou s’il y a des brelands, celui qui a le breland le plus
haut ; ou celui qui a un breland, s’il n’y en a qu’un,
tire tout l’atgent qui eft fur le jeu.
Il faut obferver que la carte retournée eft du nombre
de celles qui peuvent être enlevées ou par celui
qui a dans fa main la carte^a plus haute de la même
couleur, ou de préférence par celui qui a trois autres
cartes, non de la même couleur, mais de la même efpece
: ainfi dans le cas où. la carte retournée feroit un
d ix, le joiieur qui auroit trois dix en main, auroit de
droit le quatrième ; ce qui lui formeroit le jeu qu’on
appelle tricon. Le tricon eft le jeu le plus fort qu’on
puiffe avoir ; cependant ce jeu n’eft pas fur.
Si le breland eft un jeu commode, en ce qu’on ne
joue que quand on v eu t , c’eft un jeu cruel, en ce
qu’on n’eft guere libre de ne jouer que ce qu’on veut.
.Tel fe met au jeu avec la réfolution de perdre ou de
gagner un loiiis dans la foirée, qui en perd 50 en un
coup. C ’eft votre tour à parler, vous croyez avoir
jeu de rifquer la valeur de la paffe; je fuppofe qu’elle
foit d’un écu : vous dites, je joue, '& vous mettez au
jeu un écu. Celui qui vous fuit, croira pouvoir aufîi
rifquer un écu, & dira, je joue, & mettra fon écu :
mais le troifieme croira fon jeu meilleur qu’un écu ;
il dira, je joue aufji, voilà Vécu de la paffe, mais j ’en
mets vingt, trente, quarante en fus. Le quatrième
joiieur, ou paffe, ou tient, ou enchérit. S’il pafle, il
met fes cartes au talon ; s’il tient, il met &: l’écu de
paffe, & l’enchere du troifieme joiieu r ; s’il enchérit,
il met & l’eçu de paffe , & l’enchere du troifieme <
joiieur, & fon enchère particulière. Le cinquième i
joiieur choifit aufli de pafler, de tenir ou de pouffer. I
g ’il tient, il met la paffe, l’ençhere du troifieme,
Joifti l l h • <
celle du quatrième ; s’il pouffe ou enchérit, il ajoute
encore Fon enchère. Le jeu fe continue de cette ma-
mÇre > jufqu’à ce que le tour de parler revienne à celui
qui a joiié le premier ; il peut ou pafler, en ce cas il
perd ce qu’il a déjà mis fur jeu ; ou tenir, en ce cas il
ajoute à fa mife la Comme néceflaire pour que cette
mife & fon addition fafl'ent une fomme égale à la
mife totale du dernier enchériffeur ; où il pouffe &
enchérit lui-même ; & en ce cas il ajoute encore à
cette fomme totale fon enchère. Les enchères ou tenues
fe continuent, & vont aufli loin que l’acharnement
des joiieurs les entraîne, à moins qu’elles ne
foient arrêtées tout-court par une derniere tenue faite
dans un moment où celui qui tient, ajoutant à fa
mife ce qui manque pour qu’elle fafle avec fon addition
une fomme totale égale à la derniere enchère ,
tous les joiieurs fe trouvent avoir fur le jeu la même
fomme d’argent, excepté celui qui a fait, à qui il en
coûte toûjours la paffe de plus qu’aux autres. En général
, tout joiieur qui a moins d’argent fur jeu qu’un
autre joiieur, peut enchérir ; & les enchères fe pouffent
néceffairement jufqu’à ce qu’il arrive une tenue
au moment où Ja mife de tous ceux qui ont fuivi les
enchères, eft abfolumcnt égale.
Il faut favoir qu’on n’eft point obligé de fuivre les
enchères , & qu’on les abandonne quand on veut ;
mais aufîi qu’on perd en quittant, tout ce qu’on a mis
d’argent fur le jeu : il n’y a que ceux qui fuivent les
enchères jufqu’au bout, qui puiflent gagner.
Lorfque tous les joiieurs qui ont fuivi les enchères,
font réduits à l’égalité de mife & arrêtés par quelque
tenue, ils abattent leurs cartes ; ils fe diftribuent celles
qui leur appartiennent par le droit de fupériorité
de celles qu’ils ont, s’il n’y a point de breland; ÔC
celui qui forme le point le plus haut dans les cartes
d’une même couleur, gagne tout. S’il y a un brelandy
celui qui l’a , tire ; s’il y en a plufieurs, tout l’argent
appartient au plus fort breland, à moins qu’il n’y ait
un tricon : le tricon a barre fur tout. Il n’y a de ref-
fource contre le tricon , que d’avoir plus d’argent
que lui, 8c que de le forcer à quitter par une enchère
qu’il n’eft pas.en état de fuivre. C ’eft par cette raifon
que nous avons dit que tricon étoit le plus beau jeu
que l’on pût avoir; fans toutefois être un jeu fûr.
Tel eft le jeu qu’on appelle le breland: il n’y a
peut-être aucun jeu de hafard plus terrible & plus attrayant.
Il eft difficile d’y joiier fans en prendre la
fureur ; & quand on en eft poffédé, on ne peut plus
fupporter d’autres jeux : ce qu’il faut, je crois, attribuer
à fes révolutions, & à l’efpérance qu’on a de
pouffer le gain tant qu’on v eut, & de recouvrer en
un coup la perte de dix féancés malheûreufes ; efpé-
rances extravagantes, car il y a démonftration morale
que le gain ne peut aller que jufqu’à un certain
point ; & il eft d’expérience que le grand gain .rend
les joiieurs plus refferrés &: plus timides, & que la
grande perte les rend plus avides & plus téméraires.
La police n’a pas tardé à fentir les.triftes fuites de ce
jeu, 8c il a été proferit fous les peines les plus fé veres j
cependant il fe joue toûjours , & je fuis convaincu
que les hommes n’y renoncefont que quand ils en
auront inventé un autre qui foit aufli égal & plus orageux
; deux conditions difficiles à remplir, car il faut
convenir que le breland eft un jeu très-égal, quand
l’enchere la plus forte eft bornée.
* BRELLE, f. m. (Commerce de bois quarre.)t ç’cft
ainfi q u e c e u x q u i fo n t c e c om m e r c e , nomment u n e
c e r ta in e q u an tité d e p iè c e s d e b ois lié e s e n fem b le en
forme, d e rad e a u . I l fa u t qu a t re brelles p o u r fo rm e r
un t ra in com p le t . Voyeç T r a in .
* BRELUCHE, f. f. (Commerce.) c’eft ainfi qu’on
appelle des drogues fil & laine qui fe fabriquent à
Roiien, à Darnetal & à Caen,. & les tiretaines de
Poitou, F'qy^DRQGÙET, foye^ TlRET Al NE.
' ' F f f i>