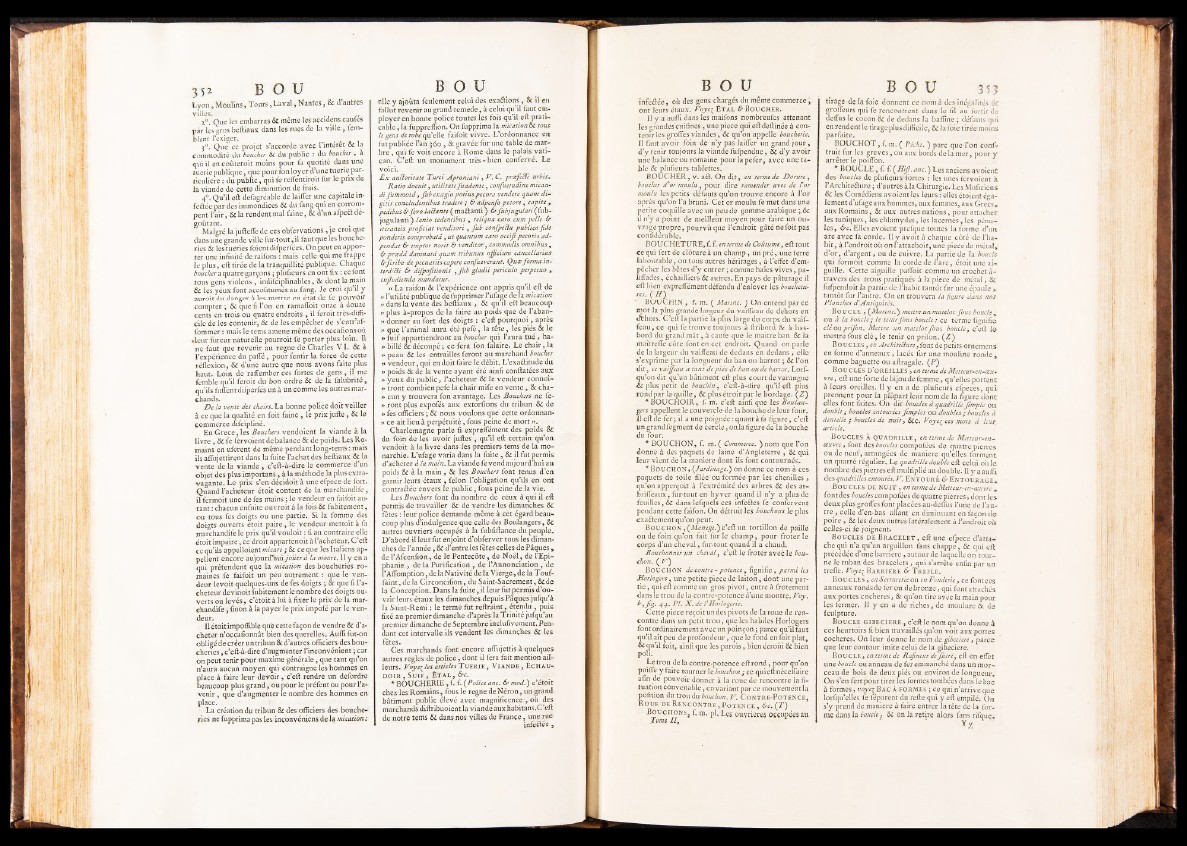
352 B O U
L y o n , M oulins, T ou r s , L a va l , Nantes, & d autres
a°. Que les embarras & même les accidens caufés
par les gros beftiaux dans les mes de la v ille , fem-
blent l’exiger. ,
3°. Que ce projet s’accorde avec 1 intérêt 6c la
Commodité du toucher & du public : du boucher , à
qui il en coûteroit moins pour fa quotité dans une
t-uerie publique, que pour fon loyer d’une tuerie particuliere
: du public * qui fe reffentiroit fur le prix de
la viande de cette diminution de frais.
4°. Qu’il eft defagréable de lailfer une capitale in*
feâée par des immondices &c du fang qui en corrompent
l’air, & la rendent mal faine, 6c d’un afpeô de*
goûtant.
Malgré la jufteffe de ces obfervations, je croi que
dans une grande ville fur-tout, il faut que les bouche*
ries & les tueries foientdifperfées. On peut en apporter
une infinité de raifons i mais celle qui me frappe
le plus, eft tirée de la tranquillité publique. Chaque
boucher a quatre garçons ; plufieurs en ont fix : ce font
tous gens violens , indifciplinables, & dont la main
& les yeux font accoûtumés au fang. Je croi qu’il y
auroit du danger à les mettre en état de fe pouvoir
compter ; 6c que fi l’on en ramalfoit onze à douze
cents en trois ou quatre endroits , il feroit très-difficile
de les contenir, &c de les empêcher de s’entr’af-
fommer : mais le tems amene même des occafions où
•leur fureur naturelle pourroit fe porter plus loin. Il
ne faut que revenir au régné de Charles V I . & à
l’expérience du paffé, pour fentir la force de cette
réflexion, & d’une autre que nous avons faite plus
haut. Loin de raffember ces fortes de gens, il me
femble qu’il feroit du bon ordre 6c de la falubrité,
qu’ils biffent difperfés im à un comme les autres marchands.
. . .
Ve la. vente des chairs. La bonne police doit veiller
à ce que la qualité en foit faine, le prix jufte, 6c le
commerce difcipliné.
En Grece, les Bouchers vendoient la viande à la
liv re , & fe fervoient de balance & de poids. Les Romains
en uferent de même pendant long-tems : mais
ils afluiettirent dans la fuite l’achat des beftiaux 6c la
vente de la viande , c’eft-à-dire le commerce d’un
objet des plus importans, à la méthode la plus extravagante.
Le prix s’en décidoit à une efpece de fort.
Quand l’acheteur étoit content de la marchandife,
il fermoit une de fes mains ; le vendeur en faifoit autant
: chacun enfuite ouvroit à la fois & fubitement,
ou tous fes doigts ou une partie. Si la fomme des
doigts ouverts étoit paire, le vendeur mettoit à fa
marchandife le prix qu’il vouloit : fi au contraire elle
étoit impaire, ce droit appartenoit à l’acheteur. C’eft
ce qu’ils appelloient micare ; 6c ce que les Italiens appellent
encore aujourd’hui jouer à la moure. Il y en a
qui prétendent que la mication des boucheries romaines
fe faifoit un peu autrement : que le vendeur
levoit quelques-uns de fes doigts ; & que fi l’a-
cheteur devinoit fubitement le nombre des doigts ouverts
ou levés, c’étoit à lui à fixer le prix de la marchandife
, finon à la payer le prix impofé par le vendeur.
Il étoit impoffible que cette façon de vendre 6c d’acheter
n’occafionnât bien des querelles. Auffi fut-on
obligé de créer un tribun & d’autres officiers des boucheries
, c’eft-à-dire d’augmenter l’inconvénient ; car
on peut tenir pour maxime générale, que tant qu’on
n’aura aucun moyen qui contraigne les hommes en
place à faire leur devoir, c’eft rendre un defordre
beaucoup plus grand, ou pour le préfent ou pour l’avenir
, que d’augmenter le nombre des hommes en
place.
La création du tribun & des officiers des boucheries
ne fupprimapas les jnçonvéniens de la mication ;
elle y ajouta feulement celui des exaâions, & il en
fallut revenir au grand remede, à celui qu’il faut employer
en bonne police toutes les fois qu’il eft praticable
, la fuppreffion. On fupprima la mication 6c tous
le.gens de robe qu’elle faifoit vivre. L’ordonnance en
fut publiée l’an 360 , & gravée fur une table de marbre
, qui fe voit encore à Rome dans le palais Vatican.
C’eft un monument très-bien confervé. Le
voici.
E x aucloritate Turci Aproniani, V. C. preefeeti urbis.
Ratio docuit, utilitate fuadente, confuetudine mican-
di fummotâ, fub exagio potiuspecora vendere quant di-
gitis concludentibus tradere ; & adpenfo pecore , capite ,
pedibus & fevo luttante ( maâsanti ) & fubjugulari (fub-
jugulanti ) lanio cedentibus , reliqua caro cum pelle &
iteraneis proficiat venditori , fub confpectu publico fide
ponderis comprobatâ, ut quantum caro occijîpecoris ad-
pendat 6* emptor norit & venditor, commodis omnibus ,
& preedâ damnatâ quant tribunus ojficium cancellarius
&fcriba de pecuariis capere confueverant. Quoi forma inter
dicti & difpojitionis , fub gladii periculo perpetuo ,
cuflodienda mandatur.
« La raifon & l’expérience ont appris qu’il eft de
» l’utilité publique defupprimerl’ufage delà mication
» dans la vente des beftiaux , 6c qu’il eft beaucoup
» plus à-propos de la faire au poids que de l’aban-
» donner au fort des doigts : c’eft pourquoi, après
» que l’animal aura été pefé, la tête, les piés & le
» fuif appartiendront au boucher qui l’aura tué , ha-
» bille 6c découpé ; ce fera fon falaire. Le chair, la
» peau 6c les entrailles feront au marchand boucher
» vendeur, qui en doit faire le débit. L ’exa&itude du
» poids & de la vente ayant été ainfi conftatées aux
» yeux du public, l’acheteur 6c le vendeur connoî-
» tront combien pefe la chair mife en vente, & cha-
» cun y trouvera fon avantage. Les Bouchers ne fe-
» ront plus expofés aux extorfions du tribun 6c de
» fes officiers ; 6c nous voulons que cette ordonnan-
» ce ait lieu à perpétuité, fous peine de mort ».
Charlemagne parle fi expreflement des poids 6c
du foin de les avoir juftes , qu’il eft certain qu’on
vendoit à la livre dans les premiers tems de la monarchie.
L’ufage varia dans la fuite , 6c il fut permis
d’acheter à la main. La viande fe vend aujourd’hui au
poids & à la main , & les Bouchers font tenus d’en
garnir leurs étaux , félon l’obligation qu’ils en ont
contractée envers le public, fous peine de la vie.
Les Bouchers font du nombre de ceux à qui il eft
permis de travailler 6c de vendre les dimanches 6c
fêtes : leur police demande même à cet égard beaucoup
plus d’indulgence que celle des Boulangers, 6c
autres ouvriers occupés à la fubfiftance du peuple.
D ’abord il leur fut enjoint d’obferver tous les dimanches
de l’année, 6c d’entre les fêtes celles de Pâques ,
de l’Afcenfion, de le Pentecôte, de Noël, de l’Epiphanie
> de la Purification , de l’Annonciation , de
l’Aflomption, de la Nativité delà Vierge,de la Touf-
faint, de la Circoncifion, du Saint-Sacrement, & de
la Conception. Dans la fuite, il leur fut permis d’ouvrir
leurs étaux les dimanches depuis Pâques jufqu’à
la Saint-Remi : le terme fut reftraint, étendu , puis
fixé au.premier dimanche d’après la Trinité jufqu’au
premier dimanche de Septembre inclufivement. Pendant
cet intervalle ils vendent les dimanches 6c les
fêtes.
Ces marchands font encore affujettis à quelques
autres réglés de police, dont il fera fait mention ailleurs.:
Foyei les articles T u e r i e , V i ANDE, ÉCHAU-
d o i r , S u i f , É t a l , &c.
* BOUCHERIE, f. f. (Police anc. & mod.) c’étoit
chez les Romains, fous le régné de Néron, un grand
bâtiment public élevé avec magnificence , où des
marchands diftribuoient la viande aux habitans.C’eft
de notre tems 6c dans nos villes de France, une rue
infettée ,
in f e & é e , o ù des g en s ch a rg é s du m êm e com m e r c e J
o n t leu rs é ta u x . Foye1 É t a l & B o u c h e r .
Il y a auffi dans les maifons nombreufes attenant
les grandes cuifines, une piece qui eft deftinée à contenir
les grofles viandes, 6c qu’on appelle boucherie.
Il faut avoir foin de n’y pas laiffer un grand jou r,
d’y tenir toujours la viande fufpendue, 6c d’y avoir
une balance ou romaine pour la pefer, avec une table
6c plufieurs tablettes. •
BOUCHER, v. att. On dit, en terme de Dorure,
boucher d’or moulu, pour dire ramender avec de l ’or
moulu les petits défauts qu’on trouve encore à l’or
après qu’on l’a bruni. Cet or moulu fe met dans une
petite coquille avec un peu de gomme arabique ; 6c
il n’ÿ a point de meilleur moyen pour faire un ouvrage
propre, pourvu que l’endroit gâté ne foit pas
considérable.
BOUCHETURE,f. f. en terme de Coutume, eft tout
ce qui fert de clôture à un champ, un pré, une terre
labourable, ou tous autres héritages, à l’effet d’empêcher
les bêtes d’y entrer ; comme haies v ives, pa-
liffades, échailliers 6c autres. En pays de pâturage il
eft bien expreflement défendu d’enlever les bouchetur
c s .jH ) w m
BOUCHIN, f. m. ( Marine. ) On entend par ce
mot la plus grande largeur du vaifleau de dehors en
dfchors. C ’eft la partie la plus large du corps du vaif-
feau, ce qui fe trouve toujours à ftribord & à bas-
bord du grand m ât, à caufe que le maître ban & la
maîtreffe côte font en cet endroit. Quand on parle
de la largeur du vaifleau de dedans en dedans , elle-
s’exprime par la longueur du ban ou barrot ; 6c l’on
dit, ce vaijfeau a tant de piés de ban ou de barrot. Lorf-
qu’on dit qu’un bâtiment eft plus court de varangue
6c plus petit de bouchin, c’eft-à-dire qu’il eft plus
rond par la quille, 6c plus étroit par le bordage. (Z )
*BOUCHOIR, f. m. c’eft ainfi que les Boulangers
appellent le couvercle de la bouche de leur four.
Il eft de fer; il a une poignée : quant à fa figure, c’eft
ungrandfegment de cercle, ou la figure de la bouche
du four.
* BOUCHON, f. m. ( Commerce. ) nom que l’on
donne à des paquets de laine d’Angleterre , 6c qui
leur vient de la maniéré dont ils font contournés.
* BOUCHON, ( Jardinage.) on donne ce nom à ces
paquets de toile filée ou formée par les chenilles ,
qu’on apperçoit à l’extrémité des arbres 6c des ar-
briffeaux, fur-tout en hy ver quand il n’y a plus de
feuilles, 6c dans lefquels ces infe&es fe confervent
pendant cette faifon. On détruit les bouchons le plus
exa&ement qu’on peut.
B o u c h o n , (Manege.) c’eft un tortillon de paille
où de foin qu’on fait fur le champ, pour froter le
corps d’un cheval, fur-tout quand il a chaud.
Bouchonner un cheval, c’ e ft le f r o t e r a v e c le bouchon.
( V')
BOUCHON de contre - potence, fignifie, parmi les
Horlogers, une petite piece de laiton, dont une partie
, qui eft comme un gros pivot, entre à frotement
dans le trou de la contre-potence d’une montre. Voy.
b , fig. 44. PI, X . de VHorlogerie.
Cette piece reçoit un des pivots de la roue de rencontre
dans un petit trou, que les habiles Horlogers
font ordinairement avec un poinçon ; parce qu’il faut
qu’il ait peu de profondeur, que le fond en foit plat,
& qu’il foit, ainfi que les parois, bien écroiii 6c bien
poli.
Le trou de la contre-potence eft rond, pour qu’on
puiffe y faire tourner le bouchon ; ce quieftnéceflaire
afin de pouvoir donner à la roue de rencontre la fi-
tuation convenable, en variant par ce mouvement la
pofition du trou du bouchon. V. C o n t r e -P o t e n c e ,
R o u e d e R e n c o n t r e , P o t e n c e , &c. ( T )
B o u c h o n s , f, m, pl, Les ouvrières occupées au
Tome II,
tirage de la foie donnent ce nom à des inégalités 6c
grofleurs qui fe rencontrent dans le fil au fortir de
deflus le cocon 6c de dedans la baffine ; défauts qui
en rendent le tirage plus difficile, 6c la foie tirée moins
parfaite.
BOUCHOT, f. m. ( Pêche. ) parc que l’on construit
fur les grèves, ou aux bords de la mer, pour y
arrêter le poiffon.
* BOUCLE, f. f'.{Hijt. anc.') Les anciens avoient
des boucles A n plufieurs fortes : les unes fervoient à
l’Architetture ; d’autres à la Chirurgie. Les Muficiens
6c les Comédiens avoient les leurs : elles étoient également
d’ufage aux hommes, aux femmes, aux Grecs V
aux Romains, & aux autres nations, pour attacher;
les tuniques, les chlamydes, les lacernes, les pénu-;
les, 6*c. Elles avoient prefque toutes la forme d’un
arc avec fa corde. Il y avoit à chaque côté de l’habit,
à l’endroit où on l’attachoit, une piece de métal,'
d’or, d’argent, ou de cuivre. La partie de la boucle.
qui formoit comme la corde de l’arc, étoit une aiguille.
Cette aiguille pafloit comme un crochet à-
travers des trous pratiqués à la piece de métal, &
fufpendoit la partie de l’habit tantôt fur une épaule »
tantôt fur l’autre. On en trouvera la figure dans nos
Planches d'Antiquités.
BOUCLE , [Marine.') mettre un-matelot fous boucle^
ou à la boucle; le tenir fous boucle: ce terme fignifie
clé o\\ prifon. Mettre un matelot fous boucle, c’eft le
mettre fous c lé , le tenir en prifon. (Z )
B o u c l e s , en Architecture,font de petits ornemens
en forme d’anneaux , lacés fur une mouline ronde ,
comme baguette ou aftragale. (P)
B o u c l e s d ’o r e i l l e s , en terme de Metteur-en-oeu-
vre, eft une forte de bijou de femme, qu’elles portent
à leurs oreilles^ Il y en a de plufieurs efpeces, qui
prennent pour la plupart leur nom de la figure dont
elles font faites. On dit boucles à. quadrille Jimple ou
double ; boucles entourées fimples ou doubles ; boucles à
dentelle ,• boucles de nuit, 6cc. Voyeç ces mots à leur,
article.
B o u c l e s À q u a d r i l l e , en terme de Metteur-en-
oeuvre, font des boucles compofées de quatre pierres
ou de neuf, arrangées de maniéré qu’elles forment
un quarré régulier. Le quadrille double eft celui où le.
nombre des pierres eft multiplié au double. Il y a aufli
des quadrilles entourés. V. E n t o u r é & E n t o u r a g e »
BOUCLES DE n u i t , en terme de Metteur-en-ceuvre *
font des boucles compofées de quatre pierres, dont les
deux plus grofles font placées au-deffus l’une de l’autre,
celle d’en-bas allant en diminuant en façon de
poire , 6c les deux autres latéralement à l’endroit où
celles-ci fe joignent.
B o u c l e s d e B r a c e l e t , eft une efjjece d’attache
qui n’a qu’un arguillon fans chappe, 6c qui eft
précédée d’une barrière, autour de laquelle on tourne
le ruban des bracelets, qui s’arrête enfin par un
trefle. Voye^ B a r r i è r e & T r e f l e .
B o u c l e s , en Serrurerie ou en Fonderie , ce font ces
anneaux ronds de fer ou de bronze, qui font attachés
aux portes cocheres, & qu’on tire avec la main pour
les fermer. Il y en a de riches, de moulure & de
fculpture.
B o u c l e g i b e c i e r e , c ’ e ft le nom q u ’o n d onn e à
c e s h eu r to ir s fi b ien t ra v a illé s q u ’ o n v o i t a u x p o r te s
co c h e r e s . On le u r d o n n e le nom d e gibeciere , p a r c e
q u e le u r co n to u r im ite c e lu i de la g ib e c ie re .
BOUCLE, en terme de Rafineur de fucre, eft en effet
une boucle ou anneau de fer emmanché dans un morceau
de bois de deux piés ou environ de longueur.1
On s’en fert pour tirer les formes tombées dans le bac
à formes, voye^ B a c à f o r m e s ; ce qui n’arrive que
lorfqu’elles fe féparent du refte qui y eft empilé. On
s’y prend de maniéré à faire entrer la tête de la forme
dans la boucle 6c on la retire alors fans rifquç.