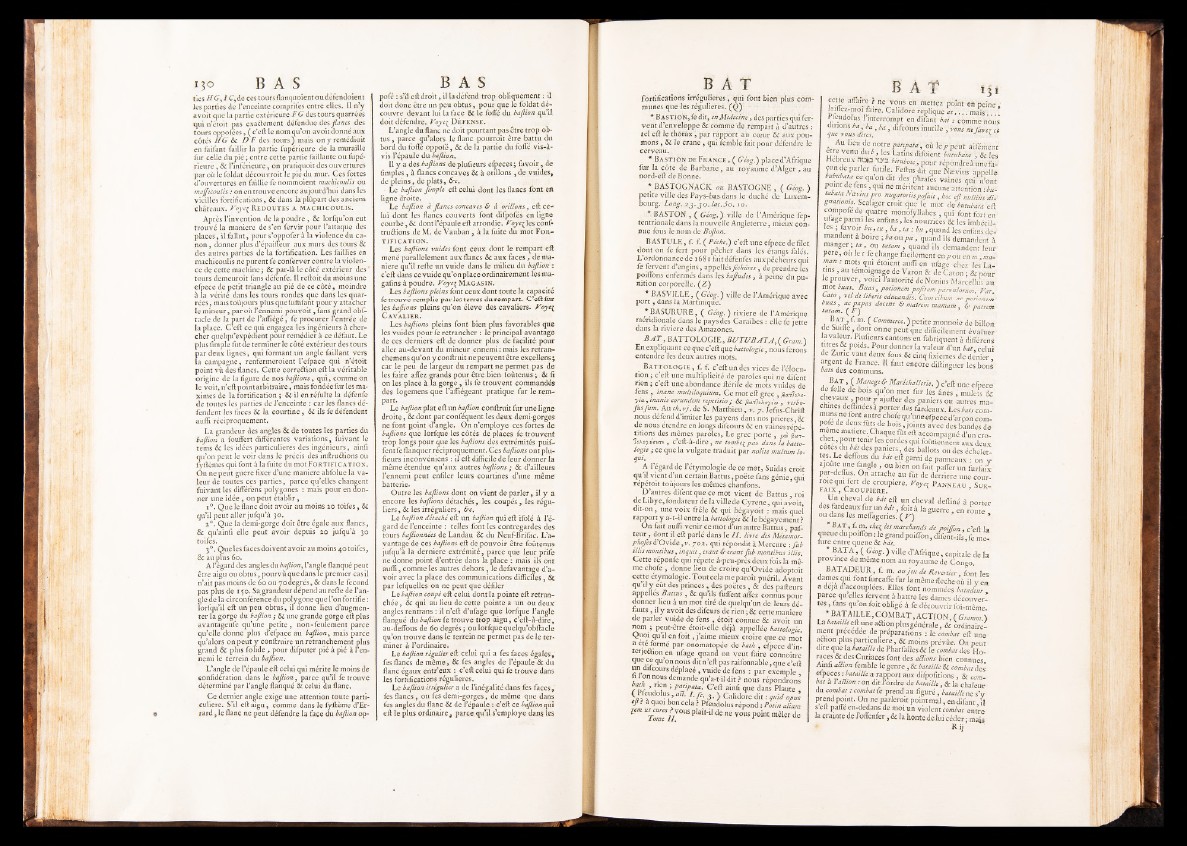
ties H G, 1C, de ces tours flanquoient ou défendoient j
les parties de l’enceinte comprifes entre elles. 11 n’y
avoit que la partie extérieure FG des tours quarrées
qui n’étoit pas exa&ement défendue des flancs des ;
tours oppofées, ( c’eft le nom qu’on avoit donné aux
côtés H G &c D F des tours ) mais on y remédioit
en faifant faillir la partie fupérieure de la muraille i
fur celle du pié ; entre cette partie faillante ou fupé-
ïieure, & l’inférieure, on pratiquoit des ouvertures
par oh le foldat découvroit le pié du mur. Ces fortes
d’ouvertures en faillie fe nommoient mâchicoulis ou
majfùoulis : on en trouve encore aujourd’hui dans les ,
vieilles fortifications, & dans la plupart des anciens
châteaux. Voyt{ Redoutes a mâchicoulis.
Après l’invention de la poudre, & lorfqu’on eut
trouvé la maniéré de s’en fervir pour l’attaque des
places, il fallut, pour s’oppofer à la violence du canon
, donner plus d’épaiffeur aux murs des tours &
des autres parties de la fortification. Les faillies en
mâchicoulis ne purent fe conferver contre la violence
de cette machine ; & par-là le côté extérieur des '
tours demeuroit fans défenfe. Il reftoit du moins une
efpece de petit triangle au pié de ce côté, moindre
à la vérité dans les tours rondes que dans les quarrées,
mais toujours plus quefuffifant pour y attacher
le mineur, paroiil’ennemi pouvoit, fans grand obf-
tacle de la part de l’afliégé, fe procurer l’entrée de
la place. C’eft ce qui engagea les ingénieurs à chercher
quelqu’expédient pour remédier à ce défaut. Le
plus fimple fut de terminer le côté extérieur des tours
par deux lignes, qui formant.un angle faillant vers
la campagne, renfermeroient l’efpace qui n’étoit
point vu des flancs. Cette correction eft la véritable
origine de la figure de nos baftions, qui, comme on
le voit, n’eft point arbitraire, mais fondée fur les maximes
de la fortification ; & il en réfulte la défenfe
de toutes les parties de l ’enceinte : car les flancs défendent
les faces & la courtine, & ils fe défendent
aulîi réciproquement.
La grandeur des angles & de toutes les parties du
bajlion a fouffert différentes variations, îuivant le
tems & les idées particulières des ingénieurs, ainfi
qu’on peut le voir dans le précis des inftrucfions ou
fyftèmes qui font à la fuite du mot Fortification,
On ne peut guere fixer d’une maniéré abfolue la valeur
de toutes ces parties, parce qu’elles changent
fuivant les différens polygones : mais pour en donner
une idée , on peut établir,
i° . Que le flanc doit avoir au moins 20 toifes, &
qu’il peut aller jufqu’à 30.
20. Que la demi-gorge doit être égale aux flancs,
& qu’ainfi elle peut avoir depuis 20 jufqu’à 30
toifes.
30. Que les faces doivent avoir au moins 40 toifes,
& au plus 60.
A l’égard des angles du bajlion, l’angle flanqué peut
être aigu ou obtus, pourvu que dans le premier cas il
n’ait pas moins de 60 ou 70degrés, & dans le fécond
pas plus de 150. Sa,grandeur dépend au refte de l’angle
de la circonférence du polygone que l’on fortifie :
lorfqu’il eft un peu obtus, il donne lieu d’augmenter
la gorge du bajlion ; & une grande gorge eft plus
avantageufe qu’une petite, non-feulement parce
qu’elle donne plus d’efpace au bajlion, mais parce
qu’alors on peut y conftruire un retranchement plus
grand & plus folide, pour difputer pié à pié à l’ennemi
le terrein du bajlion.
L’angle de l’épaule eft celui qui mérite le moins de
confidération dans le bajlion, parce qu’il fe trouve
déterminé par l’angle flanqué & celui du flanc.
Ce dernier angle exige une attention toute particulière.
S’il eft aigu, comme dans le fyftème d’Er-
rard, le flanc ne peut défendre la face du bajlion oppofé
: s’il eft droit, il la défend trop obliquement : U
doit donc être un peu obtus, pour que le foldat découvre
devant lui la face & le foffé du bajlion qu’il
doit défendre. Voye^ Défense.
L’angle du flanc ne doit pourtant pas être trop obtus
, parce qu’alors le flanc pourroit être battu du
bord du foffé oppofé, & de la partie du foffé vis-à-
vis l’épaule du bajlion.
Il y a des bajlions de plufieurs efpeces ; favoir, de
Amples, à flancs concaves & à orillons , de vuides,
de pleins, de plats, &c.
■ Le bajlion Jîmple eft celui dont les flancs font en.
ligne droite.
Le bajlion à JLancs concaves & â orillons, eft celui
dont les flancs couverts font difpofés en ligne
courbe, ôt dont l’épaule eft arrondie. F'oye^ lesconfi
truffions de M. de Vauban, à la fuite du mot Fortification.
Les baftions vuides font ceux dont le rempart eft
mené parallèlement aux flancs & aux faces , de maniéré
qu’il refte un vuide dans le milieu du bajlion :
c’eft dans ce vuide qu’on place ordinairement lés ma-
gafins à poudre. Voye[ Magasin.
Les bajlions pleins font ceux dont toute la capacité
fe trouve remplie par les terres du rempart. C ’eft fur
les bajlions pleins qu’on éleve des cavaliers. Voye^ Cavalier.
Les bajlions pleins font bien plus favorables que
les vuides pour fe retrancher : le principal avantage
de ces derniers eft de donner plus de facilité pour
aller au-devant du mineur ennemi : mais les retran-
chemens qu’on y conftruit ne peuvent être excellens ;
car le peu de largeur du rempart ne permet pas de
les faire affez grands pour être bien loûtenus ; & fi
on les place à la gorge , ils fe trouvent commandés
des logemens que l’afliégeant pratique fur le rempart.
Le bajlion plat eft un bajlion conftruit fur une ligne
droite, & dont par conféquent les deux demi-gorges
ne font point d’angle. On n’employe ces fortes de
bajlions que lorfque les côtés de places fe trouvent
trop longs pour que les bajlions des extrémités puif-
fentfe flanquer réciproquement. Ces bajlions ont plu-
fieurs inconvéniens : il eft difficile de leur donner la
même étendue qu’aux autres bajlions ; & d’ailleurs
l’ennemi peut enfiler leurs courtines d’une même
batterie.
Outre les bajlions dont on vient de parler, il y a
encore les bajlions détachés, les coupés, les réguliers
, & les irréguliers, &c.
Le bajlion détaché eft un bajlion qui eft ifolé à l’é-
gard de l’enceinte : telles font les contregardes des
tours bajlionnées de Landau & du Neuf-Brifac. L’avantage
de ces bajlions eft de pouvoir être foûtenus
jufqu’à la derniere extrémité, parce que leur prife
ne donne point d’entrée dans la place : mais ils ont
aufli, comme les autres dehors, le defavantage d’avoir
avec la place des communications difficiles, &
par lefquelles on ne peut que défiler
Le bajlion coupé eft celui dont la pointe eft retranchée
, & qui au lieu de cette pointe a un ou deux
angles rentrans : il n’eft d’ufage que lorfque l’angle
flangué du baflion fe trouve trop aigu, c’eft-à-dire,
au-deffous de 60 degrés ; ou lorfque quelqu’obftacle
qu’on trouve dans le terrein ne permet pas de le terminer
à l’ordinaire.
Le bajlion régulier eft celui qui a fes faces égales
fes flancs de même, & fes angles de l’épaule & du
flanc égaux entr’eux : c’eft celui qui fe trouve dans
les fortifications régulières.
Le bajlion irrégulier a de l’inégalité dans fes faces,
fes flancs, ou fes demi-gorges, de même que dans
fes angles du flanc & de l’épaule : c’eft ce bajlion qui
eft le plus ordinaire, parce qu’il s’employe dans les
fortifications irrégulières, qui font bien plus communes
que les régulières, (Q)
* Bastion, fe dit, en Medecine, des parties qui fervent
d’enveloppe & comme de rempart à d’autres : tel eft le thorax i par rapport au coeur & aux poumons
, & le crâne,cerveau.-. qùi fémble fait pour défendre le
* Bastion de Frange , ( Géog.) place d’Afrique
fur la côté de Barbarie, au royaume d’A lger, au
nord-eft de Bonne.
* BASTOGNACK ou BASTOGNE , ( Géog. )
petite ville des Pays-bas. dans le duché de Luxembourg.
Long. 0.3.3o. lat.5o. 10.
BASTON , ( Géog. ) ville de l ’Amérique fep-
tentrionale dans la nouvelle Angleterre, mieux connue
fous le nom de Bojlon.
BASTULE, f. f. ( Pêche.) c’eft une efpece de filet
dont on fe fert pour pêcher dans les étangs falés.
L’ordonnance de 1681 faitdéfenfes aux pêcheurs qui
fe fervent d’engins, appellésJichûres, de prendre les
poiffons enfermés dans les bajtudes , à peine du punition
corporelle. (Z )
BAS VILLE, ( Geog. ) ville de l’Amérique avec
po rt, dans la Martinique.
* BASURURE, ( Géog. ) riviere de l’Amérique
méridionale dans le pays des Caraïbes : elle fe jette
dans la riviere dés Amazones.
B A T , BATTOLOGIE, BUTUBATA, ( Gram J
En expliquant ce que c’eft que battologie, nous ferons
entendre les deux autres mots.
Battologie , f. f. c’eft un des vices de l’élocution
; c’eft une multiplicité de paroles qui ne difent
rien ; c’eft une abondance ftérile de mots vuides de
fens , inane multiloquium. Ce mot eft grec , fietrloXo-
y ta., inahis eorundem repetitio ; & $a.-rlo\oyiu , verbofusfum.
Au ch. yj. de S. Matthieu, v. y . Jefus-Chrift
nous défend d’imiter les payens dans nos prières ,&
de nous étendre en longs difeours & en vaines répétitions
des mêmes paroles, Le grec porte , pii fictr-
loXoywnri , c’eft-à-dire , ne tombe^pas dans la battologie
j ce que la vulgate traduit par nolite multum lo-
qui.
A l’égard de l’étymologie de ce mot, Suidas croit
qu’il vient d’un certain Battus, poète fans génie, qui
repetoit toûjours les mêmes chanfons.
D ’autres difent que ce mot vient de Battus, roi
de Libye, fondateur de la ville de Cyrene, qui avoit
dit-on, une voix frêle & qui bégayoit : mais quel
rapport y a-t-il entre la battologie & le bégayement?
On fait aufli , venir ce mot d’un autre Battus, paf-
teur, dont il eft parlé dans le II. livre des Métamor-
phofes d’Ovide ,v. yoz. qui répondit à Mercure : fub
illis montibus, inquit, erant & erant fub montibus illis.
Cette réponfe qui répété à-peu-près deux fois la même
chofe , donne lieu de croire qu’Ovide adoptoit
cette étymologie. Tout cela me paroît puéril. Avant
qu’il y eût des princes, des poètes , & des pafteurs
appelles Battus , & qu’ils fuffent affez connus pour
donner lieu à un mot tiré de quelqu’un de leurs défauts
, il y avoit des difeurs de rien ; & cette maniéré
de parler vuide de fens , étoit connue & avoit un
nom ; peut-être étoit-elle déjà appellée battologie.
Quoi qu’il en fo it , j’aime mieux croire que ce mot
a été formé par onomatopée de bath , efpece d’in-
terjeôion en ufage quand on veut faire connoître
que ce qu’on nous dit n’eft pas raifonnable, que c’eft
un dilcours déplacé , vuide de fens : par exemple
li I on nous demande qu’a-t-il dit ? nous répondrons
H , rien ; patipata. C’eft ainfi que dans Plaute ,
( Pfeudolus ail. W M 3 . ). Calidore dit : quid opus
ejl ? à quoi bon cela ? Pfeudolus répond : Potin aüam
jxm yVOUS pkît-il de ne vous point mêler de
f e.“ é ne vous eri mette« poîàt eh peine,
nuJ!ez-rriqi fure. Càhcfôië réplique ai. . . . mais1;
Weudolqs. I’iriterronipt en difant lai : :comme nous
dirions !)a j ta y i a , difeours inutile yom nt lavez ci
qûc vdaiiditey * . l ( . , ,y 0.
B aîfément
être venu du ■ les Latins dûment bmubd'.a , & les
Hebreux — ■ rdpondreàunefa,
IdHisiiit ("lie Kaivius appelle
on dit H a W B g vairids* 'qui V ont
point de fens, qui ne mentent aucune attention WÊ
tabataNoev,uspro augaforiispj/fuit, hàc iff'm llik dU
gnauoms. Scaligcr croit que le mot de Itmibàia elt
compofe de quatre monôïyllabes , qiii font fort eif
ulage.parmi les enfans, les nourrices6t les imbécil-
■ * H H lu. H H B • 1 j quand lesenfansdeJ
mandent à boire ; ba Ou pa , quand ils demandent à
manger ; m 01} tacam , quand ils demandent leur
pere, oti le e fe change facilement en p ou en rn ; maà
man : mots qui étoiènt aufli en ufage-chëz lés Latins
, au témoignage de Varan & de Caton ; & pour
le prouver; voici l’autorité deNonins Marcellus an
mot buas. Buas. potiohetn pojîtam pârvûlàrümy Far. I
Lato y velde ïiberis cducahdisl■ Cumcibum ac pottotUm'
buas, ac papas deàht & màirïm mamam, <S- pacrem.
tatam. \ F \ .
I B*Fj r- “ • ( Cofi&im. y petite monnoie de!billpn
de Suiffe .dont onne peut que difficilement évaluer •
ta valeur. Plufieurs cantoniren fabriquent à-différens
titres ôf poids. Pour donner la valeur d’un baïilcehà
de Zurie vaut deux fous & cinq fixiemes'dp denier
argent de Fraiiee. Il faut encore diftinguer les boni
bats des communs.
H i f l y c*eft une efpecâ1
de lelle de bois qu on met fur les ânës mulets Sc
chevaux , pour y ajufter dès paniers ou autres machines
deftmeesà porter des fardeaux. Les bats cornpofe
de deux fûts de bois, joints avec des bandés de
même matière . Chaque ffit eft accompagné d’un cro-
- Pol;r.tc.mr les “ rdes qui foûtiennent aux deux
cotes ta bat des paniers H H des échelet-
; tes. Le deffqnHu bât eft garni de panneaux : ou y
™°rUdtiïae n"gle ’ fl blenr°n fait H i M M par-deffus. On attache au ffit de derrière Une courroie
qui fert de croupiefe. V o y P a n n e a u , Sus-
FAIX , CROUPIERE.
Un cheval de Mreft un cheval deftiné à porter
des fardeaux fur un bât, foit à la guerre , en route
ou dans les meffageries. ( V } *
* Ba t , f. m. che^ les marchands de poiffon, c’eft la
queue du poiffon : le grand poiffon, difent-ils, fe me-
lure entre queue & bât.
* BAT^ » ( Géog. ) ville d’Afrique, capitale de la
province de meme nom au royaume de Congo.
^ BATAOEUR, f. m. au jeu Je Revertier , font les
dames qui font fnreaffe fur la même fléché où il y en
a déjà d accouplées. Elles font nommées baladeur .
parce qu elles fervent à battre les dames découvertes
. fans qu on foit obligé,à fe découvrir foi-mêmet
* BA.TAILLE ,COM B A T ,A C T IO N ,( Grnmm.)
La bataille eft une aéhon plus générale, & ordinairement
précédée de préparations : le combat eft une
action plus particulière, & moins prévue. On peut
dire que la bataille de Pharfalles & le combat des Ho-
races & des Curiaces font des actions bien connues
Ainfi action femble le genre, & bataille & combat des
efpeces : bataille a rapport aux dilpofitions, & combat
à Y action : on dit l’ordre de bataille, & la chaleur
du combat : combat {e prend au figuré, bataille ne s’y
Fend point. On ne parleroit point mal, en difant il
s eft paffé en-dedans de moi un violent combat entre
la crainte de l’offenfer, & la honte de lui céder; mais
R ij