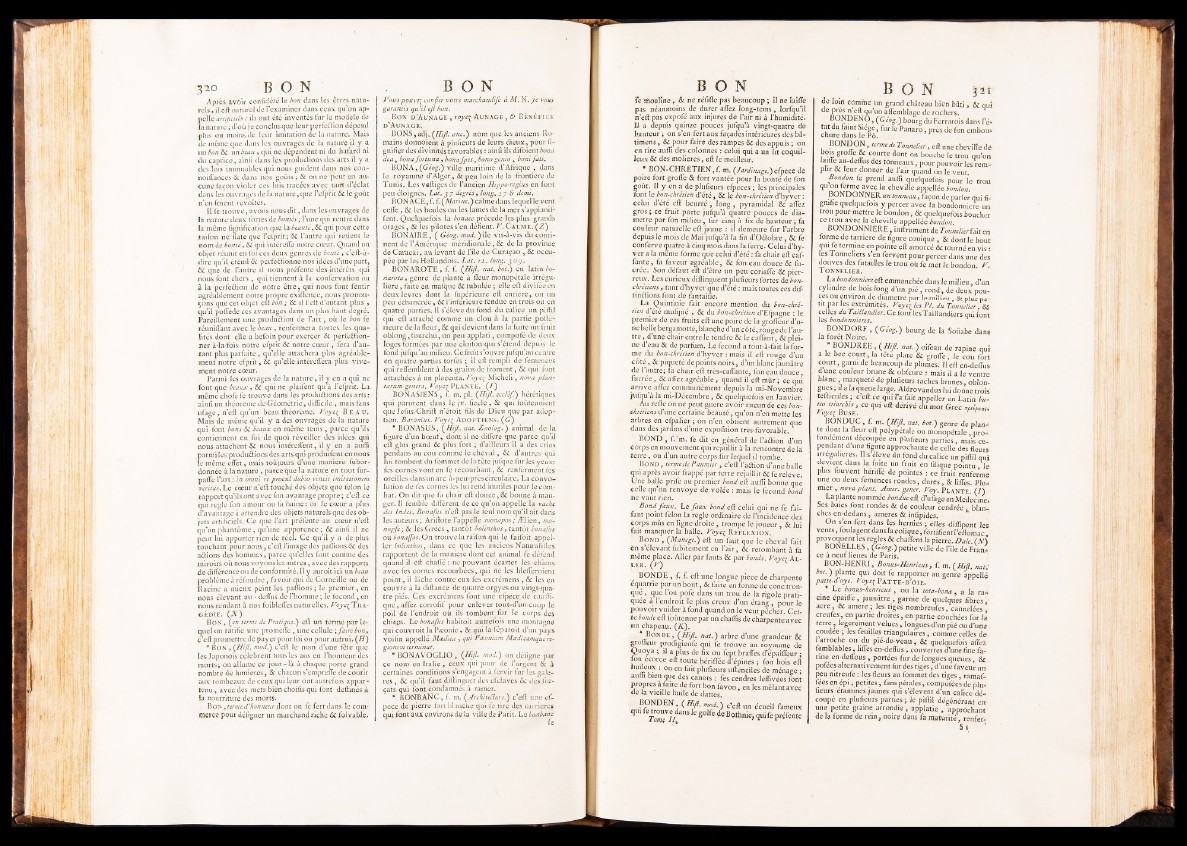
Après avoir confidéré le bon clans les etres naturels
, il eft naturel de l’examiner dans ceux qu’on appelle
artificiels : ils ont été inventés fur le modele de
la nature ; d’où je conclus que leur perfe&ion dépend
plus ou moins de leur imitation de la nature. Mais
de meme que dans les ouvrages de la nature il y a
un bon & un beau, qui ne dépendent ni du hafarcl ni
du caprice, ainfi dans les produ&ions des arts il y a
des lois immuables qui nous guident dans nos con-
noifl'ances 8t dans nos goûts ; & on ne peut en aucune
façon violer ces lois tracées avec tant d’éclat
dans les ouvrages de la nature, que l’efprit & le goût
n’en foient révoltés.
Il fe trouve, avons-nous dit, dans les ouvrages de
la nature deux fortes de bontés; l’une qui rentre dans
la même fignification que la beauté, & qui pour cette
raifon ne date que l’efprit; 8c l’autre qui retient le
110m de bonté, & qui intcreffe notre coeur. Quand un
objet réunit en foi ces deux, genres de bonté, c’eft-à-
dire qu’il étend 8c perfeftipnne nos idées d’une part,
8c que de l’autre il nous préfente des intérêts qui
nous font chers, qui tiennent à la confervation ou
à la perfeftion de notre être, qui nous font fentir
agréablement notre propre exiftence, nous prononçons
que cet objet eft bon.; 8c il l’eft d’autant plus ,
-cju’il poffede ces avantages dans un plus haut degré.
Pareillement une production de l’a r t , où le bon fe
réunifiant avec le beau , renfermera toutes les qualités
dont elle a befoin pour exercer 8c perfectionner
à-la-fois notre efprit 6c notre coeur, fera d’autant
plus parfaite, qu’elle attachera plus agréablement
notre efprit, 8c qu’elle intéreflera plus vivement
notre coeur.
Parmi les ouvrages de la nature, il y en a qui ne
font que beaux, 8c qui ne plaifent qu’à l’efprit. La
même chofefe trouve dans les productions des arts:
ainfi un théorème de Géométrie, difficile , mais fans
ufage, n’eft qu’un beau théorème. Voye[ B e a u .
Mais de même qu’il y a des ouvrages de la nature
qui font bons 8c beaux en même tems , parce qu’ils
contiennent en foi de quoi réveiller des idées qui
nous attachent 8c nous intéreffent, il y en a aufli
parmi les productions des arts qui produifent en nous
le même effet, mais toûjours d’une maniéré fubor-
donnée à la nature, parce que la nature en tout fur-
paffe l’ art : in omni re procul dubio vincit imitationem
veritas. Le coeur n’eft touché des objets que félon le
rapport qu’ils ont avec fon avantage propre ; c’eft ce
qui regle fon amour ou fa haine : or le coeur a plus
d’avantage à attendre des objets naturels que des objets
artificiels. Ce que l’art préfente au coeur n’eft
qu’un phantôme, qu’une apparence ; 8c ainfi il ne
peut lui apporter rien de réel. Ce qu’il y a de plus
touchant pour nous, c’eft l’image des pallions 8c des
aCtions des hommes, parce qu’elles font comme des
miroirs où nous voyons les autres, avec des rapports
de différence ou de conformité. Il y auroit ici un beau
problème à réfoudre, favoir qui de Corneille ou de
Racine a mieux peint les panions; le premier, en
nous élevant au - deflùs de l’homme ; le lecond, en
nous rendant à nos foibleffes naturelles. Voye^ T r a g
é d i e . (A T )
Bon , (en terme de Pratique.) eft un terme par lequel
on ratifie une promeffe , une cellule ; faire bon,
c ’eft promettre de payer pour foi ou pour autrui. (H)
* Bon , (Hiß. mod.) c’eft le nom d’une fête que
les Japonois célèbrent tous les ans en l’honneur des
morts ; on allume ce jour - là à chaque porte grand
nombre de lumières, & chacun s’emprefle de courir
aux tombeaux de ceux qui leur ont autrefois appartenu
, avec des mets bien choilis qui font deftinés à
la nourriture des morts.
, Bon , terme d'honneur dont on fe fert dans le commerce
pour défigner un marchand riche 8c folvable.
Vous pouvez confier votre marchandife a M. N. je vous
garantis qu'il eft bon.
B o n d ’A u n a g e , v oy e^ A u n a g e , & B é n é f i c e
d ’A u n a g e .
BONS, adj. (Hift. anc.) nom que les anciens Romains
donnoient à plufieurs de leurs dieux, pour fi-
gnifier des divinités favorables : ainfi ils difoient bona
dea t bona fortuna, bona J'pes, bono genio , boni fiati.
BONA, (Géog.) ville maritime d’Afrique , dans
le royaume d’Alger, & peu loin de la frontière de
Tunis. Les veftiges de l’ancien Hippo-regius en font
peu éloignés. Lat. 3 7 degrés , long. 2.7 & demi.
BON ACE, f. f.(Marine.) calme dans lequel le vent
ceffe, 8c les houles ou les lames de la mer s’applanif-
fent. Quelquefois la bonace précédé les plus grands
orages, & les pilotes s’en défient. V. C a l m e . (Z )
BONAIRE, ( Géog. mod. ) île vis-à-vis du continent
de l’Amérique méridionale, 8c de la province
de Caracai, au levant de l’île de Curaçao , 8c occupée
par les Hollandais. Lat. 12. long. 3 o^!.
BONAROTE, f. f. (Hift, nat. bot.) en latin bo-
narota, genre de plante à fleur monopétale irrégulière
, faite en malque 8c tubulée ; elle eft divifée en
deuxlevres dont la fupérieure eft entière, ou un
peu échancrée, 8c l’inférieure fendue en trois ou en
quatre parties. Il s’élève du fond du calice un piftil
qui eft attaché comme un clou à la partie pofté-
rieure de la fleur , 8c qui devient dans la fuite un fruit
oblong, fourchu, un peu applati, compofé de deux
loges formées par une eloifon qui s’étend depuis le
fond jufqu’au milieu. Ce fruit s’ouvre jufqu’au centre
en quatre parties torfes ; il eft rempli de femences
qui reffemblent à des grains de froment, 8c qui font
attachées à un placenta. Voye^ Micheli, nova plarir
tarum généra. Voye{ PLANTE. ( / )
BONASIENS , f. m. pl. (Htfi. eccléfé) hérétiques
qui parurent dans le jv. fiecle & qui foûtenoient
que Jefus-Chrift n’étoit fils de Dieu que par adoption.
Baronius. Voyeç ADOPTIENS. (G)
* BONASUS, (Hift. nat. Zoolog. ) animal de la
figure d’un boeuf, dont il ne différé que parce qu’il
eft glus grand 8c plus fort ; d’ailleurs il a des crins
pendans au cou comme le cheval, 8c d’autres qui
lui tombent du fommet de la tête jufque fur les yeux:
fes cornes vont en fe recourbant, 8c renferment fes
oreilles dans un arc à-peu-près circulaire. La coiivot
lution de fes cornes les lui rend inutiles pour le combat.
On dit que fa chair eft douce, 8c bonne à manger.
II femble différent de ce qu’on appelle la vache
des Indes. Bonafus n’eft pas le lèul nom qu’il ait dans
les auteurs; Ariftote l’appelle monapos; Ælien, mor
nopfe; & les Grecs , tantôt bolinthos, tantôt bonafos
ou bonaftfos. On trouve la raifon qui le faifoit appel-
ler bolinthos y dans ce que les anciens Naturaliftes
rapportent de la maniéré dont cet animal fe défend
quand il eft chafîe : ne pouvant écarter les chiens
avec fes cornes recourbées, qui ne les blefferoient
point, il lâche contre eux fes excrémens , 8c les en
couvre à la diftance de quatre orgyes ou vingt-quatre
piés. Ces excrémens font une efpece de caufti-
que, affez corrofif pour enlever tout-d’un-coup le
poil de l’endroit où ils tombent fur le corps des
chieps. Le bonafus habitoit autrefois une montagne
qui couvroit la Pæonie, & qui la féparoit d’un pays
voifin appelle Mcedica, qui Pteoniam Mcedicanique re-
gionctn terminât.
■ * BONAVOGLIO , (Hift. mod.) on défigne par
ce nom en Italie, ceux qui pour de l’argent & à
certaines conditions s’engagent à fervir fur les gale-
res, 8c qu’il faut diftinguer des efclaves 8c des forçats
qui font condamnés à ramer.
* BONBANC, f. m. (Architecture.) c’eft une efpece
de pierre fort blanche qui fe tire des carrières
qui font aux environs de la ville de Paris. Le bonbanc
fe
ïe rfioùlîne, & ne réfifte pas beaucoup ; il ne làiffé
pas néanmoins de durer affez long-tems, lorfqu’il
n’eft pas expofé aux injures de l’air ni à l’humidité.
Il a depuis quinze pouces jufqu’à vingt^-quatre de
hauteur ; on s’en fert aux façades intérieures des bâ-
timens, 8c pour faire des rampes 8c des appuis ; on
en tire aufli des colonnes : celui qui a un lit eoquil-
leux 8c des molieres, eft le meilleur.
* BON-CHRÉTIEN, f. m. (Jardinage.) efpecé dé
poire fort groffe & fort vantée pour la bonté de fon
goût. Il y en a de plufieurs efpeces ; les principales
font le bon-chrétien d’été, 8c le bon-chrétien d’hy ver :
celui d’eté eft beurré, long, pyramidal 8c affez
gros ; ce fruit porte jufqu’à quatre pouces de diamètre
par fon milieu, fur cinq à fix de hauteur ; fa
couleur naturelle eft jaune : il demeure fur l’arbre
depuis le mois de Mai jufqu’à la fin d’Oélobre, 8c fe
conferve quatre à cinq mois dans la ferre. Celui d’hy-
ver a la meme forme que celui d’été : fa chair eft caf-
fante, fa faveur agréable, 8c fon eau douce 8c fu-
crée. Son défaut eft d’être un peu coriaffe 8c pierreux.
Les curieux diflinguent plufieurs fortes de bon-
chrétiens , tant d’hyvèr que d’eté : mais toutes ces dif-
tin&ions font de fontaine.
La Quintinie fait encore mention du bon-chré-
tïen d’été mufqué , 8c du bon-chrétien d’Efpagne ; le
premier de ces fruits eft une poire de la groffeur d’une
belle bergamotte, blanche d’un côté, rouge de l’autre
, d’une chair entre le tendre 8c le caffant, 8c pleine
d’eau 8t de parfum. Le fécond a tout-à-fait la forme
du bon-chrétien d’hyver : mais il eft rouge d’un
cô té , 8t piqueté de points noirs, d’un blanc jaunâtre
de l’autre; fa chair eft très-caffante, fon eau douce,
fucrée, 8c affez agréable , quand il eft mûr ; ce qtii
arrive affez communément depuis la mi-Novembre
jufqu’à la mi-Décembre, 8c quelquefois en Janvier.
• Au refte on ne peut guere avoir aucun de ces bbh±
chrétiens d’une certaine beauté, qu’on n’en mette les
arbres en efpalier ; on n’en obtient autrement que
dans des jardins d’une expofition très-favorable.
BOND , corps en mouf.v*emm. efne td qittt ie rne jagiéllniét ràa ll-ad ree nl’ac&oniotrne dde’u lna
terre, Ou d’un autre corps fur lequel il tombe.
Bond , terme de Paumier , c’eft l’a&ion d’une balle
qui après avoir frappé par terré rejaillit 8c fe relève.
Une balle prife au premier bond eft aufli bonne que
celle qu’on renvoyé de volée : mais le fécond bond
ne vaut rien.
Bond faux. Le faux bond eft celui qui ne fe faiscaonrpt
ps ominûts feénlo lnig lnae r dégroléi toer,d itnroamirep ed ele l ’jionucieduern,c 8ec d leusi fait manquer la balle. Voye1 Réflexion.
Bond , (Manege.) eft un faut que Iè cheval fait
en s’élevant fubitement en l’air, 8c retombant à fa
lmeêrm. e( pVla)c e. Aller par fatits 8c rp ar bonds. Vo«yrezi AlBONDE
, f. f. eft une longue pièce de charpente
equarrie par un bout, 8t faite en forme de cône tronqué
, que l’on pofe dans un trou de la rigole pratiquée
à l’endroit le plus creux d’un étang , pour le
pouvoir vuider à fond quand on le veut pêcher. Cette
bonde eft foûtenue par un chaflis de charpente avec
un chapeau, ( if) .
* Bonde, (Hift. nat.) arbre d’uné grandeur 8c
groffeur prodigieiife qui le trouve au royaume de
Quoya ; il a plus de fix ou fept braffes d’épaiflêur ; Ion écorce eft toute hériffée d’épines ; fon bois eft
huileux : on en fait plufieurs uftenciles de ménage :
aufli bien que des canots : fes cendres leflivées font
dpreo lpar evsie ài lflaei rheu dilee fdoer td baottne sf.av on, en les mêlant avec
BONDEN ( Hifl. y i . ) c.efl un M famel]x
{ To°méh * 6 S 6 de Bothnie’ H HH
de loin comme lin grand château bîën bâti , 8c qui
deprès n eft qu’un affemblage de rochers.
BONDENO, (Géog.) bourg du Ferrarois dans fté-
tat du famt Siège, fur le Panaro, près de fon embouchure
dans le Pô.
BOND ON, terme de Tonnelier, eft une chevillé dé
■ Sroflf £ co»«6 dont on bouche le trou qu’ort
laifie au-deffus des tonneaux, pour pouvoir les rem*
plir 8c leur donner de l’air quand on le veut
Bondon fe prend aufli quelquefois pour lé trou
qu on ferme avec la cheville appellée bondon.
BONDONNER un tonneau, façon de parler qui fi-
gnine quelquefois y percer avec la bondonniere un
trou pour mettre le bondon, 8c quelquefois boucher
ce trou avec la cheville appellée bondon.
BONDONNIERE, inftrument de Tonnelier fût eil
forme de tarriere de figure conique , 8c dont le bout
qui fe termine en pointe eft amorcé 8c tourné en vis *
les Tonneliers s’en fervent pour percer dans une des
douves des futailles le trou où fe met le bondon. V.
T onnelier.
La bondonniere eft emmanchée dans le milieu, d’un
cylindre de bois long d’un p ié, rond, de deux pouces
ou environ de diamètre par le milieu, 8c plus petit
par les extrémités. Voye^ les Pl. du Tonnelier, 8C
celles du Taillandier. Ce font les Taillandiers qui font
les bondonnieres.
lI a ?fo°reNt ?Nto°.irReFs I ( GeV ) bourg de la Soiiabe dans
BONDRÉE , ( Hifl. nat. ) oifeau de rapine qui
a le bec court, la tête plate & grolîe, .le cou fort-
court, garni de beaucoup de plumes. Il efl ert-deffus
d une couleur brune & obfcure : mais il a le ventre
blanc .marqueté de plufieurs taches brunes, oblon.
gîtes ; il a la queue large. Aldrovandus lui donne trois
teiticules ; c’e/hce qui l’a fait appeller en Latin bu.
m trio refus'$ ce qui efi dérivé du mot Grec W « * » 1
Voye{ BuSEs .
BONDUC, f; m; (Hift. nat. bot.) genre de ofatK
te dont la fleur eft polypétale ou monopétale , pro^
fondement découpée en plufieurs parties , mais, cependant
d une figure approchante de celle des fleurs
irreguheresi II s’élève du fond du calice un piftil qui
devient dans la fuite un fruit en filique pointu, lé
plus fouvent hénffé de pointes : ce fruit renferme
up e .^ * fu x femences rondes, dures, & liftés. Plu-i
mier, nova plant. Amer, gener. Vùy. Plante, (ƒ) •
La plante nommée rnirn eft d’ufage en Medecine,
Ses baies font rondes & de couleur cendrée , blan-
ches en-dedans, ameres 8c infipides^
On s’en fert dans les hernies ,j elies diflïpent les
vents, foulagent dans la colique, fortifient l’eftomac -,
provoquent les réglés & chaflént la pierre. Date. (A't
BONELLES, (Géog.) petite ville de l’île de Fran.
ce à neuf lieues de Paris.
BON-HENRI, Bonus-Hmrkm, f, m. ( Hifl. nali
bot. ) plante qui doit fe rapporter au genre appellé
patte-d'oye. Voye[ Pa t t e -d’oie.
* Le bonus-henricus , ou la tota-bonà, a la ra*
cine epaiffe, jaunâtre , garnie de quelques fibres i
acre, & amere ; les tiges nombreufes, cannelées *
creufes, en partie droites, eh partie couchées fur là
terre, legerement velues * longues d’un pié du d’une
coudeè ; les feuijles triangulaires, comme celles de
1 arroche ou du pie-de-veau, & quelquefois afl'ez
femblables, liffes en-deffus, couvertes d’une fine farine^
en-deffous, portées fur de longues queues, 8c
pofées alternativement fur des tiges, d’une faveur un
peu nitreufe : les fleurs au fommet des tiges, ramaf-
fées en épi, petites, fans pétales, compofées de plii-*-
fieurs étamines jaunes qui s’élèvent d’un calice découpé
en plufieurs parties ; le piftil dégénérant en
une petite graine arrondie, applatie , approchant
de la forme de rein, noire dans fa maturité, renfer