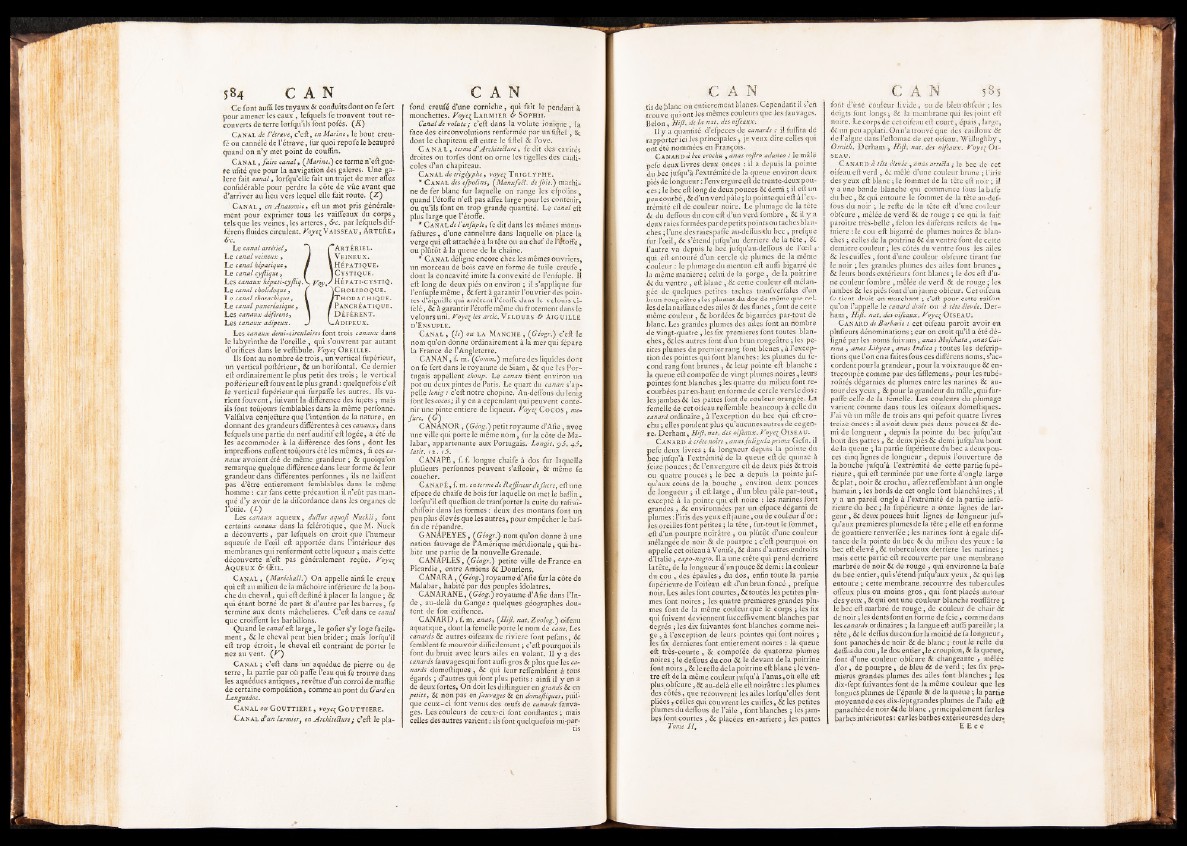
C e font auffi les tuyaux & conduits dont on fe fert
pour amener les eaux , lefquels fe trouvent tout recouverts
de terre lorfqu’ils font pofés. (A )
Canal de l'étrave, c’eft, en Marine , le bout creu-
fé ou cannélé de l’étrave, fur quoi repofe le beaupré
quand on n’y met point de couffin.
Canal , faire canal, {Marine.') ce terme n’eft guère
ufité que pour la navigation des galeres. Une galère
fait canal, lorfqu’elle fait un trajet de mer affez
confidérable pour perdre la côte de vue avant que
d’arriver au lieu vers lequel elle fait route. {Z)
' Canal , en Anatomie, eft un mot pris généralement
pour exprimer tous les vaiffeaux du corps,
tels que les veines, les arteres, &c. par lefquels dif-
férens fluides circulent. Voyei V aisseau , Artere ,
&c.
Le canal artériel,
Artériel.
Le canal veineux,
Veineux.
Le canal hépatique ,
Hépatique.
Le canal cyjlique , |
Cystique.
Les canaux hépati-cyjliq.
Voy.
Hépati-cystiq.
Le canal cholidoque ,
C holidoque.
Le canal thorachique ,
'Thorachique.
Le canal pancréatique ,
Pancréatique.
Les canaux déférent,
Déférent.
Les canaux adipeux.
Adipeux.
Les canaux demi-circulaires font trois canaux dans
le labyrinthe de l’oreille , qui s’ouvrent par autant
d’orifices dans le veftibule. Voye{ Oreille.
Ils font au nombre de trois, un vertical fupérieur,
un vertical poftérieur, & un horifontal. Ce dernier
eft ordinairement le plus petit des trois ; le vertical
poftérieur eft fouvent le plus grand : quelquefois c’eft
le vertical fupérieur qui furpaffe les autres. Ils varient
fouvent, fuivant la différence des fujets ; mais
ils font toûjours femblables dans la même perfonne.
Valfalva conjeâure que l’intention de la nature, en
donnant des grandeurs différentes à ces canaux, dans
lefquels une partie du nerf auditif eft logée, a été de
les accommoder à la différence des fons , dont les
impreffions euffent toûjours été les mêmes, fi ces canaux
avoient été de même grandeur ; & quoiqu’on
remarque quelque différence dans leur forme & leur
grandeur dans différentes perfonnes , ils ne laiffent
pas d’être entièrement femblables dans le même
homme : car fans cette précaution il n’eût pas manqué
d’y avoir de la difcordance dans les organes de
l’oiiie. (L)
Les canaux aqueux, ductus aquoji Nuckii, font
certains canaux dans la felérotique, que M. Nuck
a découverts , par lefquels on croit que l’humeur
aqueufe de l’oeil eft apportée dans l’intérieur des
membranes qui renferment cette liqueur ; mais cette
découverte n’eft pas généralement reçûe. Voye^
Aqueux & OEil.
Canal , (Maréchall.) On appelle ainfi le creux
qui eft au milieu de la mâchoire inférieure de la bouche
du cheval, qui eft deftiné à placer la langue ; &
qui étant borné de part & d’autre par les barres, fe
termine aux dents mâchelieres. C ’eft dans ce canal
que croiffent les barbillons.
Quand le canal eft large, le gofier s’y loge facilement
, & le cheval peut bien brider ; mais lorfqu’il
eft trop étroit, le cheval eft contraint de porter le
nez au vent. ( V )
Canal ; c’ eft dans un' aquéduc de pierre ou de
terre, la partie par où paffe l’ëau qui fe trouve dans
les aquéducs antiques, revêtue d’un corroi de maftic
de certaine compofition, comme au pont du Gard en
Languedoc.
Canal ou Gouttière , voye% Gouttière.
Canal d'un larmier, en Architecture ; c’eft le plafond
creüfé d’une corniche, qui fait le pendant à
mouchettes. Voyei Larmier & Sophii.
Canal de volute ; c’eft dans la volute ionique , la
face des circonvolutions renfermée par un fiftel, &
dont le chapiteau eft entre le fiftel & l’ove.
C a n a l , terme d'Architecture, fe dit des-cavités
droites ou torfes dont on orne les tigelles des cauli-
coles d’un chapiteau.
Canal de triglyphe, voye{ T riglyphe.
* Canal des efpolins, (Manufacl. de Joie.) machine
de fer blanc fur laquelle on range les efpolins ,
quand l’étoffe n’eft pas affez large pour les contenir,
ou qu’ils font en trop grande quantité. Le canal eft
plus large que l’étoffe.
* Canal t/c Venfuple, fe dit dans les mêmes manufactures
, d’une cannelure dans laquelle on place la
verge qui eft attachée à la tête ou au chef de l’étoffe,
ou plûtôt à la queue de la chaîne.
* Canal défigne encore chez les mêmes ouvriers,
Un morceau de bois cave en forme de tuile creufe,
dont la concavité imite la convexité de l’enfuple. Il
eft long de deux piés ou environ ; il s’applique fur
l’enfuple même, & fert à garantir l’ouvrier des pointes
d’àiguille qui arrêtent l’étoffe dans le velours ci-
felé, & à garantir l’étoffe même du frotement dans le
velours uni. Voye{ les artic. Velours & Aiguille
d’Ensuple.
Canal , {le) ou la Manche , {Géogr.) c’eft le
nom qu’on donne ordinairement à la mer qui fépare
la France de l’Angleterre.
' CANAN, f. m. {Comm.) mefure des liquides dont
on fe fert dans le royaume de Siam, & que les Portugais
appellent choup. Le canan tient environ un
pot ou deux pintes de Paris. Le quart du canan s’appelle
lenig : c’eft notre chopine. Au-deffous du lenig
font les cocos; il y en a cependant qui peuvent contenir
une pinte entière de liqueur. Voye? C o c o s , mefure
Hi ' CANANOR, {Geog.) petit royaume d’Afie, avec
une ville qui porte le même nom, fur la côte de Malabar,
appartenante aux Portugais. Longit. $ 5. 4S.
latit. ix . iS.
CANAPÉ, f. f. longue chaife à dos fur laquelle
plufieurs perfonnes peuvent s’affeoir, & même fe
coucher.
CANAPÉ, f. m. en terme de Raffineur defucre, eft une
efpece de chaife de bois fur laquelle on met le baffin,
lorfqu’il eft queftion de tranfporter la cuite du rafraî-
chiffoir dans les formes : deux des montans font un
peu plus élevés que les autres, pour empêcher le bal-
fin de répandre.
GANAPEYES, (Géogr.) nom qu’on donne à une
nation fauvage de l’Amérique méridionale, qui habite
une partie de la nouvelle Grenade.
CANAPLES, {Géogr.) petite ville de France en
Picardie, entre Amiens & Dourlens.
C ANARA, {Géog.) royaume d’Afie fur la côte de
Malabar, habité par des peuples idolâtres.
CANARANE, {Géog.) royaume d’Afie dans l’Inde
, au-delà du Gange : quelques géographes doutent
de fon exiftence.
CANARD, f. m, anas, {Hiß. nat. Zoolog J) oifeau
aquatique, dont la femelle porte le nom de cane. Les
canards & autres oifeaux de riviere font pefans, &
femblent fe mouvoir difficilement ; c’eft pourquoi ils
font du bruit avec leurs ailes en volant. Il y a des
canards fauvages qui font auffi gros & plus que les canards
domeftiques , & qui leur reffemblent à tous
égards ; d’autres qui font plus petits : ainfi il y en a
de deux fortes, On doit les diftinguer en grands & en
petits, & non pas en fauvages & en domefliques, puif-
que ceux-ci font venus des oeufs de canards fauvages.
Lés couleurs de ceux-ci font confiantes ; mais
celles des autres varient : ils font quelquefois mi-partis
tis deblahc où entièrement blancs. Cependarit il s’en
trouve qui ont les mêmes couleurs que les fauvages.
Selon, Hift. de la nat. des oifeaux-.
Il y a quantité d’efpeces de canards ;• il fuffira dé
rapporter ici les principales , je veux dire celles qui
©nt été nommées en François.
CANARD à bec crochu , anas rojtro adunco : le malë
pefe deux livres deux onces : il a depuis la pointe
du bec jufqu’à l’extrémité de la queue environ deux
piés de longueur : l’envergure eft de trente-deux pouces
; le bec eft long de deux pouces & demi ; il eft un
peu courbé, & d’un verd pâle ; la pointe qui eft à l’ex-
trémité eft de couleur noire. Le plumage de la tête
& du deffous du cou eft d’un verd fombre , & il y a
deux raies formées par de petits points ou taches blanches
; l’une, des raies paflè au-deflusAlu bec -, prefque
fur l’oeil, & s’étend jufqu’au derrière de la tête , ôe
l’autre va depuis le bec jufqu’au-deffous de l’oeil j-
qui eft entouré d’un cercle de plumes de la même
couleur : le plumage du menton eft auffi bigarré de
la mêmetnaniére ; celui de la gorge , de la poitrine
&c du ventre , eft blanc , & cette couleur eft mélangée
de quelques petites taches tranfverfales d’un
brun rougeâtre ; les*plumes du dos de même que celles
de la naiffanee des ailes & des flancs, font de cette
même couleur, & bordées & bigarrées par-tout de
blanc. Les grandes plumes des ailes font au nombre
de vingt-quatre , lès fix premières font toutes blanches
, & les autres font d’un brun rougeâtre ; les petites
plumes du premier rang font bleues , à l’exception
des pointes qui font blanches : les plumes du fécond
rang font brunes , & leur pointe eft blanche :
la queue eft eompofée de vingt plumes noires, leurs
pointes font blanches ; les quatre du milieu font recourbées
par en-haut en forme de cercle vers le dos :
les jambes & les pattes font de couleur orangée. La
femelle de cet oifeau reffemble beaucoup à celle du
canard ordinaire, à l’exception du bec qui eft crochu
; elles pondent plus qu’aucunes autres de ce genre.
Derham, Hijh nat. des oifeaux. Voye[ OlSEAU;
CANARD à crête noire , anasfuligulaprima Gefn. il
pefe deux livres ; fa longueur depuis la pointe du
bec jufqu’à l’extrémité de la queue eft de quinze à
feize pouces ; & l’envergure ëft de deux piés & trois
ou quatre pouces ; le bec a depuis la pointe juf-
qu’aux coins de la bouche , environ deux pouces
de longueur ; il eft large, d’un bleu pâle par-tout ,
excepté à la pointe qui eft noire : les narines, font
grandes > & environnées par un efpace dégarni de
plumes : l’iris des yeux eft jaune, ou de couleur d’or :
les oreilles font petites ; la tête, fur-toüt le fommet,
eft d’un pourpre noirâtre , ou plûtôt d’une couleur
mélangée de noir & de pourpre ; c’eft pourquoi on
appelle cet oifeau à Venife, & dans d’autres endroits
d’Italie, capo-negro. Il a urie crête qui pend derrière
la tête, de la longueur d’un pouce & demi : la couleur
du cou , des épaules, du dos, enfin toute la partie
fupérieure de l’oifeau eft d’un brun foncé , prefque
hoir. Les ailes font courtes, & toutes les petites plumes
font noires ; les quatre premières grandes plu*
mes font de la même couleur que le corps ; les fix
qui fuivent deviennent fucceffivement blanches par
degrés ; les dix fuivantes font blanches comme neigé
, à l’exception de leurs pointes qui font noires ;
les fix dernieres font entièrement noires : là queue
eft très-courte , & eompofée de quatorze plumes
noires ; le deffous du cou & le devant de la poitrine
font noirs ,& le refte delà poitrine eft blanc ; le ventre
eft de la même couleur jufqu’à l’anus, où elle eft
plusobfcure, & aü-dëlà elle eft noirâtre : les plumes
des côtés, que recouvrent les ailes lorfqu’elles font
pliées, celles qui couvrent les cuiffes, & les petites
plumes du deffous de l’aile , font blanches ; les jam-
jbçs foqt courtes , & placées en-arriéré ; les pattes
Tome II,
font cî’urtè douleur livide, ou dé bleti ôbfciir ; les
doigts font longs , &c la membrane qui les joint eft
noire. Le corps de cèt oifeaü eft court, épais, large,
& un peu applati. On n’a trouvé que des cailloux ôc
de l’algue dans l’eftomac de cet oifeau. Willughby,
Ornith. Derham , Hiß\ nat. des oifeaux. Voye£ O f-
SEAÜ/i- ,
Canard a tête élevée , ànàs arrecta • le bec de cet
oifeau eft verd , & mêlé d’une couleur brune ; l’iris
des yeux eft blanc ; le fommet de la tête eft noir ; il
y a une bande blanche qui commence fous la bafe
du bec, & qui entoure le fommet de la tête au-deffous
du noir ; le refte de la tête eft d’une couleur
obfcure , mêlée de v erd'& de rouge ; ce qui la fait
paroître très-bellè, félon les différens reflets de lumière
: le cou eft bigarré de plumes noires & blanches
; celles de la poitrine & du ventre font de cette
derniere couleur ; les côtés du ventre fous les ailes
& les cuiffes , font d’une couleur obfcure tirant fur
le noir ; les grandes plumes des ailes font brunes ,
& leurs bords extérieurs font blancs ; le dos eft d’une
couleur fombre , mêlée de verd & de rouge ; les
jambes & les piés font d’un jaune obfcur. Cet oifeau
fe tient droit en marchant ; c’eft pour cette raifort
qu’on l’appelle le canard droit Ou à tête élevée. Derham
, Hiß. nat. des oifeaux. Voyeç OtSEAUi
Canard de Barbarie : cet oifeau paroît avoir eu
plufieurs dénominations ; car on croit qu’il a été dé-
figné par les noms fuivans , anas Mofchata, anas Cai-
rina , anas Libyca, anas Indica ; toutes les deferip-
tions que l’on ena faites fous ces différens noms, s’accordent
pour la grandeur, pour la voixrauque & entrecoupée
comme par des fifllemens ,* pour les tubé-
rofités dégarnies de plumes entre les narines & autour
des yeux, & pour la grandeur du mâle, qui furpaffe
celle de la féffielle. Les couleurs du plumage
varient comme dans tous les oifeaux domeftiques.
J’ai vû un mâle de trois ans qui pefoit quatre livres
treize onces : il avoit deux piés deux pouces & demi
de longueur -, depuis la pointe du bec jufqu’au
bout des pattes j & deux piés & demi jufqu’au bout
de la queue ; la partie fupérieure du bec a deux pouces
cinq lignes de longueur , depuis l’ouverture dé
la bouche jufqu’à l’extrémité de cette partie fupérieure
, qui eft terminée par une forte d’ongle large
& plat, noir ôc crochu, affez reffemblant à un onglé
humain ; les bords de cet ongle font blanchâtres ; il
y a un pareil ongle à l’extremité de la partie inférieure
du bec ; la fupérieure a onze lignes de largeur
, & deux pouces huit lignes de longueur juf-
qu’aux premières plumes de la tête ; elle eft en forme
de gouttière renverfée ; les narines font à egale dif-
tance de la pointe du bec & du milieu des yeux : le
bec eft élevé, & tuberculeux derrière les narines ;
mais cette partie eft recouverte par une membrane
marbrée de noir & de rouge i qui environne la bafe
du bec entier, qui s’étend jufqu’aux yeux, &c qui les
entoure ; cette membrane, récouvre des tubercules
offeux plus ou moins gros , qui font placés autour
des y eu x, &qui ont une couleur blanche rouffâtre ;
le bec eft marbré de rouge, de couleur de chair &
de noir ;les dents font en forme de feie , comme dans
les canards ordinaires ; la langue eft auffi pareille; la
tête , & lè deffüs du cou fur la moitié de fa longueur ^
font panachés de noir & de blanc ; tout le refte du
deffus du cou , le dos entier, le croupion, & la queue*
font d’une couleur obfcure & changeante mêlée
d’o r, de pourpre , de bleu & de verd ; les fix premières
grandes plumes des ailes font blanches ; les
dix-fept fuivantes font de la même couleur que les
| longues plumes de l’épaule & de la queue ; la partie
moyenne de ces dix-fept grandes plumés de l’aile eft
panachée de noir & de blanc , principalement furies
barbes intérieures : car les barbes extérieures des der«