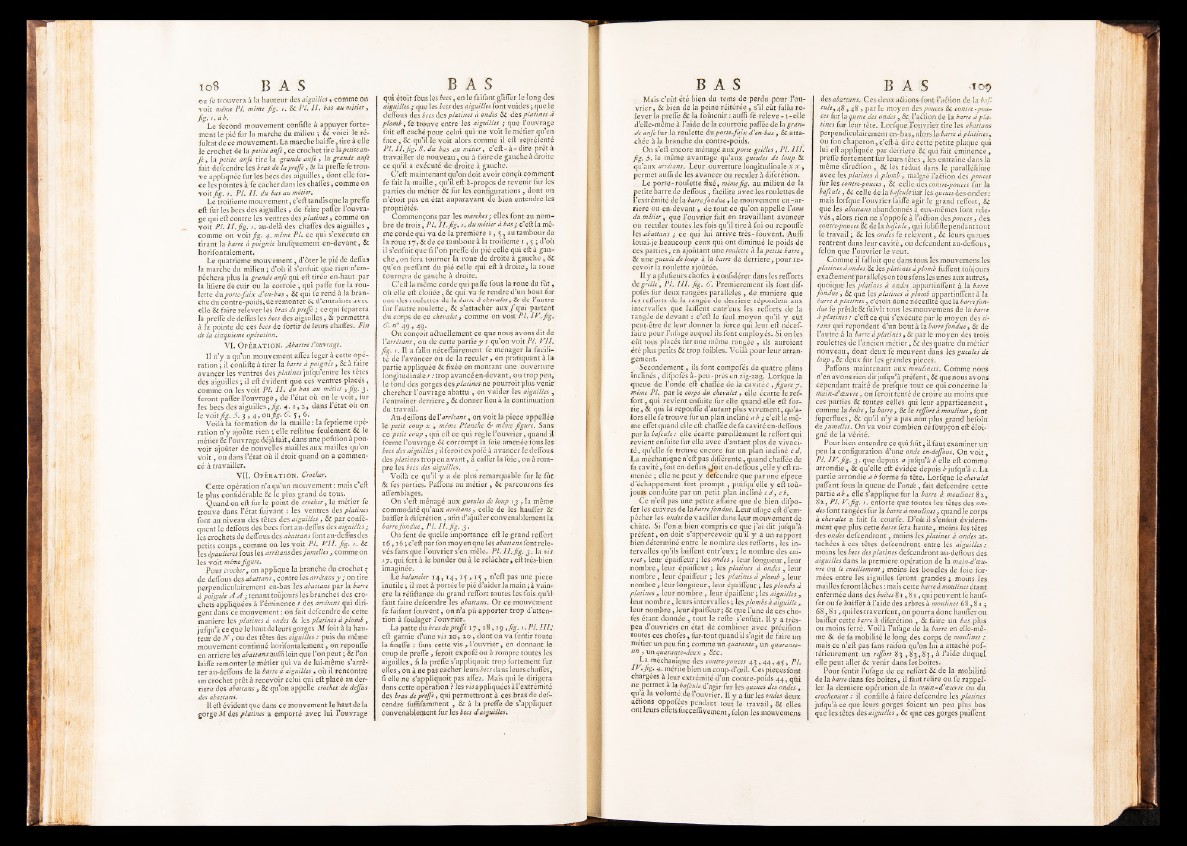
ou fe trouvera à la hauteur des aiguilles , comme on
voit même PI. même fig. t. ÔC.PL II. bas au métier,
^Le fécond mouvement confifte à appuyer fortement
le pié fur la marche du milieu ; & voici le ré-
fultat de ce mouvement. La marche baiffe, tire à elle
le crochet de la petite anfe, ce crochet tire la petite anf
e , la petite anfe tire la grande anfe, la grande anfe
fait defeendre les bras de laprejffé, & la preffe fe trouve
appliquée fur les becs des aiguilles, dont elle force
les pointes à fe cacher dans les chafl.es, comme on
y Oit fig. t. PI. II. du bas au metier.
Le troifieme mouvement, e’eft tandis que la preffe
eft fur les becs des aiguilles, de faire palier l’ouvrage
qui eft contre les ventres des platines, comme on
voit PI. II. fig. i. au-delà des chaffes des aiguilles ,
comme on voit fig. 4. même PL ce qui s’exécute en
tirant la barre à poignée brufquement en-devant, &
horifontalement.
Le quatrième mouvement, d’ôter le pié de deffus
la marche du milieu ; d’oii il s’enfuit que rien n’empêchera
plus la grande anfe qui eft tirée en-haut par
la lifiere de cuir ou la corroie, qui paffe fur la roulette
du portefaix d'en-bas , Sc qui fe rend à la branche
du contre-poids, de remonter Sc d’entraîner avec
elle Sc faire relever les bras dipreffe. ; ce qui féparera
la preffe de deffus les becs des aiguilles, & permettra
à la pointe de ces becs de fortir de leurs chaffes. Fin
de la cinquième opération.
VI. Opération. Abattre l'ouvrage.
Il n’y a qu’un mouvement affez leger à cette opération
; il confifte à tirer la barre à poignée, &.à faire
avancer les ventres des platines jufqu’entre les têtes
des aiguilles ; il eft évident que ces ventres placés,
comme on les voit PL II. du bas au métier , fig. 3.
feront paffer l’ouvrage, de l’état où on le voit , fur
les becs des aiguilles,fig. 4. 1 , 2, dans l’état ou on
le voit fig. 5. 3 j 4 , ou fig. <?. 5 ,6 . f
Voilà la formation de la maille : la feptieme operation
n’y ajoûte rien ; elle reftitue feulement Sc le
métier Sc l’ouvrage déjà fait, dans une pofition à pouvoir
ajouter de nouvelles mailles aux mailles qu’on
v o it , ou dans l’état où il étoit quand on a commencé
à travailler.
VII. Opération. Crocher.
Cette opération n’a qu’un mouvement : mais c’eft
le plus eonfidérable Sc le plus, grand de tous.
Quand on eft fur le point de crocher, le métier fe
trouve dans l’état fuivant : les ventres des platines
font au niveau des têtes des aiguilles, Sc par confe-
quent le deffous des becs fort au-deffus des aiguilles ;
les crochets de deffous des abattans font au-deffus des
petits coups , comme on les voit PL VII. fig. /. Sc
les épauüeres fous les arrêtons des jumelles , comme on
les voit même figure.
Pour crocher, on appliqué la branche du crochet {
de deffous des abattans, contre les arrêtans y ; on tire
perpendiculairement en-bas les abattans par la barre
à poignée A A ; tenant toujours les branches des crochets
appliquées à l’éminence t des arrêtans qui dirigent
dans ce mouvement : on fait defeendre de cette
maniéré les platines à ondes & leS platines à plomb,
jufqu’à ce que le haut de leurs gorges M foit à la hauteur
de N , ou des têtes des aiguilles : puis du même
mouvement continué horifontalement, on repouffe
en arriéré les abattans aufli loin que l’on peut ; Sc l’on
laiffe remonter le métier qui va de lui-même s’arrêter
au-deffous de la barre à aiguilles , où il rencontre
un crochet prêt à recevoir celui qui eft placé au derrière
des abattans , Sc qu’on appelle crochet de deffus
des abattans.
Il eft évident que dans ce mouvement le haut de la
gorge M des platines a emporté avec lui l’ouvrage
qui étoit fous les becs, en le faifant gliffer le long des
aiguilles ; que les becs des aiguilles font vuides ; que le
deffous des becs des platines à ondes Sc dés platines à
plomb, fe trouve entre les aiguilles ; que l’ouvrage
fait eft caché pour celui qui ne^ voit le métier qu’en
face, Sc qu’il le voit alors comme il eft reprélenté
PI. II. fig. 8. du bas au métier, c’eft-à--dire prêt à
travailler de nouveau, ou à faire de gauche à droite
ce qu’il a exécuté de droite à gauche.
G’eft maintenant qu’on doit avoir conçu comment
fe fait la maille, qu’il eft à-propos de revenir fur les
parties du métier Sc fur les configurations, dont on
n’étoit pas en état auparavant de bien entendre les
propriétés.
Commençons par les marches; elles font au nombre
dé trois, PL II. fig. 1. du métier a bas ; c’eft la même
corde qui va de la première 1 , 5, au tambour de
la roue 17, & de ce tambour à la troifieme 1 ,5 ; d’où
il s’enfuit que fi l’on preffe du pié celle qui eft à gauche
, on fera tourner la roue de droite à gauche, &c
qu’en preffant du pié celle qui eft à droite, la roue
tournera de gauche à droite.
C’eft la même corde qui paffe fous la roue du fû t ,
où elle eft cloiiée, & qui va fe rendre d’un bout fur
une des roulettes de la barre à chevalet, & de l’autre
fur l’autre roulette, Sc s’attacher aux ƒ qui partent
du corps de ce chevalet, comme on voit PI. IV.fig.
G. n° 49 ,4 9.
On conçoit a&uellement ce que nous avons dit de
l'arrêtant, ou de cette partie^ / qu’on voit Pl. VII.
fig. 1. Il a fallu néceffairement fe ménager la facilité
de l’avancer ou de la reculer, en pratiquant à la
partie appliquée & fixée en montant une ouverture
longitudinale r : trop avancé en-devant, ou trop peu,
le fond dès gorges des platinés ne poutroit plus venir
chercher l’ouvrage abattu , en vuider les aiguilles ,
l’entraîner derrière, Sc donner lieu à la continuation
du travail.
Au-deffous de l’arrêtant, on voit la piece appellée
le petit coup x , même Planche 6* même figure. Sans
ce petit coup, qui eft ce qui réglé l’ouvrier, quand il
forme l’ouvrage Sc corrompt la foie amenée fous les
becs des aiguilles ; ilferoitexpofé à avancer le deffous
des platines trop en avant, à caffer la foie, ou à rompre
les becs des aiguilles.
Voilà ce qü’il y a de plus remarquable fur le fut
& fes parties. Paffons au métier, Sc parcourons fes
afîemblages.
On s’eft ménagé aux gueules de loup 13 , la même
commodité qu’aux arrêtons, celle de les hauffer &
baiffer à diferétion, afin d’ajufter convenablement la
barre fondue , Pl. I I . fig. 3 .
On fent de quelle importance eft le grand reffort
16 ,16 ; c’eft par fon moyen que les abattans font relevés
fans que l’ouvrier s’en mêle. Pl. II. fig. 3 . la vis
ty. qui fert à le bander ou à le relâcher, eft très-bien
imaginée.
Le balancier 1 4 , 1 4 , 1 5 , 1 5 , n’eft pas une piece
inutile ; il met à portée le pié d’aider la main ; à vaincre
la réfiftanee du grand reffort toutes les fois qu’il
faut faire defeendre les abattans. Or ce mouvement
fe faifant fouvent, on n’a pu apporter trop d’attention
à foulager l’ouvrier.
La patte du bras de preffe 1 7 ,1 8 ,1 9 ,fig. 1. Pl. I I I2
eft garnie d’une vis îo , 20, dont on va fentir toute
la fineffe : fâns cette v is , l ’ouvrier, en donnant le
coup de preffe, feîoit expofé ou à rompre toutes les
aiguilles, fi la preffe s’appliquoit trop fortement fur
elles, Ou à ne pas cacher leurs becs dans leurs chaffes,
ft elle-ne s’appliquoit pas âffez. Mais qui le dirigera
dans cette opération r les vis appliquées à l’extrémité
des bras de preffe, qui permettront à ces bras de defeendre
fufEfamihent , & à la preffe de s’appliquer
convenablement fur les becs #aiguilles.
Mais c’eût été bien du tems de perdu pour l’ouvrier,
& bien de la peine réitérée , s’il eût fallu relever
la preffe & la loûtenir : aufti fe releve - 1 - elle
d’elle-même à l’aide de la courroie paffée de la grande
anfe fur la roulette du porte fa ix d'en-bas , Sc attachée
à la branche du contre-poids.
On s’eft encore ménagé aux porte-grilles, Pl. III.
fig. b. le même avantage qu’aux gueules de loup &
' qu’aux arrêtans. Leur ouverture longitudinale x x ,
permet aufli de les avancer ou reculer à diferétion.
Le porte - roulette fixé, même fig. au milieu de la
petite barre de deffous , facilite avec les roulettes de
l ’extrémité de:1a barre fondue ,lemouvement en-ar-
riere ou en-devant, de tout ce qu’on appelle l'ame
du métier, que l’ouvrier fait en travaillant ayancer
ou reculer toutes les fois qu’il tire à foi ou repouffe
les abattans ; ce qui lui arrive très-fouvent. Aufli
louai-je beaucoup ceux qui ont diminué le poids de
ces parties, en ajoûtant une roulette à la petite barre,
& une gueule de loup à la barre de derrière, pour recevoir
la roulette ajoûtée.
II y a plufienrs chofes à confidérer dans les refforts
de grille, Pl. III. fig. 6. Premièrement ils font dif-
pofés fur deux rangées parallèles , de maniéré que
les refforts de la rangée de derrière répondent aux
intervalles que laiffent entr’eux les refforts de la
rangée de devant j c’eft le feul moyen qu’il y eût
peut-être de leur donner la force qui leur eft néeef-
faire pour l’ufage auquel ils font employés. Si on les.
eût tous placés fur une même rangée , ils auroient
été plus petits Sc trop foibles. Voilà pour leur arrangement.
.. • Secondement, ils font compofés de quatre plans
inclinés, difpofés à - peu - près en zig-zag. Lorfque la
queue de l’onde eft chaffée dela cavité c , figure y.
même Pl. par le corps du chevalet, elle écarte le reffort
* qui revient enfuite fur elle quand elle eft for-
îie , & qui la repouffe d’autant plus vivement, qu’a-
lors elle fe trou ve fur un plan incliné a b ; c’eft le même
effet quand elle eft chaffée de fa cavité en-deffous
par la bafcule: elle écarte pareillement le reffort qui
revient enfuite fur elle avec d’autant plus de vivacité,
qu’elle fe trouve encore fur un plan incliné c d.
La méchanique n’eft pas différente, quand chaffée de
fa cavité, foit en deffus fo i t en-deffous, elle y eft ramenée
; elle ne peut y defeendre que par une efpece
d’échappement fort prompt , puifqu’elle y eft toû-
jours conduite par un petit plan incliné c d , cb.
Ce n’eft pas une petite affaire que de bien difpo-
fer les cuivres de la barre fondue. Leur ufage eft d’empêcher
les ondes de vaciller dans leur mouvement de
chûte. Si l’on a bien compris ce que j’ai dit jufqn’à
préfent, on doit s’âppercevoir qu’il y a un rapport
bien déterminé entre le nombre' des refforts, les intervalles
qu’ils laiffent entr’eux ; le nombre des cuivres,
leur épaiffeur ; les ondes, leur longueur, leur
nombre, leur épaiffeur ; les platines à ondes , leur
nombre, leur épaiffeur ; les platines à plomb , leur
nombre , leur longueur, leur épaiffeur ; lesplombs à
platines , leur nombre, leur épaiffeur; les aiguilles ,
leur nombre, leurs intervalles ; les plombs a aiguille ,
leur nombre, leur épaiffeur ; & que l’une de ces chofes
étant donnée , tout le refte s’enfuit. Il y a très-
peu d’ouvriers en état de combiner avec préeifion
toutes ces chofes, fur-tout quand il-s’agit de faire un
métier un peu fin ; comme un quarante, un quarante-
un » un quarante-deux , &c.
La méchanique des contre-ponces 4 3 ,44 ,45 PL
IV. fig. 4• mérite bien un eoup-d’oeil. Ces pièces font
chargées à leur extrémité d’un contre-poids 44, qûi
ne^permet à la bafcule d’agir fur les queues des ondes ,
qu à la volonté de l’ouvrier, il y a fur les ondes deux
actions oppofées pendant tout le travail, & elles
ont leurs effets fuçceflivement, félon les mouvemens
des abat fans. Ces deux actions font Taétion de la bafcule,
48,48 , par le moyen des pdtfces & contre-pouces
fur la queue des ondes, & l’aétion de la barre à platines
fur leur tête. Lorfque l ’onyrier tire les abattans
perpendiculairement en-bas,j alors la barre à platines,
ou fon chaperon, o’ert-à dire tette' petite plaque qui
lui eft appliquée par derrière & qui fait éminence,
preffe fortement fur leurs têtes j les entraîne daiis la
même direction , & lès réduit dans le. parallé.Iifme
avec les platines à plomb , malgré i’aétion des pouces
fur les contrerpouces, & celle, Aqs, contre-pouces fur la
bafcule, & celle de labafcule fuf les quelles des ondes :
mais lorfque l’ouvrier laiffe agir ie grand reffort, &c
que les abattans abandonnés à eux-mêmes font relevés
, alors ri,én ne s^oppofe à l’aftion des pouces , des
contre-pouces St de la bafcule, qui fubïiftependànftoiit
le travail ; & les ondes fe releyent, & leurs queues
rentrent dans leur cavité, où defeendent au-deffous ,
félon que l’ouvrier le veut.
Comme il falloit que dans tous lès mouvemens les
platines à ondes & les platinés aplomb fuffent tQÛjours
exaélement'parallelesen tous fens les unes aux autres,,
quoique les platines à ondes appartinffent à la barre
fondue, & que les platines à plomb appartinffent à la
barre à platines , c’étoit donc néceflité que la barre fondue
fe prêtât Si fuivît tous les mouvemens de là barre
à platirtes : c’eft ce qui s’exécute par le moyen des titans
qui répondent d’un bout à Va barre fondue, & de"
l’autre à la barre à platines, & par le moyen des trois
roulettes de l’ailcien métier, Sc des quatre du métier
nouveau, dont detiX fc meuvent dans les gueules de
loup, & deux fur les grandes pièces.
Paffons maintenant aux moulinets. Comme noüs-
rî’en avons rien dit jufqu’à ptéfent, & que nous avons
cependant traité de prèfque tout ce qui concerne la
fhain-d'Oeuvre. on feroit tenté de croire au moins que
ces parties Sc toutes celles qui leur appartiennent ,
comme la boîte , la barre , Sc le reffort à moulinet, font
fuperfluesf, Sc qu’il n’y a pas non plus grand befoin
de jumelles. On va voir combien ce foupçon eft éloigné
de là vérité.
Pour bien entendre ce qui fuit ; il faut examiner un-
peu la configuration d’une onde en-deffous. Oh v o it ,
Pl. IV. figj 3 . que depuis a jufqu’à b elle eft comme
arrondie, & qu’elle eft évidée depuis b jufqu’à c. La
partie arrondie a b forme fa tête. Lorfque le chevalet
paffant fous la queue de l'onde, fait defeendre cette
partie ab, elle s’applique fur la barre à moulinet S i ,
82, PL V fig. 1. enforte que toutes les têtes des ondes
font rangées fur la barre à moulinet, quand le corps
à chevalet a fait fa courfe. D ’où, il s’enfuit évidemment
que plus cette barre fera haute, moins les têtes
des ondes defeendront, moins les platines à ondes attachées
à ces têtes defeendront entre les aiguilles :
moins les becs des platines defeendront au-deffous des
aiguilles dans la première opération de la main-d'oeuvre
ou le cueillement ; moins les boucles de foie formées
entre les aiguilles feront grandes ; moins les
mailles feront lâ cries : mais cette barre à moulinet étant
enfermée dans des bottes 8 1 ,8 1 , qui peuvent fè hauffer
ou fe baiffer à l’aide des arbres à moulinet 6 8 ,8 1 ;
6 8 ,8 1 , qui les traverfent, on pourra donc hauffer ou
baiffer cette barre à diferétion , & faire un bas plus
ou moins ferré. Voilà l’ufage de la barre en elle-même
& de fa mobilité le long des corps de moulinet :
mais ce n’eft pas fans raifon qu’on lui a attaché pof-.
' térieurement un reffort 83,83,83 , à l’aide duquel
elle peut aller Sc venir dans les boîtes.
Pour fentir l’ufage de ce reffort & de la mobilité
de la barre dans fes boîtes, il faut relire ou fe rappel-
ler la derniere opération de la main-d'oeuvre ou du
crochetrient : il confifte à faire defeendre les platines
jufqu’à ce que leurs gorges foient un peu plus bas
que les têtes des aiguilles , Sc que ces gorges puiffent