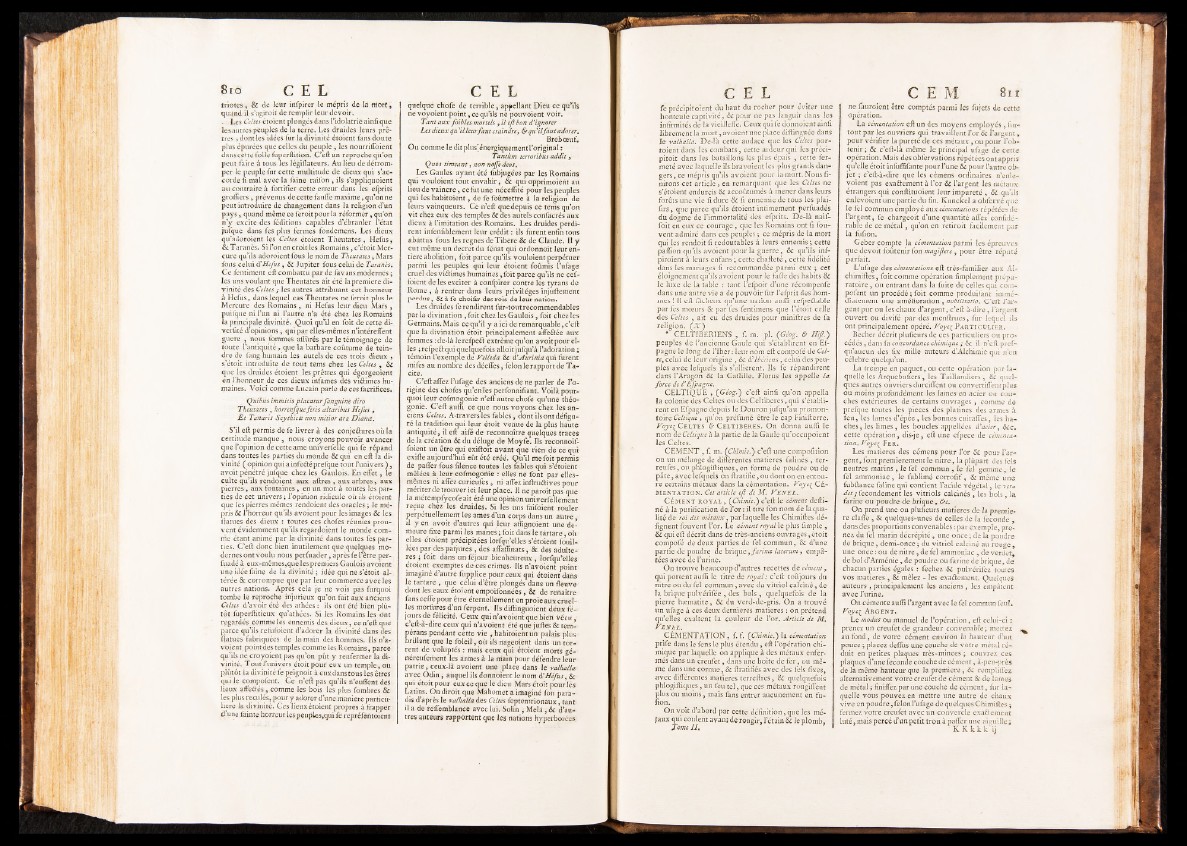
triâtes >, & de leur irifpirer le mépris de là n ior t,
^ ivM il s’-agii’oit de remplir lèur devoir.
• Les Celtes étoient plongés dans l’idolatriè ainfi que
les autres peuples de la terre. Les druides leurs prêtres
, dofttles idées fur la divinité étoient fans doute
plus épurées que celles du peuple * les nourriffoient
dans cfette folle fuperftition. C ’eft un reproche qu’on
peut faire à tous les légiflateurs. Au lieu de détromper
le peuple fur cette multitude de dieux qui s’accorde
fi mal avec la faine raifon , ils s’appliquoient
au contraire à fortifier cëtte erreur dans les efprits
groffiers * prévenus de cette fauffe maxime, qu’on ne
peut introduire de changement dans la religion d’un
p a y s , quand même ce feroit pour la réformer, qu’on
n’y excite des féditions capables d’ébranler l’état
jufque dans fes plus fermes fondemens. Les dieux
qu’adoroient les Celtes étoient Theutates , Hefus,
& Taranès. Si l’on en croit les Romains, c’étoit Mercure
qu’ils adoroient fous le nom de Theutates -, Mars
fous celui d’Hefus, & Jupiter fous celui de Tarants.
C e fentiment eft combattu par de favans modernes ;
les uns voulant que Theutates ait été la première divinité
des Celtes ; les autres attribuant cet honneur
à Hefus, dans lequel cas Theutates ne feroit plus le
Mercure des Romains , ni Hefus leur dieu Mars ,
puifque ni l’un ni l’autre n’a été chez les Romains
la principale divinité. Q u oi qu’il en foit de cette di-
verfité d’opinions ; qui par elles-mêmes n’intéreffent
guere , nous femmes allurés par le témoignage de
toute l’antiquité , que la barbare coutume de teindre
de fang humain les autels de ces trois dieux ,
s’étoit introduite de tout tëms chez les Celtes , &
que les druides étoient les prêtres qui égorgeoierit
en l ’honneur de ces dieux infâmes dés viôimes humaines.
Vo ici comme Lucain parle dé ces facrifices.
Quibus iihthitis placatur fanguiht diro
Tkeittates , hàrrehfque feris altaribus Hefus ,
Et Tamaris Scythica non mitior ara Diana,
S’il eft permis de le livrer à des conjectures Ou la
certitude manque , nous croyons pouvoir avancer
que l’opinion de cette ame univerfelle qui fe répand
dans toutes les parties du monde & qui en eft la divinité
( opinion qui a infeété prefque tout l’univers ) ,
av o it pénétré jufque chez les Gaulois. En e ffe t, le
culte qu’ils rendoient aux aftres , aux arbres -, aux
pierres, aux fontaines, en un mot à toutes les parties
de cet univers ; l ’opinion ridicule où ils étoient
que les pierres mêmes rendoient des oracles ; le mépris
& l ’horreur qu’ils avoient pour les images & les
ftatues des dieux : toutes ces chofes réunies prouvent
évidemment qu’ils regardoient le monde comme
étant animé par la divinité dans toutes fes parties.
C ’eft donc Sien inutilement que quelques modernes
ont voulu nous perfuader, après fe l’être per-
fuadé à eux-mêmes,que les premiers Gaulois avoient
une idée faine de la divinité ; idée qui ne s’étoit altérée
& corrompue que par leur commerce avec les
autres nations. Après cela je ne vdis pas ftir'quoi
tombe le reproche injurieux qu’on fait aux anciens
Celtes d’avoir été des athées : ils ont été bien plutô
t fuperftitieux qu’athées; Si lès Romains les Ont
regardés comme les ennemis des dieux, c e n ’eft que
parce qu’ils refufoient d’adorër la divinité dans des
ftatues fabriquées de la main des hommes; Ils n’avoient
pointées temples comme les Romains, parce
qu’ils ne erpypient pas qu’on pût y renfermer la divinité.
T ou t l’univers étoit pour eux un temple, ou
plutôt la divinité fe peignoit à eux dans tOus les êtres
qui le cpmpofent. Ge n’eft pas qu’ils n’euffenl des
lieux affe£fés., comme les bois les plus fombres &
les plus reculés, pour y adorer d’une maniéré particuliers
la divinité. Ces lieux étoient propres àfrappér
d ’une fainte horreur lespeuples,qui fe repréfôntoient
quelque chofe de te rrible , appellant Dieu ce qu’ils
ne vpyoient point, ce qu’ils nè pouvoient v o ir.
Tant aux foibles mortels ; il ejl bon d’ignorer
Les dieux qu 'il leur faut craindre, & qu 'ilfaut adorer.
Breboeuf.-
O u comme le dit plus'énergiquement l’original :
Tantùm terroribüs addit,
Quos timeant, non nojfe deos.
Les Gaules ayant été fubjugées par les Romains
qui vouloient tout envahir, & qui opprimoiént au
lieu de v a in cr e , ce fut une néeeflité pour les peuples
qui les habitoient, de fe foûmettre à la religion de
leurs vainqueurs. C e n’eft que depuis ce te'ms qu’on
v it chez eux des temples & des autels confacrés aux
dieux à l’imitation des Romains. Les druides perdirent
infenfiblement leur crédit : ils furent enfin tous
abattus fous les régnés deTib ere & de Claude. Il y
eut même un decret du fénat qui ordonnoit leur entière
abolition, foit parce qu’ils vouloient perpétuer
parmi les peuples qui leur étoient fournis l ’üfage
cruel des viCfimes humaines, foit parce qu’ils ne cef-
foient de lés exciter à confpirèr contre les tyrans de
Rome , à rentrer dans leurs privilèges injuftèmeht
perdus, & à fe choifir des rois de leur nation.
Les druides fe rendirent fur-toutrecommendables
pa rla divination ,fo it chez les G au lo is , foit chez les
Germains. Mais ce qu’il y a ici de remarquable, e’eft
que la divination étoit principalement affèCtée aux
femmes : de-là lere fpeû extrême qu’on avo it pour elles
;re fpeûqu i quelquefois alloit jufqu’à j ’adoration ;
témoin l’exemple de Velleda & d’Auri/iiâ qui furent
mifes au nombre des déeffes, félon le rapport de T a -
C e f t affez l’ufage des anciens de ne parler de l’origine
des chofes qu’en'Ies perfonnifiânt. Voilà pourquoi
leur cofmogonie rt’ëft autre chofë qu’une théogonie.
C ’eft auffi ce que nous voyons chez les anciens
Celtes. A-travers les fab les, dont ils ont défiguré
la tradition qui leur étoit venue de la plus haute
antiquité, il eft aifé de reconnaître quelques traces
de la création 6t du déluge de Mo ÿfé. Ils reconnoif-
foient un être qui exiftoit avant que rien de ce qui
exifte aujourd’hui eût été créé. Qu ’il me foit permis
de paffér fous filence toutes les fables qui s’étoient
mêlées à leur cofmogonie : elles ne font par elles-
mêmes ni affez curieufes, ni affez inftrtiâives pour
mériter dè trouver ie i leur place. Il nepâroîtpas que
la métempfycofe ait été une opinion uni verfellériîent
reçue chez les druides; Si les Uns faifoient rouler
perpétuellement les âmes d’iin corps dans un autre
il y en avo it d’autres qui leur alfignoient une demeure
fixe parmi les mânes ; fo it dans le tarta re, Oti
elles étoient précipitées lorfqu’elles s’étoient foû il*
lées par des parjures , des affaffinats, & dés adultères
; foit dans un féjour bienheureux, lorfqu’elles
étoient exemptes de ces crimes. Ils n’avbiént point
imaginé d’autre fupplice pour ceux qui étoient dans
le tartare , que célui d’être plongés dans un fleuve
dont les eaux étoient empoifonnéés, & dé renaître
fans eeffe pour être éternellement en proie aux cruelles
morfures d’uii ferpent. Ils diftinguoient deux fé-
jours de félicité. C eu x qui n’avoient que bien v é c u ,
c’eft-à-dire ceux qui n’avoient été que juftés & tem-
perans pendant cette v ie , habitoient un palais plus -
brillant que le fo le il, oit ils nageoient daris un torrent
de voluptés : mais ceux qui étoient morts gé-
néreufertient les armes à la rriain pour défendre leur
patrie, ceux-là avoient une place dans le valhalla
av e c Odin ; auquel ils donnOient le nom à'Hefus, &
qui étoit pour eux ce que le dieu Mars étoit pour lés
Latins. On diroit que Mahomet a imaginé fon paradis
d’après le valhalla des Celtes feptentrionaux, tant
il a de féffembianee avec lui. Solih , M ê la , & d’autres
auteurs rapportent que les nations hyperboréeà.
fe précipitoient du haut du rocher pour éviter une
honteufe captivité, & p o u r ne pas languir dans les
infirmités de la vieilleffe. Ceu x qui fe donnoient ainfi
librement la mo r t, avoient une place diftinguée dans
le valhalla. De-là cette audace que les Celtes por-
toient dans les combats, cette ardeur qui les préci-
pitoit dans les bataillons les plus épais , cette fermeté
av e c laquelle ils bravoient les plus grands dang
er s , ce mépris qu’ils avoient pour la mort. Nous finirons
cet article, en remarquant que les Celtes ne
s’étoient endurcis & accoûtumés à mener dans leurs
forêts une v ie fi dure & fi ennemie de tous les plai-
fir s , que parce qu’ils étoient intimement perfuadés
du dogme de l’immortalité des efprits. De -là naif-
foit en eux ce courage, que les Romains ont fi fou-
vent admiré dans ces peuples ; ce mépris de la mort
qui les rendoit fi redoutables à leurs ennemis ; cette
p’affion qu’ils avoient pour la guerre , & qu’ils inf-
piroient à leurs enfans ; cette cha fteté, cette fidélité
dans les mariages fi recommandée parmi eux ; cet
éloignement qu’ils avoient pour le fafte des habits 6c
le luxe de la table : tant l’efpoir d’une récompenfe
dans une autre vie a de pouvoir fur i’efprit des hommes
! II eft fâcheux qu’une nation auffi refpeâable
par fes moeurs & par fes fentimens que l’étoit celle
des Celtes , ait eu des druides pour miniftres de fa
religion. (X)
* CELTIBERIENS , f. m. pl. (Géog. & Hiß.)
peuples de l’ancienne Gaule qui s’ établirent en Ef-
pagne le long de l’Iber: leur nom eft eompofé de Celte,
celui de leur origine , 6c libériens, celui des peuples
av e c lefquels ils s’allièrent. Ils fe répandirent
dans l ’Aragon Sc la Caftille. Florus les appelle la
force de l’Efpagne.
C E L T IQ U E , ( Géog. ) c’eft ainfi qu’on appella
la colonie des Celtes ou des C eltiberes, qui s’établirent
en Efpagne depuis le Douron jufqu’ au promontoire
Celtique, qu’on préfumê être le cap Finifterre. Voye^ C e l t e s & C e l t i b e r e s . On donna auffi le
nom de Celtique à la partie de la G aule qu’occupoient
les Celtes.
C EMENT , f. m. (Chimie.) c’ eft une compofilion
ou un mélange de différentes matières falines , ter-
reufes, ou pnlogiftiques, en forme de poudre ou de
p â te , av e c lefquels on ftratifie, ou dont on en entoure
certains métaux dans la cémentation. Voye£ C é m
e n t a t i o n . Cet article efi de M. Ve n EL.
C ÉM EN T R O Y A L , (Chimie.) c’eft le cément defti-
né à la purification de l’or : il tire fon nom de la qualité
de roi des métaux, par laquelle les Chimiftes dé-
fignent fouvent l’or. L e cément royal le plus fimple ,
& qui eft décrit dans de très-anciens ouv rages, étoit
eompofé de deux parties de fe l commun, & d’une
partie de poudre de brique, farina laterum , empâtées
a v e c de l’urine.
On trouve beaucoup d’autres recettes de cément,
qui portent auffi le titre de royal : c’eft toûjours du
nitre où du fel commun, avec du v itriol ca lc in é , de
la brique pulvérifée , des bols , quelquefois de la
pierre hæmatite, & du verd-de-gris. On a trouvé
un ufage à ces deux dernieres matières : on prétend
qu’elles exaltent la couleur de l’or. Article de M.
V e n e l .
C ÉM E N T A T IO N , f . f . (Chimie.) h cémentation
prife dans le fens le plus étendu, eft l’opération chimique
par laquelle on applique à des métaux enfermés
dans un creufet, dans une boîte de fe r , ou même
dans une cornue, & ftratifiés avec des fels fixes,
a v e c différentes matières terreftres, & quelquefois
phlogiftiques, un feu te l, que ces métaux rougiffent
plus ou moins , mais fans entrer aucunement en fu-
fion.
O n voit d’abord par cette définition, que les métaux
qui coulent avant de rougir, l’étain 6c le plomb,
Tome II,
ne fanroient être comptés parmi les fujets de cette
| opération.
La cémentation eft un des moyens employés , fur-
tout par les ouvriers qui travaillent l’or & l’argent,
pour vérifier la pureté de ces métaux, ou pour l’obtenir
; & c ’eft-là même le principal ufage de cette
opération. Mais des obfervations répétées ont appris
qu’elle étoit infuffifante pour l’une & pour l’autre obje
t ; c’eft-à-dire que les cémens ordinaires n’enle-
voient pas exa&ement à l’or & l’argent les métaux
étrangers qui conftituoient leur impureté , & qu’ils
enlevoient une partie du fin. Kunck el a obfervé que
le fel commun employé aux cémentations répétées de
l’argent, fe chargeoit d’une quantité affez confidé-
rable de ce m é ta l, qu’on en retiroit facilement par
la fufion.
Geber compte la cémentation parmi les épreuves
que devoit foûtenir fon magiflere, pour être réputé
parfait.
L ’ufage des cémentations eft très-familier aux Al-
chimiftes, fo it comme opération Amplement préparatoire
, ou entrant dans la fuite de celles qui corn-
pofent un pro céd é; foit comme produifant immé--
diatement une amélioration , nobilitatio. C ’eft l ’argent
pur ou les chaux d’argent, c ’eft à-dire, l ’argent
ouvert ou divifé par des menftrues, fur lequel ils
ont principalement opéré. Voye^ P a r t i c u l i e r .
Becher décrit plufieurs de ces particuliers ou procédés
, dans fa concordance chimique ; 6c il n’eft pref-
qu’aucun des fix mille auteurs d’A lchimie qui n’en
célébré quelqu’un.
L a trempe en paquet, ou cette opération par laquelle
les Arquebufiers, les Taillandiers , 6c quelques
autres ouvriers durciffent ou convertiffenrplus
ou moins profondément les lames en acier ou couches
extérieures de certains ouvrages , comme de
prefque toutes les pièces des platines des armes à
fe u , les lames d’é p e e , les bonnes cuiraffes , les haches
, les lime s , les boucles appellées d’acier, Sec.
cette opération, dis-je, eft une efpece de cémentation.
Voyeç F e r .
Les matières des cémens pour l’or & pour l’arg
en t, font premièrement le nitre., la plûpart des fels
neutres marins , le fel commun , le fel gemme, le
fel ammoniac, le fublimé c o r ro fif, & même une
fubftance faline qui contient l’acide v é g é ta l, le ver-
det; fecondement les vitriols calcinés , les b o ls , la
farine ou poudre de brique, &c.
O n prend une ou plufieurs matières de la première
claffe , & quelques-unes de celles de la fécondé ,
dans des proportions convenables : par exemple, prenez
du fel marin décrépité, une once ; de la poudre
de briqu e , demi-once ; du vitrio l calciné au rouge ,
une once : ou de nitre , de fel ammoniac , de verdet,
de bol d’Arménie, de poudre ou farine de brique, de
chacun parties égales : fechez & pulvérifez toutes
vos matières , & mêlez - les exactement. Quelques
auteurs , principalement les anciens, les empâtent
a v e c l’urine.
On cémente auffi l’argent av e c le fel commun feul.
Voye[ A r g e n t .
Le modus ou manuel de l’opération, eft celui-ci :
prenez un creufet de grandeur convenable; mettez ^
au fond, de votre cément environ la hauteur d’un
pouce ; placez deffus une couche de votre métal réduit
en petites plaques très-minces; couvrez ces
plaques d’une fécondé couche de cément, à-peu-près
de la même hauteur que la première, & rempliffez
alternativement votre creufet de cément & de lames
de métal ; finiffez par une couche de cément, fur la quelle
vous pouvez en mettre une autre de chaux
v ive en poudre, félon l’ufage de quelques Chimiftes ;
fermez votre Creufet avec un couvercle exaflement
luté, mais percé d’un petit trou à paffer une aiguille ;