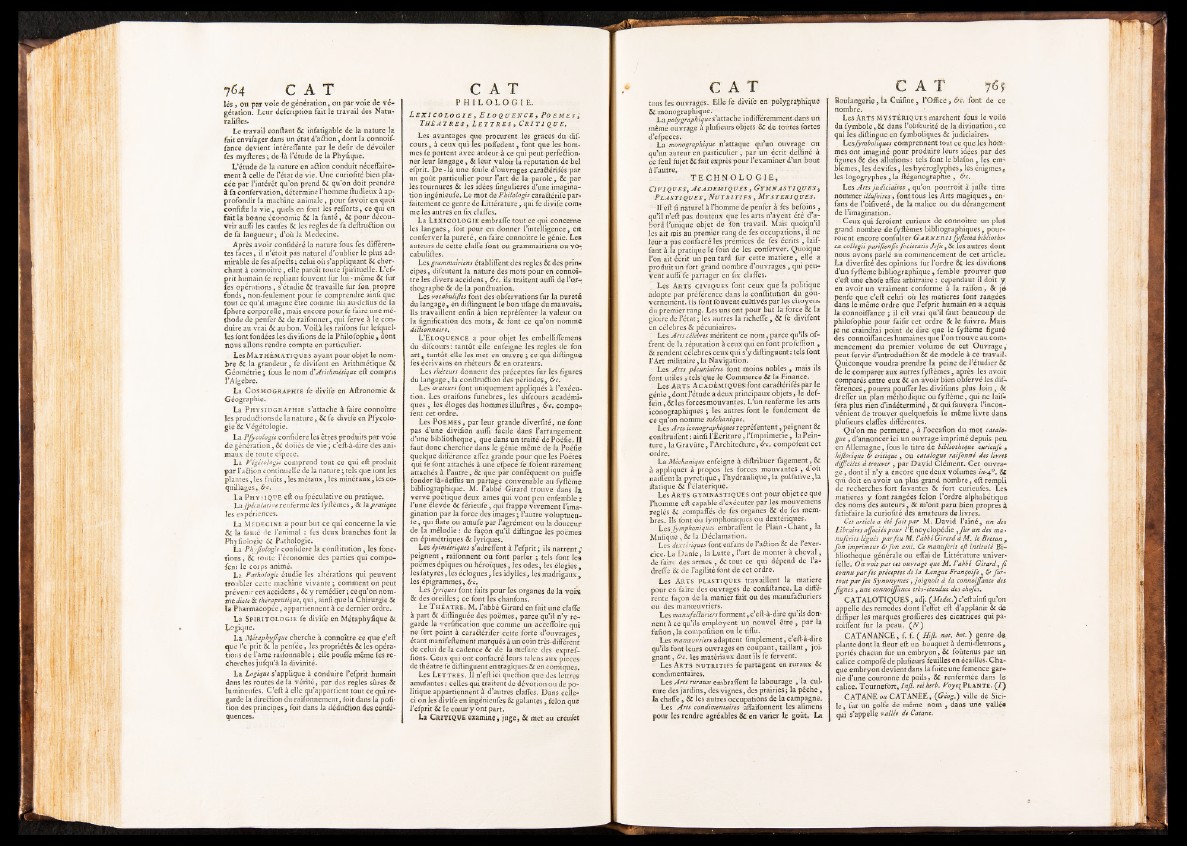
lé s , ou par v oie de génération, ou par v o ie de v é gétation.
Leur defeription fait le travail des Naturalises.
Le travail confiant Sc infatigable de la nature la
fait enviïager dans un état d’aétion, dont la connoif-
fance devient intéreffante par le defir de dévoiler
fes myfteres ; de-là l’étude de la Phyfique.
L ’étude de la nature en aftion conduit néceffaire-
tnent à celle de l’état de v ie . Une curiofité bien plac
ée par l’intérêt qu’on prend Sc qu’on doit prendre
à fa confervation, détermine l’homme ftudieux à approfondir
la machine animale, pour faVoir en quoi
confifte la v i e , quels en font les refforts, ce qui en
fait la bonne économie Sc la fanté, Sc pour découv
rir aufli les caufes Sc les réglés de fa deftruttion ou
de fa langueur ; d’où la Medecine.
Après avo ir confidéré la nature fous fes différentes
fa ce s, il n’étoit pas naturel d’oublier le plus admirable
de fes afpefts ; celui oit s’appliquant Sc cherchant
à connoître, elle paraît toute fpirituelle. L ’efprit
humain fe repliant fouvent fur lui - même Sc fur
les opérations, s’ étudie Sc travaille fur fon propre
fonds, non-feulement pour fe comprendre ainfi que
tout ce qu’il imagine être comme lui au-deffus de la
fphere corporelle, mais encore pour fe faire une méthode
de penfer & de raifonner, qui ferve à le conduire
au v rai Sc au bon. Vo ilà les raifons fur lefquel-
les font fondées les divifions de la Philofophie, dont
nous allons rendre compte en particulier.
Les Mathématiques ayant pour objet le nombre
Sc la grandeur, fe divifent en Arithmétique Sc
Géométrie ; fous le nom dû Arithmétique eft compris
l ’A lgebre.
La Cosmographie fe divife en Aftronomie &
Géographie.
La Physiographie s ’attache à faire connoître
les productions de la nature, & fe divife en Pfycolo-
gie Sc Végétologie.
La Pfycologie confidere les êtres produits par voie
de génération, Sc doiiés de v ie ; c’eft-à-dire des animaux
de toute efpece. -
La Végétologie comprend tout ce qui eft produit
par l’aâ ion continuelle de la nature ; tels que font les
plantes, les fru its , les métaux, les minéraux , les coquillages
, &c.
L a Physique eft ou fpéculative ou pratique.
La fpéculati ve renferme les fyftèmes, & la pratique
les expériences.
La Medecine a pour but ce qui concerne la vie
& la fanté de l’animal : fes deux branches font la
Phyfiologie Si Pathologie.
La Phyfiologie confidere la conftitution, les fonctions
, Sc toute l’économie des parties qui compo-
fent le corps animé.
La Pathologie étudie les altérations qui peuvent
troubler cette machine vivante ; comment on peut
prévenir ces accidens, & y remédier ; ce qu’on nomme
diete & thérapeutique, qu i, ainfi que la Chirurgie &
la Pharmacopée, appartiennent à ce dernier ordre.
La Spiritologie fe divife en Métaphyfique &
Logique.
La Métaphyfique cherche à connoître ce que c’eft
que l’e prit Sc la penfé e , les propriétés & les opérations
de l’ame raifonnable ; elle pouffe même fes recherches
jufqu’à la divinité.
La Logique s’applique à conduire l’efprit humain
dans les routes de la v é r ité , par des réglés sûres &
lumineufes. C ’eft à elle qu’appartient tout ce qui regarde
la direction du raifonnement, loit dans la poli-
tion des principes, f oit dans la déduction des confé-
quences.
P H I L O L O G I E .
L e X I C.OLOGI E , ÉLO Q U EN CE, Po EM ES * Th ÉAT RES y LET T RES , CRI T 1 QU E.
Les avantages que procurent les grâces du discours
, à ceux qui les poffedent, font que les hommes
fe portent av e c ardeur à ce qui peut perfeétion-
ner leur langage, & leur valoir la réputation de bel
efprit. D e - là une foule d’ouvrages caraftérifés par
un goût particulier pour l’art de la pa role , Sc par
les tournures & les idées fingulieres d’une imagination
ingénieufe. Le mot de Philologie caraélérife parfaitement
ce genre de L ittérature, qui fe divife com^
me les autres en fix claffes.
La Lexicologie embraffe tout ce qui concerne
les langues, foit pour en donner l’intelligence, en
conferver la pureté, en faire connoître le génie. Les
auteurs de cette claffe font ou grammairiens ou vo».
cabuliftes.
Les grammairiens établiffent des réglés Sc des principes
, difeutent la nature des mots pour en connoî-;
tre les divers accidens, &c. ils traitent aufli de l’ar-j
thographe & de la ponctuation.
Les vocabulifies font des obfervations fur la pureté
du langage, en diftinguent le bon ufage du mauvais.
Ils travaillent enfin à bien repréfenter la valeur ou
la lignification des mots, & font ce qu’on nomme
dictionnaire.
L’Eloquence a pour objet les embelliffemens
du difeours : tantôt elle enfeigne les réglés de fon
art, tantôt elle les met en oeuvre ; ce qui diftingue
fes écrivains en rhéteurs Sc en orateurs.
Les rhéteurs donnent des préceptes fur les figures
du langage, la conftruâion des périodes, &c.
Lés orateurs font uniquement appliqués à l’exécution.
Les oraifons funèbres, les difeours académiques
, les éloges des hommes illuftres, &c. compo-
lent cet ordre.
Les P o em e s , par leur grande div erfité, ne font
pas d’une divifion aufli facile dans l’arrangement
d’une bibliothèque, que dans un traité de Poéfie. II
faut donc chercher dans le génie même de la Poéfie
quelque différence affez grande pour que les Poètes
qui fe font attachés à une efpece fe foient rarement
attachés à l’autre , Sc que par conféquent on puiffe
fonder là-deffus un partage convenable au fyftème
bibliographique. M. l’abbé Girard trouve dans la
v erv e poétique deux âmes qui v ont peu enfemble :
l ’une éle vé e Sc fé rieufe , qui frappe vivement l’imagination
par la force des images ; l’autre voluptueu-
f e , qui flate ou amufe par l’agrément ou la douceur
de la mélodie : de façon qu’il diftingue les poèmes
en épimétriques & lyriques.
Les épimétriques s’adreffent à l’efprit; ils narrent}
peignent, raifonnent ou font parler ; tels font les
poèmes épiques ou héroïques, les odes, les é le g ies ,
les fa ty re s , les éclogues, les id ylles , les madrigaux ,
les épigrammes, &c.
Les lyriques font faits pour les organes de la v o ix
& des oreilles ; ce font les chanfons.
Le T héâtre. M. l ’abbé Girard en fait une claffe
à part Sc diftinguée des poèmes, parce qu’il n’y regarde
la verfification que comme un acceffoire qui
ne fert point à caraôérifer cette forte d’ouv rages,
étant manifeftement marqués à un coin très-différent
de celui de la cadence Sc de la mefure des expref-
fions. Ceux qui ont confacré leurs talens aux pièces-
de théâtre fe diftinguent en tragiques & en comiques.
Les Lettres. Il n’eft ici queltion que des lettres
amufantes : celles qui traitent de dévotion ou de politique
appartiennent à d’autres claffes. Dans celle-
ci on les divife en ingénieufes Sc galantes, félon que
l’efprit Sc le coeur y ont part.
La Critique examine, juge, & met au creufet
tons les OBŸragéS. Elle fe divife en polygrafhiqud
& monographique. ^ -
L apolygraphique s’attache indifféremment dans uti
même ouvrage à plufieurs objets & de toutes fortes
d’efpeces.
La monographique n’attaque qu’un ouvrage ou
qu’un auteur en particulier , par un écrit deftiné à
ce feul fujet Sc fait exprès pour l’examiner d’un bout
à l’autre.
T E C H N O L O G I E ,
C i v i q u e s , A c a d é m i q u e s , G y m n a s t i q u e s ,
P l a s t i q u e s , N u t r i t i f s , M y s t é r i q u e s .
Il eft fi naturel à l’Homme de penfer à fes befoins ,
qu’il n’eft pas doutèux que les arts n’aÿént été d’abord
Tunique objet de fon travail. Mais quoiqu’il
les ait mis au premier rang de fes occupations, il ne
leur a pas confacré les prémices de fes écrits , laif-
fant à la pratique le foin de les conferver. Quoique
l’on ait écrit un peu tard fur cette matière, elle a
produit un fort grand nombre d’ouvrages , qui peuv
en t aufli fe partager en fix claffes.
Les Arts civiques font ceux que la politique
adopte par préférence dans la conftitution du gouvernement.
Us font fouvent cultivés par les citoyens
du premier rang. Les uns ont pour but la force Sc la
gloire de l’état ; les autres la richeffe, & fe divifent
en célébrés & pécuniaires.
Les Arts célébrés méritent ce nom, parce qu’ils offrent
de la réputation à ceux qui en font profeflion ,
& rendent célébrés ceux qui s’y diftinguent: tels font
l ’Art militaire j la Navigation.
• Les Arts pécuniaires font moins nobles , mais ils
font utiles i'tels^qiie le Commerce Sc la Finance.
Les Arts Ac ADÉMiQUES>font caraâérifés par le
génie, dont l’étude a deux principaux objets, le def-
l’ein ,& les forces mouvantes. L’un renferme les arts
iconographiques ; les autres font le fondement de
ce qu’on nomme méchanique.
Les Arts iconographiques repréfentent, peignent Sc
conftruifent : ainfi l’Écriture, l’Imprimerie, la Peinture
, la G ra vû re , l’Archite&ure, &c. compofent cet
ordre.
L a Méchanique enfeigne à diftribuer' fagement, &
à appliquer à propos les forces mouvantes , d’oîi
naiffent la py retiqu e, l’hydraulique, la pu lfa tiv e,la
ftatique & l’élatérique.
Les Arts gymnastiques ont pour objet ce que
l ’homme eft capable d’exécuter par les mouvemens
réglés Sc compaffés de fes organes Sc de fes membres.
Ils font ou fymphoniques ou dextériques.
LesJymphoniques embraffent le P lairt-Chan t, la
Mufique , Sc la Déclamation.
Les dextériques font enfans de l’aûion Sc de l’exercice.
La D an fe , là L u tte , i’art de monter à c h e v a l,
de faire des armes , Sc tout ce qui dépend de l’a-
dreffe Sc de l’agilité font de cet ordre.
Les Arts plastiques travaillent la matière
pour en faire des ouvrages de confiftance. La différente
façon de la manier fait ou des manufacturiers
o u des manoeuvriers.
Les manufacturiers forment, c*eft-à-dire qu’ils donnent
à ce qu’ils employent un nouvel ê t r e , par la
fu fion , la compofition ou le tiffu.
Les manoeuvriers adaptent Amplement, c’eft-à-dire
qu’ils font leurs ouvrages en coupant, taillant, joignant
, &c. les matériaux dont ils fe fervent.
Les Arts nutritifs fe partagent en ruraux Sc
condimentaires.
Les Arts ruraux embraffent le labourage , la Culture
des jardins, des v ign e s, des prairies; la p ê ch e ,
la cha ffe, Sc les autres occupations de la campagne.
Les Arts condimentaires affaifonnent les alimens
pour les rendre agréables Sc en varier le gQÛt. La
Boulangerie, la Cuifine , l ’O ffice , &c. font de ce
nombre.
Les ArYs Mystériques marchent fous le v o ilé
du fymbo le , Sc dans l’obfcurité de la divination, ce
qui les diftingue en fymboliques Sc judiciaires*
Les fymboliques comprennent tout ce que les hommes
ont imaginé pour produire leurs idées par des
figures Sc des allufions : tels font le b la fon , les emblèmes,
les d ev ifes , les hyéroglyphes, les énigmes,
les logogryphes, la ftéganographie , &c.
Les Arts judiciaires , qu’on pourrait à jufte titré
nommer iliufoires, font tous les Arts magiques, en-
fans de l’o ifive té , de la malice ou du dérangement
de | ’imagination. ■
Ceu x qui feroient curieux de connoître un plus
grand nombre de fyftèmes bibliographiques, pourraient
encore confulter Ga RNERU fyfiema bibliothe-
ca collegii parifienfis focietatis Jefu, & les autres dont
nous avons parlé au commencement de cet article.
L a diverfité des opinions fur l’ordre Si les divifions
d’un fyftème bibliographique, femble prouver que
c ’eft une chofe affez arbitraire : cependaut il doit y,
en avo ir un vraiment conforme à la raifon, & jé
penfe que c ’eft celui où les matières font rangées
dans le même ordre que l’efprit humain en a acquis
la connoiffance ; il eft vrai qu’il faut beaucoup de
philofophie pour faifir cet ordre & le fuivre. Mais
je ne craindrai point de dire que le fyftème figuré
des connoiffances humaines que l’on trou v e au commencement
du premier volume de cet O u v ra g e ,
peut fervir d’ introduétion Sc de modèle à ce travail*
Quiconque voudra prendre la peine de l ’étudier Sc
de le comparer aux autres fyftèmes, après les avoir
comparés entre eux Sc en avoir bien obfervé les différences
, pourra pouffer les divifions plus lo in , &
dreffer un plan méthodique ou fy ftèm e, qui ne laif-
fera plus rien d’indéterminé, & qui fauvera l’inconvénient
de trouver quelquefois le même liv re dans
plufieurs claffes différentes.
Qu ’on me permette , à l’occafion du mot catalogue
, d’annoncer ici un ouvrage imprimé depuis peu
en Allemagne, fous le titre de bibliothèque curieufe ,
hifiorique & critique , ou catalogue raifonné des livres
difficiles à trouver , par D a v id Clément. C e t ouvrage
, dont il n’y a encore que deux volumes in-40. Se
qui doit en avoir un plus grand nombre, eft rempli
de recherches fort favantes & fo rt curieufes. Les
matières y font rangées félon l’ordre alphabétique
des noms des auteurs, & m’ont paru bien propres à
fatisfaire la curiofité des amateurs de livres.
Cet article a été fait par M. Da vid l’a în é, un des
Libraires affociés pour /’Encyclopédie ,fur un des ma •
nufçrits légués par feu M. l'abbé Girard à M. le Breton ,
fon imprimeur & fon ami. Ce manuferit efi intitulé Bibliothèque
générale ou effai de Littérature univer-
Telle. On voit par cet ouvrage que M. l'abbé Girard, fi
connu par fes préceptes de la Langue Françoife, & fur-
tout parfes Synonymes yjoignoit à la connoiffance des
fignes, une connoiffance tris-étendue des chofes.
C A T A L O T IQ U E S , adj. (Medecé) c’eft ainfi qu’on
appelle des remedes dont l’effet eft d’applanir & de
difliper les marques groffieres des cicatrices qui pa-
roiffent fur la peau. (AQ
Ç A T A N A N Ç E , f. f. ( Wfi. nat. bot.) genre/de,
plante dont la fleur eft un bouquet à demi-neurons ,
portés chacun fur un embryon , & foûtenus par un
calice compofé de plufieurs feuilles en écailles. C h a que
embryon devient dans la fuite une femence garnie
d’une couronne de poils > Sc renfermée dans le
calice. Tournefort, Infi. réiherb. V?ye{Plante. ( / )
C A T ANE ou C A T A N É E , (Géog.) v ille de Sicile
fur un golfe de même nom , dans une yallé#
qui s’appelle vallée de Catane.