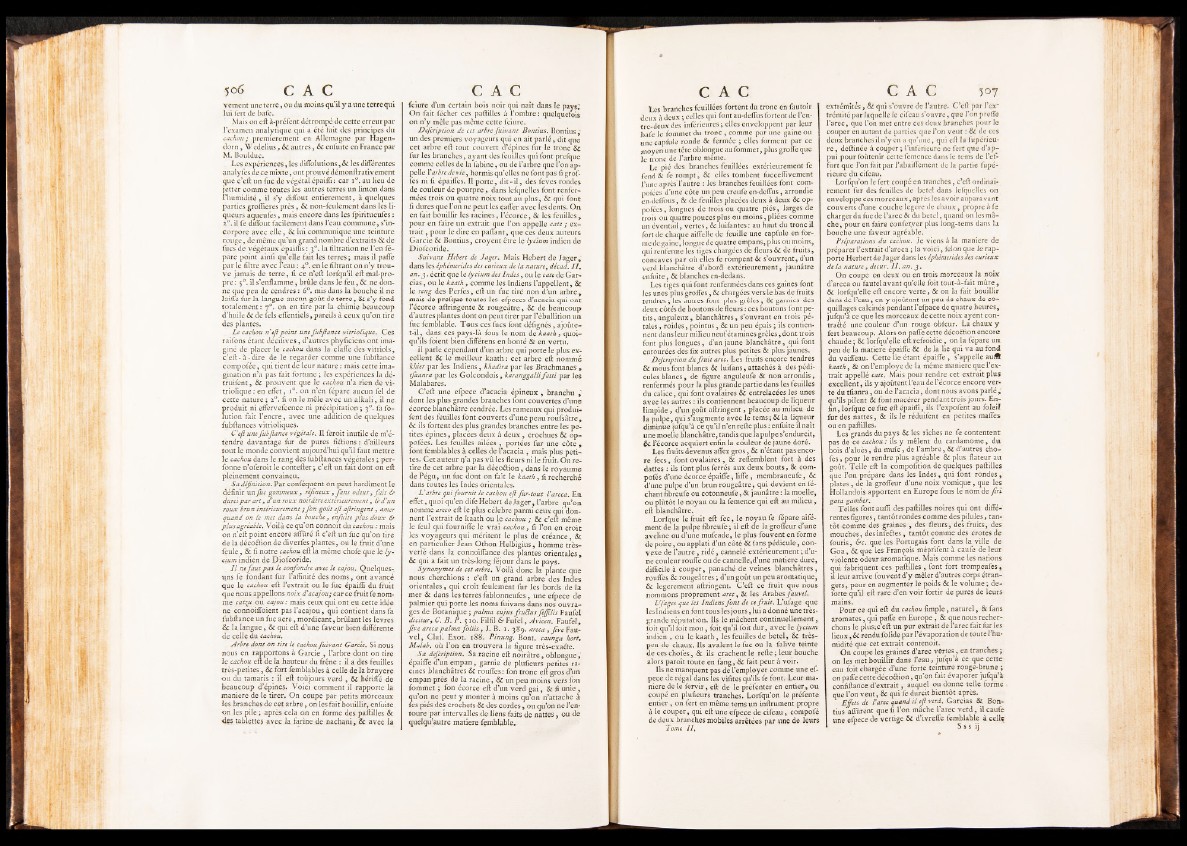
vement une terre, ou du moins qu’il y a une terre qui
lui fert de bafe.
Mais on eft à-préfent détrompé de cette erreur par
l’examen analytique qui a été fait des principes du
cachou; premièrement en Allemagne par Hagen-
dorn, \Vedelius , 6c autres, 6c enfuite en France par
M. Boulduc.
Les expériences, les diffolutions, 6c les différentes
analyfes de ce mixte, ont prouvé démonftrativement
que c’eft un lue de végétal épaiffi; car i°. au lieu de
jetter comme toutes les autres terres un limon dans
l’humidité , il s’y diffout entièrement, à quelques
parties groflieres près, 6c non-feulement dans les liqueurs
aqueufes, mais encore dans les fpiritueufes :
i° . il fe dilfout facilement dans l’eau commune, s’incorpore
avec elle, 6c lui communique une teinture
rouge, de même qu’un grand nombre d’extraits 6c de
fucs de végétaux épaims: 30. la filtration ne l ’en fé-
pare point ainfi qu’elle fait les terres ; mais il paffe
par le filtre avec l’eau : 40. en le filtrant on n’y trouve
jamais de terre, fi ce n’eft lorfqu’il efi mal-propre
: 50. il s’enflamme, brûle dans le feu, & ne donne
que peu de cendres : 6°. mis dans la bouche il ne
laifTe fur la langue aucun goût de terre, 6c s’y fond
totalement : 70. on en tire par la chimie beaucoup
d’huile 6c de fels effentiels, pareils à ceux qu’on tire
des plantes.
Le cachou n'efi point une fub(lance vitriolique. Ces
raifons étant decifives, d’autres phyficiens ont imaginé
de placer le cachou dans la claffe des vitriols,
c ’eft - à - dire de le regarder comme une fubftance
compofée, qui tient de leur nature : mais cette imagination
n’a pas fait fortune ; les expériences la dé-
truifent, & prouvent que le cachou n’a rien de v itriolique:
en effet, i°. on n’en fépare aucun fel de
cette nature ; z°. fi on le mêle avec un alkali, il ne
produit ni effervefcence ni précipitation ; 30. fa fo-
lution fait l’encre, avec une addition de quelques
fubftances vitrioliques.
C’efl une fub fiance végétale. Il feroit inutile de m’étendre
davantage fur de pures fi&ions : d’ailleurs
tout le monde convient aujourd’hui qu’il faut mettre
le cachou dans le rang des fubftances végétales ; per-
fonne n’oferoit le contefter ; e’eft un fait dont on eft
pleinement convaincu.
S a définition. Par conféquent on peut hardiment le
définir un fuc gommeux , réfineux , fans odeur, fait &
durci par art, d'un roux noirâtre extérieurement, & d'un
roux brun intérieurement j fon goût efi afiringent, amer
quand on le met dans la bouche , enfuite plus doux &
plus agréable. Voilà ce qu’on connoît du cachou : mais
on n’eft point encore affûré fi c’eft un fuc qu’on tire
de la décoction de diverfes plantes, ou le fruit d’une
feule, & fi notre cachou eft la même chofe que le ly-
cjum indien de Diofcoride.
I l ne faut pas le confondre avec le cajou. Quelques-
uns fe fondant fur l’affinité des noms, ont avancé
que le cachou eft l’extrait ou le fuc épaiffi du fruit
que nous appelions noix d'acajou; car ce fruit fe nomme
catçu ou cajou : mais ceux qui ont eu cette idée
ne connoiffoient pas l’acajou, qui contient dans fa
fubftance un fuc acre, mordicant, brûlant les levres
6c la langue, 6c qui eft d’une faveur bien différente
de celle du cachou.
Arbre dont on tire le cachou fuivant Garde. Si nous
nous en rapportons à Garcie , l’arbre dont on tire
le cachou eft de la hauteur du frêne : il a des feuilles
très-petites, 6c fort femblables à celle de la bruyere
ou du tamaris : il eft toûjours verd , 6c hérifle de
beaucoup d’épines. Voici comment il rapporte la
maniéré de le tirer. On coupe par petits morceaux
les branches de cet arbre, on les fait bouillir, enfuite
on les pile ; après cela on en forme des paftilles &
«les tablettes avec la farine de nacbani, & avec la
fciure d’un certain bois noir qui naît dans le pays?
On fait fécher ces paftilles à l’ombre: quelquefois
on n’y mêle pas même cette fciure.
Defcription de cet arbre fuivant Bontius. Bontius
un des premiers voyageurs qui en ait parlé, dit que
cet arbre eft tout couvert d’épines fur le tronc 6c
fur les branches, ayant des feuilles qui font prefque
comme celles de la fabine, ou de l’arbre que l’on appelle
l'arbre de vie, hormis qu’elles ne font pas fi grof-
fes ni fi épaiffes. Il porte, d it- il, des feves rondes
de couleur de pourpre, dans lefquelles font renfermées
trois ou quatre noix tout au plus, 6c qui font
fi dures que l’on ne peut les cafter avec les dents. On
en fait bouillir les racines, l ’écorce, & les feuilles ,
pour en faire un extrait que l’on appelle cate ; extrait
, pour le dire en paffant, que ces deux auteurs
Garcie 6c Bontius, croyent être le lycium indien de
Diofcoride.
Suivant Hébert de Jager. Mais Hebert de Jager,'
dans les èphémerides des curieux de la nature, décad. IL
an. 3 . écrit que le lycium des Indes, ou le cate de Gardas
, ou le kaath, comme les Indiens l’appellent, &
le reng des Perfes, eft un fuc tiré non d’un arbre,
mais de prefque toutes les efpeces d’acacia qui ont
l’écorce aftringente & rougeâtre, 6c de beaucoup
d’autres plantes dont on peut tirer par l’ébullition un
fuc femblable. Tous ces fucs font défignés, ajoûte-
t-il , dans ces pays-là fous le nom de kaath, quoiqu’ils
foient bien différens en bonté & en vertu.
Il parle cependant d’un arbre qui porte le plus excellent
& le meilleur kaath : cet arbre eft nommé
khier par les Indiens, khadira par les Brachmanes ,
tfaanra par les Golcondois, karanggalli fatti par les
Malabares.
C ’eft une efpece d’acacia épineux , branchu ,'
dont les plus grandes branches font couvertes d’une
écorce blanchâtre cendrée. Les rameaux qui produi-
fent des feuilles font couverts d’une peau roufsâtre,
6c ils fortent des plus grandes branches entre les petites
épines, placées deux à deux, crochues 6c op-
pofées. Les feuilles ailées , portées fur une côte ,
font femblables à celles de l’acacia , mais plus petites.
Cet auteur q’a pas vû les fleurs ni le fruit. On retire
de cet arbre par la décoftion, dans le royaume
de Pégu, un fuc dont on fait le kaath , fi recherché
dans toutes les Indes orientales.
L'arbre qui fournit le cachou efi fur-tout l'areca. En
effet, quoi qu’en dife Hebert de Jager, l’arbre qu’on
nomme areco eft le plus célébré parmi ceux qui donnent
l’extrait de kaath ou le cachou ; 6c c’en: même
le feul qui fournifte le vrai cachou , fi l’on en croit
les voyageurs qui méritent le plus de créance, &
en particulier Jean Othon Helbigius, homme très-
verfé dans la connoiffance des plantes orientales,
6c qui a fait un très-long féjour dans le pays.
Synonymes de cet arbre. Voilà donc la plante que
nous cherchions : c’eft un grand arbre des Indes
orientales, qui croît feulement fur les bords de la
mer & dans les terres fablonneufes, une efpece de
palmier qui porte les noms fuivans dans nos ouvrages
de Botanique ; palma eu jus fruclus feffilis Faufel
dicitur, C. B. P. 510. Filfil & Fufel, Avicen. Faufel,
m areca palma foliis9 J. B. I. 389. areca , jîve Fauv
e !, Cluf. Exot. 188. Pinung. Bont. caunga hort.
Malab. oii l’on en trouvera la figure très-exaâe.
Sa defcription. Sa racine eft noirâtre, oblongue ,
épaiffe d’un empan, garnie de plufieurs petites racines
blanchâtres & rouffes: fon tronc eft gros d’un
empan près de la racine, & un peu moins vers fon
fommet ; fon écorce eft d’un verd g a i, & fi unie,
qu’on ne peut y monter à moins qu’on n’attache à
fes piés des crochets 6c des cordes, ou qii’on ne l’entoure
par intervalles de liens faits de nattes, ou de
quelqu’autre matière femblable.
Les branches feuillées fortent du tronc en fautoir
deux à deux ; celles qui font au-deffus fortent de l’entre
deux des inférieures ; elles enveloppent par leur
bafe le fommet du tronc, comme par une gaine ou
une capfule ronde & fermée ; elles forment par ce
moyen une tête oblongue au fommet, plus groffe que
le tronc de l’arbre même.
Le pié des branches feuillées extérieurement fe
fend & fe rompt, 6c elles tombent fucceflivement
l’iine après’l’autre : les branches feuillées font com-
polées d’une côte un peu creufe en-deffus, arrondie
en-deffcus, & de feuilles placées deux à deux 6c op-
pofees, longues de trois ou quatre piés, larges de
trois ou quatre pouces plus ou moins, pliées comme
un éventail, vertes, 6c luifantes : au haut du tronc il
fort de chaque aiffelle de feuille une capfule en forme
de gaîne, longue de quatre empans, plus ou moins,
qui renferme les tiges chargées de fleurs 6c de fruits,
concaves par oîi elles fe rompent & s’ouvrent, d’un
verd blanchâtre d’abord extérieurement, jaunâtre
enfuite, 6c blanches en-dedans.
Les tiges qui font renfermées dans ces gaînes font
les unes plus groffes, 6c chargées vers le bas de fruits
tendres ; les autres font plus grêles, 6c garnies des
deux côtés de boutons de fleurs : ces boutons font petits
, anguleux, blanchâtres, s’ouvrant en trois pétales
, roides, pointus, 6c un peu épais ; ils contiennent
dans leur milieu neuf étamines grêles, dont trois
font plus longues, d’un jaune blanchâtre, qui font
entourées des fix autres plus petites & plus jaunes.
Defcription du fruit arec. Les fruits encore tendres
6c mous font blancs 6c luifans, attachés à des pédicules
blancs, de figure anguleufe & non arrondis,
renfermés pour la plus grande partie dans les feuilles
du calice, qui font ovalaires 6c entrelacées les unes
avec les autres : ils contiennent beaucoup de liqueur
limpide, d’un goût aftringent , placée au milieu de
la pulpe, qui s’augmente avec le tems; 6c la liqueur
diminue jufqu’à ce qu’il n’en refte plus : enfuite il naît
une moelie blanchâtre, tandis que la pulpe s’endurcit,
6c l’écorce acquiert enfin la couleur de jaune doré.
Les fruits devenus affez gros, 6c n’étant pas encore
fecs, font ovalaires, & reffemblent fort à des
dattes : ils font plus ferrés aux deux bouts, & com-
pofés d’une écorce épaiffe, lifte, membraneufe, 6c
d’une pulpe d’un brun rougeâtre, qui devient en fé-
chantfibreufe ou cotonneufe, & jaunâtre : la moelle,
ou plutôt le noyau ou la femence qui eft au milieu,
eft blanchâtre.
Lorfque le fruit eft fec, le noyau fe fépare aifé-
ment de la pulpe fibreufe ; il eft de la groffeur d’une
aveline ou d’une mufeade, le plus fouvent en forme
de poire, ou applati d’un côté & fans pédicule, convexe
de l’autre, ridé, cannelé extérieurement ; d’une
couleur rouffe ou de cannelle,d’une matière dure,
difficile à couper, panaché de veines blanchâtres,
rouffes 6c rougeâtres ; d’un goût un peu aromatique,
6c legerement aftringent. C’eft ce fruit que nous
nommons proprement arec, & les Arabes fauvel.
Ufages que les Indiens font de ce fruit. L’ufage que
les Indiens en font tous les jours, lui a donné une très-
grande réputation. Ils le mâchent continuellement,
Toit qu’il foit mou, foit qu’il foit dur, avec le lycium
indien , ou le kaath, les feuilles de betel, 6c très-
peu de chaux. Ils avalent le fuc ou la falive teinte
de ces chofes, & ils crachent le refte ; leur bouche
alors paroît toute en fang, 6c fait peur à voir.
Ils ne manquent pas de l’employer comme une efpece
de régal dans les vifites qu’ils fe font. Leur maniéré
de le fervir, eft de le préfenter en entier, ou
coupé en plufieurs tranches. Lorfqu’on le préfente
entier, on fert en même tems un inftrument propre
à le couper, qui eft une efpece de cifeau, compofé
de deux branches mobiles arrêtées par une de leurs
extrémités, 6c m s’ouvre de l’autre. C ’eft par l’ex"
trémité par laquelle le cifeau s’ouvre, que l’on preffè
l’arec, que l’on met entre ces deux branches pour le
couper en autant de parties que l’on veut : & de ces
deux branches il n’y en a qu’une, qui eft la fupérieu-
r e , deftinée à couper ; l’inférieure ne fert que d’appui
pour foûtenir cette femence dans le tems de Veffort
que l’on fait par l’abaiffement de la partie fupé-
rieure du cifeau.
Lorfqu’on le fert coupé en tranches, c’eft: ordinairement
fur des feuilles de betel dans lefquelles on
enveloppe ces morceaux, après les avoir auparavant
couverts d’une couche legere de chaux, propre à fe
charger du fuc de l’arec & du betel, quand on les mâche
, pour en faire confeçver plus lông-tems dans la
bouche une faveur agréable.
Préparations du cachou. Je viens à lâ maniéré de
préparer l’extrait d’areca ; la voici, félon que le rapporte
Herbert de Jager dans les èphémerides des curieux
de la nature, decur. II. an. 3 .
On coupe en deux ou en trois morceaux la noix
d’areca ou fautelavant qu’elle foit tout-à-fait mûre,
6c lorfqu’elle eft encore Verte, & on la fait bouillir
dans de l’eau, en y ajoûtant un peu de chaux de coquillages
calcinés pendant l’efpace de quatre heures,
jufqu’a ce que les morceaux de cette noix ayent contracté
une couleur d’un rouge obfcur. La chaux y
fert beaucoup. Alors on paffe cette décoftion encore
chaude ; 6c lorfqu’elle eft refroidie, on la fépare un
peu de la matière épaiffe 6c de la lie qui va au fond
du vaiffeau. Cette lie étant épaiffe , s’appelle auf#
kaath, & on l’employe de la même maniéré que l’extrait
appellé cote. Mais pour rendre cet extrait plus
excellent, ils y ajoûtent l’eau de l’écorce encore verte
du tfianra, ou de l’acacia, dont nous avons parlé ,-
qu’ils pilent & font macérer pendant trois jours. Enfin,
lorfque ce fuc eft épaiffi, ils l’expofent au foleil
fur des nattes, & ils le réduifent en petites maffes
ou en paftilles.
Les grands du pays 6c les riches ne fe contentent
pas de ce cachou : ils y mêlent du cardamome, du
bois d’aloès, du mufe, de l’ambre, 6c d’autres chofes,
pour le rendre plus agréable 6c plus flateur au
goût. Telle eft la compofition de quelques paftilles
que l’on prépare dans les Indes, qui font rondes ,
plates, de la groffeur d’une noix vomique, que les
Hollandois apportent en Europe fous le nom de firi
gata gamber.
Telles font auffi des paftilles noires qui ont différentes
figures, tantôt rondes comme des pilules, tantôt
comme des graines , des fleurs, des fruits, des
mouches, des infefres, tantôt comme des crotes de
fouris, &c. que les Portugais font dans la ville de
Go a , 6c que les François méprifent à caufe de leur
violente odeur aromatique. Mais comme les nations
! qui fabriquent ces paftilles , font fort trompeufes ,
il leur arrive fouvent d’y mêler d’autres corps étrangers,
pour en augmenter le poids 6c le volume ; de-
forte qu’il eft rare d’en voir fortir de pures de leurs
mains.
Pour ce qui eft du cachou fimple, naturel, & fans
aromates, qui paffe en Europe, & que nous recherchons
le plus;c’eft un pur extrait de î’arec fait fur les
lieux, 6c rendu folide par l’évaporation de toute l’humidité
que cet extrait contenoit.
On coupe les graines d’arec vêrtes, en tranches ;
on les met bouillir dans l’eau, jufqu’à ce que cette
eau foit chargée d’une forte teinture rouge-brune ;
on paffe cette décofrion, qu’on fait évaporer jufqu’à
confiftarice d’extrait, auquel ou donne telle forme
que l’on veut, & qui fe durcit bientôt apres.
Effets de l'arec quand il efi verd. Gardas & Bontius
aflurent que fi l’on mâche l’arec vefd, il caufe
une efpece de vertige 6c d’ivreffe femblable à cellç
S $ s ij