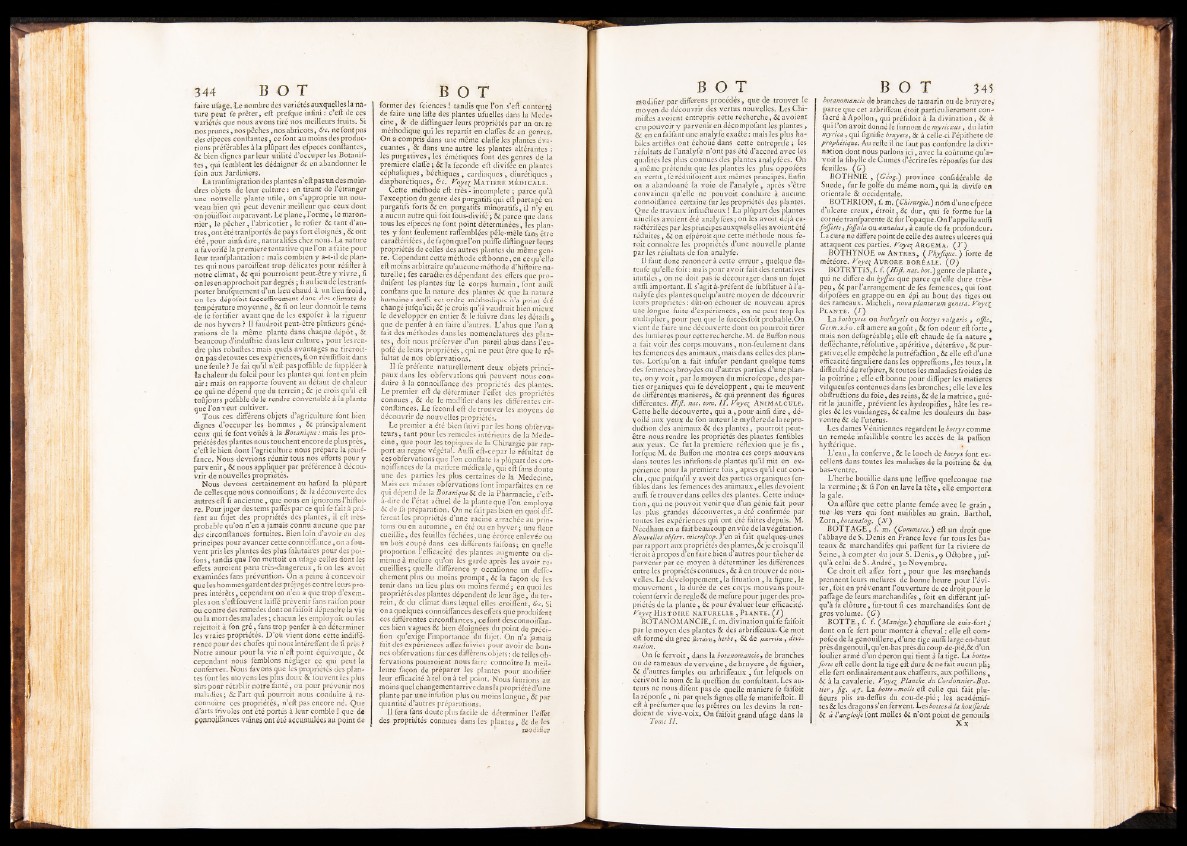
faire ufage. Le nombre des variétés auxquelles la nature
peut fe prêter, eft prefque infini : c’eft de ces
variétés que nous avons tiré nos meilleurs fruits. Si
nos prunes, nos pêches, nos abricots, &c. ne font pas
des efpeces confiantes, ce font au moins des productions
préférables à la plupart des elpeces confiantes,
& bien dignes par leur utilité d’occuper les Botanil-
t e s , qui femblent les dédaigner & en abandonner le
foin aux Jardiniers.
La tranfmigration des plantes n’eft pas un des moindres
objets de leur culture : en tirant de l’étranger
•une nouvelle plante utile, on s’approprie un nouveau
bien qui peut devenir meilleur que ceux dont
o n joüiffoit auparavant. Le plane, l’orme, le maron-
nier, le pêcher, l’abricotier, le rofier tant d’autres
, ont été tranfportés de pays fort éloignés, & ont
é té, pour ainfi dire, naturalifés chez nous. La nature
a favorifé la première tentative que l’on a faite pour
leur tranfplantation : mais combien y a-t-il de plantes
qui nous paroiffent trop délicates pour réfifter à
notre climat, & qui pourroient peut-être y vivre, fi
on les en approchoit par degrés ; fi au lieu de les tranf-
porter brufquement d’un lieu chaud à un lieu froid,
on les dépofoit fucceffivement dans des climats de
température moyenne, & fi on leur donnoit le tems
de fe fortifier avant que de les expofer à la rigueur
de nos hyvers ? Il faudroit peut-être plufieurs générations
de -la même plante dans chaque dépôt, &
beaucoup d’induftrie dans leur culture, pour les rendre
plus robuftes : mais quels avantages ne tireroit-
on pas de toutes ces expériences, fi on réufliffoit dans
une feule? Je fai qu’il n’eft paspoffible de fuppléerà
la chaleur du foleii pour les plantes qui font en plein
air: mais on rapporte fouvent au défaut de chaleur
ce qui ne dépend que du terrein ; & je crois qu’il eft
toûjours poflîble de le rendre convenable à la plante
que l’on veut cultiver.
Tous ces différens objets d’agriculture font bien
dignes d’occuper les hommes , & principalement
ceux qui fe font voués à la Botanique: mais les propriétés
des plantes nous touchent encore de plus près,
c’eft le bien dont l ’agriculture nous prépare la joüif-
fance. Nous devrions réunir tous nos efforts pour y
parvenir, & nous appliquer par préférence à découvrir
de nouvelles propriétés.
Nous devons certainement au hafard la plupart
de celles que nous connoiffons; & la découverte des
autres eft fi ancienne, que nous en ignorons l’hiftoi-
re. Pour juger des tems paffés par ce qui fe fait à pré-
fent au fujet des propriétés des plantes, il eft très-
probable qu’on n’en a jamais connu aucune que par
des circonftances fortuites. Bien loin d’avoir eu des
principes pour avancer cette connoifl'ance, on a fou-
vent pris les plantes des plus falutaires pour des poi-
fons, tandis que l’on mettoit en ufage celles dont les
effets auroient paru très-dangereux, fi on les avoit
examinées fans prévention. On a peine à concevoir
que les hommes gardent des préjugés contre leurs propres
intérêts, cependant on n’en a que trop d’exemples
i on s’eft fouvent laiffé prévenir fans raifon pour
ou contre des remedes dontonfaifoit dépendre la vie
ou la mort des malades ; chacun les employoit ou les
rejettoit à fon g ré, fans trop penfer à en déterminer
les vraies propriétés. D ’où vient donc cette indifférence
pour des chofes qui nous intéreffent de fi près ?
Notre amour pour la vie n’eft point équivoque, &
cependant nous femblons négliger ce qui peut la
conferver. Nous favons que les propriétés des plantes
font les moyens les plus doux & fouvent les plus
surs pouf rétablir notre fanté, ou pour prévenir nos
maladies ; & l’art qui pourroit nous conduire à re-
connoître ces propriétés, n’eft pas encore né. Que
d’arts frivoles ont été portés à leur comble ! que de
fçnnoiffançes vaines ont été accumulées au point de
former des fciences ! tandis que l’on s’eft contenté
de faire une lifte des plantes ufuelles dans la Médecine,
& de diftinguer leurs propriétés par un ort re
méthodique qui les repartit en clafles & en genres.
On a compris dans une même claffe les plantes évacuantes
, & dans une autre les plantes altérantes :
les purgatives, les émétiques font des genres de la
première claffe ; & la fécondé eft divifee en plantes
céphaliques, béchiques , cardiaques , diurétiques ,
diaphoniques, &c. Voyei Matière médicale.
Cette méthode eft très - incomplète ; parce qu’à
l’exception du genre des purgatifs qui eft partagé en
purgatifs forts & en purgatifs minoratifs, il n’y en
a aucun autre qui foit fous-divifé ; & parce que dans
tous les efpeces ne font point déterminées, les plantes
y font feulement raffemblées pêle-mêle fans être
caraélérifées, de façon que l’on puiffe diftinguer leurs
propriétés de celles des autres plantes du même genre.
Cependant cette méthode eft bonne, en ce qu’elle
eft moins arbitraire qu’aucune méthode d’hiftoire naturelle
; fes cara&eres dépendant des effets que pro-
duifent les plantes fur le corps humain, font aufii
conftans que la nature des plantes & que la nature
humaine : aufii cet ordre méthodique n’a point été
changé jufqu’ici; & je crois qu’il vaudroit bien mieux
le développer en entier & le fuivre dans les détails,
que de penfer à en faire d’autres. L’abus que l’on a
fait des méthodes dans les nomenclatures des plantes
, doit nous préferver d’un pareil abus dans l’ex-
pofé de leurs propriétés, qui ne peut être que le ré-
lultat de nos obfervations.
Il fe préfente naturellement deux objets principaux
dans les obfervations qui peuvent nous conduire
à la connoifl'ance des propriétés des plantes.
Le premier eft de déterminer l’effet des propriétés
connues , & de le modifier dans les différentes circonftances.
Le fécond eft de trouver les moyens de
découvrir de nouvelles propriétés.
Le premier a été bien fuivi par les bons obferva-
teurs, tant pour les remedes intérieurs de la Médecine
, que pour les topiques de la Chirurgie par rapport
au régné végétal. Auffi eft-cepar le réfultat de
ces obfervations que l’on conftate la plupart des con-
noiffances de la matière médicale, qui eft fans doute
une des parties les plus certaines de la Medecine.
Mais ces mêmes obfervations font imparfaites en ce
qui dépend de la Botanique & de la Pharmacie, c’eft-
à-dire de l’état a chie! de la plante que l ’on employé
& de fa préparation. On ne fait pas bien en quoi different
les propriétés d’une racine arrachée au prin-
tems ou en automne, en été ou en hyver ; une fleur
cueillie, des feuilles féchées, une écorce enlevée ou
un bois coupé dans ces différents faifons; en quelle
proportion l’efficacité des plantes augmente ou diminue
à mefure qu’on les garde après les avoir recueillies
; quelle différence y occafionne un deflë-
chement plus ou moins prompt, & la façon de les
tenir dans un lieu plus ou moins fermé ; en quoi les
propriétés des plantes dépendent de leur âge, du ter-
rein,'& du climat dans lequel elles croiffent, &c. Si
on a quelques connoiflances des effets queproduifent
ces différentes circonftances, ce font desconnoiflan-
ces bien vagues & bien éloignées du point de préci-
fion qu’exige l’importance du fujet. On n’a jamais
fait des expériences allez fuivies pour avoir de bonnes
obfervations fur ces différens objets : de telles obfervations
pourroient nous faire connoître la meilleure
façon de préparer les plantes pour modifier
leur efficacité à tel ou à tel point. Nous faurions au
moins quel changement arrive dans la propriété d’une
plante par une infufion plus ou moins longue, & par
quantité d’autres préparations.
Il fera fans doute plus facile de déterminer l’effet
des propriétés connues dans les plantes, & de les
modifie?
modifier par differens procédés , que de trouver le
moyen de découvrir des vertus nouvelles. Les Chi-
miftes avoient entrepris cette recherche, & avoient
cru pouvoir y parvenir en décompofant les plantes ,
& en en faifant une analyfe exa&e : mais les plus habiles
artiftes ont échoiie dans cette entreprife ; les
réfultats de l’analyfe n’ont pas été d’accord avec les
qualités les plus connues des plantes analyfées. On
a_ même prétendu que les plantes les plus oppofées
en vertu, feréduifoient aux mêmes principes.Enfin
on a abandonné la voie de l’analyfe, après s’être
convaincu qu’elle ne pouvoit conduire à aucune
connoifl'ance certaine fur les propriétés des plantes.
Que de travaux infru&ueux ! La plupart des plantes
ufuelles avoient été analyfées ; on les avoit déjà ca-
raétérifées par les principes auxquels elles avoient été
réduites, & on efpéroit que cette méthode nous fe-
r.oit connoître les propriétés d’une nouvelle plante
par les réfultats de fon analyfe.
Il faut donc renoncer à cette erreur, quelque fla-
teufe qu’elle foit : mais pour avoir fait des tentatives
inutiles, on ne doit pas fe décourager dans un fujet
auffi important. Il s’agit à-préfent de fubftituer à l’a-
nalyfe des plantes quelqu’autre moyen de découvrir
leurs propriétés : dût-on échoiier de nouveau après
une longue fuite d’expériences, on ne peut trop les
multiplier, pour peu que le fuccès foit probable.On
vient de faire une découverte dont on pourroit tirer
des lumières pour cette recherche. M. de Buffon nous
a fait voir des corps mouvans, non-feulement dans
les femences des animaux, mais dans celles des plantes.
Lorfqu’on a fait infufer pendant quelque tems
des femences broyées ou d’autres parties d’une plante
, on y vo it , par le moyen du microfcope, des parties
organiques qui fe développent, qui fe meuvent
de differentes maniérés, & qui prennent des figures
différentes. H iji. nat. tom. II. Voyei Animalcule.
Çette belle découverte, qui a , pour ainfi dire , dévoilé
aux yeux de fon auteur le myftere de la repro-
duâion des animaux & des plantes, pourroit peut-
être nous rendre les propriétés des plantes fenfibles
aux yeux. Ce fut la première réflexion que je fis ,
lorfque M. de Buffon me montra ces corps mouvans
dans toutes les infufions de plantes qu’il mit en expérience
pour la première fois , après qu’il eut conclu
, que puifqu’il y avoit des parties organiques fenfibles
dans les femences des animaux, elles dévoient
auffi fe trouver dans celles des plantes. Cette induction,
qui ne pouvoit venir que d’un génie; fait pour
les plus grandes découvertes, a été confirmée par
toutes les expériences qui ont été faites depuis. M.
Néedham en a fait beaucoup en vue de la végétation.
Nouvelles obferv. microfcop. J’en ai fait quelques-unes
par rapport aux propriétés des plantes, & je crois qu’il
-leroit à propos d’en faire.bien d’autres pour tâcher de
parvenir par ce moyen à déterminer les différences
entre les propriétés connues, & à en trouver de nouvelles.
Le développement, la fituation, la figure,le
mouvement, la durée de ces côrps mouvans pourroient
fervir de réglé & de mefure pour juger des propriétés
de la plante, & pour évaluer leur efficacité.
Koye^ Histoire naturelle , Plante. (/)
BOTANOMANCIE,f. m. divination qui fefaifoit
par le moyen des plantes & des arbriffeaux. Ce mot
ejft. formé du grec /3ot«V# , herbe, & de /«imia, divination.
On fe fervoit, dans la botanomancie, de branches
ou de rameaux de verveine, de bruyere, de figuier,
& d’autres fimples ou arbriffeaux , fur lefquels on
écrivoit le nom & la queftion du confultant. Les auteurs
ne nous difent pas de quelle maniéré fe faifoit
la réponfe , ni par quels lignes elle fe manifeftoit. Il
eft à préfumer que les prêtres ou les devins la ren-
doient de vive-voix. On faifoit grand ufage dans la
' Tome II.
botanofhdncie de branches de tamarin ou de bruyere,’
parce que cet arbriffeau étoit particulièrement con-
facré à Apollon, qui préfidoit à la divination -, 6c à
qui l’on avoit donné le furnom de myricceus, du latin
myrica, qui lignifie bruyere, & à celle-ci l’épithete de
prophétique. Au relie il ne faut pas confondre la d ivination
dont nous parlons ic i, avec la coutume qu’a-
voit la fibylle de Cumes d’écrire fes réponfes fur des
feuilles» ( G)
BOTHNIE , (Géog.) province cônfidérable de
Suède* fur le golfe du même nom, qui la divife en
orientale & occidentale.
BOTHRION, f. m» ('Chirurgie!) nom d’une efpéce
d’uicere creux, étroit, & dur, qui fe forme fur la
cornée tranfparente Ôc furl’opaqtie.On l’appelle auffi
foffette JfoJJula ou annulus, à caufe de fa profondeur»
La cure ne différé point de celle des autres ulcérés qui
attaquent ces parties. Voyeç Argema» ( F )
BOTHYNOE ou A n t r e s , (Phyfique) fo r te d e
m é téo re . Voye[ A u r o r e b o r é a l e . ( O )
BOTRYTIS,f. f. (Hifl. nat. bot.')genre déplanté,
qui ne différé du byjjiis que parce qu’elle dure très-*
peu, & par l’arrangement de fes femences* qui font
difpofées en grappe ou en épi au bout des tiges ou
des rameaux. Micheli, novaplantarum généra. Voye^
P l a n t e . ( / )
La bothrytes ou bothrytis ou botrys vulgaris , officé
Germ.zSo. eft amere au goût, & fon odeur eft forte ,
mais non defagréable ; elle eft chaude de fa nature ,
deflechante,réfolutive, apéritive, déterfive, & purgative;
elle empêche la putréfaction, & elle eft d’une
efficacité finguliere dans les oppreffions, les toux, la
difficulté de refpirer, & toutes les maladies froides de
la poitrine ; elle eft bonne pour diffiper les matières
vifqueufes contenues dans les bronches; elle leve les
qbftruCtions du foie, des reins, & de la matrice, guérit
la jaunifle, prévient les hydropifiesI hâte les réglés
& les vuidanges,& calme les douleurs du bas-
ventre & de l’uterus.
Les dames Vénitiennes regardent le botrys comme
un remede infaillible contre les accès de la paffion
hyftérique. *
L’eau, la conferve, & le looch de botrys font ex-
cellens dans toutes les maladies de la poitrine & du
bas-ventre.
L’herbe bouillie dans une Ieffive quelconque tue
la vermine ; & fi l’on en lave la tête, elle emportera
la gale.
On aflure que cette plante femée avec le grain,
tue les vers qui font nuifibles au grain. Barthol.
Zorn, bptanalog, (N )
BOTTAGE, f. m. (Commerce!) eft un droit que
l’abbaye de S. Denis en France leve fur fous les bateaux
& marchandifes qui paffent fur la riviere de
Seine, à compter du jour S. Denis,9 Oftobre, juf-
qu’à celui de S. André ,3 0 Novembre.
Ce droit eft affez fo r t , pour que les marchands
prennent leurs mefures de bonne heure pour l’éviter
, foit en prévenant l’ouverture de ce droit pour le
paflage de leurs marchandifes, foit en différant juf-
qu’à fa clôture, fur-tout fi ces marchandifes font de
gros volume. ( G)
BO TTE, f. f. (Manège!) chauffure de cuir-fort,
dont on fe fert pour monter à cheval : elle eft com-
pofée de la genouillère * d’une tige auffi large en-haut
près du genouil, qu’en-bas près du coup-de-pié,& d’un
foulier armé d’un éperon qui tient à la tige. La botte-
forte eft celle dont la tige eft dure & ne fait aucun pli;
elle fert ordinairement aux chafleurs, aux poftillons ,
& à la cavalerie. Voye^ Planche du Cordonnier-Bottier
, fig. 47. La botte-molle eft celle qui fait plufieurs
plis au-deflus du cou-de-pié; les académif-
tes & les dragons s’en fervent. Les bottes à la hou farde
& à CangloiJ'e font molles & n’ont point de genouils
X x