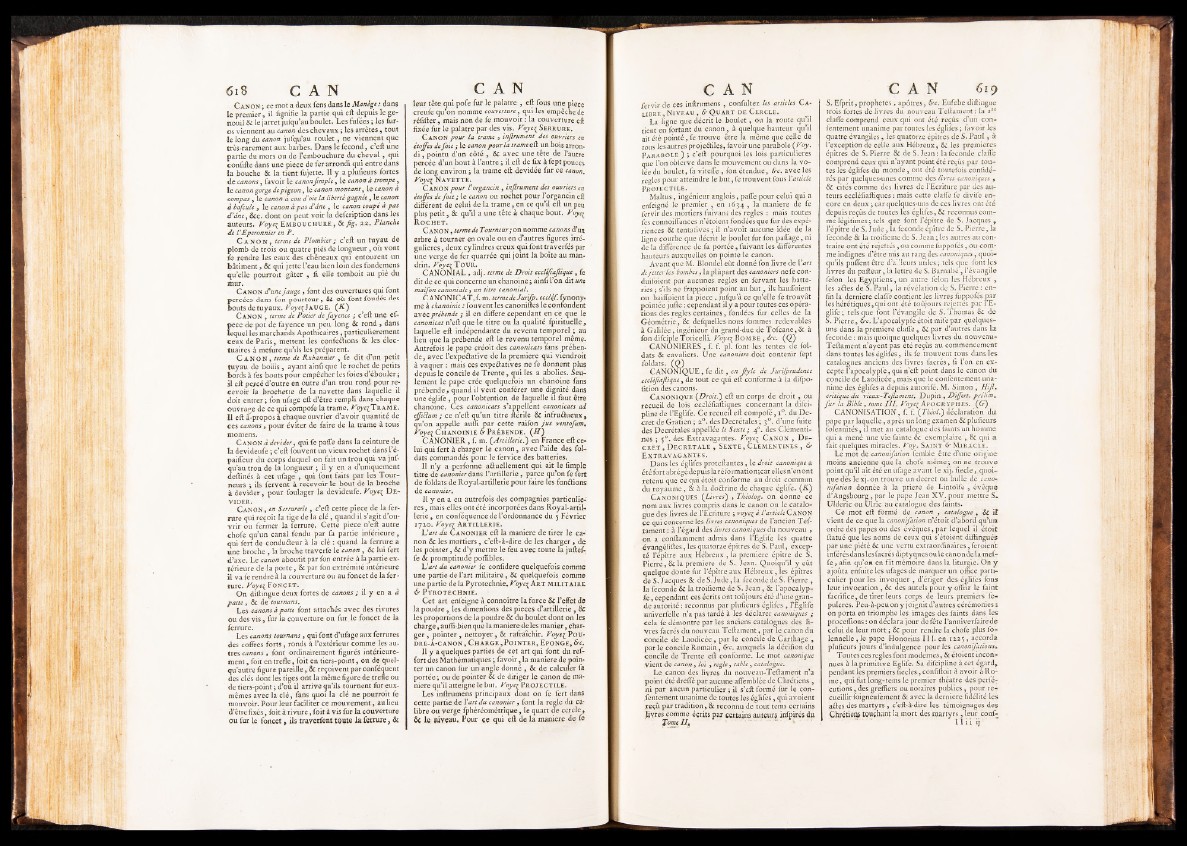
Canon ; ce mot a deux fens dans le Manège : dans
le premier, il lignifie la partie qui eft depuis le ge-
nouil & le jarret jusqu’au boulet. Les fufées ; les fur-
os viennent au canon des chevaux ; les arrêtes, tout
-le long du canon jufqu’au roulet, ne viennent que
très-rarement aux barbes. Dans le fécond, c’eft une
partie du mors ou de l’embouchure du cheval, qui
confifte dans une piece de fer arrondi qui entre dans
la bouche & la tient fujette» Il y a plufieurs fortes
de canons, favoir le canonJîmple, le canon à trompe,
le canon gorge de pigeon, le canon montant, le canon a
compas, le canon à cou d'oie la liberté gagnee, le canon
à baj'culc , le canon à pas d'âne , le canon coupe a pas
d'âne, & c . dont on peut voir la defeription dans les
auteurs. Voye%_Embouchure, & fig. x z . Planche
de l'Eperonnier en P.
C a n o n , terme de Plombier ; c’eft un tuyau de
plomb de trois ou quatre piés de longueur, oii vont
le rendre les eaux des chêneaux qui entourent un
bâtiment , & qui jette l’eau bien loin des fondemens
qu’elle pourroit gâter , fi elle tomboit au pie du
mur.
Canon (Tune jauge, font des ouvertures qui font
percées dans fon pourtour, & où font foudés des
bouts de tuyaux. Voyt^ Jauge. (K )
Canon , terme de Potier de fayence ; c’eft une ef-
pece de pot de fayence un peu long & rond, dans
lequel les marchands Apothicaires, particulièrement
ceux de Paris, mettent les conférions & les élec-
tuaires à mefure qu’ils les préparent.
C an o n , terme de Kubannier , fe dit d’un petit
tuyau de boiiis, ayant ainfi que le rochet de petits
bords à fes bouts pour empêcher les foies d’ébouler ;
il eft pe^cé d’outre en outre d’un trou rond pour recevoir
la brochette de la navette dans laquelle il
doit entrer; fon ufage eft d’être rempli dans chaque
ouVrave de ce qui eompofe la trame. FoyeiT r ame.
Il eft a-propos à chaque ouvrier d’avoir quantité de
ces canons, pour éviter de faire de la trame à tous
momens.
Canon à dévider, qui fe paffe dans la ceinture de
la devideufe ; c’eft fouvent un vieux rochet dans l’é-
paifteur du corps duquel on fait un trou qui va jufqu’au
trou de la longueur ; il y en a d’uniquement
deftinés à cet ufage , qui font faits par les Tourneurs
; ils fervent à recevoir le bout de la broche à de vider, pour foulager la devideufe. Voye{ D évider.
Canon , en Serrurerie , c’eft cette piece de la ferrure
qui reçoit la tige de la clé , quand il s’agit d’ouvrir
ou fermer la ferrure. Cette piece n’eft autre
chofe qu’un canal fendu par fa partie inférieure,
qui fert de conduôeur à la clé : quand la ferrure a
une broche , la broche traverfe le canon, & lui fert
d’axe. Le canon aboutit par fon entrée à la partie extérieure
de la porte, & par fon extrémité intérieure
il va fe rendre à la couverture ou au foneet de la ferrure.
Voye%_ Foncet.
On diftingue deux fortes de canons ; il y en a à
patte , & de tournans.
Les canons à patte font attachés avec des rivures
ou des v is , fur la couverture ou fur le foncet de la
ferrure.
Les canons tournans, qui font d’ufage aux ferrures
des coffres forts, ronds à l’extérieur comme les autres
canons, font ordinairement figurés intérieurement
, foit en trefle, foit en tiers-point, ou de quel-
qu’autre figure pareille, & reçoivent par conféquent
des clés dont les tiges ont la même figure de trefle ou
de tiers-point ; d’où il arrive qu’ils tournent fur eux-
mêmes avec la clé, fans quoi la clé ne pourroit fe
mouvoir. Pour leur faciliter ce mouvement, au lieu
d’être fixés, foit à rivure, foit à vis fur la couverture
ou fur le foncet, ils traverfent toute la ferrure} &
leur tête qui pofe fur le palatre , eft fous une piece
creufe qu’on nomme couverture, qui les empêche de
réfifter, mais non de fe mouvoir : la couverture eft
fixée fur le palatre p C ar des vis. Voye{ Serrure. anon pour la trame , injlrument des ouvriers en
étoffes de foie ; le canon pour la trame eft un bois arrondi
, pointu d’un côté , & avec une tête de l’autre
percée d’un bout à l’autre ; il eft de fix à fept pouces
de long environ ; la trame eft devidée fur ce canon,
FoyCe{ Navette. anon pour l'organcin , injlrument des ouvriers en
étoffes de foie ; le canon ou rochet pour l’organcin eft
différent de celui de la trame, en ce qu’il eft un peu
plus petit, & qu’il a une tête à chaque bout. Voye^ Rochet.
Canon , terme de Tourneur; on nomme canons d’un
arbre à tourner en ovale ou en d’autres figures irrégulières
, deux cylindres creux qui fonttraverfés par
une verge de fer quarrée qui joint la boîte au mandrin.
Voye^ T our.
CANONIAL, adj. terme de Droit ecclèjîajlique, fe
dit de ce qui concerne un chanoine ; ainfi l’on dit une
maifon canoniale , un titre canonial.
CANONICAT,f. m. termedeJurifp. ecclèf. fynony.
me à chanoinie : fouvent les canoniftes le confondent
avec prébende ; il en différé cependant en ce que le
canonicat n’eft que le titre ou la qualité fpirituelle ,
laquelle eft indépendante du revenu temporel ; au
lieu que la prébende eft le revenu temporel même.
Autrefois le pape créoit des canonicats fans prébende,
avec l’expeâative de la première qui viendroit
à vaquer : mais ces expectatives ne fe donnent plus
depuis le concile de Trente, qui les a abolies. Seulement
le pape crée quelquefois un chanoine fans
prébende , quand il veut conférer une dignité dans
une églife, pour l’obtention de laquelle il faut être
chanoine. Ces canonicats s’appellent canonicats ad
effeclum ; ce n’eft qu’un titre ftérile & infructueux ,
qu’on appelle aufli par cette raifon jus ventofum. Poye{ Chanoinie 6* Prébende. (H )
CANONIER, f. m. (Artillerie.) en France eft celui
qui fert à charger le canon, avec l’aide des fol-
dats commandés pour le fervice des batteries.
Il n’y a perfonne actuellement qui ait le fimple
titre de canonier dans l’artillerie, parce qu’on fe lert
de foldats de Royal-artillerie pour faire les fondions
de canonier.
Il y en a eu autrefois des compagnies particulières
, mais elles ont été incorporées dans Royal-artillerie
, en conféquence de l’ordonnance du 5 Février 1710. Foye^ Artillerie.
L’art du Canonier eft la maniéré de tirer le canon
& les mortiers, c’eft-à-dire de les charger , de
les pointer, & d’y mettre le feu avec toute la juftef-
fe & promptitude poflibles.
L’art du canonier fe confidere quelquefois comme
une partie de l’art militaire, & quelquefois comme
une partie de la Pyrotechnie. Foye{ Art militaire
6* Pyrotechnie.
Cet art enfeigne à connoître la force & l’effet de
la poudre, les dimenfions des pièces d’artillerie, &C
les proportions de la poudre & du boulet dont on les
charge, aufli-bien que la maniéré de les manier, charger
, pointer, nettoyer, & rafraîchir. Voye^ Pou-
DRE-À-CANON , CHARGE , POINTER, EPONGE, &C. Il y a quelques parties de cet art qui font du ref-
fort des Mathématiques ; favoir, la maniéré de pointer
un canon fur un angle donné , & de calculer fa
portée ; ou de pointer & de diriger le canon de maniéré
qu’il atteigne le but. Vyyeç Projectile.
Les inftrumens principaux dont on fe fert dans
çette partie de l’art du canonier, font la réglé du calibre
ou verge fphéréométrique, le quart ae cercle ,
& le niveau. Pour ce qui eft de la maniéré de fe
fervir de ces inftrumens , confultez les articles C al
i b r e , Niveau , & Q uart de C e r c l e .
La ligne que décrit le boulet , ou la route qu’il
tient en fortant du canon, à quelque hauteur qu’il
ait été pointé, fe trouve être la même que celle de
tous les autres projectiles, lavoir une parabole {Voy.
P a r a b o l e ) ; c’eft pourquoi les lois particulières
que l’on obferve dans le mouvement ou dans la volée
du boulet, fa vîteffe , fon étendue, &c. avec les
réglés pour atteindre le but,fe trouvent fous l’article
P r o j e c t i l e .
Maltus, ingénieur anglois, paffe pour celui qui a
enfeigné le premier , en 1634 , la maniéré dè fe
fervir des mortiers fuivant des réglés : mais toutes
fes connoifiances n’étoient fondées que fur des expériences
& tentatives ; il n’a voit aucune idée de la
ligne courbe que décrit le boulet fur fon paffage, ni
de la différence de fa portée, fuivant les différentes
hauteurs auxquelles on pointe le canon.
Avant que M. Blondel eût donné fon livre de l ’art
de jetter les bombes, la plupart des canoniers nefe condu
isent par aucunes réglés en fervant les batteries
; s’ils ne frappoient point au bu t, ils hauffoient
ou baiffoient la piece , jufqu’à ce qu’elle fe trouvât
pointée jufte : cependant il y a pour toutes ces opérations
des réglés certaines, fondées fur celles de la
Géométrie, & defquelles nous fommes redevables
à Galilée, ingénieur du grand-duc de Tofcane,& à
fon difcipleToricelli. Voyt%_ Bombe , &c. (Q)
CANONIERES , f. f. pl. font les tentes de foldats
& cavaliers. Une canoniere doit contenir fept
foldats. (Q)
CANONIQUE, fe dit, en Jlyle de Jurifprudence
ecclèjîajlique, de tout ce qui eft conforme à la difpo-
fition des canons.
Canonique (Droit.) eft un corps de droit, ou
recueil de lois eccléfiaftiques concernant la difei-
pline de l’Eglife. Ce recueil eft compofé, i°. du D ecret
de Gratien ; x°. des Décrétales ; 30. d’une fuite
des Décrétales appellée le Sexte ; 40. des Clémentines
; 50. des Extravagantes. Foye^ C anon , D ecr
et , D ecretale , Se x t e , C lémentines , 6*
E xtra v ag an t es. .
Dans les églifes proteftantes, le droit canonique a
été fort abrégé depuis la réformation;car elles n’en ont
retenu que ce qui étoit conforme au droit commun
du royaume, & à la do&rine de chaque églife. (K )
C anoniques (Livres") , Thèolog. on donne ce
nom aux livres compris dans le canon ou le catalogue
des livres de l’Ecriture ; voye^ à l ’article C anon
ce qui concerne les livres canoniques de l’ancien Teftament
: à l’égard des livres canoniques du nouveau ,
on a conftamment admis dans l’Eglife les quatre
évangéliftes, les quatorze épîtres de S. Paul, excepté
l’épître aux Hébreux , la première épître de S.
Pierre , & la première de S. Jean. Quoiqu’il y eût
quelque doute fur l’épître aux Hébreux, les épîtres
de S. Jacques & de S. Jude, la fécondé de S. Pierre ,
la fécondé & la troifieme de S. Jean, & l’apocalyp-
fe , cependant ces écrits ont toûjours été d’une grande
autorité : reconnus par plufieurs églifes , l’Eglife
nniverfelle n’a pas tardé à les déclarer canoniques ;
cela fe démontre par les anciens catalogues des livres
facrés du nouveau Teftament, par le canon du
concile de Laodicée , par le concile de Carthage ,
par le concile Romain, &c. auxquels la décifion du
concile de Trente eft conforme. Le mot canonique
yient de canon , loi , réglé , table, catalogue.
Le canon des livres du nouveau-Teftamerit n’a
point été dreffé par aucune affemblée de Chrétiens ,
ni par aucun particulier ; il s’eft formé fur le consentement
unanime de toutes les églifes, qui avoient
reçû par tradition, & reconnu de tout tems certains
livres comme écrits par certains auteurs infpirés du lom llt ■ ............. '
S. Efprit, prophètes -, apôtres, &c. Eufebe diftingue
trois fortes de livres du nouveau Teftament : la i r*
claffe comprend ceux qui ont été reçûs d’un con-
fentement unanime par toutes les églifes ; favoir les
quatre évangiles, les quatorze épîtres de S. Paul, à
l’exception de celle aux Hébreux, & les premières
épîtres de S. Pierre & de S. Jean: la fécondé claffe
comprend ceux qui n’ayant point été reçûs par toutes
les églifes du monde, ont été toutefois confidé-
rés par quelques-unes comme des livres canoniques >
& cités comme des livres de l’Ecriture par des auteurs
eccléfiaftiques : mais cette claffe fe divife encore
en deux ; car quelques-uns de ces livres ont été
depuis reçûs de toutes les églifes, & reconnus comme
légitimes ; tels que font l’épître de S. Jacques ,
l’épître de S. Jude, la fécondé epître de S. Pierre, la
fécondé & la troifieme de S. Jean ; les autres au contraire
ont été rejettes, ou comme fuppofés, ou comme
indignes d’être mis au rang des canoniques, quoiqu’ils
puffent être d’ailleurs utiles ; tels que font les
livres du pafteur, la lettre de S. Barnabe, l’évangile
félon les Egyptiens, un autre félon les Hébreux ,
les aftes de S. Paul, la révélation de S. Pierre : enfin
la derniere claffe contient les livres fuppofés par
les hérétiques, qui ont été toûjours rejettés par l’Eglife
; tels que font l’évangile de S. Thomas & de
S. Pierre, &c. L’apocalypfe étoit mife par quelques-
uns dans la première claffe, & par d’autres dans la
fécondé : mais quoique quelques livres du nouveau-
Teftament n’ayent pas été reçûs au commencement
dans toutes les églifes, ils fe trouvent tous dans les
catalogues anciens des livres facrés, fi l’on en excepte
l’apocalypfe, qui n’eft point dans le canon du
concile de Laodicée, mais que le confentement unanime
des églifes a depuis autorifé. M. Simon , Hiß. critique du vieux-Teßament. Dupin , Differt. prélihi,
fur la Bible t tome III. Foye{ A PO CRY PHES. (G)
CANONISATION, f. f. (Th éoljdéclaration du
pape par laquelle, après un long examen & plufieurs
folennités, il met au catalogue des faints un homme
qui a mené une vie fainte & exemplaire , &c qui a
fait quelques miracles. Voy. Saint 6* Miracle.
Le mot de canonifation femble être d’une origine
moins ancienne que la chofe même ; on ne trouve
point qu’il ait été en ufage avant le xij. fiecle ^ quoique
dès lexj.on trouve un decret ou bulle de cano*.
nifation donnée à la priere de Lintolfe , évêque
d’Augsbourg, par le pape Jean XV. pour mettre S*
Ulderic ou Ulric au catalogue des faints.
Ce mot eft formé de canon , catalogue , & if
vient de ce que la canonifation n’étoit d’abord qu’un
ordre des papes ou des évêques, par lequel il étoit
ftatué que les noms de ceux qui s’étoient diftingués
par une piété. & une vertu extraordinaires, feroient
inférés dans les facrés diptyques ou le canon de la mef-
fe , afin qu’on en fît mémoire dans la liturgie. On y
ajoûta enfuite les ufages de marquer un office particulier
pour les invoquer , d’ériger des églifes fous
leur invocation , & des autels pour y offrir le faint
facrifice, de tirer leurs corps de leurs premiers fe^
pulcres. Peu-à-peu on y joignit d’autres cérémonies r
on porta en triomphe les images des faints dans les
procédions : on déclara jour de fête l ’anniverfaire de
celui de leur mort ; & pour rendre la chofe plus fo-
lennelle , le pape Honorius III. en 1215 , accorda
pliifieurs jours d’indulgence pour les canonifitions»
Toutes ces réglés font modernes, & étoient inconnues
à la primitive Eglife. Sa difeipline à cet égard,
pendant les premiers fiecles, confiftoit à avoir à Rome
, qui fut long-tems le premier théâtre des perfé^
cutions, des greffiers ou notaires publics, pour re-?
cueillir foigneufement & avec la derniere fidélité les
attes des martyrs , c’eft-à-dire les témoignages des
Chrétiens touchant la mort des martyrs, leur conf