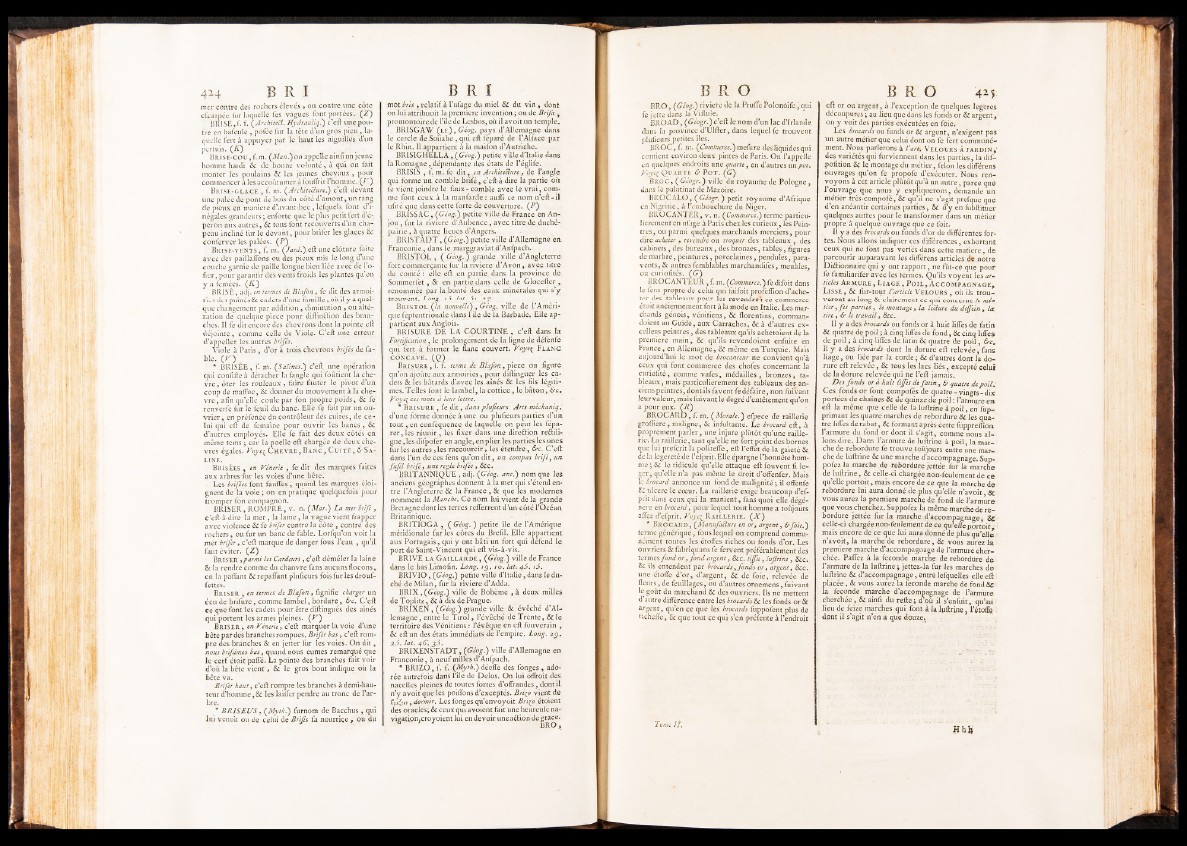
mer contre des rochers éleves , ou contre une cote
eicarpée-fur laquelle fes vagues font portées, (Z )
BRISE, f. f. (Architccl. Hydrauiiq.') c’e'ft une poutre
en bafcule , poféè fur la tête d’un gros piep, laquelle
fert à appuyer par lé haut les aiguilles ,'d’un
pertuis. (K) - . . ■
Brise-c o u , f.m. (Mari.)on appelle ainfiun jeune
homme hardi 6c de bonne volonté, à qui on fait
monter lès poulains 5c les jeunes chevaux, pour
Commencer à les accoutumer à fouffrir l’homme. (rQ,
Brise-GLACE 1'. m. (Architecture.') c’eft devant
une palée de pont de bois du côté d’amont, un rang
de pieux en maniéré d’avant-bec , lefquels font d’ï- :
négales grandeurs ; enforte que le plus petit lert d’e-
perôn aux autres, 6c tous font recouverts d’un cha-
peau incliné fur le devant, pour brifer les glaces 6c
conferver les paiées. (P)
. Brise-vents , f. m. ( Jard.) eft une clôture faite
avec dés paillaftbns ou des pieux mis le long d’une
couche garnie de paillé longue bien liée avec dé l’o-
fier, pour garantir des vents froids les plantes q\i’on
y a femées. (X )
BRISÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit des armoiries
des puînés 6c cadets d’une famille, où il y a quelque
changement par addition, diminution, ou altération
de quelque piece pour diftinûion des branches.
Il fe dit encore des chevrons dont la pointe eft
déjointe, comme celle de Viole. C ’eft une erreur
d’appeller les autres brifés.
Viole à Paris , d’or à trois chevrons brifés de fable.
(V ) . ■ ■ ■ ■
* BRISÉE, f. m. (Salines.') c’eft. une operation
qui confifteà détacher lafangle qui foûtient la chèv
re, ôter les rouleaux, faire fauter le pivot d’un,
coup de maflue, 6c donner du mouvement à la chèv
re , afin qu’elle coule par fon propre poids, & fe*
renverfè fur le féuil du banc. Elle.fe fait par un ouvrier,
en préfenée du contrôleur dés cuites, de celui
qui eft de femaine pour ouvrir les bancs , &
d’autres employés. Elle fe fait des deux côtés en
même tems ; car la poelle eft chargée de deux chèvres
égales. Voye^C hevre,B a n c , C u it e , 6*Sa line.
Brisée s, en Vénerie, fe dit des marques faites
aux arbres fur les voies'd’une bête.
Les brifèes font fauffès , quand les marques,éloignent
de la voie ; on en pratique quelquefois pour
tromper fon compagnon.
BRISER, ROMPRE, v. n. (Mar.) La mer brife ,
c ’eft-à-dire la mer, la lame, la vague vient frapper
avec violence & fe brifer contre la côte , contre des
rochers, ou fur un banc de fable. Lorfqu’on voit la
mer brifer, c ’eft marque de danger fous l’eau , qu’il
faut éviter. (Z )
Briser , parmi les Cardeurs, c’eft déméler la laine
& la rendre comme du chanvre fans aucuns flocons,
en la paffant 6c repaflant plufieurs fois fur les drouf-
fettes.
Briser , en termes de Blafon, lignifie charger un
écu de brifure, comme lambel, bordure, &c. C ’eft
ce que font les cadets pour être diftingués des aînés
qui portent les armes pleines. (V )
Briser , en Vénerie, c’eft marquer la voie d’une
bête par des branches rompues. Brifer bas, c’eft rompre
des branches & en jetter fur les voies. On d it ,
nous brifâmes bas, quand nous eûmes remarqué que
le cerf étoit paffé. La pointe des branches fait voir
d’o îila bête vient > & le gros bout indique où la
bête va.
Brifer haut, c’eft rompre les branches à demi-hauteur
d’homme, & les laiffer pendre au tronc de l’arbre.
* B RIS EU S , (Myth.) furnom de Bacchus , qui
lui venoit ou de celui de Br i f s fa nourrice > ou du
mot bris,.relatif à l’ufage, du miel & du vin , dont
on lui attribuoit la première invention ; ou de Brifa ,
promontoire de l’île de Lesbos,où il a voit un temple.
BRISGAW ( l e ) , Géog. pays d’Allemagne dans
le cercle de Soiiabe , qui eft feparé de l’Alface-par
le Rhin. Il appartient à la maifon d’Autriche.^
BRISIGHELLA, (Géog.) petite ville d’Italie dans
la Romagne, dépendante des états de l’églife.
BRISIS , f. m. fe dit, en Architecture, de l’angle
qui forme un. comble brife, c’eft-à-dire la partie où
fe vient joindre le faux - comble avec le vrai, comme
font ceux, à la manfarde : aufli ce nom n’eft-il
ufué que dans, cette forte de couverture. (P)
BRISSAC ,(Géog.) petite ville de France en Anjou
, fur la riviere d’Aubencq, avec titre de duché-
pairie, à quatre lieues d’Angers.
BRISTADT, (Géog.) petite ville d’Allemagne en
Franconie, dans le marggraviat d’Anfpach.
BRISTOL , ( Géog. ) grande ville d’Angleterre
fort; commerçante fur la riviere d’A von, avec titre
de comté : elle eft en partie dans la province de
Sommerfèt , & en partie dans celle de Glocefter ,
renommée par la,bonté des eaux minérales qui s’y
trouvent. Long. i<5. lat.5i . z y . ;
B r i s t o l (la nouvelle) , Géog. ville de l ’Amérique
fèptentrionale dans. l’île de la Barbade. Elle appartient
aux Anglois.
BRISURE DE LA COURTINE , c ’ e ft dans la
Fortification, le p ro lo n g em en t d e la lig n e d e d é fen fe
q u i f e r t à . fo rm e r le, flan c c o u v e r t . Voye^ F l a n c
c o n c a v e '. (Q)
B r i s u r e , f. f. terme de Blafon, piece ou figure
qu’on àjoûte-aux armoiries, pour diftinguer les cadets
& les bâtards d’avec les aînés & les .fils légitimes.
Telles font le lambel, la cottice, le bâton, &c.
Voye[ ces mots à leur lettre., I
* BRISURE , fe dit , dans plufieurs Arts mèchaniq)
d’une forme donnée à une ou plufieurs parties d’un,
tou t, en conféquenee de laquelle on peut les fépa-
rer,les réunir., les fixer dans une dire&ion reâili-
gne ,les difpofer en angle, en plier les parties les unes
furies autres, les raccourcir, lés étendre, &c. C ’eft
dans l’un de ces fens qu’on dit, un compas brifé, un
fujîl brifé, une réglé brifée , & c .
BRITANNIQUE , adj. (Géog. anc.) nom que les
anciens gé.ographes donnent à la mer qui s’étend entre
l’Angleterre 6c la France , & que les modernes
nomment la Manche. Ce nom lui vient de la grande
Bretagne dont les terres reflerrent d’un côté l’Océan
Britannique.
BRlTlOGA , ( Géog. ) petite île de l’Amérique
méridipnale fur les côtes du Brefil. Elle appartient
aux Portugais, qui y ont bâti'un fort qui défend le
port de Saint-Vincent qui eft vis-à-vis.
BRIVE l a G a i l l a r d e , (Géog.) ville de France
dans le bas Limofin. Long, ig, io. lac. q5. i5.
BRIVIO, (Géog.) petite ville d’Italie, dans le duché
de Milan, fur la riviere d’Adda.
BRIX, (Géog.) ville de Bohème , à deux milles
de Toplitz, 6c à dix de Prague.
BRIXEN, (Géog.) grande ville & évêché d’Allemagne
, entre le Tiro l, l’évêché de Trente, & le
territoire des Vénitiens : l’évêque en eft fouverain ,
Sc eft un des états immédiats de l’empire. Long. zg .
z 5. lat. 4 ( 3 . .
BRIXENSTADT, (Géog.) ville d’Allemagne en
Franconie, à neuf milles d’Anfpach.
* BRIZO, f. f. (Myth.) déefle des fonges , adorée
autrefois dans l’île de Delos. On lui offroit des
nacelles pleines de toutes fortes d’offrandes, dont il
n’y avoit que les poiffons d’exceptés. Bri[o vient de
CpiÇuv, dormir. Les fonges qu’envoyoit Briço é toient
des oracles; & ceux qui avoient fait une heureufe na-
vigation,croyoient lui en devoir une a&ion de grâce.
BRO, (Géog.) riyiete de la Pruffe Polonôife, qui
fe jette dans la Viftule.
BROAD, (Géogr.) c’eft le nom d’un lac d’Irlande
dans la province d’U lfter, dans lequel fe trouvent
plufieurs petites îles.
BROC, f. in. (Commerce.) mefùre des liquides qui
contient environ deux pintes de Paris. On l’appelle
en quelques endroits une quarte, en d’autres un pot.
Voyei Q u a r t e & P o t . (G )
B r o c , ( Géogr. ) ville du royaume de Pologne,
dans le palatinat de Mazoire;
BROCALO, ( Géogr. ) petit royaume d’Afrique
en Nigritie, à l’embouchure du Niger.
BROCANTER, v. n. (Commerce?) ternie particulièrement
en ufage à Paris chez les curieux, les Peintres,
ou parmi quelques marchands merciers , pour
dire acheter , revendre ou troquer des tableaux , des
cabinets, des bureaux, des bronzes, tables, figures
de marbre, peintures, porcelaines, pendules, paravents,
& autres femblables marchandifes, meubles,
ou curiofités. (G)
BROCANTEUR -, f» m. (Commerce?) fe difoit dans
le fens propre de celui qui faifoit profeffioà d’acheter
des tableaux pour les revendre’: ce commerce
étoit anciennement fort à la mode en Italie. Les marchands
génois, vénitiens, 6c florentins, comman-
doient au Guide, aux Càrraches, & à d’autres ex-
cellens peintres, des tableaux qu’ils achetoient dé la
première main, & qu’ils revendoient enfuite en
France, en Allemagne, &c même en Turquie. Mais
aujourd’hui le mot de brocanteur ne convient qu’à
ceux qui font commerce des chofes concernant la
curiofité, comme vafés, médailles , bronzes, tableaux,
mais partjculieretnent des tableaux des anciens
peintres, dont ils favent fe défaire, non fui vant
leur valeur, mais fuivant le degré d’entêtement qu’on
a pour eux. (R)
BROCARD, f. m. ( Morale. ) efpece de raillerie
groflïere, maiigrte, & infultante. Le brocard eft, à
proprement parler, une injure plûtôt qu’une raillerie.
La raillerie, tant qu’elle ne fort point des bornes
què lui preferit la politeffe, eft l’effet de la gaieté &
de la legereté de l’efprit. Elle épargne l’honnête homme
; & le ridicule qu’elle attaque eft fouvent fi léger,
qu’elle n’a pas même le droit d’offenfer. Mais
le brocard annonce un fond de malignité ; il offenfe
& ulcéré le coeur. La raillerie exige beaucoup d’ef-
prit dans ceux qui la manient, fans quoi elle dégénéré
en brocard, pour lequel tout homme a toujours
affez d’efprit. Voye^ R a i l l e r i e . (X )
* B R O C A R D , (Manufacture en or, argent, &foie.)
terme générique, fous lequel on comprend communément
toutes les étoffes riches ou fonds d’or. Les
ouvriers & fabriquans fe fervent préférablement des
termes fond or, fond argent, &c. tijfu, lufirine, 6ca 5c ils entendent par brocards, fonds or, argent, Sec.
une étoffé d’or, d’argent, & de foie, relevée de
fleurs, de feuillages, ou d’autres ornemens, fuivant
le goût du marchand & des ouvriers. Ils ne mettent
d’autre différence entre les brocards Si les fonds or &
argent, qu’en ce que les brocards fuppofent plus de
richeffe, Sc que tout ce qui s’en préfente à l’endroit
eft or ou argent, à l’exception de quelques légères
découpures ; au lieu que dans les fonds or Sc argent*
on y voit des partiès exécutées eh foie;
Les brocards ou fonds or Sc argent, n’exigent pas
un autre métier que celui dont on fe fert communément.
Nous parlerons à l ’ara. V elours à ja rd in,’
des variétés qui ftirviennent dans les parties, la dif-
pofition Sc le montage du métier, félon les différens
ouvrages qu’on fe propofe d’exécuter. Nous renvoyons
à cet article plûtôt qu’à un autre * parce que
l’ouvrage que nous y expliquerons, demande un
métier très-compofé, & qu’il ne s’agit prefque que
d’en anéantir certaines parties, Sc d’y en fubftituer
quelques autres pour le transformer dans un métier
propre à quelque ouvrage que ce fôit.
Il y a des brocards ou fonds d’or de différentes fortes.
Nous allons indiquer ces différences, exhortant
ceux qui ne font pas verfés dans cette matière, de
parcourir auparavant les différens articles de notre
Diâionnaire qui y ont rapport, ne fïit-cè que pour
fe familiarifer avec les termes. Qu’ils voyent les articles
A r m u r e , L i a g e , P o i l , A c c o m p a g n a g e ,
L i s s e , Sc fur-tout l ’article V e l o u r s , où ils trouveront
au long & clairement ce qui concerne le métier,
fes parties, le montage, la lecture dudeffein, la
tire, & le travail, Sec.
Il y a des brocards ou fonds or à huit liftes de fatiii
6c quatre de ppil ; à cinq lifles de fond, Sc cinq liftes
de poil ; à cinq liftes de fatin Sc quatre de poil, &c.
Il y a des brocards dont la doruré eft relevée * fans
liage, ou liée par la corde; Sc d’autres dont la dorure
eft relevée, Sc tous les lacs liés, excepté celui
de la dorure relevée qui iie l’eft jamais.
Des fonds or à huit liffes de fatin, & quatre de poil,J
Ces fonds or font compofés de quatre-vingts-dix
portées de chaînes 6c de quinze de poil : l’armure en
eft la même que celle de la luftrine à p oil, en fup-
primant lés quatre marches de rebordure & les quatre
liftes de rabat, Sc formant après cette füppreflïdn
l’armure du fond or dont il s’agit, comme nous allons
dire. Dans l’armure de luftrine à poil, la marche
de rebordure fe trouve,toûjours entre une marche
de luftrine & une marche d’accompagnage. Sup-
pofez la marche de rebordure jettéë fur la marche
de luftrine, Sc celle-ci chargée.non-feulement de ce
qu’elle portoit, mais encore de ce que la marche de
rebordure lui aura donné de plus qu’elle n’avoit 8c
vous aurez la première marche de fond de l’armuré
que vous cherchez. Suppofez la même marche de rebordure
jettee fur la marche d’aeçompagnage; 8c
celle-ci chargée non-feulement de ce qu’elle portoit ■
mais encore de ce qüe lui aura donné de plus qu’elle
n’avoit, la marche de rebordure, & vous aurez la
première marche d’accompagnage de l’armure cherchée.
Paflez à la fécondé marche de rebordure de
l’armure de la luftrine ; jettez-la fur les marches de
luftrine & d’accompagnage, entre lefquelles efle eft
placée, & vous aurez la fécondé marche de fond 8c
là fécondé marche d’accompagnage de l’armure
cherchée, & ainfi du refte ; d’où il s’enfuit, qu’au
lieu de feize marches qui font à la luftrine, l’étoffe..
dont il s’agit n’en a que douze*
Tome Iï.
l îh f c