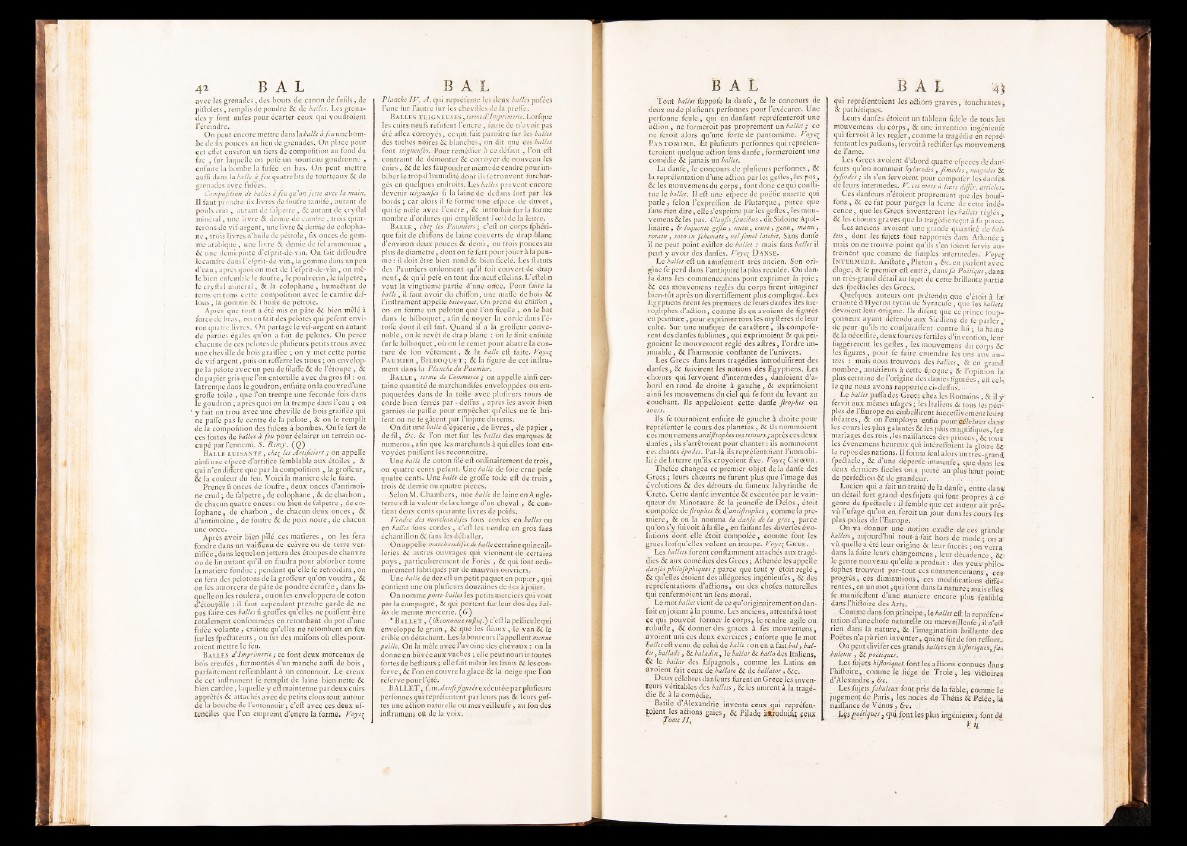
avec les grenades, des bouts de canon de.fufils, de
piftolets , remplis de poudre 8c de balles. Les grenades
y font rnifes pour écarter ceux qui youdroient
l’éteindre.
On peut encore mettre dansla Az//e à feu une bombe
de fix pouces au lieu de grenades. On place pour
cet effet environ un tiers de compofition au fond du
fac , fur laquelle on pofe un tourteau goudronné ,
enfuite la bombe la fufée en bas. On peut mettre
auflï dans la balle à feu quatre lits de tourteaux 8c de
grenades avec fufées.
Compofition de balles à feu qu'on jette avec la main.
Il faut prendre fix livres de foufre tarnifé, autant de
poulverin , autant de falpetre, 8c autant de cryftal
minéral, une livre & demie de canrfre , trois quarterons
de vif-argent, une livre 8c demie de colophane
, trois livres d’huile de pétrole, fix onces de gomme
arabique , une livre & demie de fel ammoniac ,
8c une demi-pinte d’cfprit-de-vin. On fait diffoudre
lecamfre dans Tefprit-de-vin, la gomme dans un peu
d’eau ; après quoi on met de l’efprit-de-vin on mêle
bien enfemble le foufre, le poulverin, le falpetre,
le cryffal minéral, & la colophane , humeâant de
tems en tems cette compofition avec le camfre dif-
fous , la gomme 8c l’huile de pétrole.
Après que tout a été mis en pâte 8c bien mêlé à
force de bras, on en fait des pelotes qui pefent environ
quatre livres. On partage le vif-argent en autant
de parties égales qu’on a fait de pelotes. On perce
chacune de ces pelotes de plufieurs petits trous avec
line cheville de bois graiffée ; on y met cette partie
de vif-argent, puis on refferre les trous ; on enveloppe
la pelote avec un peu de filaffe 8c de l’étoupe , 8c
du papier gris que l’on entortille avec du gros fil : on
la trempe dans le goudron, enfuite on la couvre d’une
groffe toile , que l’on trempe une fécondé fois dans
le goudron ; après quoi on la trempe dans l’eaù ; on
y fait un trou avec une cheville de bois graiffée qui
ne paffe pas le centre de la pelote , & on le remplit
de la compofition des fufées à bombes. Onfe fert de
ces fortes de balles à feu pour éclairer un terrein occupé
par l’ennemi. S. Remy. (Q) Balle luisante, chéries Artificiers ; on appelle
ainfi une efpece d’artifice femblable aux étoiles , &
qui n’en différé que par la compofition , la groffeur,
8c la couleur du feu. Voici la maniéré de le faire.
Prenez fi onces de foufre, deux onces d’antimoine
crud ; de falpetre, de colophane , & de charbon,
de chacun quatre onces : ou bien de falpetre , de colophane
, de charbon , de chacun deux onces, 8c
d’antimoine, de foufre 8c de poix noire, de chacun
une once.
Après avoir bien pilé ces matières , on les fera
fondre dans un vaiffeau de cuivre ou de terre ver-
niffée, dans lequel on jettera des étoupes de chanvre
ou de lin autant qu’il en faudra pour abforber toute
la matière fondue ; pendant qu’elle fe refroidira, on
en fera des pelotons de la groffeur qu’on voudra, 8c
ôn les amorcera de pâte de poudre écrafée, dans laquelle
on les roulera, ou on les enveloppera de coton
d’étoupille : il faut cependant prendre garde de ne
pas faire ces balles fi groffes qu’elles ne puiffent être
totalement confommées en retombant du pot d’une
fufée volante, crainte qu’elles ne retombent en feu
fur les fpeâfateurs, ou fur des maifons oii elles pour*
roient mettre le feu. Balles d'Imprimerie ; ce font deux morceaux de
bois creufés , furmontés d’un manche aufiî de bois ,
parfaitement reffemblant à un entonnoir. Le creux
de cet inftrument fe remplit de laine bien nette 8c
bien cardée, laquelle y eft maintenue par deux cuirs
apprêtés 8c attachés avec de petits clous tout autour
de la bouche de l’entonnoir; c’eft avec ces deux uf-
tenciles que l’on empreint d’encre la forme. Foyer
Planche IF . A. qui repréfente les deux balles pofées
l’une fur l’autre lur les chevilles de la preffe. BALLES teigneuses, terme d'Imprimerie. Lorfque
les cuirs neufs refufent l’encre , faute de n’avoir pas
été allez corroyés, ce qui fait paroître fur les balles
des taches noires 8c blanches, on dit que ces balles
font teigneufes. Pour remédier à ce défaut, l’on eft
contraint de démonter 8c corroyer de nouveau les
cuirs, 8c de les faupoudrer même de cendre pour imbiber
le trop d’humidité dont ils fe trouvent l'urchar-
gés en quelques endroits. Les balles peuvent encore
devenir teigneufes fi la laine de dedans fort par les
bords ; car alors il fe forme -une efpece de duvet,
qui fe mêle avec l’encre , 8c introduit fur la forme
nombre d’ordures qui emplifl'ent l’oeil de la lettre. Balle, che[ les Paumiers; c’eft un corps fphéri-
que fait de chiffons de laine couverts de drap blanc
d’environ deux pouces & demi, ou trois pouces au
plus de diamètre, dont on fe fert pour joiier à la paume
: il doit être bien rond 8c bien ficelé. Les ftatuts
des Paumiers ordonnent qu’il foit couvert de drap
neuf, 8c qu’il pefe en tout dix-neuf eftelins.L’eftelin
vaut la vingtième partie d’une oifce. Pour faire la
balle, il faut avoir du chiffon, une maffe de bois 8c
l’inftrument appellé bilboquet. On prend du chiffon ,
on en forme un peloton que l ’on ficelle , on le bat
dans le bilboquet, afin de noyer la corde dans l’étoffe
dont il eft fait. Quand il a la groffeur convenable,
on le revêt de drap blanc : on le finit enfuite
fur le bilboquet, où on le remet pour abatre la couture
de fon vêtement, & la balle eft faite. Foyeç Paumier , Bilboquet ; 8c la figure de cet inftruT
ment dans la Planche du Paumier. Balle, terme de Commerce; on appelle ainfi certaine
quantité de marchandifes enveloppées ou empaquetées
dans de la toile avec plufieurs tours de
corde bien ferrés par - deffus , après les avoir bien
garnies de paille pour empêcher qu’elles ne fe bri-
lènt ou ne fe gâtent par l’injure du tems.
On dit une balle d’épicerie, de livres, de papier ,
de fil, &c. 8c l’on met fur les balles des marques 8c
numéros, afin que les marchands à qui elles font envoyées
puiffent les reconnoître.
Une balle de coton filé eft ordinairement de trois,
ou quatre cents pefant. Une balle de foie crue pefe
quatre cents. Une balle de groffe toile eft de trois ,
trois 8c demie ou quatre pièces.
. Selon M. Chambers, une balle de laine en A ngle-
terre eft la valeur de la charge d’un cheval , 8c contient
deux cents quarante livres de poids;
Fendre des marchandifes fous cordes en balles ou
en balles fous cordes, c’eft: les vendre en gros fans
échantillon 8c fans les déballer.
On appelle marchandifes de balle certaine quincailleries
8c autres ouvrages qui viennent de certains
pays, particulièrement de Forés , 8c qui font ordinairement
fabriqués par de mauvais ouvriers..
Une balle de dez eft un petit paquet en papier, qui
contient une ou plufieurs douzaines de dez à joiier.
On nomme porte-balles les petits merciers qui vont
par la campagne, 8t qui portent fur leur dos des balles
de menue mercerie. (G)
* Ballet , (<'Economie rufiiq.) c’eft la pellicule qui
enveloppe le grain , 8c que les fléaux, le van 8c le
crible en détachent. Les laboureurs l’appellent menue
paille. On la mêle avec l’avoine des chevaux : on la
donne en bûvéeaux vaches ; elle peut nourrir toutes
fortes de beftiaux ; elle fait mûrir les fruits 8c lescon-
ferve, 8c l’on en couvre la glace 8c la neige que l’on
réfervë pour l’été.
BALLET, {.m.danfefigurée exécutée parpluficurs
perfonnes qui repréfentent par leurs pas & leurs gaf-
tes une aérion naturelle ou merveilleufe , au fon des
inftrumens oû de la yoix.
Tout ballet fùppofe la danfe, 8c le concours de
tleux ou de plufieurs perfonnes pour l’exécuter. Une
perfonne feule , qui ên danfant repréfenteroit une
•aérion , ne formeroit pas proprement un ballet; ce
ne feroit alors qu’une forte de pantomime. Foyei Pantomime. Et plufieurs perfonnes quirepréfen-
teroient quelque aérion fans danfe, formeroient une
comédie 8c jamais un ballet.
La danfe, le concours de plufieurs perfonnes, ôc
la repréfentation d’une aftion par les geftes, les pas,
;8c les mouvemens du corps, font donc ce qui confti-
tue le ballet. Il eft une efpece de poëfie muette qui
parle, félon Pexpreflîon de Plutarque, parce que
fans rien dire, elle s’exprime par les geftes, les mou-
Vemefis 8c les pas. Claufis faucibus, dit Sidoine Apollinaire,
& loquentè gefiu , nutu, entre, genu, manu ,
roratu , tôto in fehemate , velfemel latebit. Sans danfe
il ne peut point exifter de ballet : mais fans ballet il
peut y avoir des danfes. Foye^ D anse.
Le ballet eft un amufement très ancien. Son origine
fe perd dans l’antiquité la plus reculée. On dan-
la dans les commencemens pour exprimer la joie ;
oc ces mouvemens réglés du corps firent imaginer
bien-tôt après un divertiffement plus compliqué. Les
Egyptiens firent les premiers de leurs danfes des hié-
ivogliphes d’adion, comme ils en avoient de figurés
en peinture, pour exprimer tous les myfteres de leur
culte. Sur une mufique de cara&ere, ils compofe-
rent des danfes fublimes, qui exprimoient & qui pei-
gnoient le mouvement réglé des affres y l’ordre immuable
, 8c l’harmonie confiante de l’univers.
Les Grecs datls leurs tragédies introduifirent des
danfes, 8c fuivirent les notions des Egyptiens. Les
choeurs qui fervoient d’intermedes, danfoient d’abord
en rond de droite à gauche, 8c exprimoient
ainfi les mouvemens du ciel qui fe font du levant au
Couchant. Ils appelloient cette danfe Jlrophes ou
itours-.
Ils fe tournoient enfuite de gauche à droite pour
jrepréfenter le cours des planètes , 8c ils nommoient
ces mouvemens antijlrophes ou retours ; après ces deux
danfes, ils s’arrêtoient pour chanter : ils nommoient
ces chants épodes. Par-là ils repréfentoient l’immobilité
de la terre qu’ils eroyoient fixe. Foyei Choeur.
Théfée changea ce premier objet de la danfe des
Grecs ; leurs choeurs ne furent plus que l’image des
évolutions 8c des détours du fameux labyrinthe de
Crete. Cette danfe inventée 8c exécutée par le vainqueur
du Minotaure 8c la jeuneffe de Delos, étoit
cpmpofée de Jlrophes & à'antifirophes, comme la première,
8[ ôn la nomma la danfe de la gruei parce
qu’on s’y fui voit à la file > en faifant les diverfes évolutions
dont elle étoit fcompofée, comme font les
grues lorfqu’elles volent en troupe. Voyc%_ Grue.
Les ballets furent conftamment attachés aux tragédies
8c aux comédies des Grecs ; Athenée les appelle
danfesphilofophiques; parce que tout y étoit réglé,
& qu’elles étoient des allégories ingénieufes, 8c des
repréfentations d’aftions, ou des chofes naturelles
qui renfermoient un fens moral.
Le mot ballet vient de ce qu’originairenient ondan-
foit en jouant à la paume. Les anciens, attentifs à tout
ce qui pouvoit former le corps, le rendre agile ou
irobufte, 8c donner des grâces à fes mouvemens,
avoient uni ces deux exercices ; enforte que le mot
lallée eft venu de celui de balle : on en a fait bal, ballet
, ballade, 8c baladin, le ballar 8c ballo des Italiens,
& le bailar des Efpagnols y comme les Latins en
avoient fait ceux de ballare de ballator, 8cc»
Deux célébrés danfeûrs furent en Grece les inventeurs
Véritables des ballets, 8c les unirent à la tragédie
8c à la comédie»
Batile d’Alexandrie inventa ceux qui repréfen-
Joient les aérions gaies 3 8c Pilade iitroduifit ceux
fome I f
qui repiéfentoient les aérions graves, touchantes ;
& pathétiques.
Leurs danfes étoient un tableau fidele de tous les
mouvemens du corps, & une invention ingénieufè
qui fervoit à les regler, comme la tragédie en repré1-
lentant les pallions, fervoit à reérifîer les mouvemens
de l’ame.
Les Grecs avoient d’abord quatre efpeces de dan**
feurs qu’on nommoit hylarodes , f i modes; magodes 8c
lyfiodes ; ils s’en fervoient pour compofér les danfes
de leurs intermèdes. F. ces mots à leurs différ. articles.
Ces danfeûrs n’étoient proprement que des bouffons
, 8c ce fut pour purger îa feene de cette indécence
, que les Grecs inventèrent les ballets réglés t
8c les choeurs graves que la tragédie ifeçut à fa place-.
Les anciens avoient une grande quantité de ballets,
dont les fujets font rapportés dans Athenée ;
mais on ne trouve point qu’ils s’en foient fervis autrement
que comme de fimples intermedés. Foye^
INTERMEDE. Ariftote, Platon , &c. en parlent avec
éloge; & le premier eft entré, dans fa Poétique, dans
un très-grand détail au fujet de cette brillante partie
des fpedacles des Grées.
Quelques auteurs ont prétendu que c’étoit à lét
cruauté d’Hyeron tyran de Syracufe, que les ballets
dévoient leur origine. Ils difent que ce prince foup-
çonneux ayant défendu aux Siciliens de fe parler
de peur qu’ils ne confpiraffent contre lui ; la haine
8c la néceffité, deux fources fertiles d’invention, leur
fuggérerent les geftes, les mouvemens du corps 8c
les figures , pour fe faire entendre les uns aux autres
: mais nous trouvons des ballets, 8t en grand
nombre, antérieurs à cette époque ; & l’opinion la
plus certaine de l’origine des danfes figurées * eft cel^
le que nous avons rapportée ci-deffus. •• • -
Le ballet paffades Grecs chez les Romains , 8c il ÿ
fervit aux mêmes ufages ; les Italiens & tous lès peuples
de l’Europe en embellirent fucceffiVenient leurs
théâtres, Sc on l’employa enfin pour célébrer dans1
les cours les plus galantes 8c les plus magnifiques, les-
mariages des rois, les naiffances des princes > 8c tous
les évenemens heureux qui intéreffoient la gloire 8c
le repos des nations. Il forma feul alors Un très-grand
fpeétacle, 8c d’une dépenfe immenfeque.dans les
deux derniers fiecles on a porté au plus* hau t point
de perfëérion 8c de grandeur. . , . . ..
Lucien qui a fait un traité de la danfe, entre dans?
un détail fort grand des fujets qui font propres à cê
genre de fpeélacle : il femble que cet auteur ait pré-'
vu l ’ufage qu’on en feroit un jour dans les Cours les
plus polies de l’Europe.
On va donner une notion exaéle de ces grands'
ballets, aujourd’hui tout-à-fait hors de mode ; on a-
vu quelle a été leur origine & leur fuccès ; on verra
dans la fuite leurs ehangemens, leur décadence 8c
le genre nouveau qu’elle a produit : des y eux'philo-
fophes trouvent par-tout ces commencemens , cés-
progrès , ces diminutions ces modifications différentes
, en un mot * qui font: dans la nature ; mais elles,
fe manifeftent d’une maniéré encore plus fenfiblè
dans l’hiftoire des Arts.
Comme dans fon principe, le ballet eft la repréfèn-
tation d’une chofe naturelle ou merveilleufe ; il n’eft
rien dans la nature, & l’imagination brillante des
Poètes n’a pû rien inventer, qui ne fût de fon reffort-
On peut divifer ces grands ballets en 'hifibriques,faA
buleux , 8c poétiques.
Les fujets hifioriquei font les a étions connues daiis
l’hiftoire, comme le fiége de Troie; les victoires
d’Alexandre, &c. . ,
: Les (üjets fabuleux font pris de la fable; comme ïè
jugement de Paris, lés noces de Thétis 6c Pelée, là
naiffance de Vénus, 6*c»
Lçs f Qétijuçs J qui font les plus ingénieux * font dé