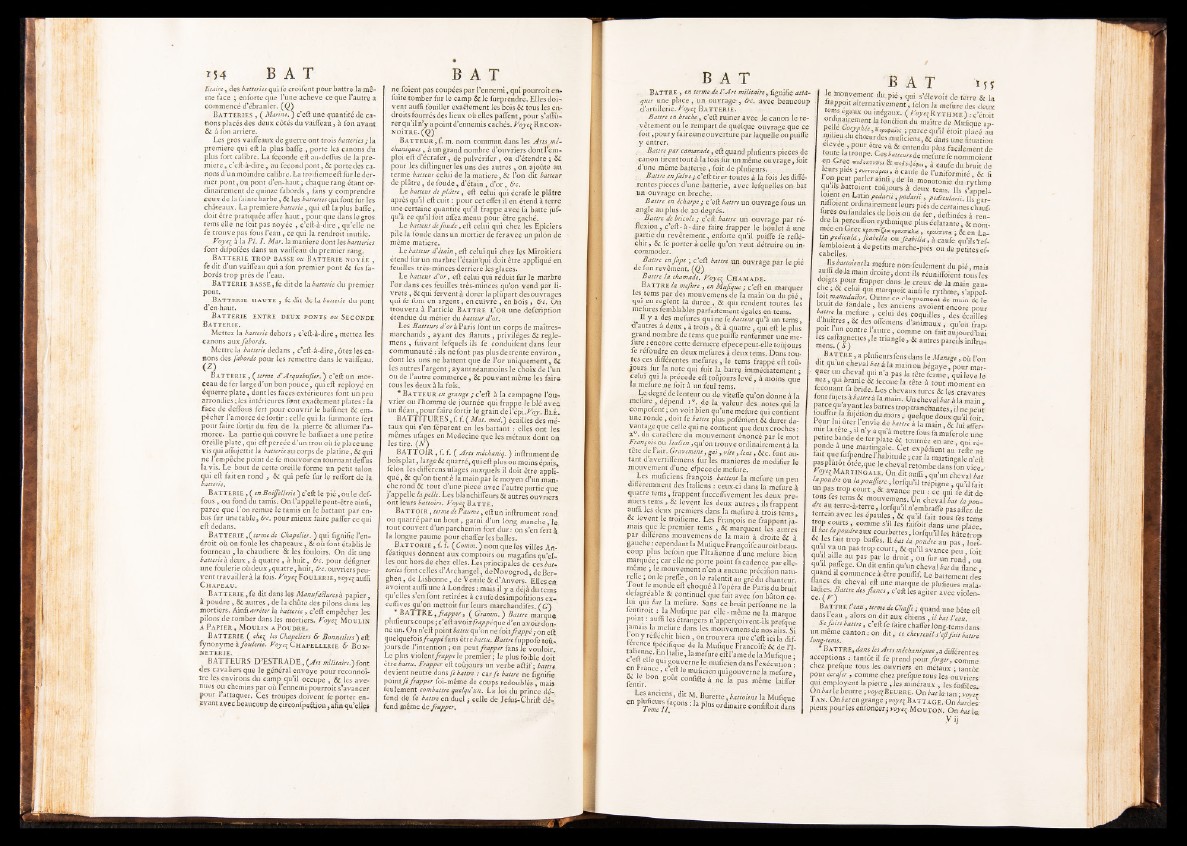
X 5 4 B A T
Ütaire, des batteries qui fe croifent pour battre la même
face ; enforte que l’une achevé ce que l’autre a
commencé d’ébranîer. (Q) Batteries , ( Marine. ) c’eft une quantité de cations
placés des deux côtés du vaifl'eau , à Ion avant
& à fon arriéré.
Les gros vaiffeaux de guerre ont trois batteries ; la
première qui eft la plus baffe , porte les canons du
plus fort calibre. La fécondé eit au-deffus de la première
, c’eft-à-dire, au fécond pont, & porte des canons
d’un moindre calibre. La troifieme eft fur le dernier
pont, ou pont d’en-haut; chaque rang étant ordinairement
de quinze fabords , fans y comprendre
ceux de la fainte barbe, & les batteries qui font fur les
châteaux. La première batterie, qui eft la plus baffe,
doit être pratiquée affez haut, pour que dans le gros
tems elle ne foit pas noyée , c’eft-à-dire, qu’elle ne
fe trouve pas fous l’eau, ce qui la rendroit inutile.
Voye^ à la Pl. I. Mar. la maniéré dont les battteries
fonr difpofées dans un vaiffeau du premier rang. Batterie trop basse ou Batterie noyée ,
fe dit d’un vaiffeau qui a fon premier pont & fes fabords
trop près de l’eau. Batterie basse, fe dit de la. batterie du premier
pont.
Batterie haute d’en-haut. , fe dit de la batterie du pont
B Batterie entre deux ponts ou Seconde atterie.
Mettez la batterie dehors , c’eft-à-dire, mettez les
canons aux fabords.
Mettre la batterie dedans , c’eft-à-dire, ôtez les canons
des fabords pour les remettre dans le vaiffeau.
( z ) Batterie , ( terme d'Arquebujier.') c ’eft un morceau
de fer large d’un bon pouce, qui eft reployé en
équerre plate, dont les faces extérieures font un peu
arrondies ; les intérieures font exactement plates : la
face de deffous fert pour couvrir le baffinet & empêcher
l’amorce de fortir : celle qui la furmonte fert
pour faire fortir du feu de la pierre & allumer l’amorce.
La partie qui couvre le baflinet a une petite
oreille plate, qui eft percée d’un trou où fe place une
vis qui affujettit la batterie au corps de platine, & qui
ne l’empêche point de fe mouvoir en tournant deffus
la vis. Le bout de cette oreille forme un petit talon
qui eft fait en rond , & qui pefe fur le reffort de la
batterie.
Batterie , ( enBoiffellerie) c’eft le pié, ouïe deffous
, ou fond du tamis. On l’appelle peut-être ainfi,
parce que l ’on remue le tamis en le battant par en-
bas fur une table, &c. pour mieux faire paffer ce qui
eft dedans. Batterie ^termede Chapelier. )qui lignifie l’endroit
où on foule les chapeaux, & où font établis le
fourneau , la chaudière & les fouloirs. On dit une i
batterieà deux , à quatre , à huit, &c. pour défigner j
une foulerie où deux, quatre, huit, &c. ouvriers peuvent
travailler à la fois. Voye^ Foulerie, voye^ aitfll Chapeau.
Batterie , fe dit dans les Manufacturesà papier,
à poudre, ôc autres, de la chute des pilons dans les
mortiers. Ainfi arrêter la batterie, c’eft empêcher les
pilons de tomber dans les mortiers. Voye{ Moulin
a Papier, Moulin a Poudre.
Batterie ( che^ les Chapeliers & Bonnetiers) eft
fynonyme k foulerie. Voyei Chapellerie & Bonneterie.
BATTEURS D ’ESTRADE, [Art militaire?) font
des cavaliers que le général envoyé pour reconnoî-
tre les environs du camp qu’il occupe , & les avenues
ou chemins par où l’ennemi pourroit s’avancer
pour l’attaquer. Ces troupes doivent fe porter en-
avant aycc beaucoup de çireonfpeftion, afin qu’elles
B A T
ne foient pas coupées par l’ennemi, qui pourroit en-
fuite tomber fur le camp & le furprendre. Elles doivent
aufli fouiller exactement les bois & tous les endroits
fourrés des lieux où elles paffent, pour s’affû-
rer qu’il n’y a point d’ennemis cachés. Voye£ R e c o n -
n o î t r e . (Q )
B a t t e u r , f. m. nom commun dans les Arts mé-
chaniques, à un grand nombre d’ouvriers dont remploi
eft d’écrafer, de pulvérifer , ou d’étendre ; 6c
pour les diftinguer les uns des autres , on ajoute au
terme batteur celui de la matière, & l’on dit batteur
de plâtre, de foude, d’étain , d’o r , &c.
Le batteur de plâtre, eft celui qui écrafe le plâtre
après qu’il eft cuit : pour cet effet il en étend à terre
une certaine quantité qu’il frappe avec fa batte juf-
qu’à ce qu’il foit affez menu pour être gâché.
L z batteur de foude, eft celui qui chez les Epiciers
pile la foude dans un mortier de fer avec un pilon de
même matière.
Le batteur d'étain, eft celui qui chez les Miroitiers
étend fur un marbre l’étain*qui doit être appliqué en
feuilles très-minces derrière les glaces.
Le batteur d'or, eft celui qui réduit fur le marbre
1 or dans ces feuilles très-minces qu’on vend par livrets
, & qui fervent à dorer la plupart desouvrages
qui fe font en argent, en cuivre , en bois , &c. On
trouvera à l’article B a t t r e l ’o r une defcription
étendue du métier du batteur d'or.
Les Batteurs d'or à Paris font un corps de maîtres-
marchands , ayant des ftatuts , privilèges & regle-
mens , fuivant lefquels ils fe conduifent dans leur
communauté : ils ne font pas plus de trente environ ,
dont les uns ne battent que de l’or uniquement, &
les autres l’argent ; ayant néanmoins le choix de l’un
ou de l’autre commerce, & pouvant même les faire
tous les deux à la fois.
B a t t e u r en grange ; c ’ e f t à la c am p a g n e l’o u v
r ie r o u l ’h om m e d e jo u rn é e q u i fr ap p e le b lé a v e c
u n f lé a u , p o u r fa ir e fo r t ir le g r a in d e l ’ép i. V o y . B l é .
BATTITURES, f. f. ( Mat. med.) écailles des métaux
qui s’en féparent en les battant : elles ont les
memes ufages en Medecine que les métaux dont on
les tire. (A )
BATTOIR, f. f. ( Arts méclianiq. ) infiniment de
bois plat, larpe & quarré, qui eft plus ou moins épais*
félon les differens ufages auxquels il doit être appliqué
, & qu’on tient à la main par le moyen d’un manche
rond & tout d’une piece avec l’autre partie que
j’appelle la pelle. Les blanchiffeurs & autres ou vriers
ont leurs battoirs. Voye[Ba t t e .
B a t t o i r , terme de Paume, eft un infiniment rond
ou quarre par un bout, garni d’un long manche ,'le
tout couvert d’un parchemin fort dur: on s ’en fert à
la longue paume pour chaflér les balles.
B a t t o r i e , f. f. ( Comrn. ) nom que les villes An-
featiques donnent aux comptoirs ou magafins qu’el-
lesont hors de chez elles. Les principales de ces bat-
tories font celles d’Archangel, deNovogrod,deBer-
ghen, de Lisbonne, de Venife & d’Anvers. Elles.en
avoient auffi une à Londres : mais il y a déjà du tems
qu’elles s’en font retirées à caufe des impofitions ex-
ceffives qu’on mettoit fur leurs mârchandifes. ( G)
* BATTRE, frapper, ( Gramm. ) Battre matant
plufieurs coups ; c’eft avoir frappé que d’en avoir donné
un. On n’eft point battu qu’on ne foit frappé; on eft
quelquefois frappé fans être battu. Battre fuppofe tou-
jours de l’intention ; on peut frapper fans le vouloir.
Le plus violent.frappe le premier ; le plus foible doit
être battu. Frapper eft toujours un verbe aêlif ; battre
devient neutre dans fe battre : car fe battre ne fignifie
point_/c frapper foi-même de coups redoublés, mais
feulement combattre quelqu'un. La loi du prince dé-,
fend de fe battre en duel j celle de Jefuÿ-Chrift dé^
fend même de frapper,
B A T
B a t t r e , en terme de l'Art militaire, fignifie attaquer
une p la c e , iin o u v r a g e ', &c. a y e c b e a u co u p
d ’a r t ille rie . Voye{ B a t t e r i e .
Battre en breche;, ç’çft ruiner avec le, canon le revêtement
ou le rempart de quelque ouvrage que ce
foit, pour y fairenneou verture par laquelle,on puiffe
y entrer.. ,
-Battrepar camarade, eft quand plufieürs pièces de
canon tirent tout à la foi$;fur un même ouvrage; foit
d’une même batterie , foit,de plufieurs.
Battre enfalve ; c’eft tfi-er toutes à la fois les différentes
pièces d’une,batterie, avec lefquelles on bat
un ouvrage en breche.
Battre en écharpe ; c'eût battre un ouvrage fous un
•.angle au plus de. 2.0; degrés. ;
Battre de bricole.; c’eft,battre un ouvrage par réflexion,,
ç’eft-à-dire faire frapper le boulet à une
.partie du revêtement, enforte qu’il puiffe fe réfléchir
, & fe porter à celle qu’on veut détruire ou incommoder.
Battre enfape ; c ’eft battre un ouvrage par le pié
de fon revêment. (Q)
Battre la chamade. Voye^ CHAMADE.
B a t t r e la mefure , en Mufique ; c ’eft en marquer
les tems par des mouvemens de la main ou du pié ,
qm en règlent la durée , & qui rendent toutes les
mefures femblables parfaitement égales en tems.
5 II y a des mefures qui ne fe battent qu’à un tems,
d autres à deux, à trois , & à quatre , qui eft le plus
grand nombre de tems que puiffe renfermer une mefure
: encore cette derniere efpece peut-elle toujours
fe refoudre en deux mefures à deux tems. Dans toutes
ces différentes mefures -, le tems frappé eft toû-
jours .fur la note qui fuit la barre immédiatement ;
celui qui la précédé eft toujours le v é , à moins que
la mefure ne foit à un feul tems.
Le degr.e de lenteur ou de vîteffe qu’on donne à la
mefure , dépend i° . de la, valeur des notes qui la
compofent ; on voit bien qu’une mefure qui contient
une. ronde ,doit fe battre plus, pofénient & durer davantage
que celle qui ne contient que deux croches :
2,0 • du cara&ere du mouvement énoncé par le m.pt
François OU Italien ,qu’on trouve ordinairement à la
tête de l’air. Gravement, gai, vite , lent, &c. font autant
d’avertiffemens fur les maniérés de modifier le
mouvement d’une efpece de mefure.
_ Lés muficiens françois. battent la mefure un peu
différemment des Italiens : ceux-ci dans la mefure à
quatre tems, frappent fuccefliyement les, deux pre-
miers tems , & lèvent les deux autres ; ils frappent
aulfi les deux premiers dans la mefure à trois tems,
■ lèvent le troifieme. Lès François ne frappent jamais
que le premier tems , & marquent les autres
par differens mouvemens de la main à droite & à
gauche: cependant la MufiqueFrançoifeauroit beaucoup
plus befoin que l’Italienne d’une mefure bien
marquée ; car elle ne porte point fa cadence par elle-
meme ; le mouvement n’en a aucune précifion naturelle
; on le preffe, on le ralentit au gré du chanteur.
Fout le monde eft choqué à l’opéra de Paris du bruit
delagreable & continuel que fait avec fon bâton celui
qui bat la mefure. Sans ce bruit perfonne ne la
fentiroit : la Mufique par elle-même ne la marque
point : aulfi les etrangers n’apperçoivent-ils prefque
jamais la mefure dans les mouvemens de nos airs. Si!
I on y réfléchit bien , on trouvera que c’eft ici la différence
fpécifîque de la Mufique Francoife & de l’I-
tahenne. En Italie, la mefure eft Pâme de la Mufique •
c en- elle qui gouverne le muficien dans l’exécution :
en lance, c eft le muficien qui gouverne la mefure
H H D 8°ut c°nfifte à H pas même laiffer
en'ijlufieursfar dlt ®lJre:tte>. b‘a‘ oiln‘ la Mufique ^ Tome II ^°nS ‘ a P us ordinaire confiftoit dans
B A T t 5*
le taonvement dit,pié j,qui s’élevoii de terre & la
irappoit alternativement, félon la mefure des deux
tems. egsfex ou. inégaux,, ( « j^ R v t h m ï ) rc’étoit
M m f f l M % fonai°n du maître de Mufique ap-
P e Coryphée, Kopvçctîcç ; parce qu’il étoit placé au
«lreuduchoeurdesmufidens,& dans unefituation
& entendu plus facilement de
pSp : WGreeçc r0T ' Ce^ " oer-’ f en’eàl 'ucraeuffeen dou“ b“ru“it “de'
leurs pies à caufe de l’uniformité, & fi
| on peut parler ainfi ÿ de' fa; monotonie: dm,rythme
ÿ i ils liattoient toujours à: deux tems. lis s’anoel-
.ipjpjlt ,eo iatin pedmilpplam . pedicularii. Ilsaarnifioient
ordmairementleurs pies de certaines clmuli
Jures ou fanifales de bois,où de fer, deflinées à « n -
diefa.perçufliomrjîthmique plus éclatante j & nonfi
ipeeen Grec , u k U » : & en La^
c b e l u “ 1 * dePetits;n,a* he-P'és ou depetites ef-
:I k ^ m e o th meÜire nomféuiement du’pié, mais
W|E.deJaniain droite j dontils réuniffoient tous les
B 9 PGur: frappér dans le creux de la main uaiw
Che ; Sc celm qui marqiioit ainfi le rythmef s'appel-
Immanuductor. Outre ee claquement de main & le
bruit de ;fsindale, les anciens avoient,encore pour
toure la .mefiire , celui des coquilles , des écailles
d huîtres, êc des offemens dlammaux y qu’eh frap.
. ?oit ( ùn^ontre 1 autre, comme on faitîauiouréthiii
les cafiagnettes ,1e triangle:, & autres pareils inftru-
mens. ( S ) r
Ba t t r e , a plufieurs fens dans le Manette, où l?on
S B “ n cheval bu à, la main ou bégayé ,.pour mar-
■ quer un cheval qui n a pas la.tête ferme, quileve le
nez,, qui branle&£ecoiie la. tête,à tout moment en
fasopant la bride., Le§ chevaux turcs Scdésicravates
ioot'iùjêtsAbutre à là main. .Hnchevalfenà famidn
IM f f i lM f f l t l iS b/ m s trop tranchantes, il ne peut
fauffrinla fujetion dumors p quelque douxquïl loir■
Pour lui oter l’envie.de buereï la main, & lui afferl
nur la tête il n y a qu’à mettre fo'us famufefole une
petite bande de ter plate & .tournée en arc, qui r”
ponde à une martingale. Eet expédient an relie ne
fart quefufpendrel’habitude ;,car 1a martingale n’eft
pjs,plutôt otee,que le cheval retombe dans fon vice
foy*! Ma r iin g a c e . Qn.dit-auffi, qu’un cheval bu
UpoHdrç omJapoufiere „lorfqu’il trépigne , qu’il fait-
un pas trop court, & avance peu : ce qui fe dit de
tous fes tems & mouvemens. Un cheval bu Impou-
pas affez de MM av,ec les épaulés,, & qu’il fait tous fes tems
trop courts comme s il les faifoit dans une placer
U bat Upoudre aux courbettes,.lorfqu’il les hâte^trop
oc les îa:t trop baffes. Il bat Id poudre au pas Iorf.
M H I Ü paS troP court,. & qu’il avance peu I foit
qui mile, au pas par le droit,,vou,fur. un rond , ou
qu il paffege. On dit enfinqu’un cheval fat du flanc
quand il commence à être pouffif. Le battement des
f » d u ,cheval eft une marque de plufieurs m a l*
ce ( r f aure 4es fiutce , c’eft les agiter avec violen-
B a t t r e l ’eau, termede Chafi; quand une bête eft
üansl eau.,, alors on dit aux chiens .ilbatl'ea«.
He faire battre. c’eft fe faire chafferlong-temsdans
un meme canton : on dit,, ce chevreuil s'efifait butte
bons-tems.
B a t t r e , dans les Ans.mèehaniques, a différentes
acceptions :* tantôt il fe prend pour forger, comme
cl.cz prelquc tous ies ouvriers eu métaux ; tantôt
pour ccrnjcr , comme chez prefque tous les-ouvriers'
qui employent 1a pierre „les,minéraux,., les,fctfliles-'
On fat le beurre, B e u r r e . O h fat fa tan-vmer.
T an. .On bat,en grange-, «ryqB a t t ag e . On fatdey
pieux pour les-enfoncer; royq, Mo b toN, ,On bu 1®
m