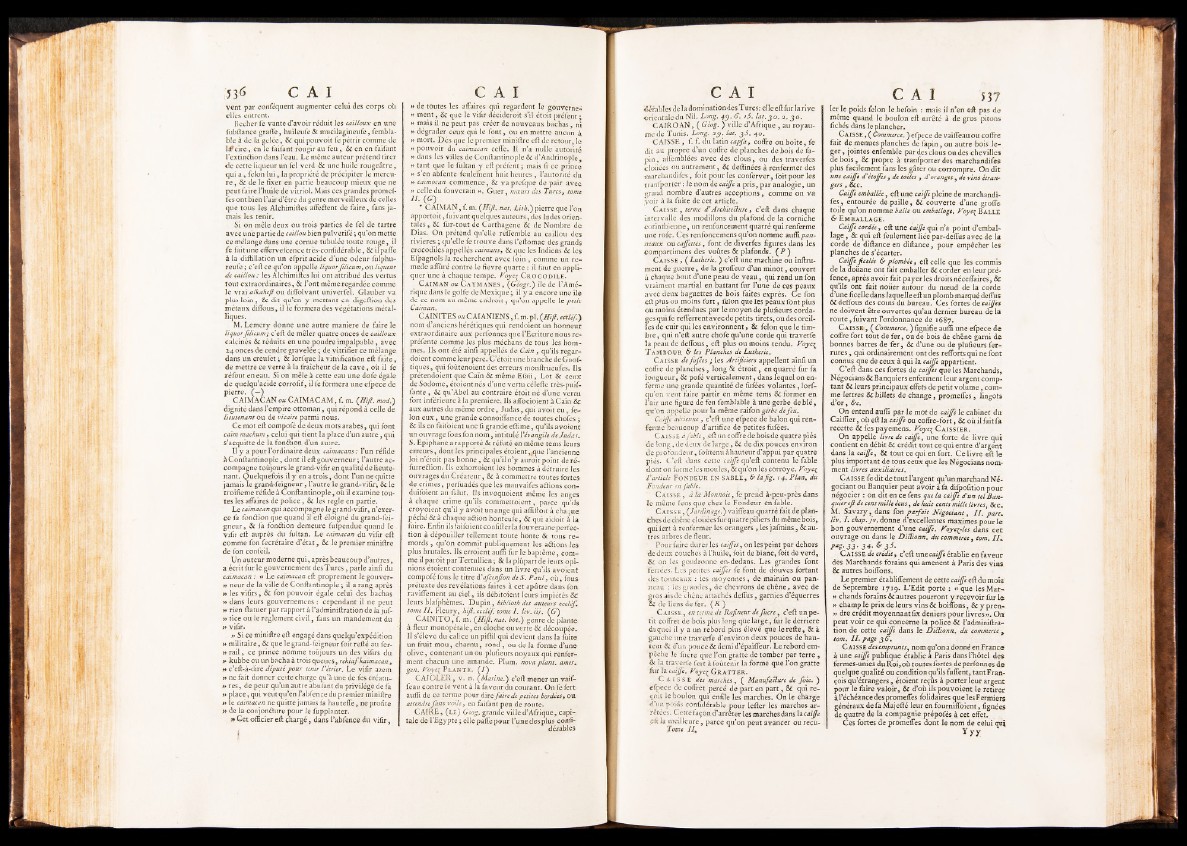
vent par conféquent augmenter celui des corps où
elfes entrent.
Becher fe vante d’avoir réduit les cailloux en une
fubftance graffe, huileufe & mucilagineufe, fembla-
ble à de la gelée, &c qui pouvoit fe pétrir comme de
lîÊcire, en le faifant rougir au feu , & en en faifant
l’extinélion dans l’eau. Le même auteur prétend tirer
de cette liqueur un fel verd & une huile rougeâtre,
qui a , félon lui, la propriété de précipiter le mercur
e , & de le fixer en partie beaucoup mieux que ne
peut faire l’huile de vitriol. Mais ces grandes promeffes
ont bien l’air d’être du genre merveilleux de celles
que tous les Alchimiftes affeétent de faire, fans jamais
les tenir.
Si on mêle deux ou trois parties de fel de tartre
avec une partie de caillou bien pulverifé ; qu’on mette
ce mélange dans une cornue tubulée toute rouge, il
fe fait une effervescence très-confidérable, & il paffe
à la diftillaticn un efprit acide d’une odeur fulphu-
reufe ; c ’eft ce qu’on appelle liquorfilïcum, ou liqueur
de caillou : les Alchimiftes lui ont attribué des vertus
tout extraordinaires, & l’ont même regardée comme
le vrai alkaheß ou diffolvant univerfel. Glaubet va
plus loin, & dit qu’en y mettant en digeftion des
métaux diffous, il fe formera des végétations métal-
liques.
M. Lemery donne une autre maniéré de faire le
liquor filicum; c’eft de mêler quatre onces de cailloux
calcinés & réduits en une poudre impalpable, avec
24 onces de cendre gravelée ; de vitrifier ce mélange
dans un creufet ; & lorfque la vitrification eft faite,
de mettre ce verre à la fraîcheur de la cave, où il fe
réfout en eau. Si on mêle à cette eau une dofe égale
de quelqu’acide corrofif, il fe formera une efpece de
pierre. (—)
CAIMACAN ou CAIMACAM, f. m. {Hiß. mod.)
dignité dans l’empire ottoman, qui répond à celle de
lieutenant ou de vicaire parmi nous.
Ce mot eft compofé de deux mots arabes, qui font
edim. machum, celui qui tient la place d’un autre, qui
s’acquitte de la fonûion d’un autre.
Il y a pour l’ordinaire deux càimacans : l’un réfide
àConftantinople, dont il eft gouverneur ; l’autre accompagne
toûjours le grand-vifir en qualité de lieutenant.
Quelquefois il y en a trois, dont l’un ne quitte
jamais le grand-feigneur, l’autre le grand-vifir; & le
troifieme réfide à Conftantinople, où il examine toutes
les affaires de police, & les regle en partie.
Le càimacan qui accompagne le grand-vifir, n’exerce
fa fonction que quand il eft éloigné du grand-feigneur,
& fa fonction demeure fufpendue quand le
vifir eft auprès du fultan. Le càimacan du vifir eft
comme fon fecrétaire d’état, &c le premier miniftre
de fon confeil.
Un auteur moderne qui, après beaucoup d’autres,
a écrit fur le gouvernement des Turcs, parle ainfi du
càimacan : « Le càimacan eft proprement le gouver-
» neur de la ville de Conftantinople ; il a rang après
a les vifirs, & fon pouvoir égale celui des bachas
» dans leurs gouvernemens : cependant il ne peut
» rien ftatuer par rapport à l’adminiftration de la juf-
» tice ou le reglement civil , fans un mandement du
» vifir.
» Si ce miniftre eft engagé dans quelqu’expédition
» militaire, & que le grand-feigneur foit refté au fer-
» rail, ce prince nomme toujours un des vifirs du
» kubbe ou un bacha à trois queues, rekiaf kàimacan,
» c’eft-à-dire députe' pour tenir l'étrier. Le vifir. azem
» ne fait donner ceite charge qu’à une de fes créatu-
» res, de peur qu’un autre abulant du privilège de fa
» place, qui veut qu’en l’abfence du premier miniftre
» le càimacan ne quitte jamais fa hauteffe, ne profite
» de la conjoncture pour le fupplanter.
» Cet officier eft chargé, dans l’abfence du YÜir,
» de toutes les affaires qui regardent le gouverne»
» ment, & que le vifir décideroit s’il étoit préfent ;
» mais il ne peut pas créer de nouveaux bachas, ni
>> dégrader ceux qui le font, ou en mettre aucun à
» mort. Dès que le premier miniftre eft de retour, le
» pouvoir du caïmacan ceffe. Il n’a nulle autorité
» dans les villes de Conftantinople & d’Andrinople,
» tant que le fultan y eft préfent ; mais fi ce prince
» s’en abfente feulement huit heures , l’autorité du
» càimocan commence, & va prefque de pair avec
» celle du fouverain ». Guer, moeurs des Turcs, tome MM
* CÂIMAN, f. m. {Hiß. nat. Lith.') pierre que l’on
apportoit, fuivant quelques auteurs, des Indes orientales,
& fur-tout de Carthagene & de Nombre do
Dias. On prétend qu’elle rëfl'emble au caillou des
rivières ; qu’elle fe trouve dans l’eftomac des grands
crocodiles appellés caïmans, & que les Indiens & les
Efpagnols la recherchent avec foin , comme un re-
mede affûré contre le fievre quarte : il faut en appliquer
fine à chaque tempe. Voye^ C r o c o d i l e .
. C a ïm a n ou C a y m a n e s , (Géogr.) île de l’Amérique
dans le golfe de Mexique ; il y a encore une île
de ce nom au même endroit, qu’on appelle le petit
Caïman.
CAINITES ou CAIANIENS, f. m. pl. {Hiß. ectléf)
nom d’anciens hérétiques qui rendoient un honneur
extraordinaire aux perfonnes que l’Ecriture nous repréfente
comme les plus méchans de tous les hommes.
Ils ont été ainfi appellés de Coin, qu’ils regar-
I doient comme leur pere. C ’étoit une branche de Gnof»
tiques, qui foûtenoient des erreurs monftrueüfes. Ils
prétendoient que Caïn & même Efaii, Lot & ceux
de Sodome, étoient nés d’une vertu célefte très-puif-
fante , & qu’Abel au contraire étoit né d’une vertu
fort inférieure à la première. Ils affocioient à Caïn &
aux autres du même ordre, Judas, qui avoit eu, félon
eux, une grande connoiffance de toutes chofes ;
& ils en faifoient une fi grande eftime, qu’ils avoient
un ouvrage fous fon nom, intitulé 'Cévangile de Judas.
S. Epiphane a rapporté & réfuté en même tems leurs
erreurs, dont les principales étoient„que l’ancienne
loi n’étoit pas bonne, & qu’il n’y auroit point de ré-
furreûion. Ils exhortoient les hommes à détruire- les
ouvrages du Créateur, & à commettre toutes fortes
de crimes, perfuadés que les mauvaifes avions con-
duifoient au falut. Ils invoquoient même les anges
à chaque crime qu’ils commettoient, parce qu’ils
croyoïent qu’il y avoit un ange qui affiftoit à chaque
péché & à chaque aélion honteule, & qui aidoit à la
faire. Enfin ils faifoient confifterlafouveraine perfection
à dépouiller tellement toute honte & tous remords
, qu’on commit publiquement les allions les
plus brutales. Ils erroient auffi fur le baptême, comme
il paroît par Tertullien ; & la plupart de leurs opinions
étoient contenues dans un livre qu’ils avoient
compofé fous le titre à'afeenfion de S. Paul, où, fous
prétexte des révélations faites à cet apôtre dans fon
raviffement au ciel, ils débitoient leurs impiétés &
leurs blafphèmes. Dupin, biblioth des auteurs eccléf
tome II. Fleury, hiß. eccléf. tome I. liv. iij. {G')
CAINITO, f. m. {Hiß, nat. bot.') genre de plante
à fleur monopétale, en cloche ouverte & découpée.
Il s’élève du calice un piftil qui devient dans la fuite
un fruit mou, charnu, rond, ou de la forme d’une
olive, contenant un ou plufieurs noyaux qui renferment
chacun une amande. Plum. nova plant, amer.
gen. Voye^ P l à NTE. ( / )
CAJOLER, v. n. {Marine.) c’eft mener un vaif-
feau contre le vent à la faveur du courant. On fe fert
auffi de ce terme pour dire faire de petites bordées, ou-
attendre fans voile, en faifant peu de route.
CAIRE, ( l e ) Geog. grande ville d’Afrique, capitale
de l’Egypte ; elle paffe pour l’une des plus confi-
dérables
durables de la domi nation des Turcs : elle eft fur la rive j
orientale du Nil. Long. 49. G. tS. lat. 3 o. 2 . 3 0.
C AlRO AN, ( Géog. ) ville d’Afrique , au royaume
de Tunis. Long. zy . Lat. 36. 40.
CAISSE , f. f. du latin capf'a, coffre ou boîte, fe
dit au propre d’un coffre de planches de bois de fa-
pin, affemblées avec des clous, ou des traverfes
cloiiées ou autrement, & deftinées à renfermer des
marchandifes, foit pour les conferver, foit pour les
tranfporter : le nom de caijfe a pris, par analogie, un
grand nombre d’autres acceptions, comme on va
voir à la fuite de cet article.
CAISSE , terme d'Architecture , c’eft dans chaque
intervalle des modillons du plafond de la corniche
corinthienne, un renfoncement quarré qui renferme
une rofe. Ces renfoncemens qu’on nomme auffi panneaux
ou caffettes, font de diverfes figures dans les
compartimens des voûtes & plafonds. ( P )
C aisse , ( Lutherie. ) c’eft une machine ou infiniment
de guerre, de la groffeur d’un minot, couvert
ù chaque bout d’une peau de veau, qui rend un fon i
vraiment martial en battant fur l’une de ces peaux
avec deux baguettes de bois faites exprès. Ce fon
eft plus ou moins fort, félon que les peaux font plus
ou moins étendues par le moyen de plufieurs cordages
qui fe refferrentaveede petits tirets, ou des oreilles
de cuir qui les environnent, & félon que le timbre,
qui n’eft autre chofe qu’une corde qui traverfe
la peau de deffous, eft plus ou moins tendu. Voye^
TAMBOUR &les Planches de Lutherie.
C aisse de fufées ; les Artificiers appellent ainfi un
coffre de planches, long & étroit, en quarré fur fa
longueur, & pofé verticalement, dans lequel on enferme
une grande quantité de fufées volantes, lorf-
qu’on veut faire partir en même tems & former en
l’air une figure de feu femblable à une gerbe de blé,
qu’on appelle pour la même raifon gerbe de feu.
Caijfe aérienne , c’eïl une efpece de balon qui renferme
beaucoup d’artifice de petites fufées.
C aisse à fable, eft un coffre de bois de quatre piés
de long, de deux de large, & de dix pouces environ
de profondeur, foûtenu à hauteur d’appui par quatre
piés. C’eft dans cette caijfe qu’eft contenu le fable
dont on forme les moules, & qu’on les corroyé. Voye{
l'article FONDEUR EN SABLE, & lafig. 14. Plan. du
Fondeur en fable.
C aissé , à ta Monnoie, fe prend à-peu-près dans
le même fens que chez le Fondeur en fable.
C aisse , {Jardinage?) vaiffeau quarré fait de planches
de chêne cloiiées fur quatre piliers du même bois,
qui lert à renfermer les orangers , les jafmins, &au-
tres arbres de fleur.
Pour faire durer les caijfes, on les peint par dehors
de deux couches à l’huile, foit de blanc, foit de verd,
& on les goudronne en-dedans. Les grandes font
ferrées. Les petites caffes fe font de douves fortant
des tonneaux : les moyennes, de mairain ou panneau
: les grandes, de chevrons de chêne, avec de
gros ais de chêne attachés deffus, garnies d’équerres
& de liens de fer. {K )
C aisse , en terme de Rafineur de fucre, c’eft un petit
coffret de bois plus long que large, fur le derrière
duquel il y a un rebord plus élevé que le refte, & à
gauche une traverfe d’environ deux pouces de hauteur
& d’un pouce & demi d’épaiffeur. Le rebord empêche
le fucre que l’on gratte de tomber par terre ,
& la traverfe fert à foûtenir la forme que l’on gratte
fur la caijfe. Voye^ GRATTER.
.Ca i s s e des marches, ( Manufacture de foie. )
efpece de coffret percé de part en part, & qui reçoit
le boulon qui enfile les marches. On le charge
d’un poids confidérable pour lefter les marches arretées.
Cette façon d’arreter les marches dans la caijfe
eft la meilleure, parce qu’on peut avancer ou recù-
Tooie II,
1er le poids félon le befoin : mais il n’en eft pas de
même quand le boulon eft arrêté à de gros pitons
fichés dans le plancher. Caisse , ( Commerce. ) efpece de vaiffeau ou coffre
fait de menues planches de fapin, ou autre bois le-
ger, jointes enfemble par des clous ou des chevilles
de bois, & propre à tranfporter des marchandifes
plus facilement fans les gâter ou corrompre. On dit
une caijfe d'étoffés , de toiles , d'oranges, de vins étrangers
, &c.
Caijfe emballée, eft une caijfe pleine de marchandifes
, entourée de paille, & couverte d’une groffe
toile qu’on nomme balle ou emballogt. Voye{ Balle
& Emballage.
Caijfe cordée, eft une caijfe qui n’a point d’embal-
lage, & qui eft feulement liée par-deffus avec de la
corde de diftance en diftance, pour empêcher les
planches de s’écarter.
Caijfe ficelée & plombée, eft celle que les commis
de la doüane ont fait emballer & corder en leur pré-
fence, après avoir fait payer les droits néceffaires, &
qu’ils ont fait noiier autour du noeud de la corde
d’une ficelle dans laquelle eft un plomb marqué deffus
& deffous des coins du bureau. Ces fortes de caiffes
ne doivent être ouvertes qu’au dernier bureau de la
route, fuivant l’ordonnance de 1687. Caisse, ( Commerce.')lignifie auffi une efpece de
coffre fort tout de fer, ou de bois de chêne garni de
bonnes barres de fer, & d’une ou de plufieurs ferrures
, qui ordinairement ont des refforts qui ne font
connus que de ceux à qui la caiffe appartient.
C ’eft dans ces fortes de caiffes que les Marchands,
Négocians & Banquiers enferment leur argent comptant
& leurs principaux effets de petit volume, comme
lettres & billets de change, promeffes, lingots
d’o r , &c.
On entend auffi par le mot de caiffe le cabinet du
Caiffier, où eft la caiffe ou coffre-fort, & où il faitfa
recette & fes payemens. Voye{ Caissier.
On appelle livre de caiffe, une forte de livre qui
contient en débit & crédit tout ce qui entre d’argent
dans la caiffe, & tout ce qui en fort. Ce livre eft le
plus important de tous ceux que les Négocians nomment
livres auxiliaires.
Caisse fe dit de tout l’argent qu’un marchand Négociant
ou Banquier peut avoir à fa difpofition pour
négocier : on dit en ce fens que la caiffe d'un tel Banquier
ejl de cent mille écus, de huit cents mille livres, & c .
M. Savary, dans fon parfait Négociant, II. paru
liv. I. chap.jv. donne d’excellentes maximes pour le
bon gouvernement d’une caiffe. Voyelles dans cet
ouvrage ou dans le Dictionn. du commerce , tom. I l*
P*gC-a33is-s e3 4- ^ de crédit, c’eft une caiffe établie en faveur
des Marchands forains qui amènent à Paris des vins
& autres boiffons.
Le premier établiffement de cette caiffe eft du mois-
de Septembre 1719. L’Edit porte : « que les Mar-
» chands forains & autres pourront y recevoir fur le
» champ le prix de leurs vins & boiffons, & y pren-
» dre crédit moyennantfix deniers pour livres». On
peut voir ce qui concerne la police & l’adminiftration
de cette caiffe dans le Dictionn. du commerce %
tom. II. page 3 G. Caisse des emprunts, nom qu’on a donné en France
à une caiffe publique établie a Paris dans l’hôtel des
fermes-unies du Roi, où toutes fortes de perfonnes de
quelque qualité ou condition qu’ils fuffent, tant François
qu’étrangers, étoient reçûs à porter leur argent
pour le faire valoir, & d’où ils pouvoient le retirer
à l’échéance des promeffes folidaires que les Fermiers
généraux de fa Majefté leur en fourniffoient, lignées
de quatre de la compagnie prépofés à cet effet.
Ces fortes de promeffes dont le nom de celui qui
X y y