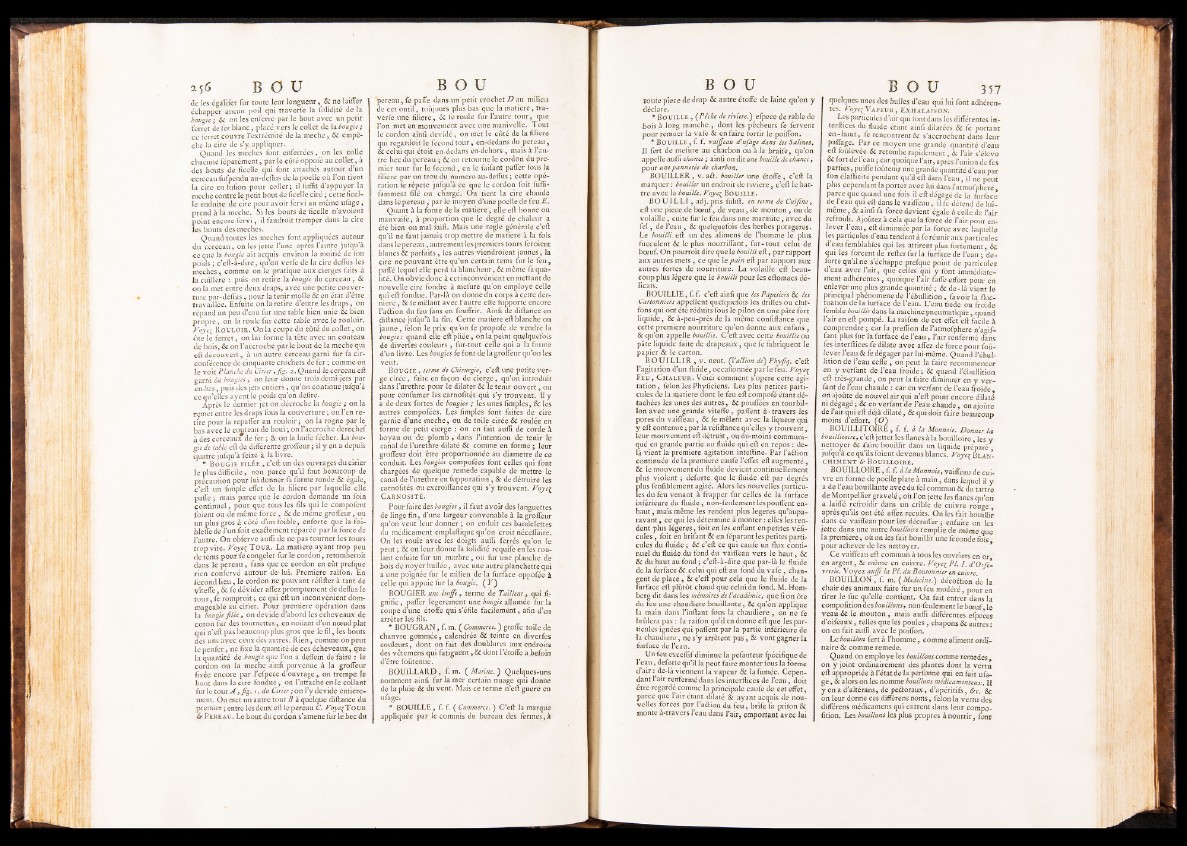
de les égalifer fur toute leur longueur, 8c ne laiffer 1
échapper aucun poil qui traverfe la folidite de la
bouoie ; 8c on les enferre- par le bout avec un petit
ferret de fer blanc, placé vers le collet de la bougie;
ce ferret couvre l’extrémité delà meche, 8c empêche
la cire de s’y. appliquer.
Quand les meches font enferrées, on les colle
chacune féparément, par le côté oppofé au collet, à
des bouts de ficelle qui font attachés autour d’un
cerceau fufpendu au-deflus de la poelle oh l’on tient
la cire en fùfion pour coller; il fuffit d’appuyer la
meche contre le petit bout de ficelle ciré ; cette ficelle
enduite de cire pour avoir fervi au même ufage,
prend à la meche. Si les bouts de ficelle n’avoient
point encore fervi, il faudroit tremper dans la cire
les bouts des meches.
Quand toutes les meches font appliquées autour
du cerceau, on les jette l’une après l’autre jufqu’à
ce que la bougie ait acquis environ la moitié de fon
poids ; c’eft-à-dire, qu’on verfe de la cire deffus les
meches-, comme on le pratique aux cierges faits à
la cuillère : puis on retire la bougie du cerceau, &
on la met entre deux draps, avec une petite couverture
par-deffus, pour la tenir molle 8c en état d’être
travaillée. Enfuite on la retire d’entre les draps, on
répand un peu d’eau fur une table bien unie 8c bien
propre, on la roule fur cette table avec le rouloir.
Voyei R o u l o i r . On la coupe du côté du collet, on
ôte le ferret, on lui forme la tête avec un couteau
de bois, 8c on l’accroche par le bout de la meche qui
eft découvert, à un autre.cerceau garni fur fa circonférence
de cinquante crochets de fer ; comme on
le voit Planche du Cirier ,fig. z . Quand le cerceau eft
garni de bougies, on leur donne trois demi-jets par
en-bas, puis des jets entiers , qu’on continue jufqu’à
ce qu’elles ayent le poids qu’on defire.
Après le dernier jet on décroche la bougie ; on la
remet entre les draps fous la couverture ; on l’en retire
pour la repaffer au rouloir ; on la rogne par le
bas avec le couteau de boui ; on l’accroche derechef
à des cerceaux de fer ; & on la laiffe fécher. La bougie
de table eft de différente groffeür ; il y en a depuis
quatre jufqu’à feize à la livre.
* B o u g i e f i l é e , c’eft un des ouvrages du cirier
le plus difficile, non parce qu’il faut beaucoup de
précaution pour lui donner fa forme ronde 8c égale,
c’eft un fimple effet de la filiere par laquelle elle
paffe ; mais parce que le cordon demande un foin
continuel, pour que tous les fils qui le compofent
foient ou de même force, 8c de meme groffeür, ou
un plus gros à côté d’un foible, enforte que la foi-
bleffe de l’un foit exa&ement réparée parla force de
l’autre. On obferve auffi de ne pas tourner les tours
trop vite. Voye^ T o u r . La matière ayant trop peu
de tems pour fe congeler fur le cordon, retomberoit
dans le pereau, fans que ce cordon en eût prefque
rien confervé autour de-lui. Première raifon. En
fécond lieu, le cordon ne pouvant réfifter à tant de
vîteffe, 8c fe dévider affez promptement de deffus le
tour, fe romproit ; ce qui eft un inconvénient dommageable
au cirier. Pour première opération dans
la bougie filée, on dévidé d’abord les écheveaux de
coton fur des tournettes, en noiiant d’un noeud plat
qui n’eft pas beaucoup plus gros que le fil, les bouts
des uns avec ceux des autres. Rien, comme on peut
le penfer, ne fixe la quantité de ces écheveaux, que
la quantité de bougie que l’on a deffein de faire : le
cordon ou la meche ainfi parvenue à la groffeür
fixée encore par l’efpece d’ouvrage, on trempe le
bout dans la cire fondue, on l’attache en le collant
fur le tour A , fig. /. du Cirier ; on l’y dévidé entièrement.
On met un autre tour B à quelque diftance du
premier ; entre les deux eft le pereau C. Voye[T o u r
& P e r e a u . Le bout du cordon s’amene fur le bec du
‘pereau, fe paffe dans un' petit crochet D au milieu
de cet outil, toujours plus bas que la matière, traverfe
une filiere, 8c fe rouie fur l’autre tour, que
l’on met en mouvement avec une manivelle. Tout
le cordon ainfi dévidé, on met le côté de la filiere
qui regardoit le fécond tour, en-dedans du pereau,
8c celui qui étoit en-dedans en-dehors , mais à l’autre
bec du pereau ; & on retourne le cordon du premier
tour fur le fécond , en le faifant paffer fous la
filiere par un trou du numéro au-deffus ; cette operation
fe répété jufqu’à ce que le cordon foit fuffi-
famment filé ou chargé. On tient la cire chaude
dans le pereau, par le moyen d’une poelle de feu E .
Quant à la fonte de la mâtiere, elle eft bonne ou
mauvaife, à proportion que le degré de chaleur a
été bien ou mal fiaifi. Mais une réglé générale c’eft
qu’il ne faut jamais trop mettre de matière à la fois
dans le pereau, autrement les premiers tours feroient
blancs 8c parfaits , les autres viendroient jaunes, la
cire ne pouvant être qu’un certain tems fur le feu ,
paffé lequel elle perd fa blancheur, 8c même fa qualité.
On obvie donc à cet inconvénient en mettant de
nouvelle cire fondre à mefure qu’on employé celle
qui eft fondue. Par-là on donne du corps à cette dernière
, & fe mêlant avec l’autre elle fupporte encore
l’aftion du feu fans en fouffrir.. Ainfi de diftance en
diftance jufqu’à la fin. Cette matière eft blanche ou
jaune, félon le prix qu’on fe propofe de vendre la
bougie : quand elle eft pliée, on la peint quelquefois
de diverfes couleurs , fur-tout celle qui a la forme
d’un livre. Les bougies fe font de la grolfeur qu’on les
veut.
B o u g i e , terme de Chirurgie-, c’eft une petite verge
cirée, faite en façon de çiërge, qu’on introduit
dans l’urethre pour le dilater 8c le tenir ouvert, ou
pour confirmer les carnofités qui s’y trouvent. Il y
a de deux fortes de bougies ; les unes fimples, 8c les
autres compofées. Les fimples font faites de cire
garnie d’une meche, ou de toile cirée & roulée en
forme de petit cierge : on en fait auffi de corde à
boyau ou de plomb, dans l’intention de tenir le
canal de l’urethre dilaté 8c comme en forme ; leur
groffeür doit être proportionnée au diamètre de ce
conduit. Les bougies compofées font celles qui font
chargées de quelque remede capable de mettre le
canal de l’urethre en fuppuration, & de détruire les
carnofités ou excroiffances qui s’y trouvent. Voye{
C a r n o s i t é .
Pour faire des bougies , il faut avoir des languettes
de linge fin, d’une largeur convenable à la groffeür
qu’on veut leur donner ; on enduit ces bandelettes
du médicament emplaftique qu’on croit néceffaire.
On les roule avec les doigts auffi ferrés qu’on le
peut ; 8c on leur donne la lolidité requife en les roulant
enfuite fur un marbre * ou fur une planche de
bois de noyer huilée, avec une autre planchette qui
a une poignée fur le milieu de la furface oppofée à
celle qui appuie fur la bougie, ( T )
BOUGIER une étoffe , terme de Tailleur , qui lignifie
, paffer legerement une bougie allumée fur la
coupe d’une étoffe qui s’éfile facilement, afin d’en
arrêter les fils.
* BOUGRAN, f. m. ( Commerce, ) groffe toile de
chanvre gommée, calendrée 8c teinte en diverfes
couleurs, dont on fait des doublures aux endroits
des vêtemens qui fatiguent, 8c dont l’étoffe a befoin
d’être foûtenue.
BOUILLARD, f. m. ( Marine. ) Quelques-uns
nomment ainfi fur la mer certain nuage qui donne
de la pluie 8c du vent. Mais ce terme n’eft guere en
ufage, . -3
* BOUILLE, f. f. ( Commerce. ) C ’eft la marque
appliquée par le commis du bureau des fermes, à
toute pièce de drap 8c autre étoffe de laine qu’on y
déclare.
* B o u i l l e , (Pêche de riviere.') efpece de rable de
bois à long manche , dont les pêcheurs fe fervent
pour remuer la vafe & en faire lortir le poiffon.
* BO U IL LE , f . f . vaiffeau d? ufage dans Les Salines.
Il fe r t d e m e fu re a u ch a rb o n o u à la b r a i f e , q u ’o n
a p p e lle auffi chanci; a infi o n d it une bouille de chanci,
p o u r une pannetée de charbon.
BOUILLER, v . a f t . boitiller u n e é to ffe , c ’ e ft la
m a rqu e r : boitiller u n e n d ro it d e r i v i e r e , c ’e ft le b a t t
re a v e c la bouille. Voye{ B o u i l l e .
B O U IL L I , adj. pris fubft. en terme de Cuijîne,
eft une piece de boeuf 9 de veau, de mouton , ou de
volaille, cuite fur le feu dans une marmite, avec du
fe l, de l’eau , 8c quelquefois des herbes potagères.
Le bouilli, eft un des alimens de l’homme le plus
fucculent & le plus nourriffant, fur-tout celui de
boeuf. On pourroit dire que le bouilli eft, par rapport
aux autres mets, ce que le pain eft par rapport aux
autres fortes de nourriture. La volaille eft beaucoup
plus légère que le bouilli pour les eftomacs délicats.
BOUILLIE, f. f. c’eft ainfi que les Papetiers 8c les
Canonniers appellent quelquefois les drilles ou chiffons
qui ont été réduits fous le pilon en une pâte fort
liquide, 8c à-peu-près de la même confiftance que
cette première nourriture qu’on donne aux enfans ,
& qu’on appelle bouillie. C ’eft avec cette bouillie ou
pâte liquide faite de drapeaux, que fe fabriquent le
papier & le carton.
B O U IL L IR , v. neut. (faction de) Phyfiq. c’eft
l’agitation d’un fluide, occafionnée par le feu. Voye%
F e u , C h a l e u r . Voici comment s’opère cette agitation
, félon les Phyficiens. Les plus petites particules
de la naatiere dont le feu eft compofé étant détachées
les unes des autres, 8c pouffées en tourbillon
avec une grande vîteffe , paffent à - travers les
pores du vaifleau, 8c fe mêlefit avec la liqueur qui
y eft contenue ; par la réfiftanee qu’elles y trouvent,
leur mouvement eft détruit, ou du-moins communiqué
en grande partie au fluide qui eft en repos : delà
vient la première agitation inteftine. Par l’aâion
continuée de la première caufe l’effet eft augmenté,
8c le mouvement du fluide devient continuellement
plus violent ; deforte. épie le fluide eft par degrés
plus fenfiblement agité. Alors les nouvelles particules
du feu venant à frapper fur celles de la furface
inférieure du fluide, non-feulement les pouffent en-
haut , mais même les rendent plus legeres qu’aupa-
ravant, ce qui les détermine à monter : elles les rendent
plus légères, foit en les enflant en petites véfi-
cules, foit en brifant 8c en féparant les petites particules
du fluide ; 8c c’eft ce qui caufe un flux continuel
du fluide du fond du vaiffeau vers le haut, 8c
& du haut au fond ; c’eft-à-dire que par-là le fluide
de la furface 8c celui qui eft au fond du v a fe , changent
de place, & c’eft pour cela que le fluide de la
furface eft plûtôt chaud que celui du fond. M. Hom-
berg dit dans les mémoires de Vacadémie) que fi on ôte
du feu une chaudière bouillante, 8c qu’on applique
la main dans l’inftant fous la chaudière , on ne fe
brûlera pas : la raifon qu’il en donne eft que les particules
ignées qui paflént par la partie inférieure de
la chaudière, ne s’y arrêtent pas, & vont gagner la
furface de l’eau.
Un feu exceffif diminue la pefanteur fpécifique de
l’eau, deforte qu’il la peut faire monter fous la forme
d’air : de-là viennent la vapeur & la fumée. Cependant
l’air renfermé dans les interftices de l’eau, doit
être regardé comme la principale caufe de cet effet,
parce que l’air étant dilaté & ayant acquis de nouvelles
forces par l’adion du feu, brife fa prifon 8c
monte à-travers l’eau dans l’air, emportant avec lui
q uelqués-iines des b u lle s d ’e a u q u i lu i fo n t ad h érente
s . Voye{V a p e u r , E x h a l a i s o n .
Les particules d’air qui font dans les différentes interftices
du fluide étant ainfi dilatées 8c fe portant
en-haut, fe rencontrent 8c s’accrochent dans leur
^ar ce moyen une grande quantité d’eau
eft foulevee 8c retombe rapidement, 8c l’air s’élève
8c fort de 1 eau ; car quoique l’air, après l’union de fes
parties, puiffe foûtenir une grande quantité d’eau par
fon elafticité pendant qu’il eft dans l’eau, il ne peut
plus cependant la porter avec lui dans l’atmofphere ,
parce que quand une fois il eft dégagé de la furface
del eau qui eft dans le vaiffeau, il le détend de lui-
même , 8c ainfi fa force devient égale à celle de l’air
refroidi. Ajoûtez à cela que la force de l’air pour enlever
l’eau, eft diminuée par la force avec laquelle
les particules d’eau tendent à fe réunir aux particules
d’eau femblables qui les attirent plus fortement, 8c
qui les forcent de refterfurla furface de l’eau ; de-
forte qu’il ne s’échappe prefque point de particules
d’eau avec l’air, que celles qui y font immédiatement
adhérentes, quoique l’air faffe effort pour en
enlever une plus grande quantité ; 8c de -là vient le
principal phénomène de l’ébullition, favoir la fluctuation
de la furface de l’eau. L’eau tiede ou froide
femble bouillir dans la machine pneumatique, quand,
l’air en eft pompé. La raifon de cet effet eft facile à
comprendre ; car la preffion de l’atmofphere n’agif-
fant plus fur la furface de l’eau, l’air renfermé dans
fes interftices fe dilate avec affez de force pour foû-
lever l’eau 8r fe dégager par lui-même. Quand l’ébullition
de l’eau celle, on peut la faire recommencer
en y verfant de l’eau froide ; 8c quand l’ébullition
eft très-grande, on peut la faire diminuer en y verfant
de l’eau chaude : car en verfant de l’eau froide
on ajoûte de nouvel air qui n’eft point encore dilaté
ni dégagé ; 8c en verfant de l’eau chaude, on ajoûte
de l’air qui eft déjà dilaté, 8c qui doit faire beaucoup
moins d’effort. (O)
BOUILLITOIRE, f. f .à la Monnoie. Donner lu
bouillitoire, c’eft jetter les flancs à la bouilloire, les y
nettoyer 8c faire bouillir dans un liquide préparé
jufqu’à ce qu’ils foient devenus blancs. Voye^ B l a n c
h im e n t & B o u i l l o i r e .
BOUILLOIRE, f. f. à la Monnoie, vaiffeau de cuivre
en forme de poelle plate à main, dans lequel il y
a de l’eau bouillante avec du fel commun 8c du tartre
de Montpellier gravelé ; oîi l’on jette les flancs qu’on
a laiffé refroidir dans un crible de cuivre rouge,
après qu’ils çnt été affez recuits. On les fait bouillir
dans ce vaiffeau pour les décraffer ; enfuite on les
jette dans une autre bouilloire remplie de même que
la première, où on les fait bouillir une fécondé fois
pour achever de les nettoyer.
Ce vaiffeau eft commuh à tous les ouvriers en or '
en argent, & même en cuivre. Voye^ PI. /. d'Orfèvrerie.
Voyez auffi la PI. du Boutonnier en cuivre.
BOUILLON, f. m. { Medecine.) déco&ion de la
chair des animaux faite fur un feu modéré, pour en
tirer le fuc qu’elle contient. On fait entrer dans la
compofition des bouillons, non-feulement le boeuf le
veau 8c le mouton, mais auffi différentes efpeces
d’oifeaux, telles que les poules, chapons 8c autres :
on en fait auffi avec le poiffon.
Le bouillon fert à l’homme, comme aliment ordinaire
8c comme remede.
Quand on employé les bouillons comme remedes '
on y joint ordinairement des plantes dont la vertu
eft appropriée à l’état de la perfonne qui en fait ufage
, & alors on les nomme bouillons médicamenteux. Il
y en a d’altérans, de peûoraux, d’apéritifs, &c. 8c
on leur donne ces différens noms, félon la vertu des
différens médicamens qui entrent dans leur compofition.
Les bouillons les plus propres à nourrir, font