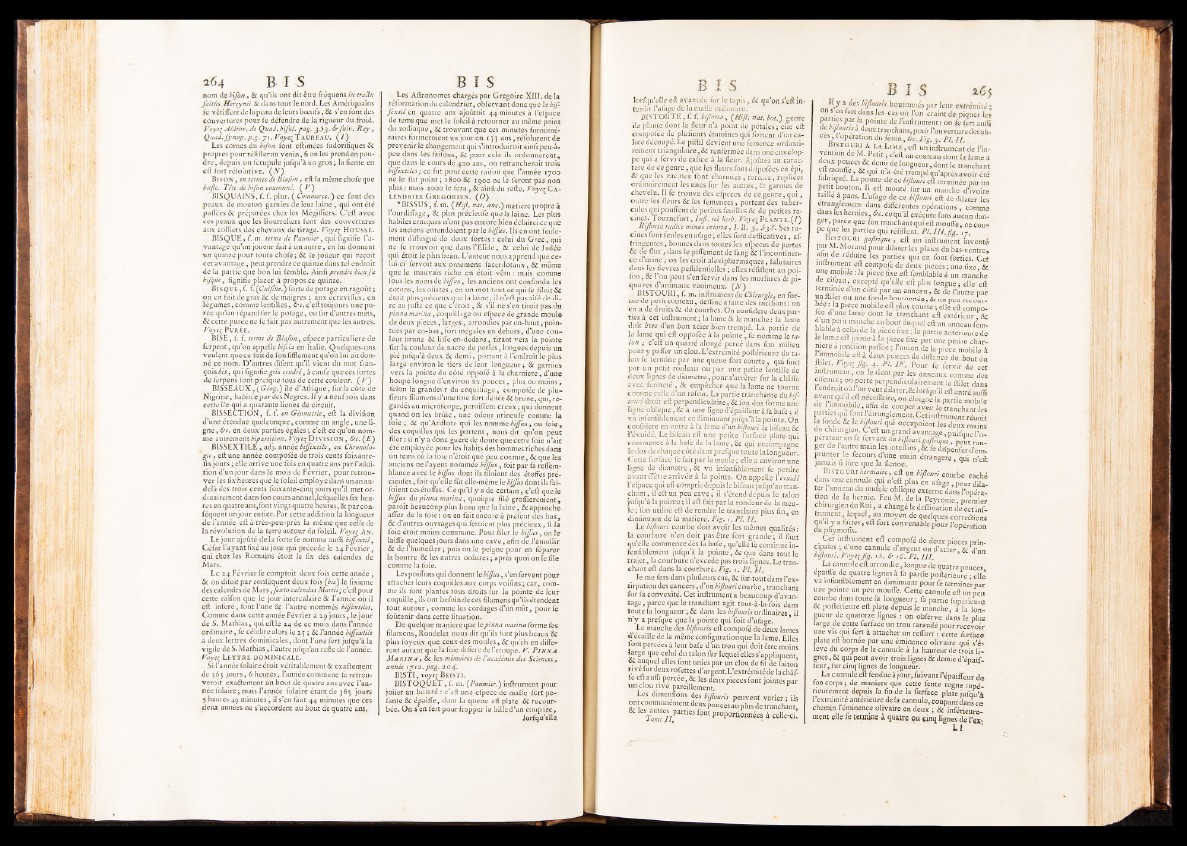
rôt B i s
nom de bifon, & qu’ils ont dit être fréquens in tracîu
faliùs Hercynii & dans tout le nord. Les Amériquains
i'e vêtiflent de la peau de leurs boeufs, & s’en font des
couvertures pour fe défendre de la rigueur du froid.
Voyez Aldrov. de Quad. biful. pag. 3 S3 . & fuiv. Ray ,
Quad.Jynop.p.g. j i . V TAUREAU. ( I )
Les cornes du bifon font eftimées fudorifïques 6c
propres pour réfifter au venin, fi on les prend en poudre,
depuis un fcrupule jufqu’à un gros ; la fiente en
elî: fort réfolutive. {N )
B i s o n , en termes de Blafon, e ft la m ême ch o fe q u e
lufle. Tête de bifon couronné. ( V )
BISQUAINS, f. f. plur. ( Commerce. ) ce font des
peaux de mouton garnies de leur laine , qui ont été
pafiées 6c préparées chez les Mégifliers. C ’eft avec
ces peaux que les Bourreliers font des couvertures
aux colliers des chevaux de tirage. Voye{ H o u s s e .
BISQUE, f. m. terme de Paumier, qui fignifie l’a-
.vantage qu’un joiieur fait à un autre, en lui donnant
un quinze pour toute chofe; & le joiieur qui reçoit
cet avantage, peut prendre ce quinze dans tel endroit
de la partie que bon lui femble. Ainfi prendre bien fa
bifque, fignifie placer à propos ce quinze.
B i s q u e , f. f. (’Cuifîne.) forte de potape en ragoût ;
on en fait de gras 6c de maigres ; aux ecrevifles, en
légumes, comme lentilles, &c. c’eft toujours une purée
qu’on répand fur le potage, ou fur d’autres mets,
& cette puree ne fe fait pas autrement que les autres.
Voyez P u r é e .
BISE, f. f. terme de Blafon, efpece particulière de
ferpent, qu’on appelle bifcia en Italie. Quelques-uns
veulèrit que ce foitde fonfifflement qu’on lui ait donné
ce nom. D’autres difent qu’il vient du mot fran-
çois bis, qui fignifie gris cendré, à caufe.que ces fortes
de ferpens font prefque tous de cette couleur. ( V )
BISSEAUX., (Géog..) île d’Afrique, fur la côte de
Nigritie, habitcepar desNegres. Il y a neuf rois dans
cette île quia quarante lieues de circuit.
BISSECTION, f. f. en Géométrie, eft la divifion
d’une étendue quelconque., comme un angle, une ligne
, &c. en deux parties égales ; c’eft ce qu’on nomme
autrement bipartition. Voyez D i v i s i o n , &c. {£)
BISSEXTILE, adj. année bijfexdle, en Chronologie
, eft une année compofée de trois cents foixante-
fix jours ; elle arrive une fois en quatre ans par l’addition
d’un jour dans le mois de Février, pour retrouver
les fix heures que le foleil employé dans un an au-
delà des trois cents foixante-cinq jours qu’il met ordinairement
dans fon cours annuel,lefquelles fix heu-
.res en quatre ans,font vingt-quatre heures, & par con-
féquent un jour entier. Par cette addition la longueur
de l’année eft à-très-peu-près la même que celle de
la révolution de la terre autour du foleil. Voyez An.
Le jour ajouté delà forte fe nomme aufii biffextil,
Céfar l’ayant fixé au jour qui précédé le 24 Février,
qui- chez les Romains étoit le fix des calendes de
.Mars.
Le 24 Février fe comptoit deux fois cette année ,
& on diioit par conféquent deux fois {bis) le fixieme
des calendes de Mars ffexto calendas Mardi; c’eft pour
cette raifon que le jour intercalaire & l’année où il
eft inféré, font l’une 6c l’autre nommés biffextiles.
Comme dans cette année Février a 29 jours, le jour
de S. Mathias, qui eft le 24 de ce mois dans l’année
ordinaire, fe célébré alors le 25 ; & l’année bijfexdle
a deux lettres dominicales, dont l’une fert julqu’à la
vigile de S. Mathias, l’autre jufqu’au refte de l’année.
Voyez L e t t r e d o m i n i c a l e .
Si l’année folaire étoit véritablement & exa&ement
de 365 jours, 6 heures, l’année commune fe retrou-
veroit exactement au bout de quatre ans avec Tannée
folaire ; mais Tannée folaire étant de 365 jours
5 heures 49 minutes, il s’en faut 44 minutes que ces
deux années ne s’accordent au bout de quatre ans.
B I S
Les Aftronomes chargés par Grégoire XIII. de la
réformation du calendrier, obfervant donc que le b iff
e x t i l en quatre ans ajoutoit 44 minutes à Fefpace
de tems que met le foleil à retourner au même point
du zodiaque, & trouvant que ces minutes furnumé-
raires formeroient un jour en 133 ans, réfolurent de
prévenir le changement qui s’introduiroit ainfi peu-à-
peu dans les faifons, 6c pour cela ils ordonnèrent,
que dans le cours de 400 ans, on retrancheroit trois
b i j f e x t i l e s ce fut pour cette raifon que Tannée 1700
ne le fut point ; .1800 & 1900 ne le feront pas non
plus : mais 2000 le fera, & ainfi du refte. Voyez C a l
e n d r i e r G r é g o r i e n . ( O )
* BISSUS ■, f. m. {Hijl. nat. anc.) matière propre à
l’ourdiflage, 6 c plus précieufe que la laine. Les plus
habiles critiques n’ont pas encore bien éclairci-ee que
les anciens entendoient par le bijfus. Ils en ont feuler
ment diftingué de. deux fortes : celui du Grec, qui
ne fe.trouvoit que dansl’Elide, & celui de Judée
qui étoit le plus beau. L’auteur nous apprend que celui
ci fervoit aux ornemens facerdotaux, 6 c même
que le mauvais riche en étoit vêtu : mais comme
fous les noms de bijfus, les anciens ont confondu les
cotons, les otiates, en un mot tout ce qui fe filoit &
étoit plus précieux que la laine, il n’eft pas aifé de dire
au jufte ce que c’étoit, & s’il ne s’en tiroit pas du
pinna marina, coquillage ou efpece de grande moule
de deux pièces, larges , arrondies par en-haut, pointues
par en-bas, fort inégales en dehors, d’une couleur
brune 6 c lifte en-dedans, tirant vers la pointe
fur la couleur de.nac-re de perles, longues depuis un
pié jufqu’à deux 6 c demi, portant à l’endroit le plus,
large environ le tiers de leur longueur; & garnies
vers la pointe du côté oppofé à la charnière, d’une
houpe longue d’environ lix pouces , plus ou moins,
félon la grandeur du coquillage, compofée de plu-
fieurs filamens d’une foie fort déliée & brune, qui, regardés
au microlcope, paroiflent creux ; qui donnent
quand on les brûle, une odeur urineufe comme la
foie ; 6 c qu’Ariftote qui les nomme biffus, ou foie ,
des coquilles qui les portent, nous dit qu’on peut
filer : il n’y a donc guere de doute que cette foie n’ait
été employée pour les habits des hommes riches dans
un tems où la foie n’étoit que peu connue, 6 c que les
anciens ne l’ayent nommée bijfus, foit par fa reflem-
blance avec le bijfus dont ils filoient des étoffes pré-
cieufes, foit qu’elle fût elle-même le biffus dont ils fai-
foient ces étoffes. Ce qu’il y a de certain, c’eft que le
biffus du pinna marina, quoique filé groflierement,
paroît beaucoup plus beau que la laine, 6c approche
allez de la foie : on en fait encore à préfent des bas,
& d’autres ouvrages qui feroient plus précieux, fi la
foie étoit moins commune. Pour filer le bijfus, on le
laiffe quelques jours dans une cave, afin de l’amollir
& de Thumeâer ; puis on le peigne pour en féparer
la bourre 6c les autres ordures ; après quoi on le file
comme la foie.
Les poiffons qui donnent le b i f fu s , s’en fervent pour
attacher leurs coquilles aux corps voifins; car, comme
ils font plantés tous droits fur la pointe de leur
coquille, ils ont befoinde ces filamens qu’ils étendent
tout autour, comme les cordages d’un-mât, pour fe
foûtenir dans cette fituation.
De quelque maniéré que le p in n a m a r in a forme fes
filamens, Rondelet nous dit qu’ils font plus beaux &
plus foyeux que ceux des moules, 6c qu’ils en diffe*
rent autant que la foie différé de l’étoupe. V . P i n n a
M a r i n a , 6 c les m ém oir e s d e l'a ca d ém ie d e s S c ie n c e s
a n n é e i j t z . p a g - 2 0 f .
BISTI, v o y e z B e i s t i .
BISTOQUET, f. m. {Paumierf) infiniment pour
jouer au billard : c’eft une efpece de malle fort pelante
6c épaifle, dont la queue eft plate & recourbée.
On s’en fert pour frapper la bille d’un coup fec,
lorfqu’elle
lorfqu’elle eft avancée fur le tapis, 6c qu’on s’eft interdit
l’ufage de la mafie ordinaire.
BISTORTE, f. f. bijlortà, {Hijl. nat. bot.) genre
de plante dont la fleur n’a point de pétales ; elle eft
compofée de plufieufs étamines qui fortent d’un calice
decotipe. Le piftil devient une femence ordinairement
triangulaire, & renfermée dans une enveloppe
qui a fervi dé calice à la fleur. Ajôûtez au caractère
de ce genre, que les fleurs font difpofées en épi,
& que les racines font charnues , tortues, repliées
ordinairement les unes fur les autres, & garnies de
chevelu. Il fe trouve des efpeces de ce genre, qui,
outre lés fleurs 6c les femences, portent des tubercules
qui pouffent de petites feuilles 6c de petites racines.
Tournefort, Inji. rei herb. Voyez P l a n t e .(/)
Bijlortà radice minus intorta, J. B. 3 . 538. Ses racines
font feules enufage ; elles font deflicatives , af-
tringentes, bonnes dans toutes les efpeces de pertes
& 'de flux , dans le piffementde fang 6c l’incontinence
d’urine ; on les croit alexipharmaques, falutaires
clans les fievres peftilentielles ; elles réfiftent au poi-
fon, & Ton peut s’en fervir dans les morfures & pi-
quures d’animaux venimeux. {N)
BISTOURI, f. m. infiniment de Chirurgie, en forme
de petit couteau, deftiné à faire des incifions: on
en a de droits & de courbes. On confidere deux parties
cet infiniment ; la lame & le manche : la lame
doit être d’un bon acier bien trempé. La partie de
la lanm qui eft oppofée à la pointe, fe nomme le talon
; c’eft un quarré alongé percé dans fon milieu
pour y paffer un clou. L’extrémité poftérieure du talon
fe termine par une queue fort courte , qui finit
par un petit rouleau ou par une petite lentille de
deux lignes de diamètre, pour s’arrêter fur la châfl'e
avec fermeté , & empêcher que la lame ne tourne
comme celle d’un rafoir. La partie tranchante du bif-
touri droit eft perpendiculaire, & fon dos forme une
ligne oblique, & a une ligne d’épaifleur à fa bafe ; il
va infenfiblement en diminuant jufqu’à la pointe. On
confidere en outre à la lame d’un biftouri le bifeau &
l ’évuidé. Le bifeau eft une petite furface plate qui
commence à la bafe de la lame, & qui accompagne
le dos de chaque côté dans prefque toute la longueur.
Cette furface fe fait par la meule ; elle a environ une
ligne de diamètre, 6c va infenfiblement fe perdre
avant d’être arrivée à la pointe. On appelle Yévuidé
Tefpace qui eft compris depuis le bifeau jufqu’au tranchant
, il eft un peu cave ; il s’étend depuis le talon
jufqu’à la pointe ; il eft fait par la rondeur de la meule
; fon utilité eft de rendre le tranchant plus fin, en
diminuant de la matière. Fig. 1. PI. II.
Le biflouri courbe doit avoir les mêmes qualités:
la courbure n’en doit pas être fort grande ; il faut
qu’elle commence dès fa bafe, qu’elle fe continue in-
fenfiblement jufqu’à la pointe, & que dans tout le
trajet, la courbure n’excede pas trois lignés. Le tranchant
eft dans la courbure. Fig. 1. PI. II.
Je me fers dans plufieurs cas, & fur-tout dans l’extirpation
des cancers, d’un biflouri courbe, tranchant
fur fa convexité. Cet infiniment a beaucoup d’avantage
, parce que le tranchant agit tout-à-la-fois dans
toute là longueur ; 6c dans les bijlouris ordinaires il
n’y a prefque que la pointe qui foit d’ufage.
.Le manche des bijlouris eft compofé de deux lames
d’écaille de la même configuration que la lame. Elles
font percées à leur bafe d’un trou qui doit être moins
large que celui du talon fur lequel elles s’appliquent
. eftes ft>nt unies par un clou de fil de laiton
rive fur deux rofettes d’argent.L’extrémité de la châf-
fe eft aufii percée, 6c les deux pièces font jointes par
un clou rive pareillement.
Les dimenfions des bijlouris peuvent varier ; ils
on communémentdeuxpoucesauplusdetranchant,
& leV r “ , r teS font à celle-ci.
B I S 16s
V 4 liftouns boutonnes par leur extrémité 5
. s en ert dans les cas oii Ton craint de. piquer les
parties par la p°inte de Tinftrnment: on fe fert aufii
cie bijtouris à deux tranchahs, pour l’ouverture des ab-
ces, 1 operation du féton, &c. Fig. o. PI. /ƒ.
Bistouri B R Lime»«« un inflrument cle fin-
m .de B l Ü couteau dont la lame a deux pouces & demi de longueur, dont le tranchant
H H & <iul n f ere lrempé qu’après,avoir été
hetitfIe". 3 P^ ntu Ge pet t bouton. Il eft monte*’ tfBtoBunB C* 1m tearnmchineé ed ’pivaor iurne
taxiie a pans. L ulage de ce ii/louri eft de dilater les
detarnasn lgelse hmeernnsie sd,a &nsc . dcieffqéur’einl teexs éocputéer afatinosn asu.,c ucno mdamiie.
pgee rq,u pea rlecse pqauret ifeosn q turai nrécfhifatnetn qt.u i eft mpuffe, ne cou« PI. III. fie. l7., •
Bl S, T? ,VRl W M inventé
parM. Morand.pour dilater les plaies du bas-yentre,
afin de redrnre les parties qui en font forties. Cef
înltrument eft compofé de deux pieces : une fixe &
une mqHle :1a piece fixe eft femblable à un manche
de cifeau , excepte qu’elle eft plus longue ; elle eft
termmee d un coté par un anneau , & de l’autre par
un Itilet ou une fonde boutonnée, & un peu recour-
nee mm p,eCe mobile eft plus courte ; elle eft compo-
| f.e dui^lame dont l e . tranchant eft extérieur ôc
f ," . " P ; 11 H H Ü aV bout duTJcl eft un anneau fênn
biable à celui de la piece fixe ; la partie anterieure de
la lame .eft jointe à la piece fixe par une petite char-
mere a jonSion paffée ; l’union de la piece mobile à
1 immobile eft à deux pouces de diftanoe du bout du
ftiiet. roM fiS 4. p i . i K Paur fe fervir de cet
inftrument, on le tient par les anneaux comme des
cueaux ; on porte perpendiculairement le ftilet dans
tendrait oui on veut dilater,&lorfqu’il eft entré auflî
avam qu J eft neceffairc, on éloigne la partie mobile
de 1 immobile, afin de couper avec le tranchant les
H H f t " °ccupoient les deux mains
ger de l’autre main les inteftins, dilpenfer d W
jparmunaiise rf il feu^rfee cqouuer sl ad ufineen nme.a in étrangère, q*ui n’eft
Bistourï herniaire , eft un hijlouri courbe caché
dans une cannule qui n’eft plus .en ufage , pour dila.
ter 1 anneau du mufcle oblique externe dans l’opéra«
lion de la hernie. Feu M. de la Peyronie, premier
chiriiigien du Roi, a change la deftination de cet inf-
trument, lequel, au moyen de quelques cofrealons
qu il y a faites , eft fort convenable pour l’opération
du pnymofis.
; Cet iliftrument eft compofé dé deux pieces prm«
cipales ;d’une cannule d’argent ou d’acier , & d’un »t/imi-. royiÿb. m » ,Tfei:ui. ■
, S E i H i eft arrondie, longue de quatre pouces '
epaille de quatre lignes à fa partie poftérieure ; elle
va infenfiblement en diminuant pour fe terminer par
une pointe un peu moufle. Cette cannule eft un peu
courbe dans toute fa longueur; fa partie Supérieure
& pofteneure eft plate depuis le manche, â la Ion«
gueur de quatorze, lignes : on obferve dans le plus
large de cette furface un trou taraudé pour recevoir
une vis qui fert à attacher un reffort : Cette furface
plate eft bornée par une éminence olivaire qui s'élève
du corps de la cannule à la hauteur de trois l i .
gnes, & qui peut avoir trois lignes & demie d’épaif.
leur, fur cinq lignes de longueur.
La cannule eft fendue à jour, fuivant Tépaifleur de
fon corps ; de maniéré que cette fente régné (upé^
fieurement depuis la fin de la furface plate jufqu’à
l’extrémité antérieure dé la cannule, coupant dans ce
chemin Imminence olivaire en deux ; & inférieure-
ment elle fe termtoe à quatre ou cinq lignes de l’ex-
L 1