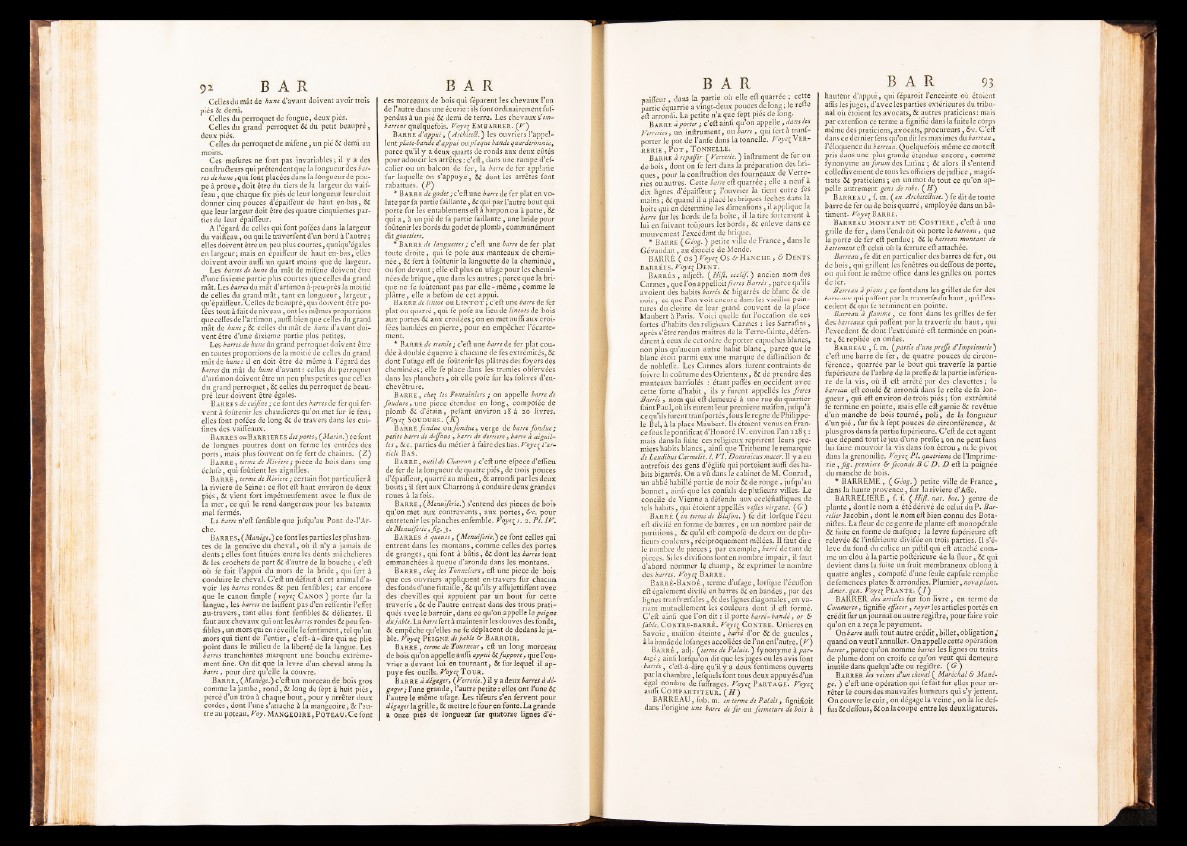
Celles du mât de hune d’avant doivent avoir trois
pies & demi.
Celles du perroquet de fougue, deux pies.
Celles du grand perroquet & du petit beaupré,
deux pies.
Celles dit perroquet de mifene, un pié & demi au
moins.
Ces mefures ne font pas invariables ; il y a des
conftrufteurs qui prétendent que la longueur des bar-
res de hune, qui font placées dans la longueur de poupe
à proue, doit être du tiers de la largeur du vail-
feau, que chaque fix piés de leur longueur leur doit
donner cinq pouces d’épaifl'eur de haut en-bas, &
que leur largeur doit être des quatre cinquièmes parties
de leur épaiffeur.
A l’égard de celles qui font pofées dans la largeur
du vaifleau, ou qui le traverfent d’un bord à l’autre ;
elles doivent être un peu plus courtes, quoiqu’égales
en largeur; mais en épaiffeur de haut en-bas, elles
doivent avoir aufli un quart moins que de largeur.
Les barres de hune du mât de mifene doivent être
d’une fixieme partie plus courtes que celles du grand
mât. Les barres du mât d’artimon à-peu-près la moitié
de celles du grand mât, tant en longueur, largeur,
qu’épaiffeur. Celles de beaupré, qui doivent être potées
tout-à-fait de niveau, ont les mêmes proportions
que celles de l’artimon, aufli-bien que celles du grand
mât de hune; & celles du mât de hune d’avant doivent
être d’une dixième partie plus petites.
Les barres de hune du grand perroquet doivent être
en toutes proportions de la moitié de celles du grand
mât de hune: il en doit être de même à l’égard des
barres du mât de hune d’avant : celles du perroquet
d’artimon doivent être un peu plus petites que celles
du grand perroquet, & celles du perroquet de beaupré
leur doivent être égales. Barres de cuifine; ce font des barres de fer qui fervent
à foûtenir les chaudières qu’on met fur le feu ;
elles font pofées de long & de travers dans les cui-
fines des vaiffeaux. Barres ou Barrières des ports, (Marin.) ce font
de longues poutres dont on ferme les entrées des
ports, mais plus fouvent on fe fert de chaînes. (Z ) Barre, terme de Riviere; pièce de bois dans une
éclufe, qui foutient les aiguilles. Barre , terme de Riviere ; certain flot particulier à
la riviere de Seine : ce flot eft haut environ de deux
piés, & vient fort impétueufement avec le flux de
la mer, ce qui le rend dangereux pour les bateaux
mal fermés.
La barre n’efl fenfible que jufqu’au Pont-de-l’Ar-
che. Barres, (Manège.') ce font les parties les plus hautes
de la gencive du cheval, oîi il n’y a jamais de
dents ; elles font fituées entre les dents mâchelieres
& les crochets de part & d’autre de la bouche ; c’eft
où fe fait l’appui du mors de la bride, qui fert à
conduire le cheval. C’eff un défaut à cet animal d’avoir
les barres rondes & peu fenfibles ; car encore
que le canon fimple (voye% Canon) porte fur la
langue, les barres ne laiffent pas d’en reffentir l’effet
au-trayers, tant elles font fenfibles & délicates. Il
faut aux chevaux qui ont les barres rondes &peu fenfibles
, un mors qui en réveille le fentiment, tel qu’un
mors qui tient de l’entier, c’eft-à-dire qui ne plie
point dans le milieu de la liberté de la langue. Les
barres tranchantes marquent une bouche extrêmement
fine. On dit que la levre d’un cheval arme la
barre, pour dire qu’elle la couvre. Barre, (Manège.) c’eft un morceau de bois gros
comme la jambe, rond, & long de fept à huit piés,
percé d’un trou à chaque bout, pour y arrêter deux
cordes, dont l’une s’attache à la mangeoire , & l’autre
au poteau. Voy. Mangeoire, Poteau. Ce font
ces morceaux de bois qui féparent les chevaux l’un
de l’autre dans une écurie : ils font ordinairement fuf-
pendus à un pié & demi de terre. Les chevaux s'em-
barrent quelquefois, Voye^ EmBARRER, (V )
Barre d'appui, (Architecl. ) les ouvriers l’appellent
plate-bande d'appui ou plaque bande quarderonnèe,
parce qu’il y a deux quarts de ronds aux deux côtés
pour adoucir les arrêtes : c’eft, dans une rampe d’ef-
çalier ou un balcon de fer, la barre de fer applatie
fur laquelle on s’appuye, & dont les arrêtes font
rabattues. (P)
* Barre de godet ; c’efl une barre de fer plat en volute
par fa partie faillante, & qui par l’autre bout qui
porte fur les entablemens eft à harpon ou à patte, &
qui a , à un pié de fa partie faillante, une bride pour
foutertir les bords du godet de plomb, communément
dit gouttière.
* Barre de languettes ; c’eft une barre de fer plat
toute droite, qui fe pofe aux manteaux de cheminée
, & fert à foûtenir la languette de la cheminée,
ou fon devant ; elle eft plus en ufage pour les cheminées
de brique, que dans les autres ; parce que la briqué
ne fe foûtenant pas par elle - même, comme le
plâtre, elle a befoin de cet appui.
Barre de lintot ou L in to t ; c’eft une barre de fer
plat ou quarré, qui fe pofe au lieu de lintots de bois
aux portes & aux croifées ; on en met aufli aux croi-
fées bandées en pierre, pour en empêcher l’écartement.
* Barre de tremie ; c’eft une barre de fer plat coudée
à double équerre à chacune de fes extrémités, &
dont l’ufage eft de foûtenir les plâtres des foyers des
cheminées ; elle fe place dans les tremies obfervées
dans les planchers, où elle pofe fur les folives d’enchevêtrure.
Barre , che^ les Fontainiers ; on appelle barre de
foudure, une piece étendue en long, compofée de
plomb & d’étain, pefant environ 18 à 20 livres,
yoye{ Soudure. (K)
Barre fendue oufondue, verge de barre fondue ;
petite barre de deffous , barre de derrière , barre à aiguilles
, &c. parties du métier à faire des bas. Voye^ l'article
Bas.
Barre, outil de Charron ; c’eft une efpece d’eflïeu
de fer de la longueur de quatre piés, de trois pouces
d’épaiffeur, quarré au milieu, & arrondi par les deux
bouts ; il fert aux Charrons à conduire deux grandes
roues à la fois.
Barre, (Menuiferie.) s’entend des pièces de bois
qu’on met aux contrevents, aux portes, &c. pour
entretenir les planches enfemble. Voye^i. 2. PI. IV.
de Menuiferie , fig. J .
Barres à queues, (Menuiferie.) ce font celles qui
entrent dans les montans, comme celles des portes
de granges, qui font à bâtis, & dont les barres font
emmanchées à queue d’aronde dans les montans.
Barre , che{ les Tonneliers, eft une piece de bois
que ces ouvriers appliquent en-travers fur chacun
des fonds d’une futaille, & qu’ils y affujettiffent avec
des chevilles qui appuient par un bout fur cette
traverfe, & de l’autre entrent dans des trous pratiqués
avec le barroir, dans ce qu’on appelle le peigne
du jable. La barre fert à maintenir les douves des fonds,
& empêche qu’elles ne fe déplacent de dedans le jable.
Voye^ Peigne de jable & Barroir.
Barre , terme de Tourneur, eft un long morceau
de bois qit’on appelle aufli appui & fupport, que l’ouvrier
a devant lui en tournant, & fur lequel il appuyé
fes outils. Voyei T our. Barre à dégager, (Vincric.) il y a deux barres à dégager;
l’une grande, l’autre petite : elles ont l’une &c
l’autre le même ufage. Les tifeurs s’en fervent pour
dégager la grille, & mettre le four en fonte. La grande
a onze piés de longueur fur quatorze lignes d’épaiffeur,
dans la partie où elle eft quarrée ; cette
partie équarrie a vingt-deux pouces de long ; le relte
eft arrondi. La petite n’a que fept pies de long. Barre à porter; c’eft ainfi qu’on appelle, dans les
Verreries, un infiniment, ou barre, qui fert à transporter
le pot de l’anfe dans la tonnelle. Voye^ Verrerie
Barr, eP oà tre ,p aTjfocrn (n Veelrlreer.ie. ) inftrument de fer ou
de bois, dont on fe fert dans la préparation des briques,
pour la conftruétion des fourneaux de Verreries
ou autres. Cette barre eft quarrée ; elle a neuf à
dix lignes d’épaiffeur; l’ouvrier la tient entre fes
mains ; & quand il a placé les briques feches dans la
boîte qui en détermine les dimenfions, il applique la
barre fiir les bords de la boîte, il la tire fortement à
lui en fuivant toûjours les bords, & enlcve dans ce
mouvement l’excédant de brique. * Barre ( Géog. ) petite ville de France, dans lé
Gévaudan, au diocèfe de Mende.
BARRÉ ( o s ) Voye{ Os & Hanche , & Dents’
barrées. Voyc[ Dent.
Barrés , adjett. ( Hijl. eccléf. ) ancien nom des
Carmes, que l’on appelioit frères Barrés, parce qu’ils
avoient des habits barrés & bigarrés de blanc éc de
noir, ce que l’on voit encore dans les vieilles peintures
du cloître de leur grand couvent de la place
Maubert à Paris. Voici quelle fut l’occafion de ces
fortes d’habits des religieux Carmes : les Sarrafins,
après s’être rendus maîtres de la Terre-fainte, défendirent
à ceux de cet ordre déporter capuches blancs,
non plus qu’aucun autre habit blanc, parce que le
blanc étoit parmi eux une marque de diftinûion &
de nobleffe. Les Carmes alors furent contraints de
fuivre la coûtume des Orientaux, & de prendre des
manteaux barriolés : étant paffés en.occident avec
cette forte d’habit, ils y furent appellés les freres
Barrés , nom qui eft demeuré à une rue du quartier
faint Paul, où ils eurent leur première maifon, jufqu’à
ce qu’ils furent tranfportés, fous le régné de Philippe-
le-Bel, à la place Maubert. Ils étoient venus en France
fous le pontificat d’Honoré IV. environ l’an 1285:
mais dans la fuite ces religieux reprirent leurs premiers
habits blancs, ainfi que Tritheme le remarque
de Laudibus Carmelit. I. V I. Dominicus macer. Il y a eu
autrefois des gens d’églife qui portoient aufli des habits
bigarrés. On a vû dans le cabinet de M. Conrad,
un abbé habillé partie de noir & de rouge, jufqu’au
bonnet, ainfi que les confuls de plufieurs villes. Le
concile de Vienne a défendu aux eccléfiaftiques de
tels habits, qui étoient appellés vejles virgatee. (G ) Barré (en terme de Blafon. ) fe dit lorfque l’écu
eft divifé en forme de barres, en un nombre pair de
partitions, & qu’il eft compofé de deux ou ae plufieurs
couleurs, réciproquement mêlées. Il faut dire
le nombre de pièces ; par exemple, barré de tant de
pièces. Si les divifions font en nombre impair, il faut
d’abord nommer le champ, & exprimer le nombre
des barres. Voye£ Barre. Barré-Bandé, terme d’ufage, lorfque l’écuffon
eft également divifé en barres & en bandes, par des
lignes tranfverfales, & des lignes diagonales, en variant
mutuellement les couleurs dont il eft formé.
C ’eft ainfi que l’on dit : il porte barré- bandé, or &
fable. Contre-BARRÉ. Voye[ Contre. Urtieresen
Savoie, maifon éteinte , bâfré d’or & d e gueules, à la bande de lofanges accollées de l’un enl’autre. (V ) Barré , adj. (terme de Palais. ) fynonyme à partagé
; ainfi lorsqu’on dit que les juges ou les avis font
' barrés, c’eft-à-dire qu’il y a deux fentimens ouverts
par la chambre, lefquels l'ont tous deux appuyés d’un
égal nombre de fuffrages. Voye{ Partage. Voyeç
aufli C oM PA R T IT E U R . (H )
BARREAU, fub. m. en terme de Palais, fignifioit
• dans l’origine une barre de fer ou fermeture de bois à
hauteur d’appui, qui féparoit l’enceinte où étoient
aflis les juges, d’avec les parties extérieures du tribunal
où étoient les avocats, & autres praticiens : mais
par extenfion ce terme a lignifié dans la fuite le corps
même des praticiens, avocats, procureurs, &c. C ’eft
dans ce dernier fens qu’on dit les maximes du barreau,
l’éloquence du barreau. Quelquefois même ce mot eft
pris dans une plus grande étendue encore, comme
iÿnonyme au forum des Latins ; & alors il s’entend
collettivement de tous les officiers de ju ftice, magif-
trats & praticiens ; en un mot de tout ce qu’on appelle
autrement gens de robe. ( H ) Barreau , f. m. (en Architecture. ) fe dit de toute
barre de fer ou de bois quarré, employée dans un bâtiment.
Voye{ Barre.
Barreau montant de Costiere, c’eft à une
grille de fer, dans l’endroit où porte le barreau, que
la porte de fer eft pendue ; & le barreau montant de
battement eft celui où la ferrure eft attachée.
Barreau , fe dit en particulier des barres de fer, ou
de bois, qui grillent les fenêtres ou deffous de porte*
ou qui font le même office dans les grilles ou portes
de fer.
Barreau à pique ; ce font dans les grilles de fer des
barreaux qui paffent par la traverfe du haut, qui l’ex-
cedent êc qui fe terminent en pointe.
Barreau à flamme, ce font dans les grilles de fer
des bancaux qui paffent par la traverfe du haut, qui
l’excedent & dont l’extrémité eft terminée en pointe
, & repliée en ondes. Barreau , f. m. (partie d'unepreffe d?Imprimerie)
c’eft une barre de fer, de quatre pouces de circonférence
, quarrée par le bout qui traverfe la partie
fupérieure de l’arbre de la preffe & la partie inférieure
de la v is , où il eft arrêté par des clavettes ; le
barreau eft coudé & arrondi dans le refte de fa longueur
, qui eft environ dé trois piés ; fon extrémité
fe termine en pointe, mais elle eft garnie & revêtue
d’un manche de bois tourné, poli, de la longueur
d’un pié , fur fix à fept pouces de circonférence, &
plus gros dans fa partie fupérieure. C ’eft de cet agent
que dépend tout le jeu d’une preffe ; on ne peut fans
lui faire mouvoir la vis dans fon écrou, ni le pivot
dans la grenouille. Vyye1 PI. quatrième de l’Imprimerie
, fig. première & fécondé B C D . D eft la poignée
du manche de bois.
* BARREME, ( Géog. ) petite ville de France,
dans la haute provence, fur la riviere d’Affe.
BARRELIERE, f. f. Çffi/l. nat. bot.) genre de
plante, dont le nom a été dérivé de celui du P. Bar-
relier Jacobin, dont le nom eft bien connu des Bota-
niftes. La fleur de ce genre de plante eft monopétale
& faite en forme de mafque ; la levre fupérieure eft
relevée & l’inférieure divifée en trois parties. Il s’élève
du fond du calice un piftil qui eft attaché comme
un clou à la partie poftérieure de la fleur, & qui
devient dans la fuite un fruit membraneux oblong à
quatre angles, compofé d’une feule capfule remplie
dAemfeemr.genence. sV polyaet^e sP &LA aNrrToEn. d(ie/s). Plumier, novap lant.
BARRER des articles fur fon livre , en terme de
Commerce, lignifie effacer, rayer les articles portés en
crédit fur un journal ou autre regiftre, pour faire voir
qu’on en a reçu le payement.
On barre aufli tout autre crédit, billet, obligation
quand on veut l’annuller. On appelle cette opération
barrer, parce qu’on nomme barres les lignes ou traits
de plume dont on croife ce qu’on veut qui demeure
inutile dans quelqu’afte ou regiftre. (G )
BARRER les veines d’un cheval ( Maréchal & Manège.
) c’eft une opération qui fe fait fur elles pour arrêter
le cours des mauvaifes humeurs qui s’y jettent.
On couvre le cuir, on dégage la veine, on la lie def-
fus & deffous, & on la coupe entre les deux ligatures.