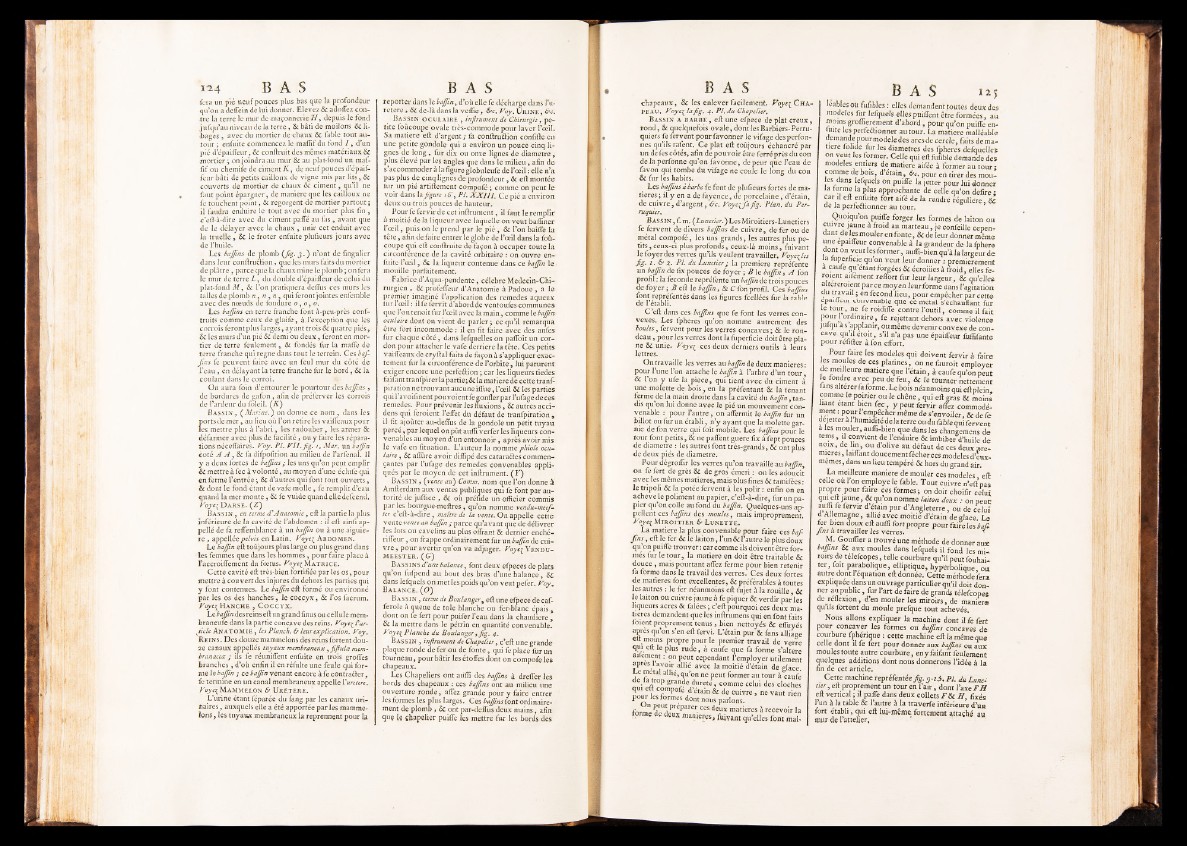
ï ^ 4 B A S
<cra un pié neuf pouces plus bas que la profondeur
qu’on a deffein de lui donner. Elevez 8c adoffez contre
la terre le mur de maçonnerie IL, depuis le fond
jufqu’au niveau de la terre, & bâti de moilons 8c limages
, avec du mortier de -chaux 8c fable tout autour
; enfuite commencez le malîif du fond I , d’un
pié d’épaiffeur, 8c conftruit des mêmes matériaux 8c
mortier ; on-joindraau mur & au plat-fond un maf-
fif ou chemife de ciment K , de neuf pouces d’épaiffeur
bâti de petits cailloux de vigne mis par lits, &
couverts de mortier de chaux ôc ciment, qu’il ne
faut point épargner, de maniéré que les cailloux ne
le touchent point, & regorgent de mortier partout ;
il faudra enduire le tout avec du mortier plus fin ,
c ’eft-à-dire avec du ciment paffé au fas, avant que
de le délayer avec la chaux , unir cet enduit avec
la truelle, 8c le froter enfuite plufieurs jours avec
de l’huile.
Les bajjins de plomb {fig. 3 . ) n’ont de fingulier
dans leur conftruôion, que les murs faits du mortier
de plâtre , parce que la chaux mine le plomb ; on fera
le mur de terre L , du double d’épailfeur de celui du
plat-fond M , & l’on pratiquera deffus ces murs les
talles de plomb n , n , n , qui feront jointes enfemble
avec des noeuds de foudure 0 ,0 , 0.
Les bajjins en terre franche font à-peu-près conf-
truits comme ceux de glaife, à l’exception que les
corrois feront plus larges, ayant trois 8c quatre piés,
8c les murs d’un pié & demi ou deux, feront en mortier
de terre feulement, & fondés fur la maffe de
terre franche qui régné dans tout le terrein. Ces baf-
Jins fe peuvent faire avec un feul mur du côté de
l’eau , en délayant la terre franche fur le bord, & la
coulant dans le corroi..
On aura foin d’entourer le pourtour des bajjins ,
de bordures de gafon , afin de préferver les corrois
de l’ardeur du foleil. (K)
Bassin , (Marine.) on donne ce nom , dans les
ports de mer, au lieu où l’on retire les vaiffeaux pour
les mettre plus à l’abri, les radouber, les armer &
défarmer avec plus de facilité , ou y faire les réparations
néceffaires. Voy. PL. VII. fig. 1. Mar. un baffin
coté A A , 8c fa difpofition au milieu de l’arfenaî. Il
y a deux fortes de bajjins ; les uns qu’on peut emplir
& mettre à fec à volonté, au moyen d’une éclufe qui
en ferme l’entrée ; & d’autres qui font tout ouverts,
& dont le fond étant de vafe m olle, fe remplit d’eau
quand la mer monte, 8c fe vuide quand elledefcend.
Voye^ D arse. (Z ) Bassin , en terme d'Anatomie, eft la partie la plus
inférieure de la cavité de l’abdomen : il eft ainfi ap-
pellé de fa relfemblance à un bajjin ou à une aiguière
, appellée pelvis en Latin. Voye^ Abdomen.
Le baffin eft toujours plus large ou plus grand dans
les femmes que dans les hommes, pour faire place à
Faccroiffement du foetus. Voye^ Matrice.
Cette cavité eft très-bien fortifiée par les os, pour
mettre à cou vert des injures du dehors les parties qui
y font contenues. Le bajjin eft formé ou environné
par les os des hanches, le coccyx, & l’os facrum.
Voye%_Hanche , Coccyx.
Le bajjin des reins eft un grand finus ou cellule mem-
braneufe dans la partie concave des reins. Voye^ Varticle
AnATOMIE , les Planch. & leur explication. Voy. Reins. Des douze mammelons des reins fortent douze
canaux appellés tuyaux membraneux, JiJlulce mem-
branacea ; ils fe réunifient enfuite en trois groffes
branches , d’où enfin il en réfulte une feule qui forme
le bajjin ; ce bajjin venant encore à fe contra&er,
fe termine en un canal membraneux appelle l'uretere.
Voyei MammeLON & URETERE. '
L’urine étant féparée du fang par les canaux urinaires
, auxquels elle a été apportée par les mammelons
, les tuyaux membraneux la reprennent pour Ja
B A S
reporter dans le bajjin, d’où elle fe décharge dans l’ib
retere, 8c de-là dans la vefîie, & c. Voy. Urine, &c:
Bassin oculaire , inßrumentde Chirurgie, petite
foûcoupe ovale très-commode pour laver l’oeil.
Sa matière eft d’argent; fa conftru&ion confifte en
une petite gondole qui a environ un pouce cinq lignes
de long , fur dix ou onze lignes de diamètre ,
plus élevé par les angles que dans le milieu, afin de
s’accommoder à la figure globuleufe de l’oeil : elle n’a
pas plus de cinq lignes de profondeur, & eft montée
lùr un pie artiftement compofé ; comme on peut le
voir dans figure 1 (T, PI. X X I I I . Ce pié a environ
deux ou trois pouces de hauteur.
Pour fe fervir de cet infiniment, il faut le remplir
à moitié de la liqueur avec laquelle on veut bafliner
l’oe il, puis on le prend par le pié , 8c l’on baiffe la
tête, afin de faire entrer le globe de l’oeil dans la foûcoupe
qui eft conftruite de façon à occuper toute la
circonférence de la cavité orbitaire : on ouvre en-
fuite l’oeil , 8c la liqueur contenue dans ce bajjin le-
mouille parfaitement.
Fabrice d’Aqua-pendente, célébré Medecin-Chi-
rurgien , 8c profefleur d’Anatomie à Padoue , a le
premier imaginé l’application des remedes aqueux
fur l’oeil : il fe fervit d’abord de ventoufes communes
que l’on tenoit fur l’oeil avec la main, comme le bajjin
oculaire dont on vient de parler ; ce qu’il remarqua
être fort incommode : il en fit faire avec des anfes
fur chaque cô té , dans lefquelles on pafloit un cordon
pour attacher le vafe derrière la tête. Ces petits
vaiffeaux de cryftal faits de façon à s’appliquer exactement
fur la circonférence de l’orbite, lui parurent
exiger encore une perfeâion ; car les liqueurs tiedes
faifant tranfpirer la partie; 8c la matière de cette tranf-
piration ne trouvant aucune ifliie, l’oèil 8c les parties
quil’avoifinent pou voient fe gonfler par l’ufage de ces
remedes. Pour prévenir les fluxions, 8c autres acci-
dens qui feroient l’effet du défaut de tranfpiration ,
il fit ajouter au-deflus de la gondole un petit tuyau
percé, par lequel on pût aufli verfer les liqueurs convenables
au moyen d’un entonnoir, après avoir mis
le vafe en fituation. L’auteur la nomme phiole oculaire
, 8c affûre avoir diflïpé des catara&es commençantes
par l’ufage des remedes convenables appliqués
par le moyen de cet infiniment. (T)
Bassin , ( vente au) Comm. nom que l’on donne à
Amfterdam aux ventes publiques qui fe font par autorité
de juftice , 8c où prénde un officier commis
par les bourgue-meftres, qu’on nomme vendu-meef-
ter c’eft-à-dire, maître de la vente. On appelle cette
vente vente au bajjin ; parce qu’avant que de délivrer
les lots ou cavelins au plus offrant 8c dernier enché-
rifleur, on frappe ordinairement fur un baßin de cuivre
, pour avertir qu’on va adjuger. Voye1 Vendu-
meester. (£ )
Bassins d’une balance, font deux efpeces de plats
qu’on fufpend au bout des bras d’une balance, 80
dans lefquels on met les poids qu’on veut pefer. Vov,
Balance. (O) 1 r y
Bassin , terme de Boulanger, eft une efpece de caf-
ferole à queue de tôle blanche ou fer-blanc épais ,
dont on fe fert pour puifer l’eau dans la chaudière ,
8c la mettre dans le pétrin en quantité convenable.
V~>ye{ Planche du Boulanger , fig. 4.
Bassin , inflrument de Chapelier, c’eft une grande
plaque ronde de fer ou de fonte, qui fe place fur un
fourneau, pour bâtir les étoffes dont on compofe les
chapeaux. .
Les Chapeliers ont aufli des bajjins à dreffer les
bords des chapeaux : ces bajjins ont au milieu une
ouverture ronde, affez grande pour y faire entrer
les formes les plus larges. Ces bajjins font ordinairement
de plomb, 8c ont par-deflus deux mains, afin
que le chapelier puiffe les mettre fur les bords des
B A S
chapeaux, 8c les enlever facilement. Voyt^ C hapeau.
Voye£ la fig. 4. Pl. du Chapelier.
Bassin a barbe , eft une efpece de plat creux,
rond, & quelquefois ovale, dont les Barbiers- Perruquiers
fe fervent pour favonner le vifage des perfon-
nes qu’ils rafent. Ce plat eft toûjours échancré par
un de fes côtés, afin de pouvoir être ferré près du cou
delaperfonne qu’on favonne, de peur que l’eau de
favon qui tombe du vifage ne coule le long du cou
8c fur les habits.
Les bajjins à barbe fe font de plufieurs fortes de matières
; il y en a de fayence, de porcelaine, d’étain,
de cuivre, d’argent, &c, Voyejja fig,. Plan, du Perruquier.
Bassin , f. m. {Lunetier.) Les Miroitiers-Lunetiers
fe fervent de divers bajjins de cuivre, de fer ou de
métal compofé, les uns grands, les autres plus petits
, ceux-ci plus profonds, ceux-là moins, fuivant
le foyer des verres qu’ils veulent travailler. Voyelles
fig. 2. & z. Pl. du Lunetier ; la première repréfente
un bajjin de fix pouces de foyer ; B le baffin, A fon
profil : la fécondé repréfente un bajjin de trois pouces
de foyer ; B eft le bajjin, & C fon profil. Ces bajjins
font repréfentés dans les figures fcellées fur la table
de l’établi.
C eft dans ces bajjins que fe font les verres convexes.
Les fpheres qu’on nomme autrement des
boules, fervent pour les verres concaves ; & le rondeau
, pour les verres dont la fuperficie doit être plane
8c unie. Voye^ ces deux derniers outils à leurs
lettres.
pour I une 1 on attache le baffin à l’arbre d’un tour,
8c l’on y ufe la piece, qui tient avec du ciment à
une molette de bois, en la préfentant 8c la tenant
ferme de la main droite dans la cavité du bajjin, tandis
qu on lui donne avec le pié un mouvement convenable
: pour l’autre, on affermit le baffin fur un
billot ou fur un établi, n’y ayant que la molette garnie
de fon verre qui foit mobile. Les bajjins pour le
tour font petits, 8c ne paffent guere fix à fept pouces
de diamètre : les autres font très-grands, 8c ont plus
de deux piés de diamètre.
Pour dégroflîr les verres qu’on travaille au baffin,
on fe fert de grès 8c de gros émeri : on les adoucit
avec les mêmes matières, mais plus fines 8c tamifées :
le tripoli 8c la potée fervent à les polir : enfin on en
achevé le poliment au papier, c’eft-à-dire, fur un papier
qu’on colle au fond du bajjin. Quelques-uns appellent
ces bajjins des moules, mais improprement.
Voye{ Miroitier 6* Lunette.
La matière la plus convenable pour faire ces baf-
fin s , eft le fer 8c le laiton, l’un 8c l’autre le plus doux
qu’on puiffe trouver : car comme ils doivent être formés
fur le tour, la matière en doit être traitable 8c
douce, mais pourtant affez ferme pour bien retenir
fa forme dans le travail des verres. Ces deux fortes
de matières font excellentes, 8c préférables à toutes
les autres : le fer néanmoins eft fujet à la rouille, 8c
le laiton ou cuivre jaune à fe piquer 8c verdir par les
liqueurs acres 8c falées ; c’eft pourquoi ces deux matières
demandent que les inftrumens qui en font faits
foient proprement tenus , bien nettoyés 8c effuyés
après qu’on s’en eft fervi. L’étain pur 8c fans alliage
elt moins propre pour le premier travail de verre
Ie plus rude, à caufe que fa forme s’altere
alternent : on peut cependant l’employer utilement
apres l avoir allié avec la moitié d’étain de glace,
j J16131 aIhé, qu’on ne peut former au tour à caufe
e a trop grande dureté, comme celui des cloches
qui e compofe d’étain 8c de cuivre , ne vaut rien
pour les formes dont nous parlons!
forme, !iwi Preparer. ceS tle«x matières à recevoir la
,, eux maniérés, fuiyam qu’elles font mal-
B A S 1 1 5
leables oü fuiibîes : elles demandent foùtés deux des
modèles fur lefquels elles puiffent être formées, au
moins groffieremélit d’aboid, pour qu’on puiffe en-*
uute les perfectionner autour. La matière malléable
demande pour modèle des arcs de cercle, faits de mattere
folide fur les diamètres des fpheres defquelles
on veut les former. Celle qui eft fufible demande des
modèles entiers de matière aifée à former au tour 2
comme de bois, d’étain, &c. poùr en tirer des moules
dans lefquels ôn puiffe la jetter pour lui donnet
la forme la plus approchante de celle qu’on defire ;
Car il eft enfuite fort âifé de la rendre régulière 8c
de la perfe&ionner au tour.
Quoiqu’fan puiffe forger les formes de laiton on
cuivre jaune à froid au marteau, je confeille cependant
de les mouler en fonte, & de leur donner même
une epaifleur convenable à la grandeur de la fphere
dont on veut les former, aufii-bien qu’à la largeur de
la luperficie qu’on veut leur donner : premièrement
à caufe qu’étant forgées 8c écroiües à froid, elles fe-
roient aifément reffort fur leur largeur, 8c qu’elles
altereroient par ce moyen leur forme dans l’agitation
, u r.^ va^ » en focond lieu, pour empêcher par cette
epaifleur cbnvenable que ce métal s’échauffant fur
le tour, ne fe roidiffe contre l’outil, comme il fait
pour l’ordinaire, fe rejettant dehors avec violence
julqu à s applanir, ou même devenir convexe de eon-
cave qu’il étoit, s’il n’a pas une épaiffeur fuffifante
pour refifter à fon effort.
de meilleure matière que l’étain, à caufe qu’on peut
le fondre avec peu de feu, 8c le tourner nettement
ians altérer fa forme. Le bois néanmoins qui eftplein,
comme le poirier ou le chêne, qui eft gras 8c moins
liant étant bien fec , y peut fervir affez commodé-
ment : pour 1 empecher même de s’envoiler, 8c de fe
dejetter à humidité delà terre ou du fable qui fervent
à les mouler, aufli-bien que dans les changemens de
tems, il convient de l’enduire 8c imbiber d’huile de
noix, de lin, ou d’olive au défaut de ces deux are»
mieres, laiffant doucement fécher ccs modèles d’eux-
memes, dans un lieu tempéré 8c hors du grand air.
La meilleure maniéré de mouler ces modèles eft
celle ou 1 on employé le fable. Tout cuivre frell pas
propre pour faire ces formes; on doit choifir celui
qui eft jaune, 8cqu’on nomme laiton doux : on peut
auffi fe fervir d’étain pur d’Angleterre, ou de celui
d Allemagne, allie avec moitié d’étain de glace. Le
fer bien doux eft aufli fort propre pour faire les bafi
fins à travailler les verres. *
M. Gouffier a tfouvé une méthode de donner aux
bajjins & aux moules dans lefquels il fond les miroirs
de télefeopes s telle courbure qu’il peut foithai-
ter, foit parabolique, elliptique, hyperbolique ou
autre dont l’équation eft donnée. Cette méthode fera
expliquée dans un ouvrage particulier qu’il doit donner
au public, fur l’art de faire de grands télefeopes
de ^réflexion, d’en mouler les miroirs, de manier©
qu’ils fortent du moule prefque tout achevés,
Nous allons expliquer la machine dont il fê fert
pour concaver les formes ou b a jjin s concaves de
courbure fphérique : cette machine eft la même que
celle dont il fe fert pour donner aux bajjins ou aux
moules toute autre courbure, en y foilânt feulement
quelques additions dont nous donnerons l’idée à la
fin de cet article.
Cette machine repréfentée fig. £-23. Pl. du Lunetier
, eft proprement un tour en l’air, dont l’axe F H
eft vertical ; il paffe dans deux collets F 8c H fixés
l’un à la table 8c l’autre à la traverfe inférieure d’un
fort établi, qui eft lui-même fortement attaché au
mur de l’attelier.