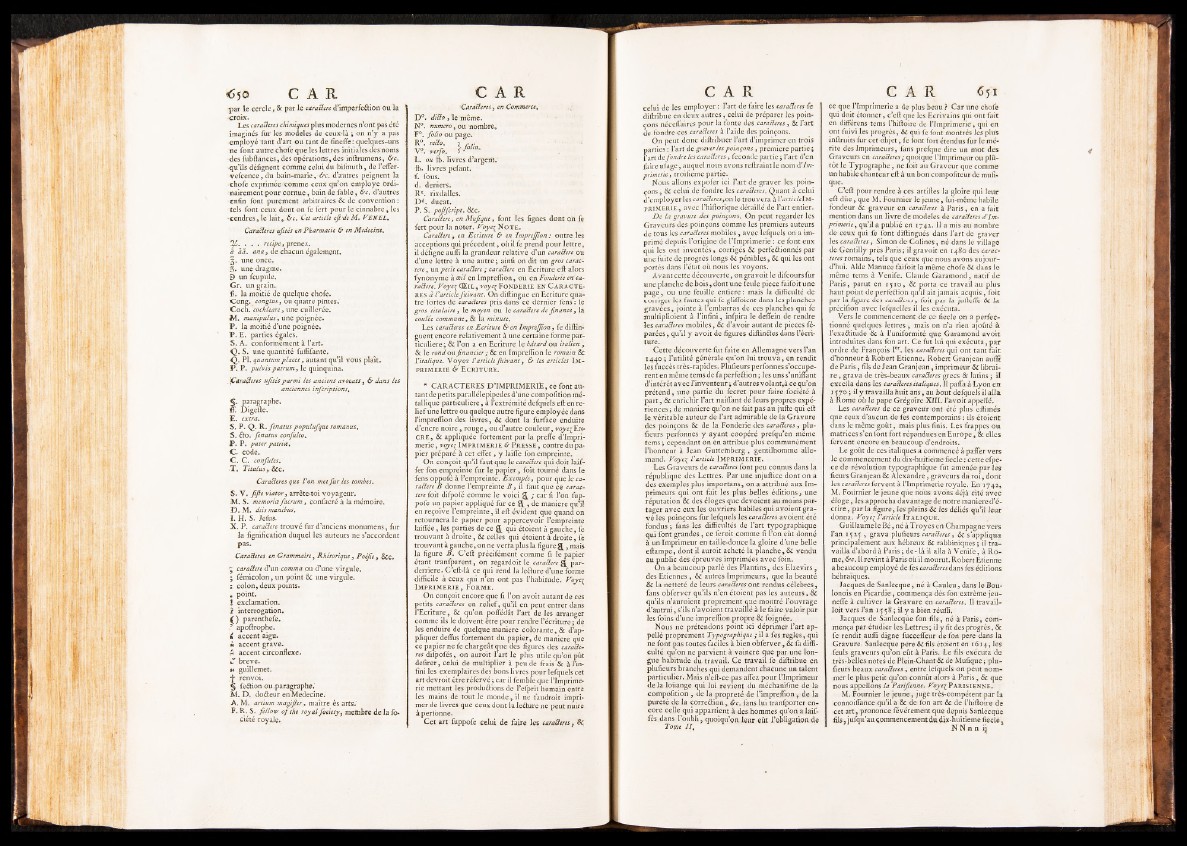
par le cercle, & par le caractère d’impcrfeôion ou îa
croix.
Les caractères chimiques plus modernes n’ont pas été
imaginés fur les modèles de ceux-là ; on n’y a pas
employé 'tant d’art ou tant de fïneffe: quelques-uns
ne font autre chofe que les lettres initiales des noms
des fübftances, des opérations, des iriftrumens, &c.
•qu’ils défignent comme celui du bifmuth, de l’effer-
•vefcence, du bain-marie, &c. d’autres peignent la
•chofe exprimée'comme ceux qu?on employé ordinairement
pour cornue-, bain de fable, &c. d’autres
enfin font purement arbitraires & de convention :
tels font ceux dont on fe fert pour le cinnabre, les
cendres, le lait, &c. 'Cet article eft de M. Ven EL.
Caractères ufitès en Pharmacie & en Medechte»
I f . . . . recipe, prenez.
d aa. ana, de chacun également.
une once. ,
g . une dragme.
B un fcupule.
Gr. un grain.
fi. la moitié de quelque chofe.
Cong. congius, ou quatre pintes.'
Coch. cochleare, une cuillerée.
M. manipulas, une poignée.
P . la moitié d’une poignée.
P . E. parties égales.
S. A. conformement à l’art.
Q . S. une quantité fuffifante.
Q . PI. quantum placet, autant qu’il vous plaît.
P. P. pulvis patrum, le quinquina.
. 'Caractères ufitès parmi les anciens avocats , & dans les
anciennes inferiptions.
§ . paragraphe,
ff. Digefte.
E. extra.
S. P. Q. R. fenatus populufque romanus.
S. âo . fenatus confulto,
P. P. pater patries.
C . code.
C . C. confules.
T . Titulus 3 &c.
Caractères que Von met fur les tombes.
S. V . fifte viator, arrête-toi voyageur.
M. S. memoria facrum , confacré à la mémoire.
D. M. diismanibus.
I. H. S. Jefus.
X . P. caractère trouvé fur d’anciens monumens, fur
la lignification duquel les auteurs ne s’accordent
pas.
Caractères en Grammaire, Rhétorique, PoèJie3 &c.
5 caractère d’un comma ou d’une virgule.
; fémicolon, un point & une virgule.
: colon, deux points.
. point,
î exclamation.
? interrogation,
parenthefe.
apoftrophe.
i accent aigu.
« accent grave.
£ accent circonflexe.
C breve.
»> guillemet.
•f renvoi* •
§ fe&ion ou .paragraphe.'
M. D. doéteur en Medecine.
A. M. artium magijler, maître ès arts.'
F. R. S. fellow o f the royal fociety3 membre de la fo-
.ciété royale.
* CARACTERES D ’IMPRIMERIE, ce font autant
de petits parallélépipèdes d’une compofition métallique
particulière, à l’extrémité defquels eft en relief
une lettre ou quelque autre figure employée dans
l’impreflion des livres, & dont la furface enduite
d’encre noire, rouge, ou d’autre couleur, voye£Encre,
& appliquée fortement par la preffe d’imprimerie
, voyei Imprimeri e & Presse , contre du papier
préparé à cet effet, y laiffe fon empreinte.
On conçoit qu’il faut que le caractère qui doit laif-
fer fon empreinte fur le papier, foit tourné dans le
fens oppofé à l’empreinte. Exemple, pour que le caractère
B donne l’empreinte B , il faut que ce caractère
foit difpofé comme le voici & > car fi l’on fup-
pofe un papier appliqué fur ce & , de maniéré qu’il
en reçoive l’empreinte, il eft évident que quand on
retournera le papier pour appercevoir l’empreinte
laiffée, les parties de ce $. qui étoient à gauche, fe
trouvant à droite, & celles qui étoient à droite, fe
trouvant à gauche, on ne verra plus la figure J , mais
la figure B. C’eft précifément comme fi le papier
étant tranfparent, on regardoit le caractère & par-
derriere. C ’eft-là ce qui rend la letture d’une forme
difficile à ceux qui n’en ont pas l’habitude. Voye^ Imprimerie, Forme.
On conçoit encore que fi l’on avoit autant de ces
petits caractères en relief, qu’il en peut entrer dans
l’Ecriture, & qu’on poffédât l’art de les arranger
comme ils le doivent être pour rendre l’écriture ; de
les enduire de quelque maniéré colorante, & d’appliquer
deflus fortement du papier, de maniéré que
ce papier ne fe chargeât que des figures des caractères
difpofés, on auroit l’art le plus utile qu’on put
defirer, celui de multiplier à peu de frais & à l’infini
les exemplaires des bons livres pour lefquels cet
art devroit être réfervé ; car il femble que l’Imprimerie
mettant les produétions de l’efprit humain entre
les mains de tout le monde, il ne faudroit imprimer
de livres que ceux dont la leéhire ne peut nuire
à perfonne.
Cet art fuppofe celui de faire les caractères, p ’
celiii de les employer ; l’art de faire les caractères fe 1
diftribue en deux autres, celui de préparer les poinçons
néceffaires pour la fonte des caractères, & l’art
de fondre ces caractères à l’aide des poinçons.
On peut donc diftribuer l’art d’imprimer en trois
parties: l’art de graver les poinçons, première partie;
l’art de fondre les caractères , fécondé partie ; l’art d’en
faire ulage, auquel nous avons reftraint le nom Imprimerie
, troifieme partie.
Nous allons expofer ici l’art de graver les poinçons
, & celui de fondre les caractères. Quant à celui
d’employer les caractères,on le trouvera à Imprimerie
, avec l’hiftorique détaillé de l’art entier.
De la gravure des poinçons. On peut regarder les
Graveurs des poinçons comme les premiers auteurs
de tous les caractères mobiles, avec lefquels ori a imprimé
depuis l’origine de l’Imprimerie : ce font eux
qui les ont inventés, corrigés & perfectionnés par
une fuite de progrès longs & pénibles, & qui les ont
portés dans l’état oîi nous les voyons.
Avant cette découverte, on gravoit le difeours fur
une planche de bois, dont une feule piece faifoit une
page, ou une feuille entière : mais la difficulté de
corriger les fautes qui fe glifloient dans les planches
gravées, jointe à l’embarras de ces planches qui fe
multiplioient à l’infini., infpira le deflein de rendre
les caractères mobiles, & d’avoir autant de pièces fé-
parées, qu’il y avoit de figures diftin&es dans l’écriture.
Cette découverte fut faite en Allemagne vers l’an
1440 ; l’utilité générale qu’on lui trouva, en rendit
les fuccès très-rapides. Plufieurs perfonnes s’occupèrent
en même tems de fa perfeâion ; les uns s’unifiant
d’intérêt avec l’inventeur ; d’autres volant,à ce qu’on
prétend, une partie du fecret pour faire fociété à
part, & enrichir l’art naiffant de leurs propres expériences
; de maniéré qu’on ne fait pas au jufte qui eft
le véritable auteur de l’art admirable de la Gravure
des poinçons & de la Fonderie des caractères, plufieurs
perfonnes y ayant coopéré prefqu’en même
tems ; cependant on en attribue plus communément
l’honneur à Jean Guttemberg, gentilhomme allemand.
Voye{ l'article IMPRIMERIE.
Les Graveurs de caractères font peu connus dans la
république des Lettres. Par une injuftice dont on a
des exemples plus importans, on a attribué aux Imprimeurs
qui ont fait les plus belles éditions, une
réputation & des éloges que dévoient au moins partager
avec eux les ouvriers habiles qui avoient gravé
les poinçons fur lefquels les caractères avoient été
fondus ; fans, les difficultés de l’art typographique
qui font grandes, ce feroit comme fi l’on eût donné
à un Imprimeur en taille-douce la gloire d’une belle
eftampe, dont il auroit acheté la planche, & vendu
au public dés épreuves imprimées avec foin.
On a beaucoup parlé des Plantins, des Elzevirs,
des Etiennes , & autres Imprimeurs, que la beauté
& la netteté de leurs caractères ont rendus célébrés,
fans obferver qu’ils n’en étoient pas les auteurs, &
qu’ils n’auroient proprement que montré l’ouvrage
d’autrui, s’ils n’avoient travaillé à le faire valoir par
les foins d’une impreflion propre & foignée.
Nous ne prétendons point ici déprimer l’art ap-
pellé proprement Typographique ; il a fes réglés, qui
ne font pas toutes faciles à bien obferver, & fa difficulté
qu’on ne parvient à vaincre que par une longue
habitude du travail. Ce travail fe diftribue en
plufieurs branches qui demandent chacune un talent
particulier. Mais n’eft-ce pas affez pour l’Imprimeur
de la loiiange qui lui revient du méchanifme de la
compofition , de la propreté de l’impreflion, de la
pureté de la correction, &c. fans lui tranfporter encore
celle qui appartient à des hommes qu’on a laif-
fés .dans l’oubli, quoiqu’on leur eût l’obligation de
Toyie II.
ce que l’Imprimerie a de plus beau ? Car une chofe
qui doit étonner, c’eft que les Ecrivains qui ont fait
en differens tems l’hiftoire de l’Imprimerie, qui en
ont fuivi les progrès, & qui fe font montrés les plus
inftruits fur cet objet, fe font fort étendus fur le mérite
des Imprimeurs, fans prefque dire un mot des
Graveurs en caractères; quoique l’Imprimeur ou plû-
tôt le Typographe, ne loit au Graveur que comme
un habile chanteur eft à un bon compofiteur de mufi-
que.
C ’eft pour rendre à ces artiftes la gloire qui leur
eft due, que M. Fournier le jeune, lui-même habile
fondeur &c graveur en caractères à Paris, en a fait
mention dans un livre de modèles de caractères d'Imprimerie
, qu’il a publié en 1741. 11 a mis au nombre
de ceux qui fe font diftingués dans l’art de graver
les caractères t Simon de Colines, né dans le village
de Gentilly près Paris; il gravoit en 1480 des caractères
romains, tels que ceux que nous avons aujourd’hui.
Aide Manuce faifoit la même chofe & dans le
même tems à Venife. Claude Garamond, natif de
Paris, parut en 1510, & porta ce travail au plus
haut point de perfection qu’il ait jamais acquis, foit
par la figure des caractères > foit par la jùfteife & la
précifion avec lefquelles il les exécuta.
Vers le commencement de ce fiecle oh a perfectionné
quelques lettres , mais on n’a rien ajoûté à
l’exaCtitude & à l’uniformité que Garamond avoit
introduites dans fon art. Ce fut lui qui exécuta, par
ordre de François Ier. les1 caractères qui ont tant fait
d’honneur à Robert Etienne. Robert Granjean auflï
de Paris, fils de Jean Granjean, imprimeur & libraire
, grava de très-beaux caractères grecs & latins ; il
excella dans les caractères italiques. Il pafla à Lyon en
1570 ; il y travailla huit ans, au bout defquels il alla
à Rome où le pape Grégoire XIII. l’avoit appellé.
Les caractères de ce graveur ont été plus eftimés
que ceux d’aucun de fes contemporains : ils étoient
dans le même goût, mais plus finis. Les frappes ou
matrices s’en font fort répandues en Europe, & elles
fervent encore en beaucoup d’endroits.
Le goût de ces italiques a commencé à pafler Vers
le commencement du dix-huitieme fiecle : cette efpe-
ce de révolution typographique fut amenée par les
fieurs Granjean & Alexandre, graveurs du roi, dont
les caractères fervent a l’Imprimerie royale. En 1742,,
M. Foiirnier le jeune que nous avons déjà Cité avec
éloge, les approcha davantage de notre maniéré d’écrire,
par la figure, les pleins & les déliés qu’il leur
donna. Voyèf l ’article It a l i q u e .
Guillaume le Bé, né à Troyes en Champagne vers
l’an 15ZJ , grava plufieurs caractères, & s’appliqua
principalement aux hébreux & rabbiniques ; il travailla
d’abord à Paris ; de - là il alla à Venife, à R ome,
&c. Il revint à Paris où il mourut. Robert Etienne
a beaucoup employé de fes caractères dans fes éditions
hébraïques.
Jacques de Sanlecque, né à Çauleu, dans le Bou-
lonois en Picardie, commença dès fon extrême jeu-
nefle à cultiver la Gravure en caractères. Il travaillâ
t vers l’an 15 58 ; il y a bien réufli.
Jacques de Sanlecque fon fils, né à Paris, commença
par étudier les Lettres ; il y fit des progrès, &
fe rendit aufli digne fuceefleur de fo;n pere dans la
Gravure. Sanlecque pere & fils- étoient en 161-4, les
feuls graveurs qu’on eût à Paris. Le fils exécuta de
très-belles notes de Plein-Chant & de Mufique ; plufieurs
beaux caractères, entre lefquels on peut nom-
I mer le plus .petit qu’on connût alors à Paris, & que
nous appelions la Parijienne. Voyeç Parisienne^
M. Fournier le jeune, juge très-compétent par la
connoiflance qu’il a & de ion art & de l’hiftoire de
cet art, prononce févérement que depuis Sanlecque
fils j j ufqu’au commencement du dix-huitieme fiecle,
N N n n ij