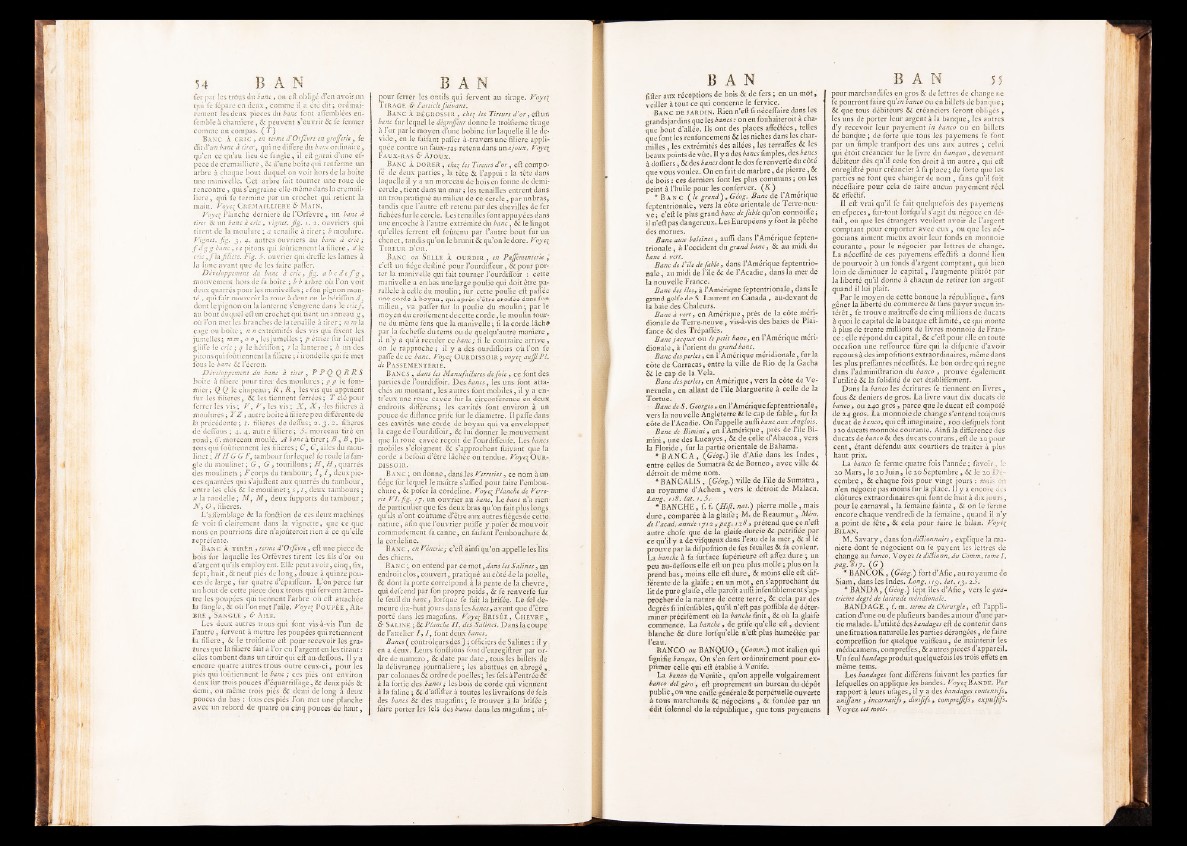
fer par les trous du banc, on eft obligé d’en avoir un
qui fe fépare en deux, comme il a été dit ; ordinairement
les deux pièces du banc font affemblées en-
femble à charnière, & peuvent s’ouvrir de fe fermer
comme un compas. ( T )
BàNC À c r ic , en terme d'Orfèvre en grojferit, fe
dit d’un banc à tirer, qui ne différé du banc ordinaire,
qu’en ce qu’au lieu de fangle, il eft garni d’une ef-
pece de cremailliere, & d’une boîte qui renferme un
arbre à chaque bout duquel on voit hors de la boîte
une manivelle. Cet arbre fait tourner une roue de
rencontre, qui s’engraine elle-meme dans la cremail-
liere, qui fe termine par un crochet qui retient la
main. Voye^ Cremailliere 6* Main.
Foyei Planche derniere de l’Orfevre, un banc à
tirer & un banc à cric, vignet. fig. 1 .2 . ouvriers qui
tirent de la moulure ; a tenaille à tirer ; b moulure.
Vignet. fig. 3 .4 . autres ouvriers au banc à cric ;
f dgg banc ,ee pitons qui foûtiennent la filiere, d le
cric, f la filiere. Fig. S. ouvrier qui dreffe les lames à
la lime avant que de les faire paffer.
Développement du banc à cric , fig. a b c de f g ,
mouvement hors de fa boîte ; b b arbre où l’on voit
deux quarrés pour les manivelles ; c fon pignon monté
, qui fait mouvoir la roue à dent ou le hériffon d ,
dont le pignon ou la lanterne s’engrene dans le cric f ,
au bout duquel eft un crochet qui tient un anneau g ,
où l’on met les branches de la tenaille à tirer ; mm la
cage ou boîte ; n n extrémités des vis qui fixent les
jumelles ; mm, 0 o , les jumelles ; p étrier fur lequel
gliffe le cric ; q le hériffon ; r la lanterne ; h un despitons
qui foûtiennent la filiere ; i irondelle qui fe met
fous le banc & l’écrou.
Développement du banc à tirer, P P Q Q R R S
boîte à filiere pour tirer des moulures ; p p le fom-
mier ; Q Q le chapeau ; R ,R , les vis qui appuient
fur les filières, & les tiennent ferrées ; T clé pour
ferrer les vis ; V 9 V , les vis ; X , X s -les filières à
moulures ; Y Z , autre boîte à filiere peu différente de
la précédente ; z. filières de deffus; 2. 3 .2 . filières
de deffous ; 4. 4. autre filiere; 5. morceau tiré en
rond; 6. morceau moulé. A banc à tirer; B , B , pitons
qui foûtiennent les filières; C , C, aîîes du moulinet
; H H G G F9 tambour fur lequel fe roule la fangle
du moulinet \G, G , tourillons ; H , H , quarrés
des moulinets ; Fcorps du tambour; ƒ, / , deux pièces
quarrées qui s’ajuftent aux quarrés du tambour,
entre les clés & le moulinet ; s , 1 , deux tambours ;
u la rondelle ; M, M , deux fupports du tambour ;
N , O , filières.
L’affemblage 8z la fon&ion de ces deux machines
fe voit fi clairement dans la vignette, que ce que
nous en pourrions dire n’ajoûteroit rien à ce qu’elle
représente.
Banc à tirer , terme d.'Orfèvre, eft une piece de
bois fur laquelle les Orfèvres tirent les fils d’or ou
d’argent qu’ils employent. Elle peut avoir, cinq, fix,
fept, huit, & neuf piés de long, douze à quinze pouces
de large, fur quatre d’épàiffeur. L’on perce fur
un bout de cette piece deux trous qui fervent émettre
les poupées qui tiennent l’arbre où eft attachée
la fangle, & où l’on met l’aîle. Voye7 Poupée , Arbre
,-Sa n g l e , & A i l e .
Les deux autres trous qui font vis-à-vis l’un de
l ’autre , fervent à mettre les poupées qui retiennent
la filiere, & le troifieme eft pour recevoir les gra-
îures que la filiere fait à l’or eu l’argent en les tirant :
elles tombent dans un tiroir qui eft au-deffous. Il y a
encore quatre autres trous outre ceux-ci, pour les
piés qui foûtiennent le banc ; ces piés ont environ
deux fur trois pouces d’équarriffage, & deux piés &
demi, ou même trois piés & demi de long à deux
pouces du bas : fous ces piés l’on met une planche
avec un rebord de quatre ou cinq pouces de haut,
pour ferrer les outils qui fervent au tirage. Voye^ Tirage & barticle fuivant. Banc À dégrossir , che^ les Tireurs d'or, efturi
banc fur lequel le dègrojfeur donne le troifieme tirage
à l’or par le moyen d’une bobine fur laquelle il le de-
vide , en le faifant paffer à-travers une filiere appliquée
contre un faux-ras retenu dans un ajoux. Voye£ Faux-ras 6* Àjoux.
Banc à dorer , chez les tireurs d'or, eft compo-
fé de deux parties, la tête & l’appui : la tête dans
laquelle il y a un morceau de bois en forme de demi-
cercle , tient dans un mur ; les tenailles entrent dans
un trou pratiqué au milieu de ce cercle, par un bras,
tandis que l’autre eft retenu par des chevilles de fer
fichées fur le cercle. Les tenailles font appuyées dans
une encoche à l’autre extrémité du banc, & le lingot
qu’elles ferrent eft foûtenu par l’autre bout fur un
chenet, tandis qu’on le brunit & qu’on le dore. Voyez T ireur d’or.
Banc ou Selle À ourdir , en Paffementerie
c’eft un fiége deftiné pour l’ourdiffeur, & pour porter
la manivelle qui fait tourner l’ourdiffoir : cette
manivelle a en bas une large poulie qui doit être parallèle
à celle du moulin ; fur cette poulie eft paffée
une corde à boyau, qui après s’être croifée dans fon
milieu, va paffer fur la poulie du moulin ; par le
moyen du croifement de cette corde, le moulin tourne
du même fens que la manivelle ; fi la corde lâcho
par la fecheffe du tems ou de quelqu’autre maniéré ,
il n’y a qu’à reculer ce banc; fi le contraire arrive ,
on le rapproche ; il y a des ourdifl'oirs où l’on fe
paffe de ce banc. Voye? Ourdissoir; voyez aufliPl.
de Passementerie.
Bancs , dans les Manufactures de foie, ce font des
parties de l’ourdiffoir. Des bancs, les uns font attachés
au montant, les autres font mobiles, il y a en-
tr’eux une roue cavée fur la circonférence en deux
endroits différens ; les cavités font environ à un
pouce de diftance prife fur le diamètre. Il paffe dans
ces cavités une corde de boyau qui va envelopper
la cage de l’ourdiffoir, & lui donner le mouvement
que la roue cavée reçoit de l’ourdiffeufe. Les bancs
mobiles s’éloignent & s’approchent fuivant que la
corde a befoin d’être lâchée ou tendue. Voyez Ourdissoir.
Banc ; on donne, dans les Verreries, ce nom à un
fiége fur lequel le maître s’affied pour faire l’embouchure
, & pofer la cordeline. Voyez Planche de Verrerie
VI. fig. ry. un ouvrier au banc. Le banc n’a rien-
de particulier qu’ils n’ont coqûutue mfees dd’eêutrxe baruaxs aquut’roens ffiaéigt epsl,udse lcoentgtes,
nature, afin que l’ouvrier puiffe y pofer & mouvoir
lcao mcomrdoedléimnee.n,t fa canne, en faifant l’embouchure &
desB cahniecn ,s ,e"n Vénerie; c’eft ainfi qu’on appelle les lits
Ban d ; on entend par ce mot, dans les Salines, un
endroit clos, couvert, pratiqué au côté de la poèlle,
& dont la porte correfpond à la pente.de la chevré,
qui defeend par fon propre poids, & fe renveffe fur
le feuil du banc , lorîque fe fait la brifée. Le fel demeure
dix-huit jours dans les bancs, avant que d’être
porté dans lesmagafins. Voye^Erisée, Chevre,
& Saline ; & Planche II. des'Salines. Dans la coupe
de l’attelier / , / , font deux bancs.
Bancs ( contrôleurs des ) officiers de Salines : il y
en a deux. Leurs fondions font d’enregiftrér par ordre
de numéro, & date par date, tous les billets de
la délivrance journalière; les abattues en abrégé ,,
par colonnes & ordre de poelles; les fels à l’entrée &
à la fortie des bancs ; les bois de corde qui viennent
à la falinc ; & d’affifter à toutes les livraifons de fels
des bancs & des magafins ; fe trouver à la brifée ;
faire porter les fels des bancs dans les magafins; affifter
aux réceptions de bois & de fers ; en un mot,
veiller à tout ce qui concerne le fervice.
Banc de jardin. Rien n’eft fi néceffaire dans les
grands jardins que les bancs: on en fouhaiteroit à chaque
bout d’allée. Ils ont des places affeûées, telles
que font les renfoncemens & les niches dans les charmilles
, les extrémités des allées, les terraffes & les
beaux points de vûe. Il y a des bancs fimples, des bancs
à doffiers, & des bancs dont le dos fe renverfe du côté
que vous voulez. On en fait de marbre, de pierre, &
de bois : ces derniers font les plus communs ; on les
peint à l’huile pour les conferver. (/C) f
* B AN C ( le grand) , Gèog. Banc de 1 Amérique
feptentrionale, vers la côte orientale de Terre-neuve
; c’eft le plus grand banc de fable qu’on connoiffe ;
il n’eft pas dangereux. Les Européens y font la pêche
des morues. , .
Banc aux baleines , auffi dans l'Amérique feptentrionale
, à l’occident du grand banc, & au midi du
banc à yert.
Banc de l'ile de fable, dans l’Amérique feptentrionale
, au midi de l’île & de l’Acadie, dans la mer de
la nouvelle France.
Banc des îles, à l’Amérique feptentrionale, dans le
grand golfe de S. Laurent en Canada, au-devant de
la baie des Chaleurs.
Banc à vert, en Amérique, près de la côte méridionale
de Terre-neuve, vis-à-vis des baies de Plai-
fance & des Trépaffés.
Banc jacquet ou le petit banc, en l’Amérique méridionale,
à l’orient du grand banc.
Banc des perles, en l’Amérique méridionale, fur la
côte de Carracas, entre la ville de Rio de la Gacha
de le cap de la Vêla.
Banc des perles, en Amérique, vers la côte de V enezuela
, en allant de l’île Marguerite à celle de la
Tortue.
Banc de S. Georges, en. l’Amérique feptentrionale,
vers la nouvelle Angleterre & le cap de fable , fur la
côte de l’Acadie. On l’appelle auffi banc aux Anglois.
Banc de Bimini , en l’Amérique, près de l'ile Bi-
mini, une des Lucayes i de de celle d’Abacoa, vers
la Floride, fur la partie orientale de Bahama.
* B A N C A , (Géog.') île d’Afie dans les Indes,
entre celles de Sumatra de de Bornéo, avec ville de
détroit de même nom.
* B ANCALIS , (Géog.') ville de l’île de Sumatra,
au royaume d’Achem, vers le détroit de Malaca.
Long. 118. lat. :
* BANCHE, f. f. (Hift. nat.) pierre m olle, mais
dure, comparée à la glaife ; M. de Reaumur, Mém.
de l ’acad. année ry 12 , pag. 128 , prétend que ce n’eft
autre chofe que de la glaife durcie & pétrifiée par
ce qu’il y a de vifqueux dans l’eau de la mer, & il lé
prouve par la difpofition de fes feuilles & fa couleur,
La banche à fa furfaee fupérieure eft affçz dure ; un
peu au-deffous elle eft un peu plus-molle ; plus on la
prend bas, moins elle eft dure, & moins elle eft différente
de la glaife ; en un mot, en s’approchant du
lit de pure glaife, elle paroît auffi infenfiblement s’approcher
de la nature de cette terre, & cela par des
degrés fi infenfibles, qu’il n’eft pas pofiïble de déterminer
précifément où la banche finit, & où la glaife
commence. La banche , de grife qu’elle eft, devient
blanche & düre lorfqu’elle n’eft plus hume&ée par
l’eait..
BANCO ou BANQUO r (Comm.) mot italien qui
lignifie banque. On s’en fert ordinairement pour exprimer
celle qui eft établie à Venife.
La banco de Vénife, qu’on appelle vulgairement
banco del gïro, eft proprement lin bureau du dépôt
public, oü une caiffe générale & perpétuelle ouverte
à tous marchands & négocians , & fondée par un
édit folennel de la république, que tous payemens
pour marchandifes en gros & de lettres de change ne
fe pourront faire qu’i/z banco ou en billets de banque ;
& que tous débiteurs & créanciers feront obligés ,
les uns de porter leur argent à la banque, les autres
d’y recevoir leur payement in banco ou en billets
de banque ; de forte que tous les payemens fe font
par un fimple tranfport des uns aux autres ; celui
qui étoit créancier fur le livre du banquo, devenant
débiteur dès qu’il cede fon droit à un autre, qui eft
enregiftré pour créancier à fa place ; de forte que les
parties ne font que changer de nom , fans qu’il foit
néceffaire pour cela de faire aucun payement réel
& effeélif.
II eft vrai qu’il fe fait quelquefois des payemens
en efpeces, fur-tout lorfqu’il s’agit du négoce en détail
, ou que les étrangers veulent avoir de l’argent
comptant pour emporter avec eu x, ou que les né-
gqeians aiment mietix avoir leur fonds en monnoie
courante, pour le négocier par lettres de change.
La néceffité de ces payemens effedifs a donné lieu
de pourvoir à un fonds d’argent comptant, qui bien
loin de diminuer le capital, l’augmente plutôt par
la liberté qu’il donne à chacun de retirer fon argent
quand il lui plaît.
Par le moyen de cette banque la république, fans
gêner la liberté du commerce & fans payer aucun intérêt
, fe trouve maîtreffe de cinq millions de ducats
à quoi le capital de la banque eft limité, ce qui monte
à plus de trente millions de livres monnoie de France
: elle répond du capital, & c’eft pour elle en toute
occafion une reffource fûre qui la difpenfe d’avoir
recours à des impofitions extraordinaires, même dans
les plus preffantes néceffités. Le bon ordre qui régné
dans l’adminiftration du banco , prouve également
l’utilité & la folidité de cet établiffement.
Dans la banco les‘ écritures fe tiennent en livres,
fous & deniers de gros. La livre vaut dix ducats dè
banco, ou 240 gros , parce que le ducat eft compofé
de 24 gros. La monnoie de change s’entend toûjours
ducat de banco, qui eft imaginaire, 160 defquels font
120 ducats monnoie courante. Ainfi la différence des.
ducats de banco & des ducats courans, eft de 20 pour
tent, étant défendu aux courtiers de traiter à plus
haut prix.
La banco fe ferme quatre fois l’année ; favoir, le
20 Mars, le 20 Juin, le 20 Septembre, & le 20 D écembre
, & chaque fois pour vingt jours : mais on
n’en négocie pas moins fur la place. Il y a encore des
.clôtures extraordinaires qui font de huit à dix jours,
.pour le carnaval, la femaine fainte j & on le ferme
encore chaque vendredi de la femaine, quand il n’y
a point de fête, & cela pour faire le bilan. Voye£ Bilan.
M. Savary, dans fon dictionnaire, explique là maniéré
dont fe négocient ou fe payent les lettres de
change au banco. Voyez le dictionn. du Comm. tome I.
r a a B E E jM . . . . .
* BANCOK, (Geog.) fort d’A fie, au royaume de
Siam, dans les Indes. Long, 119. lat. 13.2S.
* BANDA, (Géog.) fept îles d’Afie, vers le quatrième
degré de latitude méridionale.
BANDAGE , fj m. terme de Chirurgie, eft l’application
d’une ou de plufieurs bandes autour d’une partie
malade. L’utilité des bandages eft de contenir dans
une fituation naturelle les parties dérangées, de faire
compreffion fur quelque vaiffeau, de maintenir les
médicamens, compreffes, & autres pièces d’appareil.
Un feul bandage produit quelquefois les trois effets en
même tems.
Les bandages font différens fuivant les parties fur
lefquelles on applique les bandes. V?ye£ Bande. Par
rapport à leurs ufages j il y a des bandages contentifs,
unijfans , incarnatifs , divififs , comprejjîfs, expuljifs.
Voyez ces mots.