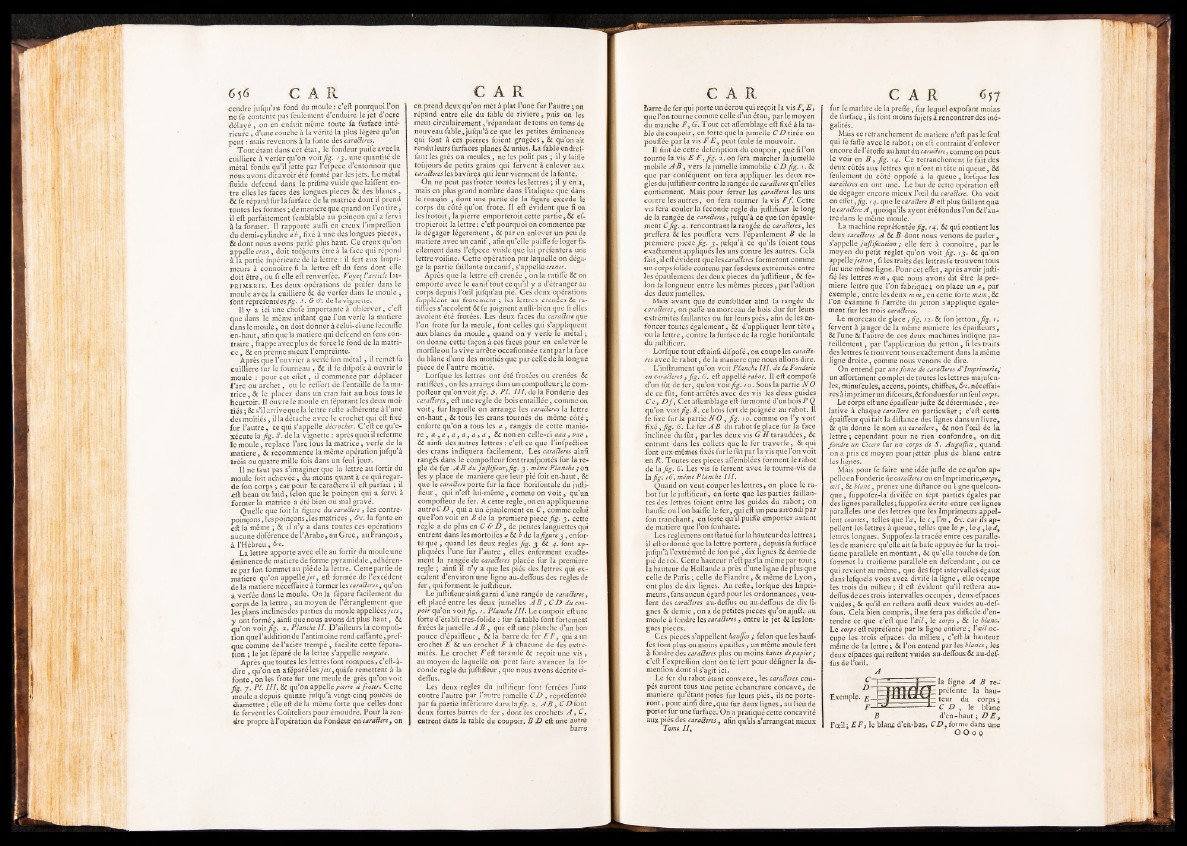
cendre jufqu’au fond du moule: c’eft pourquoi l’on
ne fe contente pas feulement d’enduire le jet d’ocre
dé la yé, on en enduit même toute fa furface intérieure
, d’une couche à la vérité la plus légère qu’on
.peut : mais revenons à la fonte des caractères.
Tout étant dans cet état, le fondeur puife avec la
cuilliere à verfer qu’on voit fig. 13. une quantité de
métal fondu qu’il jette par Pefpece d’entonnoir que
nous avons dit avoir été formé par les jets. Le métal
fluide defcend dans le prifme vuide que laiffent entre
elles les faces des longues pièces & des blancs ,
& fe-répand fur la furface de la matrice dont il prend
toutes les formes ; de maniéré que quand on l’en tire ,
il eft parfaitement femblable au poinçon qui a fervi
à la former. Il rapporte aulîi en creux l’impreffion
du demi-cylindre a b, fixé à «ne des longues pièces,
& dont nous avons parlé plus haut. Ce creux qu on
appelle cran, doit toujours être à la face qui répond
à la partie fupérieure de la lettre : il fert aux Imprimeurs
à connoître fi la lettre eft du fens dont elle
doit être, ou fi elle eft renverfée. Voye{ l'article Imprimerie.
Les deux opérations de puifer dans le
moule avec la cuilliere & de verfer dans le moule ,
font représentées^. S .& G . de la vignette.
Il y a ici une chofe importante à obferver, c’eft
que dans le même inftant que l'on verfe la matière
dans le moule, on doit donner à celui-ci une fecouffe
en-haut, afin que la matière qui defcend en fens contraire
, frappe avec plus de force le fond de la matric
e , & en prenne mieux l’empreinte.
Après que l’ouvrier a verfé fon m étal, il remet fa
cuilliere fur le fourneau , & il fe difpofe à ouvrir le
moule : pour cet effet, il commence par déplacer
l ’arc ou archet, ou le reffort de l’entaille de la matrice
, & le placer dans un cran fait au bois fous le
heurtoir. Il ouvre le moule en féparant les deux moitiés
; & s’il arrive que la lettre refte adhérente à l’une
des moitiés, il la détaché avec le crochet qui eft fixé
fur l’autre, ce qui s’appelle décrocher. C ’eft ce qu’exécute
la fig. 8. de la vignette : après quoi il referme
le moule, replace l’arc fous la matricé, verfe de la
matière, & recommence la même opération jufqu’à
trois ou quatre mille fois dans un feul jour.
Il ne faut pas s’imaginer que la lettre au fortir du
moule foit achevée, du moins quant à ce qui regarde
fon corps ; car pour le càraÔere il eft parfait ; il
eft beau ou laid, félon que le poinçon qui a fervi à
former la matrice a été bien ou mal gravé.
Quelle que foit la figure du caractère , les contre-
poinçons, les poinçons, les matrices , &c. la fonte en
eft la même ; & il n’y a dans toutes ces opérations
aucune différence de l’Arabe, au Grec, auFrançois,
à l’Hébreu, &c.
La lettre apporte avec elle au fortir du moule une
éminence de matière de forme pyramidale, adhérente
par fon fommetau piéde la lettre. Cette partie de
matière qu’on appelle je t, eft formée de l’excédent
de la matière néceffaire à former les caractères, qu’on
a verfée dans le moule. On la fépare facilement du
corps de la lettre, au moyen de l’étranglement que
les plans inclinés des parties du moule appelléesye«,
y ont formé, ainfi que nous avons dit plus haut, &
qu’on voit fig. x. Planche II. D ’ailleurs la compofi-
tion que l’addition de l’antimoine rend caftante ,pref-
que comme de l’acier trempé , facilite cette fépara-
tion ; le jet féparé de la lettre s’appelle rompure.
Après que toutes les lettres font rompues, c’eft-à-
dire , qu’on en a féparé les jets, oyait remettent à la
fonte, on les frote fur une meule de grès qu’on voit
fig, y. PL III. & qu’on appelle pierre à froter.'Cette
meule a depuis quinze jufqu’à vingt-cinq pouces de
diamettre ; elle eft de la même forte que celles dont
fe fervent les Couteliers pour émoudre. Pour la rendre
propre à l’opération du Fondeur en caractère, on
en prend deux qu’on met à plat l’une fur l’autre ; on
répand entre elle du fable de rivière, puis on les
meut circulairement, ’répandant detems en tems de
nouveau fable, jufqu’à ce que les petites éminences
qui font à ces pierres foient grugées, & qu’on ait
rendu leurs furfaces planes & unies. La fable endref-
fant les grès on meules , ne les polit pas ; il y laiffe
toujours de petits grains qui fervent à enlever aux
caractères les bavures qui leur viennent de la fonte.
On ne peut pas froter toutes les lettres ; il y en a,
mais en plus grand nombre dans l’italique que dans
le romain , dont une partie de la figure excede lé
corps du côté qu’on frote. Il eft évident que fi on
iesfrotoit, la pierre emporterait cette partie, & ef-
tropieroit la lettre : c’eft pourquoi on commence par
la dégager légèrement, & par en enlever un peu de
matière avec un canif, afin qu’elle puiffe fe loger facilement
dans l’efpece vuide que lui préfentera une
lettre voifine. Cette opération par laquelle on dégage
la partie faillante au canif, s’appelle crener.
Après que la lettre eft crenée , onia ratifie & on
emporte avec le eanif tout ce qu’il y a d’étranger au
corps depuis l’oeil jufqu’au pié. Ces deux opérations
fuppléent au frotement ; les lettres crenées & ratifiées
s’accolent & fe joignent aufli-bien que fi elles
avoient été frotées. Les deux faces du caractère que
l’on frote fur la meule, font celles qui s’appliquent
aux blancs du moule , quand on y verfe le métal ;
on donne cette façon à ces faces pour en enlever le
morfileou la vive arrête occafionnée tant par la face
du blanc d’une des moitiés que par celle de la longue
piece de l’autre moitié.
Lorfque les lettres ont été frotées ou crenées &
ratifiées, on les arrange dans un compofteur ; le com-
pofteur qu’on voit fig. 5. PL III. delà Fonderie des
caractères, eft une réglé de bois entaillée, comme on
vo it , fur laquelle oh arrange les caractères la lettre
en-haut, & tous les crans tournés du même côté ;
enfoïte qu’on a tous les a , rangés de cette maniér
é , a , a , a , a , a , a , &C non en celle-ci aaa, vav ,
& ainfi des autres lettres : c’eft ce que l’infpeétion
des crans indiquera facilement. Les caractères ainfi
rangés dans le compofteur font tranfportés fur la réglé
de fer A B dujufiifieur,fig. 3 . même Planche ; on
les y place de maniéré que leur pié foit en-haut, &
que le caractère porte fur la face horifontale du jufti-
fieur, qui n’eft lui-même, comme on v o it , qu’un
compofteur de fer. A cette réglé, on en applique une
autre C D , qui a un épaulement en G, comme celui
que l’on voit en B de la première piece fig. 3. cette
réglé a de plus en G & D , de petites languettes qui
entrent dans les mortoifes a & b dp la figure 3 , enfor-
te que , quand les deux réglés fig. 3 & 4. font appliquées
l’une fur l ’autre , elles enferment exactement
la rangée de caractères placée fur la première
réglé ; ainfi il n’y a que les piés des lettres qui excèdent
d’environ une ligne au-deffous des réglés de
fer, qui forment le juftifieur.
Le juftifieur ainfi garni d’une rangée de caractères,
eft placé entre les deux jumelles A B , C D du cou-
poir qu’on voit fig. 1. Planche III. Le coupoir eft une
forte d’établi très-folide : fur fa table font fortement
fixées la jumelle A B , qui eft une planche d’un bon
pouce d’épaiffeur , & la barre de fer B F , qui a un
crochet E & un crochet F à chacune de fes extrémités.
Le crochet F eft taraudé & reçoit une vis ,
au moyen de laquelle on peut faire avancer la fécondé
réglé du juftifieur, que nous avons décrite ci-
deffus.
Les deux réglés du juftifieur font ferrées l’une
contre l’autre par l’autre jumelle CD , repréfentée
par fa partie inférieure dans là fig. x. A B , CD font
deux fortes barres de fer, dont les crochets A , G,
entrent dans la table du coupoir. B D eft une autre
barre
Sarre de fer qui porté un écrou qui reçoit la vis F, E ,
que l’on tourne comme celle d’un étau, par le moyen
du manche F , G. Tout cet affemblage eft fixé à la table
du coupoir, en forte que la jumelle G D tirée ou
pouffée par la vis F E , peut feule fe mouvoir.
Il fuit de cette defeription du coupoir, que fi l’on
tourne la vis E F , fig. x. on fera marcher la jumelle
mobile A B , vers la jumelle immobile CD fig. /. &
que par eonféquent on fera appliquer les deux réglés
du juftifieur contre la rangée de caractères qu’ elles
contiennent. Mais pour ferrer les caractères les uns
contre les autres, on fera tourner la vis Ffi. Cette
vis fera couler la fécondé réglé du juftifieur le long
•de la rangée de caractères, jufqu’à ce que fon épaulement
Cfig. 4. rencontrant la rangée de caractères, les
preffera & les pouffera vers l’épaulement B de la
première piece fig. 3. jufqu’à ce qu’ils foient tous
«xaâement appliqués les uns contre les autres. Cela
fait, il eft évident queles caractères formeront comme
un corps folide contenu par fes deux extrémités entre
les épaulemens des deux pièces du juftifieur, & félon
fa longueur entre les mêmes pièces, par l’aôion
des deux jumelles.
Mais avant que de confolider ainfi la rangée de
caractères, on paffe un morceau de bois dur fur leurs
•extrémités faillantes ou fur leurs piés, afin de les enfoncer
toutes également, & d’appliquer leur tête,
■ ou la lettre, contre la furface de la réglé horifontale
du juftifieur.
Lorfque tout eft âinfi difpofé -, on coupe les caractères
avec le rabot, de la maniéré que nous allons dire.
L’inftrument qu’on voit Planche III. de la Fonderie
■ en caractères, fig . 6. eft appellé rabot. Il eft compofé
d ’un fût de fer, qu’on voit fig. /-o; Sous la partie NO
d e ce fût, font arrêtés avec des vis les deux guides
G e, D f t Cet affemblage eft furmonté d’un bois P Q
qu’on voit fig. 8. ce bois fert de poignée au rabot. 11
fe fixe fur la partie N O , fig. 10. comme on l’y voit
fixé,fig. C. Le fer A B du rabot fe place fur la face
inclinée du fût, parles deux vis G H taraudées, &
entrant dans les collets que le fer traverfe, & qui
font eux-mêmes fixés fur le fût par la vis que l’on voit
en R. Toutes ces piecès affemblées forment le rabot
de la fig. C. Les vis fe ferrent avec le tourne-vis de
la fig. 1 G. même Planche III.
Quand on veut couper les lettres, on place le rabot
fur le juftifieur, en forte que les parties faillantes
des lettres foient entre les guides du rabot ; on
hauffe ou l ’on baiffe le fer, qui eft un peu arrondi par
fon tranchant, en forte qu’il puiffe emporter autant
de matière que l’on fouhaite.
Les reglemens ont ftatué fur la hauteur des lettres ;
il eft ordonné que la lettre portera, depuis fa furface
iufqu’à l’extrémité de fon pié, dix lignes & demie de
pié de roi. Cette hauteur n’eft pas'la même par tout ;
la hauteur de Hollande a près d’une ligne de plus que
celle de Paris ; celle de Flandre, & même de Lyon,
ont plus de dix lignes. Au refte, lorfque des Imprimeurs
, fans aucun égard pour les ordonnances, veulent
des caractères au-deffus ou au-deffous de dix lignes
& demie, on a de petites pièces qu’on ajufte au
moule à fondre les caraîteres, entre le jet & les longues
pièces.
Ces pièces s’appellent haujfes ; félon que les haufi-
fes font plus ou moins épaiffes, un même moule fert
à fondre des caractères plus ou moins hauts de papier ;
c’eft l’expreflion dont on fe fert pour défigner la di-
menfion dont il s’agit ici.
Le fer du rabot étant convexe, les caractères coupés
auront tous une petite échancrure concave, de
maniéré qu’étant pôles fur leurs piés, ils rie porteront
, pour ainfi dire, que fur deux lignes, au lieu de
porter fur une furface. On a pratiqué cette concavité
aux piés des caractères^ afin qu’ils s’arrangent mieux Tome //,
fur fe marbre de la preffe, fur lequel expofant moins
de furface, ils font moins fujets à rencontrer des inégalités.
Mais ce retranchement de matière n*eft pasle feul
qui fe faffe avec le rabot ; oh eft contrairit d’enlever
encore del’étoffe auhaut du caractère, commeonpeut
le voir en B , fig. 14. Ce retranchement fe fait des
deux côtés aux lettres qui n’ont ni tête ni queue, &£
feulement du côté oppofé à la queue , lorfque les
caractères en oht une. Le but de cette opération eft
de dégager encore mieux l’oeil du caractère. On voit
en effet, fig. 14. que le caractère B eft plus faillantque
le caractère A , quoiqu’ils ayent été fondus l’un ôc l’autre
dans le même moule.
La machine repréfentée^. 14. & qui contient les
deux caractères A & B dont nous venons de parler,
s’appelle jufiification ; elle fert à connoître, par le
moyen du petit reglet qu’on voit fig. 13. & qu’on
appelle jetton, fi les traits des lettres fe trouvent tous
fur une même ligne. Pouf cet effet, après avoir jufti-
fié les lettres mm, que nous avons dit être la première
lettre que l’on fabrique ; on place un a, par
exemple, entre les deux mm, on cette forte mam,&
1 on examine fi l’arrête du jetton s’applique égale-,
ment fur les trois car altérés.
Le morceau de glace y fig.- ix. & fon jetton y fig. 1*
fervent à jauger de la même manière les épaiffeurs,
& l’une & l’autre de ces deux machines indique pareillement
, pâr l’application du jetton, fi les traits
des lettres fe trouvent tous exactement dans la même
ligne droite, comme nous venons de dire.
On entend par une fonte de caractères d'Imprimerie}
un affortiment complet de toutes les lettres majufeu-
Ies, minufcules, accens, points, chiffres, 6*c. néceffai*
res à imprimer un difcours,& fondues fur un feul corps.
Le corps eft une épaiffeur jufte &c déterminée, relative
à chaque caractère en particulier ; c’eft cette
épaiffeur qui fait la diftance des lignes dans un livre,
& qui donne le nom au caractère, & non l’oeil de la
lettre ; cependant pour ne rien confondre, on dit
fondre un Cicero fur un corps de S. Augufiin, quand
on a pris ce moyen pourjetter plus de blanc entre
les lignes.
Mais pour fe faire une idée jufte de ce qu’on appelle
en Fonderie de caractères ou en Imprimerie,corps^
oeil, & blanc, prenez une diftance ou ligne quelconque,
fuppofez-la'divifée en fept parties égales par
des lignes parallèles ; fuppofez écrite entre ces lignes
parallèles une des lettres que les Imprimeurs appellent
courtes, telles que Va, le c , Vm, &c. car ils appellent
les lettres à queue, telles que le p , le q , le d,
lettres longues. Suppofez-Ia tracée entre ces parallèles
de maniéré qu’elle ait fa bafe appuyée fur la troi-
fieme parallèle en montant, & qu’elle touche de fon
fommet la troifieme parallèle en defeendant, ou ce
qui revient au même, que des fept intervalles égaux
dans lefquels vous avez divifé la ligne, elle occupe
les trois du milieu ; il eft évident qu’il reftera au-
deffus de ces trois intervalles occupés, deux efpaces
vuides, & qu’il en reftera aulîi deux vuides au-deffous.
Cela bien compris, il ne fera pas difficile d’entendre
ce que c’eft que Vceil, le corps , & le blanc.
Le corps eft repréfenté par la ligne entière ; Voeil occupe
les trois efpaces du milieu, c’eft la hauteur
même de la lettre ; & l’on entend par les blancs, les
deux efpaces qui reftent vuides au-deffous & au-defl.
fus de l’oeil.
A
£ !■ ■ *____ ] ■ la ligne A B re-
^ 1 i m / l f f préfente la hau-
Exemple. £—— teur ^ corps ;
■ F-"* ^ ^ C D , le blanc
B d’en - haut ; D E 9
l’oeil; E F * le blanc d’en-bas, C D , forme dans une
O O o 0