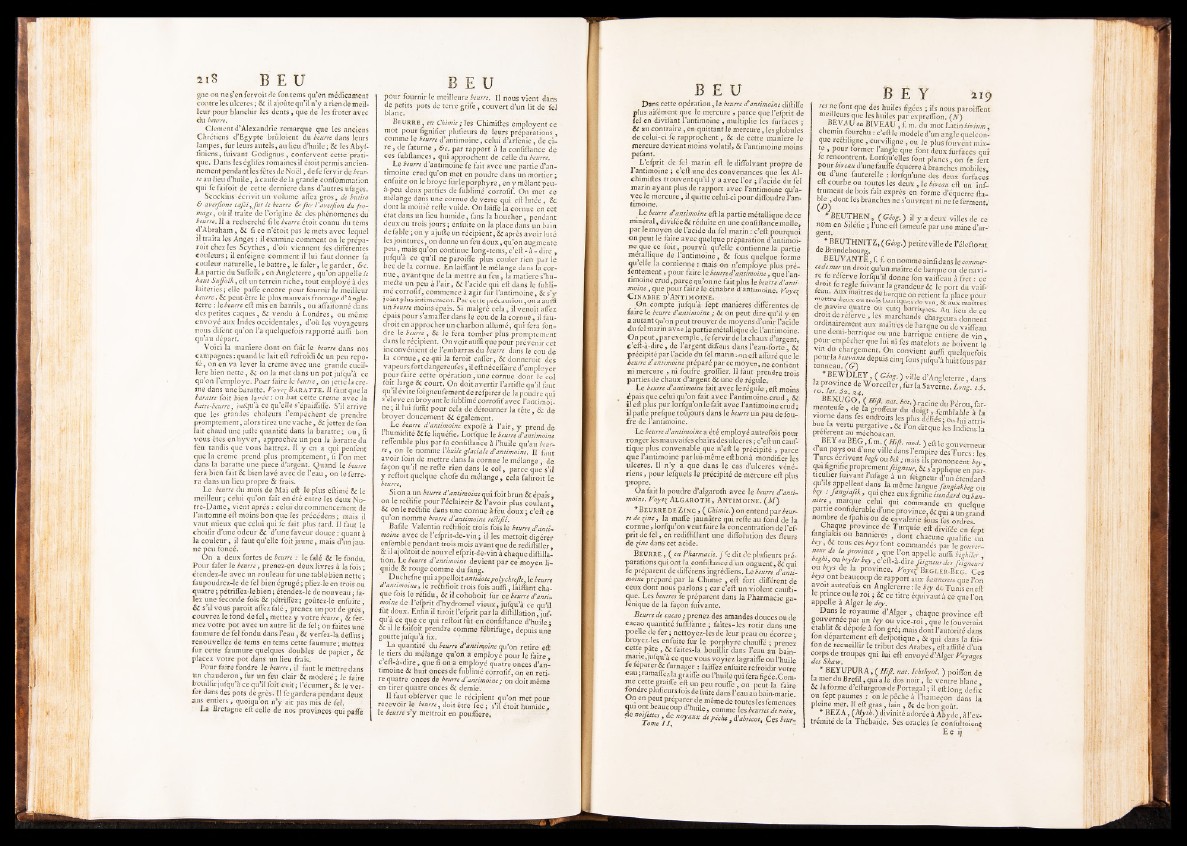
gne on ne s’en fervoit de fonteins qu’en médicament
contre les ulcérés ; & il ajoute qu’il n’y â rien de meilleur
pour blanchir les dents , que de les froter avec
du beurre.
Clement d’Alexandrie remarque que les anciens
Chrétiens d’Egypte bridoient du beurre dans leurs
lampes, fur leurs autels, au lieu d’huile ; & les Abyf-
finiens, fuivant Godignus , confervent cette pratique.
Dans les égliles romaines il étoit permis anciennement
pendant les fêtes de Noël, de fe fervir de beurre
au lieu d’huile, à caufe de la grande confommation
qui fe faifoit de cette derniere dans d’autres ufages.
Stockius écrivit un volume affez gros, de butiro
& avtrjionc cafei ,/ur le beurre & fur Vaverfion du fromage,
où il traite de l’origine & des phénomènes du
beurre. II a recherché fi le beurre, étoit connu du tems
d’Abraham, & fi ce n’étoit pas le mets avec lequel
il traita les Anges : il examine comment on le préparait
chez les Scythes, d’où viennent fes différentes
couleurs ; il enfeigne comment il lui faut donner fa
couleur naturelle, le battre, le faler, le garder, &c.
La partie du Suffolk, en Angleterre, qu’on appelle le
haut Suffolk, eft un terrein riche, tout employé à des
laiteries; elle paffe encore pour fournir le meilleur
beurre, & peut-être le plus mauvais fromage d’Angleterre
: le beurre eft mis en barrils, ou affailonné dans
des petites caques, & vendu à Londres, ou même
envoyé aux Indes occidentales, d’où les voyageurs
nous difent qu’on l’a quelquefois rapporté aufîi bon
qu’au départ.
Voici la maniéré dont on fait le beurre dans nos
campagnes : quand le lait eft refroidi & un peu repo-
f é , on en va lever la creme avec une grande cueil-
lere bien nette, & on la met dans un pot jufqu’à ce
qu’on l’employe. Pour faire le beurre, on jette la cre-
me dans une baratte. Voye.i B a r a t t e . Il faut que la
baratte foit bien lavée: on bat cette creme avec la
batte-beurre, iwAju’à ce qu’elle s’épaiftiflé. S’il arrive
que les grandes chaleurs l’empêchent de prendre
promptement, alors tirez une vache, & jettez de fon
lait chaud une jufte quantité dans la baratte; ou fi
vous êtes enhyver, approchez un peu la baratte du
feu tandis que vous battrez. Il y en a qui penfent
que la creme prend plus promptement, fi l’on met
dans la baratte une piece d’argent. Quand le beurre
fera bien fait & bien lavé avec de l’eau, on le ferrera
dans un lieu propre & frais.
Le beurre du mois de Mai eft le plus eftimé & le
meilleur ; celui qu’on fait en été entre les deux Notre
Dame, vient après : celui du commencement de
l’automne eft moins bon que les précédens ; mais il
vaut mieux que celui qui fe fait plus tard. II faut le
choifir d’une odeur & d’une faveur douce : quant à
la couleur, il faut qu’elle foit jaune, mais d’un jaune
peu foncé.
On a deux fortes de beurre : le falé & le fondu.
Pour faler le beurre, prenez-en deux livres à la fois ;
étendez-le avec un rouleau fur une table bien nette ;
faupoudrez-le de fel bien égrugé ; pliez-le en trois ou
quatre ; pétriffez-lebien ; étendez-le de nouveau ; fa-
lez une lêconde fois & pétrifiez; goûtez-le enfuite
& s’il vous paraît aflez falé, prenez un pot de grès,
couvrez le fond de fel, mettez y votre beurre, & fermez
votre pot avec un autre lit de fel; ou faites une
faumure de fel fondu dans l’eau, & verfez-la deffus ■ i
renouveliez de tems en tems cette faumure; mettez I
fur cette faumure quelques doubles de papier &
placez votre pot dans un lieu frais.
Pour faire fondre le beurre, il faut le mettre dans
un chauderon, fur un feu clair & modéré; le faire
bouillir j u fqu’a ce qu’il foit cuit; l’écumer, & le ver-
fer dans des pots de grès. Il fe gardera pendant deux
ans entiers, quoiqu’on n’y ait pas mis de fel.
La Bretagne eft celle de nos provinces qui pafle
pour fournir le meilleure beurre. Il nous vient dans
de petits pots de terre grife, couvert d’un lit de fel
blanc.
Beurre,«« Chimie; les Chimiftes employent ce
mot pour lignifier plufieurs de leurs préparations ,
comme le beurre d’antimoine, celui d’arfenic, de cire
, de faturne, &c. par rapport à la confiftance de
ces fubftances, qui approchent de celle du beurre.
Le beurre d’antimoine fe fait avec une partie d’an-
tîmoine crud qu’on met en poudre dans un mortier ;
enfuite on le broyé fur le porphyre, en y mêlant peu-
à-peu deux parties de fublimé corrofif. On met ce
mélange dans une cornue de verre qui eft lutée, 8c
dont la moitié refte vuide. On laifle la cornue en cet
état dans un lieu humide, fans la boucher, pendant
deux ou trois jours ; enfuite on la place dans un bain
de fable ; on y a jufte un récipient, 6c après avoir luté
les jointures, on donne un feu doux, qu’on augmente
peu, mais qu’on continue long-tems, c’eft - à - dire ,
jufqu’à ce qu’il ne paroiffe plus couler rien par le
bec de la cornue. En laiflant le mélange dans la cornue,
avant que delà mettre au feu, la matière s’hu-
mefte un peu à l’air, 6c l’acide qui eft dans le fublimé
corrofif, commence à agir fur l’antimoine, & s’y
joint plus intimement. Par cette précaution, on a aufîi
un beurre moins épais. Si malgré cela, il venoit aflez
épais pour s’amafler dans le cou de la cornue',' il faudrait
en approcher un charbon allumé, qui fera fondre
le beurre , 6c le fera tomber plus promptement
dans le récipient. On voit aufli que pour prévenir cet
inconvénient de l’embarras du beurre dans le cou de
la cornue, ce qui la ferait cafler, 6c donnerait des
vapeurs/ort dangereufes, il eftnéceflaire d’employer
pour faire cètte opération, une cornue dont le col
toit large 6c court. On doit avertir i’artifte qu’il faut
qu’il évite foigneufement de relpirer de la poudre qui
s’élève en broyant le fublimé corrofif avec l’antimoine
; il lui fuffit pour cela de détourner la tête, 6c de
broyer doucement 6c également.
Le beurre d'antimoine expofé à l’air, y prend de
l’humidité 6c fe liquéfie. Lorfque le beurre d'antimoine
reflemble plus par fa confiftance à l’huile qu’au beurre,
on le nomme 1 huile glaciale £ antimoine. IP faut
avoir foin de mettre dans la cornue le mélange, de
façon qu’il ne refte rien dans le co l, parce que s’il
y reftoit quelque choie du mélange, cela faliroit le
beurre.
Si on a un beurre d'antimoine qui foit brun 6c épais ,
on le reftifie pour l’éclaircir 8c l’avoir plus coulant,
6c on le reftifie dans une cornue à feu doux ; c’eft ce
qu’on nomme beurre d'antimoine rectifié.
Bafile Valentin reftifioit trois fois le beurre <Tantimoine
avec de l’efprit-de-vin ; il les mettoit digérer
enfemble pendant trois mois avant que de rediftfller
& il ajoutoit de nouvel efprit-de-vin à chaque diftilla-
tion. Le beurre d'antimoine devient par ce moyen liquide
8t rouge comme du fang.
' ? Duchefne qui zyçelloit antidote polychrefie, le beurre
d antimoine y le reftifioit trois fois aufli, laiflant chaque
fois le réfidu, 8c il cohoboit fur ce beurre et antimoine
de l ’efprit d’hydromel vieux, jufqu’à ce qu’il
fut doux. Enfin il tiroit l’efprit par la diftillation, juf.
qu’à ce que ce qui reftoit fût en confiftance d^huile *
6c il le faifoit prendre comme fébrifuge, depuis une
goutte jufqu’à fix. ' - ' ' :
La quantité du beurre d'antimoine qu’on retire eft
le tiers du mélange qu’on a employé pour le faire
c’eft-à-dire, que fi on a employé quatre onces d’antimoine
8t huit onces de fublimé corrofif, on en retire
quatre onces de beurre d'antimoine; on doit même
en tirer quatre onces 6c demie.
Il faut obferver que le récipient qu’on met pour
recevoir le beurre, doit être fec ; s’il étoit humide,
le beurre s'y mettrait en pouflierè.
Dans cette opération, le beurre £ antimoine diftille
plus aifément que le mercure , parce que l’efprit de
tel en divifant l’antimoine , multiplie les furfaces ;
8C au contraire, en-quittant le mercure, les globules
de celui-ci fe rapprochent, 6c de cette maniéré le
mercure devient moins volatil, & l’antimoine moins
pefant.
| L’efprit de 'fel marin eft le diflolvant propre de 1 antimoine ; ç’eft une des convenances que les Al-
chimiftes trouvent qu’il y a avec l’or ; l’acide du fel
marin ayant plus de rapport avec l’antimoine qu’avec
le mercure, il quitte celui-ci pour difloudre l’antimoine.
Le beurre d'antimoine eft la partie métallique de ce
minerai, divifée 6c réduite en une confiftance molle,
par le moyen de l’acide du fel marin : c’eft. pourquoi
on peut le faire avec quelque préparation d’antimoi*
ne que ce foit, pourvu qu’elle contienne la partie
métallique de l’antimoine, 8c fous quelque forme
qu elle la contienne : mais on n’employe plus pré-
fentement, pour faire le beurred'antimoine, que l’an-*
timoine crud, parce qu’on nè fait plus le beurre d'anti-
moine , que pour faire le cinabre d'antimoine. Voye?
C in a b r e d ’A n t îm o i n e .
Qn compte jufqu’à fept maniérés différentes de
faire le beurre d.'antimoine ; 8c on peut dire qu’il y en
a autant qu’on peut trouver de moyens d’unir l’acide
du fel marin avec la partie métallique de l’antimoine.
On peut, par exemple, fe fervir dé la chaux d’argent,
c ’eft-à-dire, de l’argent diffous dans l’eau-forte, 6c
précipité par l’acide du fel marin -. on eft afluré que le
beurre d'antimoine préparé par ce moytn, ne contient
ni mercure , ni foufre groflier. Il faut prendre trois
parties de chaux d’argent 6c une de régule.
Le beurre d antimoine fait avec le régule, eft moins
j épais que celui qu’on fait avec l’antimoine, crud , 6c
il eft plus pur lorfqu’on le fait avec l’antimoine crud ;
il pafle prefque toujours dans le beurre un peu de foufre
de l’antimoine.
Le beurre cCantimoine a été employé autrefois pour
ranger lesmauvaifes chairs des ulcérés ; c’eft un cauf-
tique plus convenable que n’eft le précipité , parce
que l’antimoine par lui-même eft bon à mondifier les
ulcérés. Il n’y a que dans le cas d’ulceres vénériens
, pour lefquels le précipité de mercure eft plus
propre.
On fait la poudre d’algaroth avec le beurre d'antimoine.
Voye[ A l g a r o t h , A n t im o i n e . (A f)
* B e u r r e d e Z in c , ( Chimie.) on entend par beur*
re de fine y la malle jaunâtre qui refte au fond de là
cornue, lorfqu’on veut faire la concentration de l’ef-
prit de fe l, en rediftillant une diffolution des fleurs
de fine dans cet acide.
B e u r r e , ( en Pharmacie, j ce dit de plufieurs préparations
qui ont la confiftance d’un onguent, 6c qui
le préparent de différens ingrédiens. Le beurre d'antimoine
préparé par la Chimie , eft fort différent de
ceux dont nous parlons ; car c’eft un violent caufti-
que. Les beurres fe préparent dans la Pharmacie galénique
de la façon fuivante.
Beurre de cacao; prenez des amandes douces ou de
cacao quantité fuffifante ; faites-les rôtir dans une
poelle de fer ; nettoyez-Ies de leur peau ou écorce ;
broyez-les enfuite fur le porphyre chauffé ; prenez
cette pâte , 8c faites-la bouillir dans l’eau au bain-
marie,jufqu’à ce que vous voyiez la graiffe ou l’huile
le leparer 6c furnager : laiffez enfuite refroidir votre
eau ; ramaflez la graiffe ou l’huile qui fera figée.Comme
cette graiffe eft un peu rouffe, on peut la faire
ondre plufieurs fois de fuite dans l’eau au bain-marie.
On en peut préparer de mêmede toutes les femences
mu ont beaucoup d’huile, comme les beurres de noix,
|de noifettes de noyaux dépêche , d'abricot, Ces heurns
^)nt T Ie dés huiles figées ; ils noiis paroîfîent
meilleurs que les huiles par expreflion. CAO
BEVA.U ou BIVEAU, f. m. du mot Latin bivium
chemin fourchu : c’eft le modèle d’un angle quelconque
feêtihgne , curviligne ; ou le plus fouvent mixte
, pour former l’angle que font deux furfaces qur
le rencontrent. Lorfqu’elles font planes ; on fe fort
pour biveau d’une fauffe équérre à branches mobiles,'
ou d une fauterelle : lorlqu’une des deux furfaces
eft courbe ou toutes les deux , le biveau eft un infiniment
de bois fait exprès en forme d’équerre fta-
fO j d° nt léS brànches nè s’ollvrent ni ne fe ferment.'
* BEUTHEN, ( Géog. ) il y a deux villes de ce
nom en Siléfie ; l’une eft fameufe par une mine d’argent.
i *®EUTHNITZ, (Géog.) petite ville de Véleélorat
de Brandebourg,
BEUVANTEyf. f. on nomme ainlîdans le commerce
de mer \\n droit qu’un maître de barque ou de navi-
re . rf f erve lorfqu’il donne fon vaiffeau à fret : ce
Uroît fe regie fuivant la grandeur 8c Ie pôrt du vaif-
p/' ux maîtres de barque on retient la place pour
mettre deux ou trois barnques rle vin, & aux maîtres
de/lavire quatre ou cinq barriques.'Au lieii de ce
droit de referve, les marchands chargeurs donnent
ordinairement aux maîtres dé barque ou de vaiffeau
une demi-barrique ou une barrique entiefe de vin
pour empecher que lui ni fes matelots ne boivent le •
vm du chargement. On convient aufli quelquefois
pour la beuvante depuis cinq fous jufqu’à huit fous par
tonneau. . 4 1
la ( Oiog. ) ville d’Angleterre, dans:
Vorcefle r, fur la Saveïne. Long. l i .
inentóSfe^A.’menteuie , de 1la groffeur du dRoaicgitn, eY edmu bPléarbolue ,à f ahr-
viorne dans fes endroits les plus déliés>On lu aftrS
BEY ou BEG, {. m. ( Hifi. ùiod. ) eft le gouverneur
d un pays ou d une ville dans l’empire des Turcs : les
- Turcs écrivent ou mais ils prononcent fev qui iîgmfie proprementfiignéur, & s’applique en par!
ticiilier fuivant l’ulage à un feigneur d’un étendard
qu ils appellent dans la même langue fangiMcg oii
bty : fangiafek) qui chez eux lignifie iundard bu ban-
niere , marque celui qui Commandé en queloue
partie confiderablè d’une province, & qui a ungrand
nombre de fpahis ou de cavalerie fous fes ordres
Chaque province dé Turquie eft divifée en fept
fangiakis ou bannières , dont chacune qualifie im
boy, & tous ces boysfont commandés parte gouvof-
: ncur do U province ■ , que' l’on appelle aufli ilfiûUr i
b‘ g/u,oabeylerbey,c’e{t-k-dkefögneunjis fam m i
ou beys de la province. ^rBÈGLER-BEG* Ces
beys ont beaucoup de rapport aux bnnnems que l’ori
avoit autrefois en Anglererre : le bey deTunS eneft
le prince ouïe roi ; & ce titre équiv-autà.cè que l’on
appelle à Alger le dey, 1
Dans le royaume d’Alger , chaque province eft
gouvernée par un bey ou vice-roi, que le fouvéraui
établit & depofe à fon gré; mais dontl’aütôrité dans
Ion departement eft delpotique, & qui dans la Union
de recueillir le tribut dés Arabes, eft affilé d’ütt
corps de troupes qui lui eft envoyé d’Alger Voyages
des Shaw.
* BEYUPURA, ( Hifi. nat. ïchthyol. ) poiffon de
la mer du Brefil, qui a le dos noir, le ventre blanc
& la forme d’efturgeoii de Portugal ; il eft long de fix
ou fept paumes : on le pêche à l’hameçon dans la
pleine mér. Il eft gras , fain , 6{ de bon goût.
* BEZA, (Mytk.) divinité adorée à Abyde, à l’ex-
tremite de la Thebaide, Ses oracles fe confultoienç
E e ij