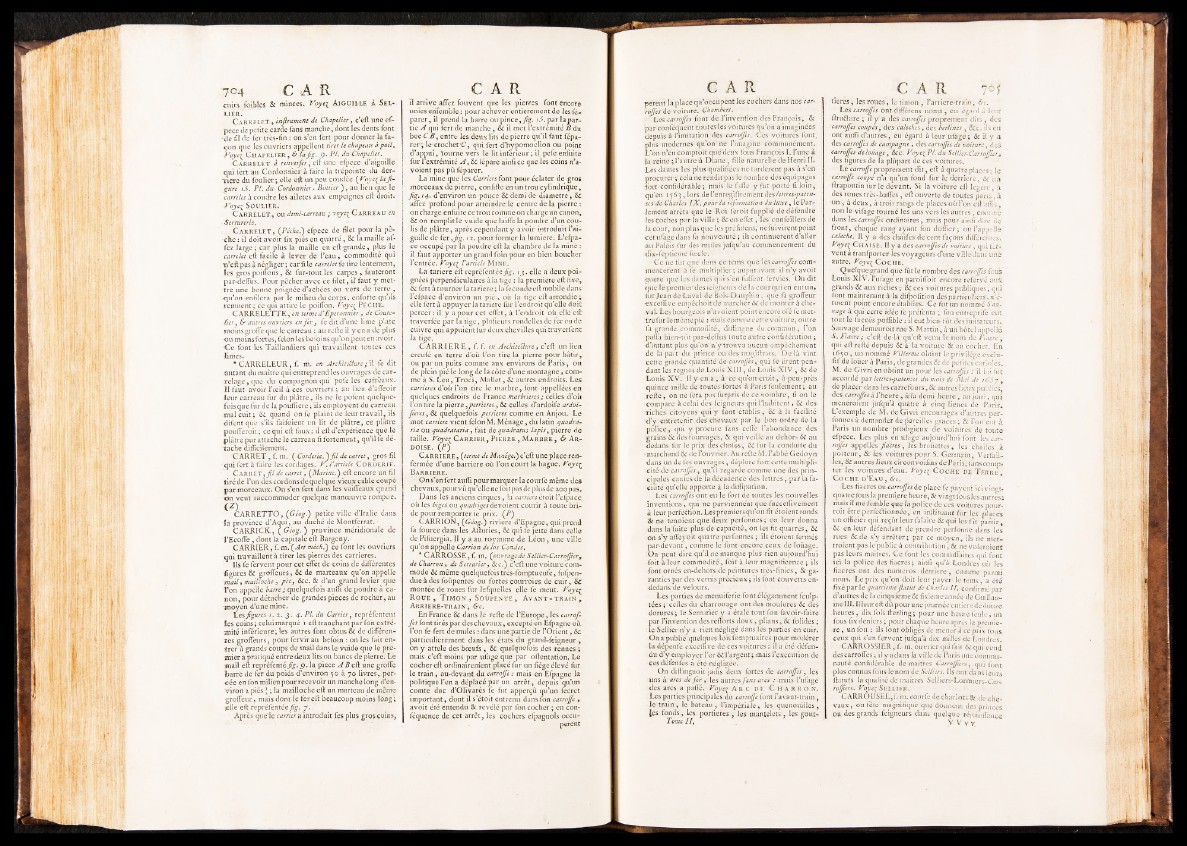
cuirs foibles & minces. Voyt{ Aiguille à Sel-
UER.
Carrelet , infiniment de Chapelier, c’eft une efpece
de petite carde fans manche, dont les dents font
-de fil de fer très-fin : on s’en fert pour donner la fa-
çbn que les ouvriers appellent firer/« chapeau a poil.
Voyei Chapelier , & lafig. 9 . PL du Chapelier.
C arrelet à renverfir, eft une efpece d’aiguille
qui fert au Cordonnier à faire la -trépqinte du derrière
du foulier ; elle eft un peu coudée ( Voyeç la figure
i3. Pl. du Cordonnier - Boeder ) , au lieu que le
carrelet à coudre les ailetes aux empeignes eft droit»
Voye^ Soulier»
C arrelet, ou demi-carreau ; voye^C arreau en
Serrurerie.
, C arrelet, (Pêche.') efpece de filet pour la pê-
xhe : il doit avoir fix, pies en quarré, & la maille af-
fez large ; car plus la maille en eft grande, plus le
carrelet eft facile à lever de l’eau, commodité qui
n’eft pas à négliger ; car fi le carrelet fe tire lentement,
les gros poiflons, & fur-tout les carpes , fauteront
par-deffus. Pour pêcher avec ce filet, il' faut y mettre
une bonne poignée d’achées ou vers de terre ,
-qu’on enfilera par le milieu du corps, enforte qu’ils
remuent ; ce qui attire le poiffon. Voye£ Pêche.
CARRELETTE, en terme d'Eperonnier , de Coutelier
, 6* autres ouvriers en fer , fe dit d’une lime plate
moins groffe que le carreau : au refte il y en a de plus
-ou moins fortes,-félon les befoins qu’on peut en avoir.
C e font les Taillandiers qui travaillent toutes ces
limes.
* CARRELEUR, f. m. en Architecture ; il fe dit
autant du maître qui entreprend les ouvrages de carrelage
, que du compagnon qui pofe les carreaux.
Il faut avoir l’oeil à ces ouvriers ; au lieu d’affeoir
leur carreau fur du plâtre, ils ne le pofent quelquefois
que fur de la pouffiere ; ils employent du carreau
mal cuit ; & quand on fe plaint de leur travail, ils
difent que s’ils faifoient un lit de plâtre, ce plâtre
poufferoit ; ce qui eft faux : il eft d’expérience que le
plâtre pur attache le carreau fi fortement, qu’il ie détache
difficilement.
C ARRET, f. m. ( Corderie. ) fil de carret, gros fil
qui fert à faire les cordages. V. L'article CoRderif.
Carret,// de carret, (Marine.) eft encore un fil
tiré de l’un des cordons de quelque vieux cable coupé
par morceaux. On s’en fert dans les vaiffeauX quand
On veut raccommoder quelque manoeuvre rompue.
( Z ) . 1
CARRETTO, (Géog.) petite ville d’Italie dans
la province d’Aqui, au duché de Montferrat.
CAR R ICK, ( Géog. ) province méridionale de
TEcofle, dont la capitale eft Bargeny.
CARRIER, f. m. (Art méch.) ce font les ouvriers
qui travaillent à tirer les pierres des carrières.
Ils fe fervent pour cet effet de coins de différentes
•figures & groffeurs, & de marteaux qu’on appelle
mail, mailloche , pic, &c. & d’un grand levier que
l ’on appelle barre ; quelquefois auffi de poudre à canon,
pour détacher de grandes pièces de rocher, au
•moyen d’une mine.
-Les figures a. 2. 3. 4. PL du Carrier, repréfentent
les coins; celui marqué 1 eft tranchant par fon extrémité
inférieure; les autres font obtus & de différentes
groffeurs, pour fervir au befoin : on les fait entrer
à grands coups de mail dans le vuide que le premier
a pratiqué entre deux lits ou bancs de pierre. Le
mail eft repréfenté fig. g . la piece A B e û une groffe
barre de fer du poids d’environ 50 à 70 livres, percée
en fon milieu pour recevoir un manche long d’environ
2 piés 7 ; la mailloche eft un marteau de même
groffeur, mais dont le fer eft beaucoup moins long ;
Telle eft repréfentée fig. y ..
Après que'le carrier a introduit fes plus gros coins,
il arrive affez fouvent que les pierres font encore
unies enfemble : pour achever entièrement de les fé-
parer, il prend la barre ou pince, fig. '3. par la partie
A qui fert de manche , & il met l’extrémité 2? du
bec C B , entre les deux lits de pierre qu’il faut fépa-
rer^ le crochefC, qui fert d’hypomoclion ou point
d’appui, tourne vers le lit inférieur ; il pefe enfuite
fur l’extrémité A , & lépare ainfi ce que les coins n’a-
voient pas pu féparer.
La mine que les Carriers font pour éclater de gros
morceaux de pierre, confifte en un trou cylindrique,
fig. 14. d’environ-un police & demi de diamètre, ôc
affez profond pour atteindre le centre de la pierre :
on charge enfuite ce trou comme on charge un canon,
& on remplit le vuide que laiffe la poudre d’un coulis
de plâtre, après cependant y avoir introduit l’aiguille
de fer,fig. 12. pour former la lumière. L’efpa-
ce occupé paria poudre eft la chambre de la miné :
il faut apporter un grand foin pour en bien boucher
l’entrée. Voye^ Varticle Mine.
La tariere eft repréfentée fig. ig. elle a deux poignées
perpendiculaires à la tige : la première eft fixe,
tk. fert à tourner la tariere ; la fécondé eft mobile dans
l’efpace d’environ un pie , où la tige eft arrondie ;
elle fert à appuyer la tariere fur l’endroit qu’elle doit
percer : il y a pour cet effet, à l ’endroit où elle eft
traverfée par la tige, plufieurs rondelles de fer ou de
cuivre qui appuient fur deux chevilles qui traverfent
la tige.
C A R R IE R E , f. f. en Architecture, c’ eft un lieu
creufé en terre d’où l’on tire la pierre pour bâtir,
ou par un puits comme aux environs de Paris, ou
de plein pié le long de la côte d’une montagne, comme
à S. Leu, Troci, Mallet, & autres endroits. Les
carrières d’où i’on tire le marbre, font appellées en
quelques endroits de France marbrières ; celles d’où
l’on tire la pierre, perrieres, & celles d’ardoife ardoi-
fieres, & quelquefois, perrieres comme en Anjou. Le
mot carrière vient félon M. Ménage, du latin quadra-
ria ou quadrataria, fait de quadratus lapis, pierre de
taille. Voyeç Carrier, Pierre , Marbre, &, Ardoise.
(P)
Carrière , (terme de Manège.) c’eft une place renfermée
d’une barrière où l’on court la bague. Voyeç
Barrière. ,
On s’en fert auffi pour marquer lacourfë même des
chevaux, pourvu qu’elle ne fôit pas de plus de 200 pas.
Dans les anciens cirques, la carrière étoit l’efpace
où les biges ou quadriges dévoient courir à toute bride
pour remporter le prix. (P)
CARRION, (Géog.) rivière d’Epagne, qui prend
fa fource dans les Afturies, & qui fe jette dans celle
de Pifuergia. Il y a au royaume de Léon, une ville
qu’on appelle Carrion de Los Coudes.
* CARROSSE, f. m. (ouvragede Sellier-Carrofiiery
de Charron, de Serrurier, &c.) c’eft une voiture commode
& même quelquefois très-fomptueufe, fufpen-
due à des foupentes ou fortes courroies de cuir, &
montée de roues fur lefqu elles elle fé meut. Voye{
Rou e , T imon, Soupente, Av ant- train,
Arriere-train, &c.
En France & dans le refte de l’Europe, les carrof-
fes font tirés par des chevaux, excepté en Efpagne où
l’on fe fert de mules : dans une partie de l’Orient, &:
particulièrement dans les états du grand-feigneur ,
on y attele des boeufs, & quelquefois des rennes ;
mais c’eft moins par ufage que par oftentation. Le
cocher eft ordinairement placé fur un fiége élevé fur
le train, au-devant du carroffe : mais en Efpagne la
politique l’en a déplacé par un arrêt, depuis qu’un
comte duc d’Olivarès fe fut apperçû qu’un fecret
important, dont il s’étoit entrenu dans.fon carroffe ,
avoit été entendu & révélé par fon cocher ; en con-
féquence de cet arrêt, les cochers efpagnols occupèrent
perent la place qu’occüpènt les cochers dans nos carrofies
de voiture. Charniers.
-•'■ ' Les carrofies font de l'invention des François, &
par conféquent toutes les:voitüresqü?on a imaginées
depuis à -l’imit-atiôn des carrofies. Ces voitures font,
plus modernes qu’on'ne l’imagine communément.
L’On n’en fcomptoit que deux fous François I. l’une à
la--reine ; l’autre'à Diane , fille naturelle de Henri II.
Lesdanies les plus qualifiées ne tardèrent pas à s’en
procurer ; cela ne rendit pas le nombre dés équipages
Tort confidérable ; mais le faite y fut porté fi loin;
qu’en 1563, lors de l’enregiftrement dislettres-paten-
-tt? dé Charles IXi pour la- rèformatiàn du luxe, le Parlement
arrêta que le Roi feroit fupplié de défendre
les Coches par la ville ; & en effet, les confeillers de
la cour, non plus que les préfidens, ne fui virent point
cet ufage dans fa nouveauté ; ils continuèrent d’aller
au Palais fur des mules jufqu’au commencement du
dix-feptieme fiecle»
Ce ne fut que1 dans Ce tems que les carrofies commencèrent
à fe multiplier; auparavant il n’y avoit
guere que les danles qui s’en fuffent fervies. On dit
que le premier des feigneurs de la courqui en éur un,
fut Jean de Laval de Bois-Dauphin, que fa gtoffeur
exceffive empêchoitde marcher & de mohter à cheval.
Les bourgeois n’a voient point encore ofé fe mettre
fur le même pié .’ niais dômnie cette voiture, outre
fa grande commodité, diftingue du-commun, l’on
paffa bien-tôt par-deffus toute autre confidération ;
d ’autant plus qu’on'-n’ÿ trouva aucun empêchement
de lapait du princè-OUdes magiftrats. De là vint
cette grande quantité de-carrofies ^ qui fe firent pendant
les régnés de Louis XIII, de Louis XIV , & de
Louis XV. Il y en a , à ce qu’on croit-, à-peu-près
quinze mille de toutes;fortes à Paris feulement ; au
refte', on ne fera pas furpris de cè nombre, fi on le
Compare à celui des feigneurs qui l’habitent, & des
riches citoyens qui y font établis,, & à.la facilité
•-d’y entretenir des chevaux par dé bon Ordre de la
police, qui y procure fans celle l’abondance des
grains & des fourrages, & qui veille au dehors & au
dedafts fur le prix des e'hôfes, Sc fur la conduite du
-marchand & de l’ouvrier. Au refte M. l’abbé Gedoyn
dans un de les-ouvrages , déplore fort cette multiplicité
dè càrrojfes, qu’il regarde comme une des principales’
caufes de la décadence des lettres, par la facilité
qu’elle apporte à la diffipation.
Les carrofies ont eu le fort de toutes les nouvelles
inventions, qui ne parviennent quefuccëffivement
à leur perfection. Les premiers qu’on fit étoient ronds
& ne tenoient que deux perfonnes ; on leur- donna
dans la fuite plus de capacité, on les fit quarrés, &
on s’y affeyoit quatre perfonnes ; ils étoient fermés
par-devant, comme le-font encore ceux de louage.
On peut dire qu’il ne manque plus rien aujourd’hui
foit à leur commodité, foit à leur magnificence ; ils
font ornés en-dehors de peintures très-finies, & garanties
par des vernis précieux ; ils font couverts en-
dedans de velours.
Les parties de menuiferie font élégamment fculp-
tées ; celles du charronage ont des-moulures & des
dorures ; le Serrurier y a étalé tout fon favoir-faire
par l’invention desreflorts doux, plians, & folides ;
le.Sellier n’y a rien négligé dans les parties en cuir.
On a publié quelques loisfomptuaires pour modérer
la dépenfe exceffive de<ces voitures : il a été défendu
d’y employer l’or & l’argent ; mais l’exécution de
ces défenfes a été négligée.
On diftinguoit jadis deux fortes de carrofies, les
Uns à arcs de fe r , les autres fans arcs : mais l’ufage
des arcs a paffé. Voye^ A r c d e G h a r r o n.
Les parties principales du carroffe font l’avant-train,
le train, le bateau, l’impériale, les quenouilles ,
les fonds, les portières , les mantelets, les gout-
Tome ÎI,
tiérés, les roues, le timon, l’arriere-train, &c.
Les carrofies ont différens noms , eu égard à leur
ftruèhire ; il y' a des carrofies proprement dits , dei
carrofies coupés, des calèches, des berlines , &c. ils erl
ont auffi d’autres, eu égard à leur ufage ; & il y a
des carrofies de Campagne , des carrofies de voiture, c!eâ
carrofies de louage, &c. Vjye^ Pl '. du Stllur-CarroJJicr±
des figures de la plupart cïe ces voitures;
Le carroffe proprement dit , eft à quatre places; le
carroffe coupé n’a qu’un fond fur le derrière, & un
ftrapontin fur le devant. Si la voiture eft legerc, à
des roues très-baffes, eft ouverte de toutes paris, à
-un, àdeux, àtrôisrangs de places où l’on eft affis,
non le vifage tourné les uns vers les autres , comnrê
dans les carrofies. ordinaires, mais pour ainfi dite de
front, chaque rang ayant fon doffier ; on f’appeltè
calèche. Il y a des chàifes de cent façons différehres,
VoyeçChaise. II y a des carrofies de voiture , qui fervent
à tranfporter les voyageurs d’une ville dans unè
autre. Voye^ CocHÊ.
Quelque grand que fût le nombre des càrroffes fous
Louis XIV. l’ufage en paroiffoit encore refervé au i
grands & aux riches ; & ces voitures publiques, qui
lont maintenant à la difpofition des particuliers, n’é-
toient point encore établies. Ce fut un nommé Sauvage
à qui cette idée fe préfenra ; fon eritreprife eut
tout le liiccés poffible : il eut bien-tôt.des imitateurs*
Sauvage demeuroit rue S. Martin:- à un hôtel appcllé
S. Fiacre ; c’eft de-Ià qu’eft venu le nom de Fiacre -,
qui eft refté depuis & à la voiture & au cocher. En
1650, un nommé Villerme obtint le privilège exclu-
fif de loiier à Paris, de grandes & de petites carioles.
M. de Givri en obtint un pour les carrofies : il lui fut
accordé par lettres-patehtes du mois de Mai de. 1 G5y ,
de placer dans les carrefours, & autres lieux publics,
des carrofies à l ’heure, à la' demi-heure, au joui-, qui
meneroient jufqu’à quatre à cinq lieues de Paris*
L’exemple de M. de Givri encouragea d'autres per-
fônnes à demander de pàTëilles grâces^ & l’on eut à
Paris un nombre prodigieux de voitures de toute
efpece. Les plus en ufage'aujourd’hui font les carrofies
appelles fideres -, les brouettes, les chaifes à
porteur, & les voitures pour S. Germain, Verfail-
ïes, & autres lieux circonvoifins de Paris, lans compter
les voitures d’eau. Voye{ Coche de T erre ,
Coche d’Eau, &c.
Les fiacres oucàrroffes de place fe payent ici vingt-
quatre fous la première heure, & vingtfous les autresî
maisjl me femble que la police de ces voitures pour-
roit être perfeâionnée, en inftituant fur les places
un officier qui reçût leur falaire & qui les fît partir
ôc en leur défendant de prendre perfonne dans les
rues & d e s’y arrêter; par ce moyen, ils ne met-
troient pas le public à contribution, & ne vqleroierït
pas leurs maîtres. Ce font les eommiffàires qui font
ici la police des fiacres; ainfi qu’à-Londres où les
fiacres ont des numéros derrièreV .éômme parmi
nous. Le prix qu’on doit leur payer; le-tems, a été
fixé par le quatrième Jlatut de Charles IL confirmé par
d’autres de la cinquième & fixieme année de Guillaume
III. Il leur eft dû pour une journée entière de douze
.heures, dix fols fterling; pour une heure féiile, un
fous fix deniers ; pour chaque heure après la premie-
•re, un fou : ils font obligés de mener à cé prix tous
ceux qui s’en fervent jufqu’à dix milles-de Londres.
CARROSSIER ,-f. m. ouvrier qui fait &-q.ui vend
des carrôffes ; il y a dans la ville de Paris une communauté
confidérable de maîtres Carrofiiers i qui font
plus connus fous le nom <\ç Selliers. Ils ont dans leurs
ftatuts la qualité de maîtres Selliers-Lormiers-Gr/-*-
rofiiers. Voye[ Sellier.
CARROUSEL, f. m. courfe de chariots & de chevaux,
ou fête magnifique que'donnent des princes
ou des grands feigneurs dans quelque réjomffanee y v y |