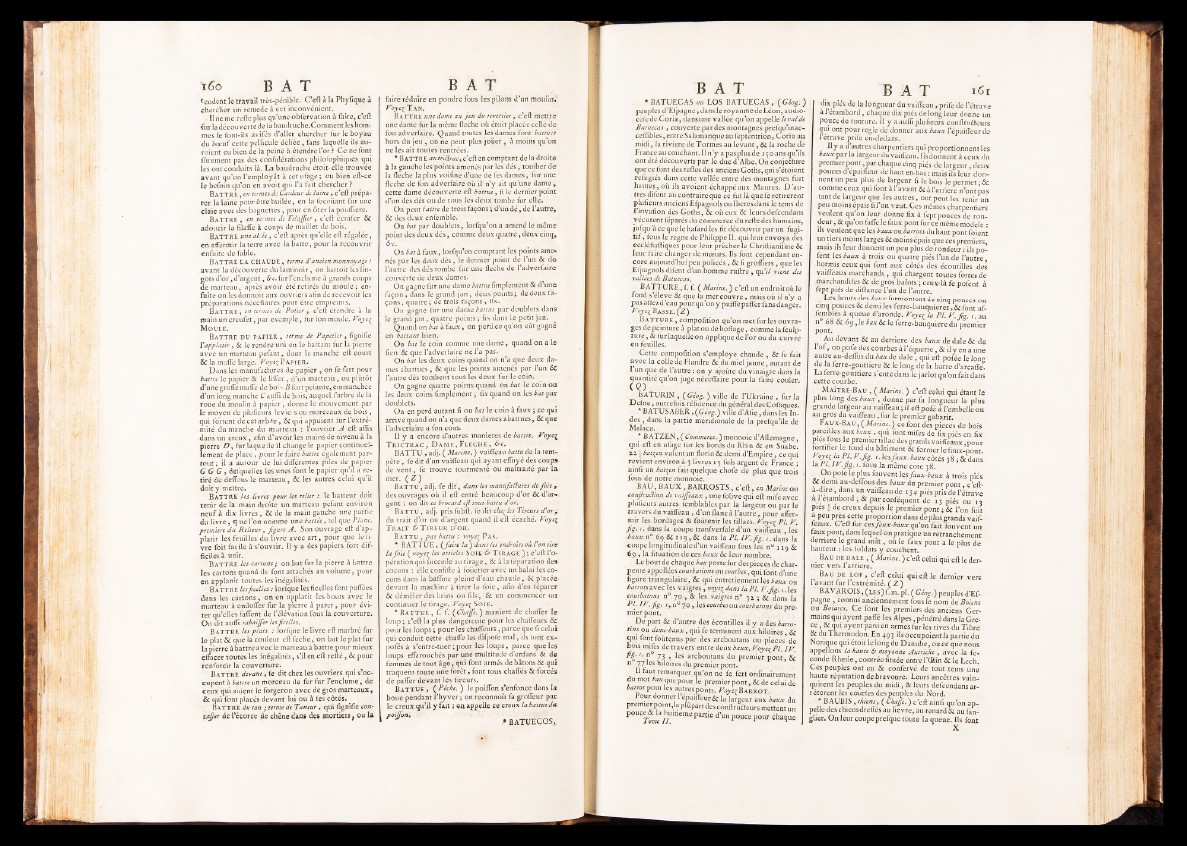
fendent le travail très-pénible. C’eft à la Phyfique à
chercher un remede à cet inconvénient.
Ï1 ne me refte plus qu’une obfervation à faire, c’eft
<ur la découverte de la baudruche.Comment les hommes
fe font-ils avifés d’aller chercher fur le boyau
du boeuf cette pellicule déliée, fans laquelle ils auraient
eu bien de la peine à étendre l’or ? Ce ne font
fûrement pas des confidérations philofophiques qui
les ont conduits là. La baudruche étoit-elle trouvée
avant qu’on l’employât à cet ufage ; ou bien eft-ce
le befoin qu’on en avoit qui l’a fait chercher ?
B a t t r e , en termes de Cardtur de laine , c’eft préparer
la laine pôur être huilée, en la fecoiiant fur une
claie avec des baguettes, pour en ôter la poufliere.
B a t t r e , en termes de FilaJJier , c’eft écrafer &
adoucir la filafle à coups de maillet de bois. ^
B a t t r e une allée , c’eft après qu’elle eft régalée,
en affermir la terre avec la batte, pour la recouvrir
enfuite de fable.
B a t t r e l a c h a u d e , terme d'ancien monnayage :
avant la découverte du laminoir , on battoit les lingots
d’o r , d’argent, &c. fur l’enclume à grands coups
de marteau, après avoir été retirés du moule; en-
fuite on les donnoit aux ouvriers afin de recevoir les
préparations néceffaires pour être empreints.
B a t t r e , en termes de Potier , c’e ft é ten d re à la
m a in un c r e u f e t , p a r e x em p le , fu r fo n m o u le. Voyei
M o u l e .
B a t t r e DU PAPIER , terme de Papetier, lignifie
Vapplatir, & le rendre uni en le battant fur la pierre
avec un marteau pefant, dont le manche eft court
& la mafle large. Voye\ P a p i e r .
Dans les manufactures de papier , on fe fert pour
battre le papier & le lifter , d’un marteau, ou plutôt
d’une grofle mafle de bois B fort pelante, emmanchée
d’un long manche C aufli de bois, auquel l’arbre de la
foue du moulin à papier, donne le mouvement par
le moyen de plufieurs levie;s ou morceaux de bois,
qui fôrtent de cet arbre, & qui appuient fur l’extrémité
du manche du m arteau : l’ouvrier A eft aflis
dans un creux, afin d’ avoir les mains de niveau à la
pierre D , fur laquelle il change le papier continuellement
de place, pour le faire battre également partout
; il a autour de lui différentes p'iles de papier
G G G , delquelles les unes font le papier qu’il a retiré
de deflous le marteau, & les autres celui qu’il
doit y mettre.
B a t t r e les livres pour les relier : le batteur doit
tenir de la main droite un marteau pefant environ
neuf à dix livres, & de la main gauche une partie
du livre, q ue l’on nomme une battée , tel que Planc.
première du Relieur, figure A. Son ouvrage eft d ap-
platir les feuilles du livre avec art, pour que le livre
foit facile à s’ouvrir. Il y a des papiers fort difficiles
à unir.
B a t t r e les cartons ; o n b a t fu r la p ie r re à b attre
le s ca rtons q u an d ils fo n t a t ta ch é s a u v o lu m e , p our
e n ap p lan ir to u te s les in é g a lité s .
B a t t r e les ficelles : lorlque les ficelles font paflees
dans les cartons, on en applatit les bouts avec le
marteau à endoffer fur la pierre à parer, pour éviter
qu’elles faffent de l’élévation fous la couverture.
On dit aufli rabaijfer les ficelles.
B a t t r e les plats : lorfque le livre eft marbré fur
le plat & que la couleur eft feche, on bat le plat fur
la pierre à battre avec le marteau à battre pour fliieux
effacer toutes les inégalités, s’il en eft refté, & pour
renforcir la couverture.
B a t t r e devant, fe dit chez les ouvriers qui s’occupent
à battre un morceau de fer fur l’enclume, de
ceux qui aident le forgeron avec de gros marteaux,
& qui font placés devant lui ou à les côtés.
B a t t r e du tan ; terme de Taneur, qui lignifie con-
fafier de l’écorce de chêne dans des mortiers ? ou la
faire réduire en poudre fous les pilons d’un moulin.’
Voyê^ Tan.
Ba t t re une dame au jeu du revertier, c’eft mettre
une dame fur la même fléché oit étoit placée celle de
fon adverfaire. Quand toutes les dames font battues hors du jeu , on ne peut plus jouer, à moins qu’on
ne *le Bs ait toutes rentrées. attr e au trictrac, c’eft en comptant de la droite
à la gauche les points amenés par les dés, tomber de
la fléché la plus voifine d’urte de fes dames, fur une
fléché de fon adverfaire oit il n’y ait qu’iine dame ,
cette dame découverte eft battue, li le dernier point
d’un des dés ou de tous les deux tombe fur elle.
On peut battre de trois façons ; d’un dé, de l’autre,
& des deux enfemble.
On bat par doublets, lorfqu’on a amené le même
point des deux dés, comme deux quatre, deux cinq,
&c.O
n bat à faux, lorfqu’en comptant les points ame*
nés par les deux dés, le dernier point de l’un & de
l’autre des dés tombe fur une fléché de l’adverfaire
coOuvne grtaeg dnee fdueru uxn dea dmaems.e battue Amplement & d’une
façon, dans le grand jan , deux points; de deux façons
, quatre ; de trois façons, fix.
On gagne fur une dame battue pat doublets dans
le grand jan, quatre points ; fix dans le petit jan.
Quand on bat à faux, on perd ce quori eût gagné
en battant bien.
On bat le coin comme line dame, quand on a le
fien & que l’adverfaire ne l’a pas.
On bat les deux coins quand on n’a que deux dames
abatruès , & que les points amenés par l’un &
l’autre dés tombent tous les deux fur le coin.
On gagne quatre points quand on bat le coin oit
les deux coins fimplement ; fix quand on les bat. par
doublets.
On en perd autant fi on bat le coin à faux ; ce qui
arrive quand on n’a que deux dames abattues, ÔC que
l’adverlaire a fon coin.
Il y a encore d’autres maniérés de battre. V?ye% Trictrac, Dame,F léché, &c.
BA T TU , adj. ( Marine. ) vaifleau battu de la tempête
, fe dit d’un vaifleau qui ayant effuyé des coup»
de vent, fe trouve tourmenté ou maltraité par la
meBr. ( Z ) attu, adj. fe dit’, dans lès manufactures de foie à dgeesn to u: vorna gdeist oii il eft entré beaucoup d’or & d’ar-. ce brocard efi tout battu d'or. Battu , adj. pris fubft. fe dit che^les Tireurs d'or y
du trait d’or ou d’argent quand il eft écaché. Voyej
Trait & Tireur d’or.
Battu , pas battu : vôye{ Pas.
* BATTUE, {faire la ) dans les endroits où Von tirs
la foie { voyei les articles S OIE & Tirage ) ; c’eft l’opération
qui fuccede au tirage, & à la réparation des
cocons : elle confifte à foiietter avec un balai les cocons
dans la bafline pleine'd’eau chaude , & placée-
devant la machine à tirer la-foie, afin d’en féparer
& démêler des brins ou fils1, en commencer ou
con* tBinuer le tirage. Voye% Soie. attue, f. î.{Ghaffe.') maniéré de chafler le
loup; c’eft la plus dangereule pour les chafleurs &c
pour les loups ; pour les chafleurs, parce que fi celui
qui conduit cette chaffe les difpofe mal, ils font ex-
plooufpéss àe fsf’aernoturceh-téuse pr a; rp uonuer mlesu lltoituupdse , dp’eanrcfaen sq u&e ldees
femmes de tout âge, qui feint armés de bâtons & qui
traquent toute une forêt , font tous chafles & forcés
de Bpalier'devant les tireurs. attue , ( Pèche. ) le poiflon s’enfonce dans la
boue pendant l’hyver ; onredonnoît fa grofleur par
le creux qu’il y fait ; en appelle ce creux la battue du
poiffon. I
 BATUEC OS*
* BATUECAS ou LOS BATUECAS , {Géog. )
peuples d’Efpagne, dans le royaume de Léon, audio-
• cèfede Coria, dansune vallée qu’on appellelevalde
Batuecas , couverte par des montagnes prefqu’inac-
. ceflibles, entre Salamanque au feptentrion, Coria au
midi, la riviere de Tormes au levant, & la roche dé
France au couchant. Il n’y a pas plus de 150 ans qu’ils
ont été découverts par le duc d’Albe. On conjecture
que ce font desreftesdes anciens Goths, qui s’étoient
réfugiés dans cette vallée entre des montagnes fort
hautes, où ils avoient échappé aux Maures. D ’autres
difent au contraire que ce fut là que fe retirèrent
plufieurs anciens Efpagnols ou Iberesdans letems de
l ’invafion des Goths, & où eux & leurs defeendans
vécurent féparés du commerce du refte des humains,
jufqu ’à ce que le hafard les fit découvrir par un fugi-
| t i f , fous le régné de Philippe II. qui leur envoya des
eccléfi^iftiques pour leur prêcher le Chriftianifme &
leur faire changer de moeurs. Ils font cependant encore
aujourd’hui peu policés, & fi groflïers, que les
Efpagnols difent d’un homme ruftre , qu'il vient des
vallées de Batuecas.
B A T T U R E , f. £, { Marine. ) c ’e ft un e n d ro it o ù le
fo n d s ’e le v e &: q u e la m e r c o u v r e , ma is o ù il n’y a
p a s a f le z d ’e au p o u r q u ’o n y p u ifle p a fle r fan s dan ger.
Vryei BASSE. ( Z )
B a t t u r e , compofition qu’on met fur les ouvra- 1
ges de peinture à platoudeboffage, comme la fculp-
ture, & fur laquelle on applique de l’or ou du cuivre
en feuilles.
Cette compofition s’employe chaude , & fe fait
avec la colle de Flandre & du miel jaune, autant de
l ’un que, de l’aiitre : on y ajoute du vinaigre dans la
^U On îuSe n®ce^aire pour la faire couler.
BATURIN , {Géog.') ville de l’Ukraine, fur la
Delne, autrefois réfidence du général des Çofaques.
* BATUSABER, {Géog.') ville d’Afie, dans les Indes
, dans la partie méridionale de la prefqu’île de
Malaca.
* BATZEN, ( Commerce. ) monnoie d’Allemagne,
qui eft en ufage fur les bords du Rhin & en Suabe.
a z j bat^en valent un florin & demi d’Empire, ce qui
revient environ à, 3 livres 15 fols argent de France ;
ainfi un bat^en fait quelque chofe de plus que: trois .
fous de notre monnoie.
B AU, BAUX, BARROSTS, ç’eft, e« Marine ou
conjlrucliçn de vaijfeaux, une folive qui eft mife avec
plufieurs autres lèmblables par la largeur ou par le
travers du vaifleau, d’un flanc à l’autre, pour affermir
les bordages & foûtenir les tillacs. Voye^ PI. V.
fig. 1. dans la coupe tranfverfale d’un vaifleau: les
baux n° 6ç) & 119 , & dans la PI. IV. fig. t, dans la
coupe longitudinale d’un vaifleau fous les n° 119 &
69 , la fituation de ces baux&c leur nombre.
Le bout de chaque bau porte fur des pièces de charpente
appellées courbations ou courbes, qui font d’une
figure triangulaire , & qui entretiennent les baux ou
barrots avtc les vaigres, voye^ dans la Pl. V.fig, 1. les
courbatons n° 70 les vaigres n° 32,; & dans la
Pl. 1V. fig. /,.nQ 70 ,,-les courbes ou courbatons .du premier
pont.
De part & d’autre des écoutilles il y a; des harror
tins ou demi-baux, quife terminent aux hiloires &
qui font foûtenus par des areboutans .ou pieces> de
bois mifes de travers entre deux baux. Voye{ PI. IV ;
fiS; |Bp| 73 1 les areboutans du premier pont, &
n 77 les hiloires du premier pont.
Il fa u t remarquer q u ’ o n ne fe fe rt o rd in airement
d u mo t bau que p o u r le p rem ie r p o n t , & d e c e lu i d e
barrot p o u r le s autres p o n ts. Voye? B a r r o t .
P o u r d onn er l’ épa iffeu r & la la rg eu r a u x baux du
p rem ie r p o in t ,la p lu pa rt des con ftru é leu r s m e ttent un
^>° UC7(,OTJ,//Ultieiîie P arrïe ^ un P °« c e p o u r ch aq u e
dix pies de la longueur du vaifleau, prife de l’étrave
à l’étambord, chaque dix piés de long leur donne un
pouce de tonture. Il y a aufli plufieurs conftruéleurs
qui ont pour réglé de donner aux baux l’épaiffeur de
l’étrave prife en-dedans.
Il y a d autres charpentiers qui proportionnent les
baux par la largeur du vaiffeau. Ils donnent à ceux du
premier pont, par chaque cinq piés de largeur, deux
pouces d’épaiffeur de haut en-bas : mais ils leur donnent
un peu plus de largeur fi le bois le permet; Sc
comme ceux qui font à l’avant & à l’arriere n’ont pas
-tant de largeur que les autres, ont peut les tenir un
peu moins épais fi l’on veut. Ces mêmes charpentiers
veulent qu’on leur donne fix à fept pouces de rondeur
, & qu’on fafle le faux pont fur ce même modèle :
ils veulent que les baux ou barrots du haut pont foient
un tiers moins larges & moins épais que ces premiers
mais ils leur donnent un peu plus de rondeur : ils po-
fent les baux à trois ou quatre piés l’un de l’autre ,
hormis ceux qui font aux côtés des écoutilles des
vaifleaux marchands , qui chargent toutes fortes de
marchandifes & de gros balots ; ceux-là fe pofent à
fept piés de diftance l’un de l’autre.
Les bouts des baux furmontent de cinq pouces ou
cinq pouces & demi les ferre-bauquieres, & font af-
femblés à queue d’aronde. Voye^ la Pl. V.fiv. /. au
n° 68 & 69,1e bau & le ferre-bauquiere du premier
pont.
f devant & au derrière des baux de dale & de
l’o f , on pofe des courbes à l’équerre, & il y en a une
autre au-deflùs du bau de dale , qui eft pofée le long
de la ferre-gouttiere & le long de la barre d’arcafle.
La ferre-gouttiere s’ente dans le jarlot qu’on fait dans
cette courbe.
. M a i t r e -Ba u , ( Marine. ) c’eft celui qui étant le
plus long des baux , donne par fa longueur la plus
grande largeur au iraiffeau ; d eft pofé à l ’embelle ou
au gros du vaifteau , fur le premier gabarit.
F* Y*7? AU > C^ rius . ) ce font des pièces de bois
pareilles aux iamç:, qui font mifes de fix piéstfn. fix
pies fous Ie premier tillac des grands vaiffeaux, pour
tomber le fond du bâtiment & former le faux-pont.
v-fis- 1 • les faux- baux côtés 3 8 ; & dans
la f l . IV,Jtg. 1. tous la même cote 38.
^ Qnpole le plus fouvent les faux-baux à trois piés
& .demi au-deffoas des. baux du premier pont, c ’eft-
, dans un vaiffeau de 13 4 piés pris de l’étrave
à l etambord ; & par conféquent de 13 piés ou 13
pies £de creux depuis le premier pont ; & l’on fuit
a peu près cette proportion dans de plus grands vaif.
féaux. C ’eft fur ces faux-baux qu’on fait fouvent un
faux pont; dans lequel on pratique un retranchement
derrière le grand niâti;; oMe faux pont a le plus de
hauteur : les foldats y couchent.
Ba isse DAM,,!)fa r in e . ) ç’eft celui qui eft le der-
mer vers l’arriere.
_ B a u d e l o f , c ’e ft c e lu i q u i e ft le d e rn ie r v e r s
l ’a v a n t fu r l ’e x t rém ité . ( Z )
BAVAROIS, ( l e s ) f. m. pl. ( Géog.) peuples d’Ef-
Pagne connus anciennement fous le nom de Boitns
ou Boiares. Ce font lës premiers des anciens Germains
qui ayent paffé les Alpes, pénétré dans la Grèce
, & qui ayent paru en armes fur les rives du Tibre
& du Thermodon. En 493 ils occupoient la partie du
Norique qui etôit le long du Danube, ou ce que nous
appelions la haute & moyenne Autriche , avec la fécondé
Rhetie, contrée fituée entre l’CEin & le Lech.
Ces peuples ont eu & confervé de tout teins une
haute réputation de bravoure. Leurs ancêtres vainquirent
les peuples du midi, & leurs defeendans arrêtèrent
les courfes des peuples du Nord.
* BAUBIS, chiens, {Chajje.) c ’eft ainfi qu’on ap^
pelle des chiens dreffés au lievre, au renard & au fan-
gfier. On leur coupe prefque toute la queue. Ils font