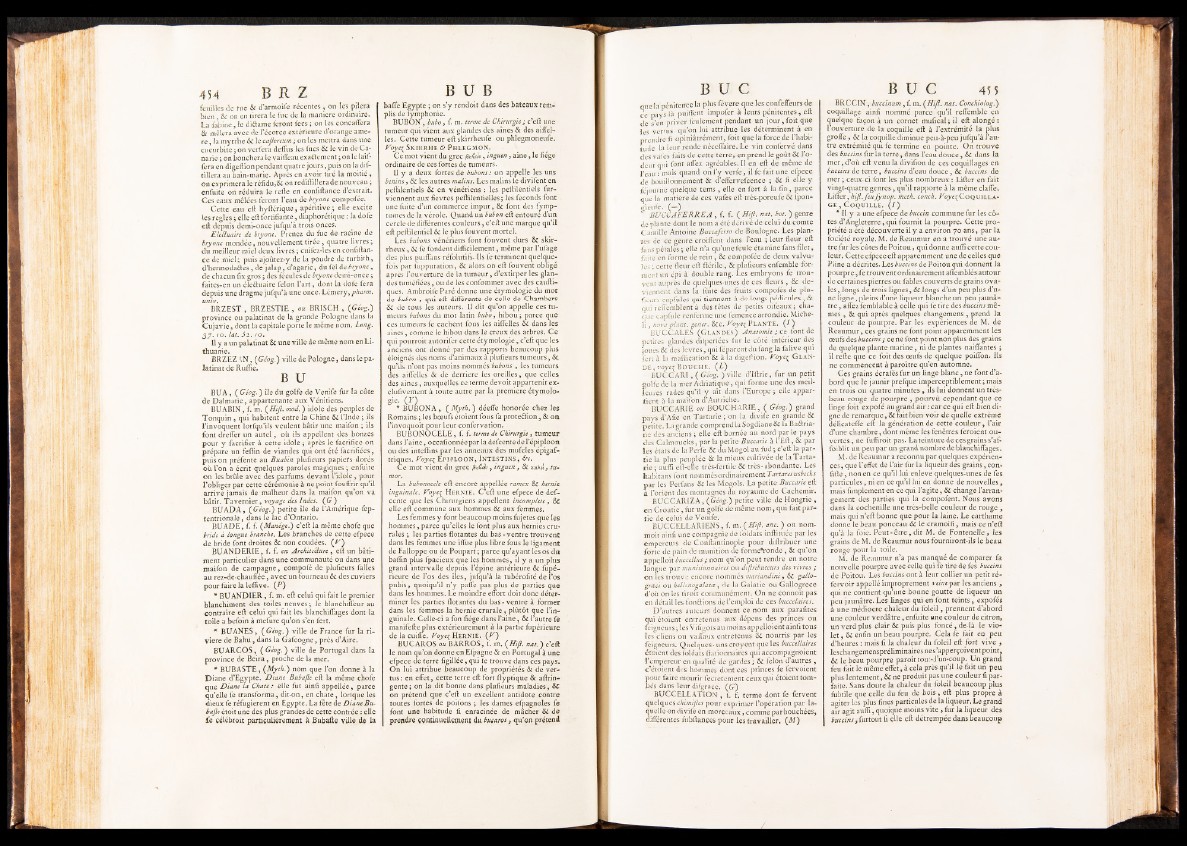
feuilles de nie & d’armoife récentes, on lès pilera
bien, & on en tirera le fuc de la maniéré ordinaire.
La fabine, le diûarne feront fecs ; on les concaffera
& mêlera avec de l’écorce extérieure d’orange ame-
re , la myrrhe 6c lecaftoreum; on les mettra dans une
cncurbite ; on verfera deffus les fucs & le vin de Ca-
narie ; on bouchera le vaiffeau exaûement ; on le laif-
fera endigeftion pendant quatre jours, puis on la dif-
tillera au bain-marie. Après en avoir tiré la moitié,
on exprimera le réfidu,& on rediftillera de nouveau ;
enfuite on réduira le relie en confiftance d’extrait.
Ces eaux mêlées feront l’eau de bryone compofée.
Cette eau eft hyftérique, apéritive ; elle excite
les réglés ; elle eft fortifiante, diaphonique : la dofe
eft depuis demi-once jufqu’à trois onces.
Electuaire de bryone. Prenez du fuc de racine de
bryone mondée, nouvellement tiree, quatre livres ;
du meilleur miel deux livres ; cuifez-les en confiftan-
ce de miel; puis ajoutez-y de la poudre de turbirh,
d’hermoda&es, de jalap, d’agaric, du fel de bryone,
de chacun lix gros ; des fécules de bryone demi-once ;
faites-en un éle&uaire félon l’art, dont la dofe fera
depuis une dragme jufqu’à une once. Lémery, pharm,
^BRZEST , BRZESTIE , ou BRISCH , (<Géog.)
province ou palatinat de la grande Pologne dans la
Cujavie, dont la capitale porte le même nom. Long.
§y. io. lut. 52. 10.
Il y a un palatinat 6c une ville de même nom en Lithuanie.
BRZEZ àN, (Géog.') ville de Pologne, dans le palatinat
de Ruffie.
B U
BU A , ( Géog. ) île du golfe de Venife fur la côte
de Dalmatie, appartenante aux Vénitiens.
BUABIN, f. m. ( Hift. mod. ) idole des peuples de
Tonquin , qui habitent entre la Chine 6c l’Inde ; ils
l’invoquent lorfqu’ils veulent bâtir une maifon ; ils
font dreffer un autel, où ils appellent des bonzes
pour y facrifier à cette idole; après le facrifice.on
prépare un feftin de viandes qui ont été facrifiées,
puis on préfente au Buabin plufieurs papiers dorés
où l’on a écrit quelques paroles magiques ; enfuite
on les brûle avec des parfums devant l’idole, pour
l’obliger par cette cérémonie à ne point fouffrir qu’il
arrive jamais de malheur dans la maifon qu’on va
bâtir. Tavernier, voyage des Indes. (G )
BUADA, (Géog.) petite île de l’Amérique fep-
tentrionale, dans le lac d’Ontario.
BUADE, f. f. (Manège.) c’eft la même chofe que
bride à longue branche. Les branches de cette efpece
de bride font droites 6c non coudées. (F )
BUANDERIE, f. f. en Architecture , eft un bâtiment
particulier dans une communauté ou dans une
maifon de campagne, compofé de plufieurs faites
au rez-de-chauffée, avec un fourneau 6c des cuviers
pour faire la leffive. (P)
* BUANDIER, f. m. eft celui qui fait le premier
blanchiment des toiles neuves ; le blanchiffeur au
contraire eft celui qui fait les blanchiffages dont la
toile a befoin à mefure qu’on s’en fert.
* BUANES, ( Géog. ) ville de France fur la rivière
de Bahu, dans la Gafcogne, près d’Aire.
BUARCOS, ( Géog. ) ville de Portugal dans la
province de Beira, proche de la mer.
* BUBASTE, (Myth.) nom que l’on donne à la
Diane d’Egypte. Diane Bubafle eft la même chofe
que Diane la Chate : elle fut ainfi appellée, parce
qu’elle fe transforma, dit-on, en chate, lorique les
dieux fe réfugièrent en Egypte. La fête de Diane Bu-
bajle étoit une des plus grandes de cette contrée : elle
Te célébroit particulièrement à Bubafte ville de la
baffe Egypte ; on s’y rendoit dans des bateaux remplis
de lymphonie.
BUBON, bubo 3 f. m. terme de Chirurgie; c’eft une
tumeur qui vient aux glandes des aînés & des aiffel-
les. Cette tumeur eft skirrheufe ou phlegmoneufe.
Foye^ SKIRRHE & PHLEGMON.
Ce mot vient du grec faÇàv, inguen, aine, le fiége
ordinaire de ces fortes de tumeurs.
Il y a deux fortes de bubons : on appelle les uns
bénins, &: les autres malins. Les malins le divifent en
peftilentiels 6c en vénériens : les pellilentiels Reviennent
aux fievres peftilentielles ; les féconds font
une fuite d’un commerce impur, 6c font des fymp-
tomes de la vérole. Quand un bubon eft entoure d’un
cercle de différentes couleurs, c’eft une marque qu’il
eft peftilentiel 6c le plus fouvent mortel.
Les bubons vénériens font fouvent durs 6c skir-
rheux, 6c fe fondent difficilement, même par l’ufage
des plus puiffans réfolutifs. Ils fe terminent quelquefois
par luppuration, 6c alors on eft fouvent obligé
après l’ouverture de la tumeur, d’extirper les glandes
tuméfiées, ou de les confommer avec des caufti-
ques. Ambroife Paré donne une étymologie du mot
de bubon , qui eft différente de celle de Chambers
6c de tous les auteurs. Il dit qu’on appelle ces tumeurs
bubons du mot latin bubo, hibou; parce que
ces tumeurs fe cachent fous les aiffelles 6c dans les
aînés, comme le hibou dans le creux des arbres. Ce
qui pourroit autorifer cette étymologie, c’eft que les
anciens ont donné par des rapports beaucoup plus
éloignés des noms d’animaux à plufieurs tumeurs, &
qu’ils n’ont pas moins nommés bubons , les tumeurs
des aiffelles & de derrière les oreilles, que celles
des aines, auxquelles ce terme devoit appartenir ex-
clufivement à toute autre par la première étymologie.
( r )
* BUBON A , ( Myth. ) déeffe honorée chez les
Romains.; les boeufs étoient fous fa proteôion, & on
l’invoquoit pour leur confervation.
BUBONOCELE, f. f. terme de Chirurgie , tumeur
dans l’aine, occafionnée par la defeente de l’épiploon
ou des inteftins par les anneaux des mufcles épigaf-,
triques. Foye^ E p i p l o o n , In t e s t i n s , &c.
Ce mot vient du grec , inguen, & , tu-
La bubonocele eft encore appellée ramex 6c hernie
inguinale. Foye^ H e r n i e . C’eft une efpece de defeente
que les Chirurgiens appellent incomplète , 6c
elle eft commune aux hommes 6c aux femmes.
Les femmes y font beaucoup moins fujetes que les
hommes, parce qu’elles le font plus aux hernies crurales
; les parties flotantes du bas-ventre trouvent
dans les femmes une iffue plus libre fous le ligament
de Falloppe ou de Poupart ; parce qu’ayant les os du
baffin plus fpacieux que les hommes, il y a un plus
grand intervalle depuis l’épine antérieure 6c fupé-
rieure de l’os des îles, jufqu’à la tubérofité de l’os
pubis, quoiqu’il n’y paffe pas plus de parties que
dans les hommes. Le moindre effort doit donc déterminer
les parties flotanfes du bas - ventre à former
dans les femmes la hernie crurale, plutôt que l’inguinale.
Celle-ci a fon fiége dans l’aine, 6c l’autre fe
manifefte plus extérieurement à la partie fupérieure
de la cuifle. Voyeç H e r n i e . (F )
BUCAROS ou BÀRROS, f. m, (Hift nat.) c’eft
le nom qu’on donne en Efpagne & en Portugal à une
efpece de terre figillée, qui le trouve dans ces pays.
On lui attribue beaucoup de propriétés & de vertus
: en effet, cette terre eft fort ftyptique & aftrin-
gente ; on la dit bonne dans plufieurs maladies, 6c
on prétend que c’eft un excellent antidote contre
toutes fortes de poifons ; les dames efpagnoles fe
font une habitude fi enracinée de mâcher 6c de
prendre continuellement du buearos, qu’on prétend
que la pénitente la plus févere que les confeffeurs de
ce pays-là puiffent impofer à leurs pénitentes, eft
de s’en priver feulement pendant un jour, foit que
les vertus qu’on lui attribue les déterminent à en
prendre fi opiniâtrément, foit que la force de l’habitude
la leur rende néceffaire. Le vin confervé dans
des vâfes faits de cette terre, en prend le goût 6c l’odeur
qui font affez agréables. Il en eft de même de
l’eau : mais quand on l’y verfe, il fe fait une efpece
de bouillonnement & d’effervefcence ; 6c fi elle y
féjournë quelque tems , elle en fort à la fin, parce
que la matière de ces vafes eft très-poreufe 6c fpon-
gieufe. (—) 1
BUCCAFERREA , f. f. ( Hift. nat. bot. ) genre
de plante dbiît le nom a été dérivé de celui du comte
Camille Antoine Buccaferro de Boulogne. Les plantes
de ce genre croiffent dans l’eau ; leur fleur eft
fans pétales ; elle n’a qu’une feule étamine fans filet,
faite en forme de rein , 6c compofée de deux valvules
; cette fleur eft ftérile, & plufieurs enfemble forment
un épi à double rang. Les embryons fe trouvent
auprès de quelques-unes de ces fleurs , 6c deviennent
dans la fuite des fruits compofés de plufieurs
capfules qui tiennent à de longs pédicules , &
qui reffemblent à des têtes de petits oifeaux ; chaque
capfule renferme une femence arrondie. Miche-
l i , nova plant, gener. 6cc. Foyeç PLANTE. ( I )
BUCCALES (Glandes) Anatomie ; ce font de
petites glandes dilperfées fur le côté intérieur des
joues 6c des levres, qui féparent du fang la falive qui
fert à la maftication & à la digeftion. Foye{ Glande,
voye{ BO U CH E. (L)
BUCCARI, ( Géog. ) ville. d’Iftrie, fur un petit
golfe de la mer Adriatique, qui forme une des meilleures
rades qu’il y ait dans l’Europe ; elle appartient
à la maiîon d’Autriche.
BUCCARIE ou BOUCHARIE, ( Géog.) grand
pays d’Afie en Tartarie ; on la divife en grande 6c
petite. La grande comprend la Sogdiane 6c la Baflria-
ne des anciens ; elle eft bornée au nord par le pays
des Calmoucks, par la petite Buccarie à l’Eft, & par
les états de la Perfe 6c du Mogol au fud ; c’eft la partie
la plus peuplée & la mieux cultivée de la Tartarie
; auffi eft-elle très-fertile Sc très-abondante. Les
habitans font nommés ordinairement Tartares usbecks
par les Perfans 6c les Mogols. La petite Buccarie eft
à l’orient des montagnes du royaume de Cachemir.
BUCCARIZA, (Géog.) petite ville de Hongrie ,
en Croatie, fur un golfe de même nom, qui fait partie
de celui de Venife.
BUCCELLARIENS, f. m. ( Hift. anc. ) on nom-
moit ainfi une compagnie de foldats inftituée par les
empereurs de Conftantinople pour diftribuer une
forte de pain de munition de forme*ronde , & qu’on
appelloit buccellus ; nom qu’on peut rendre en notre
langue par muniùonnaires ou diftributeurs des vivres ;
on les trouve encore nommés mariandini, 6c gallo-
groeci ou hellenogalatce, de la Galatie ou Gallogrece
d’où on les tiroit communément. On ne connoît pas
en détail les fondions de l’emploi de ces buccelaires.
D ’autres auteurs donnent ce nom aux parafites
qui étoient entretenus aux dépens des princes ou
feigneurs ; les Vifigots au moins appelaient ainfi tous
les cliens ou vaflaux entretenus 6c nourris par les
feigneurs. Quelques-uns croyent que les buccellaires
étoient des foldats ftationnaires qui accompagnoient
l ’empereur en qualité de gardes ; 6c félon d’autres ,
c ’étoient des hommes dont ces princes fe fervoient
pour faire mourir fecretement ceux qui étoient tombés
dans leur difgrace. (G)
BUCCELLATION , 1. f. terme dont fe fervent
quelques chimiftes pour exprimer l’opération par laquelle
on divife en morceaux, comme par bouchées,
différentes fubftances pour les travailler. (M)
BRCCIN, buccinum, f. m. (Hift. nat. Conchiolog.)
coquillage ainfi nommé parce qu’il reffemble en
quelque façon à un cornet mufical ; il eft alongé :
l’ouverture de la coquille eft à l’extrémité la plus
groffe, 6c la coquille diminue peu-à-peu jufqu’à l’autre
extrémité qui fe termine en pointe. On trouve
des buccins fur la terre, dans l’eau douce, 6c dans la
mer, d’où eft venu la divifion de ces coquillages en
buccins de terre, buccins d’eau douce, 6c buccins de
mer ; ceux-ci font les plus nombreux : Lifter en fait
vingt-quatre genres, qu’il rapporte à la même claflèi
Lifter, hift. feufynop. meth. conch. f'qye^CoQUlLLA*-
g e , C o q u i l l e . ( I )
* Il y a une efpece de buccin commune fur les cô*
tes d’Angleterre, qui fournit la pourpre. Cette propriété
a été découverte il y a environ 70 ans, par la
fociété royale. M. de Reaumur en a trouvé une au*
treNfur les côtes de Poitou, qui donne auffi cette couleur.
Cette efpece eft apparemment une de celles que
Piine a décrites. Les buccins de Poitou qui donnent la
pourpre, fe trouvent ordinairement affemblés autour
de certaines pierres ou fables couverts de grains ovales
, longs de trois lignes, 6c longs d’un peu plus d’u*
ne ligne, pleins d’une liqueur blanche un peu jaunâtre
, affez femblable à celle qui fetire des buccins mê*
mes , & qui après quelques changemens , prend la
couleur de pourpre. Par les expériences de M. de
Reaumur, ces grains ne font point apparemment les
oeufs des buccins ; ce ne font point non plus des grains
de quelque plante marine, ni de plantes naiffantes ;
il refte que ce foit des oeufs de quelque poiffon. Ils
ne commencent à paroître qu’en automne.
Ces grains écrafés fur un linge blanc, ne font d’abord
que le jaunir prefque imperceptiblement; mais
en trois ou quatre minutes , ils lui donnent un très-
beau rouge de pourpre , pourvu cependant que ce
linge foit expofé au grand air : car ce qui eft bien digne
de remarque, & fait bien voir de quelle extrême
délicateffe eft la génération de cette couleur, l’air
d’une chambre, dont même les fenêtres feroient ouvertes,
ne fuffiroit pas. La teinture de ces grains s’af*
foiblit un peu par un grand nombre de blanchiffages.
M. dé Reaumur a reconnu par quelques expériences
, que l’effet de l’air fur la liqueur des grains, con-
fifte, non en ce qu’il lui enleve quelques-unes de fes
particules, ni en ce qu’il lui en donne de nouvelles ,
mais fimplement en ce qui l’agite, 6c change l’arrangement
des parties qui la compofent. Nous avons
dans la cochenille une très-belle couleur de rouge ,
mais qui n’eft bonne que pour la laine. Le carthame
donne le beau ponceau 6c le cramoifi, mais ce n’eft
qu’à la foie. Peut-être, dit M. de Fontenelle, les
grains de M. de Reaumur nous fourniront-ils le beau
rouge pour la toile.
M. de Reaumur n’a pas manqué de comparer fa
nouvelle pourpre avec celle qui le tire de fes buccins
de Poitou. Les buccins ont à leur collier un petit ré-
fervoir appellé improprement veine par les anciens ,
qui ne contient qu’une bonne goutte de liqueur un
peu jaunâtre. Les linges qui en font teints, expofés
à une médiocre chaleur du foleil, prennent d’abord
une couleur verdâtre, enfuite une couleur de citron,
un verd plus clair & puis plus foncé, de-Ià le violet
, 6c enfin un beau pourpre. Cela fe fait en peu
d’heures : mais fi la chaleur du foleil eft fort vive ,
lescha ngemenspréliminaires ne s’apperçoi vent point,
6c le beau pourpre paroît touî-d’un-coup. Un grand
feu fait le même effet, à cela près qu’il le fait un peu
plus lentement, 6c ne produit pas une couleur fi par-
faite. Sans doute la chaleur du foleil beaucoup plus
fubtile que celle du feu de bois , eft plus propre à
agiter les plus fines particules de la liqueur. Le grand
air agit auffi, quoique moins v îte , fur la liqueur des
buccins} furtout fi elle eft détrempée dans beaucoup