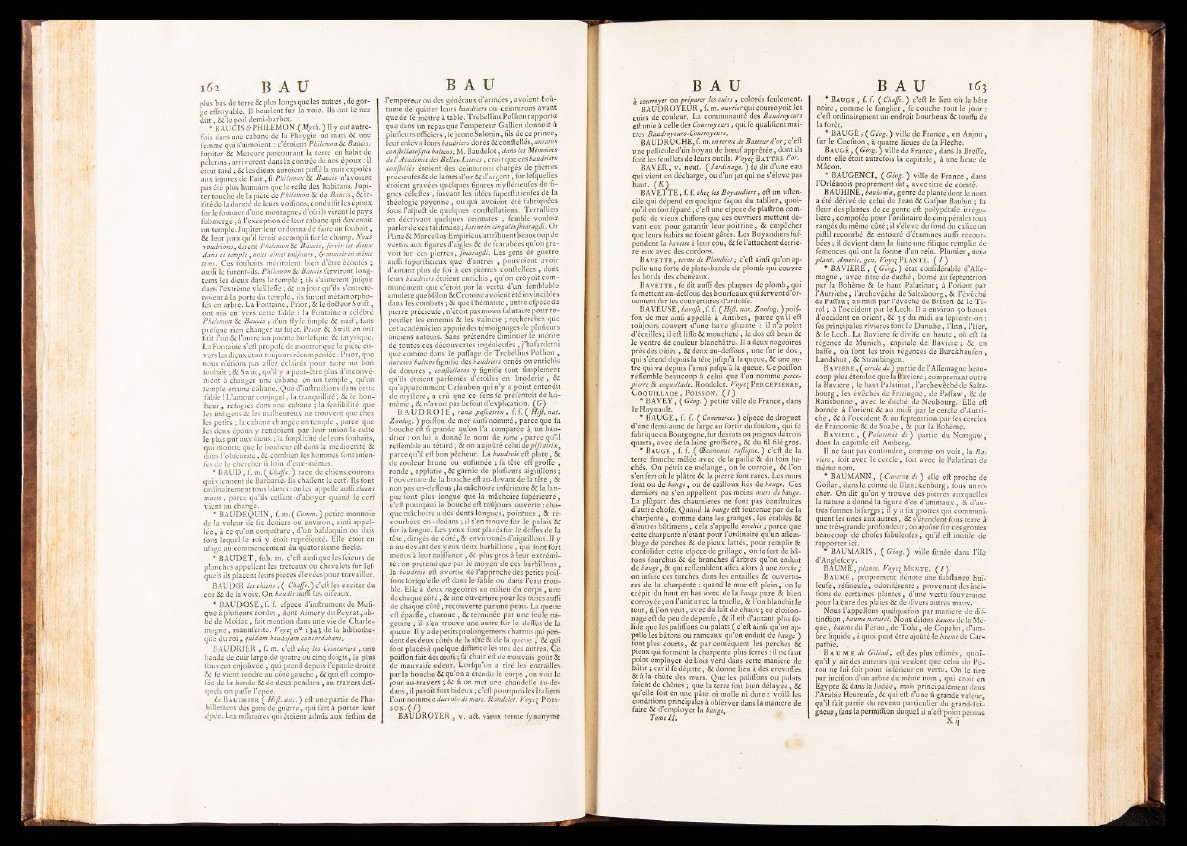
m B A U
plus bas de terre &plus longsqneles autres, de gor-
ge effroyable. Il heurlent fur la voie. Ils ont le nez
dur, 6 c le poil demi-barbet. 1 BAUCIS-S' PHILEMON^My/Â.) Il y eut autrefois
dans une cabane de la Phrygie un mari & une
femme qui s’aimoient : c’étoient Philtmon 6c Baucis.
Jupiter 6c Mercure parcourant la terre en habit de
pèlerins, arrivèrent dans la contrée de nos époux : il
étoit tard ; 6c les dieux auroient paffé la nuit expofés
aux injures de l’air , fi Philtmon 6c Baucis n’avoient
pas été plus humains que le refte des habitans. Jupiter
touché de la piété de Plùkmon & de Baucis, & irrité
de la dureté de leurs voifions, conduifitles époux
fur lefommet d’une montagne, d’où ils virent le pays
iubmergé ,à l’exception de leur cabane qui devenoit
un temple. Jupiter leur ordonna de faire un fouhait,
6c leur jura qu’il feroit accompli furie champ. Nous
voudrions, dirent Philtmon 6 c Baucis, fervir les dieux
dans ce temple, nous aimer toujours, & mourir en meme
terns. Ces fouhaits méritoient bien d’être écoutés ;
auffi le furent-ils. Philtmon & Baucis fervirent long-
tems les dieux dans le temple ; ils s’aimèrent jufque
dans l’extrême vieilleffe ; 6c un jour qu’ils s’entreté-
noient à la porte du temple, ils furent métamorpho-
fés en arbre. La Fontaine, Prior, & le doâeur Swift,
ont mis en vers cette fable : la Fontaine a célébré
Philtmon 6 c Baucis, d’un ftyle fimple & naïf , fans
prefque rien changer au fujet. Prior 6 c Swift en ont
fait l’un 6 c l’autre un poëme burlefque 6 c fatyrique.
La Fontaine s’eft propofé de montrer que la piété envers
les dieux étoit toujours réeompenfée : Prior, que
nous nétions pas affez éclairés pour faire un bon
l'ouhait ; 6 c Swift, qu’il y a peut-être plus d’inconvénient
à changer une cabane en un temple , qu’un
temple en une cabane. Que d’inftru&ions dans cette
fable ! L’amour conjugal, la tranquillité, & le bonheur
, réfugiés dans une cabane ;la fenfibilité que
les indigens & les malheureux ne trouvent que chez
les petits ; la cabane changée en temple , parce que
les deux époux y rendoient par leur union le culte
le plus pur aux dieux ; la fimplicité de leuris fouhaits,
qui montre que le bonheur eft dans la médiocrité &
dans l’obfcurité, 6 c combien les hommes font infen-
fés de le chercher fi loin d’eux-mêmes.
* BAUD, f. m. ( Chajje. ) race de chiens courans
qui viennent de Barbarie. Ils chaffent le cerf. Ils font
ordinairement tous blancs : on les appelle auffi chiens
muets, parce qu’ils ceffent d’aboyer quand le cerf
vient au change.
* BAUDEQUIN, f. m.fComm. ) petite monnoie
de la valeur de fix deniers ou environ, ainfi appel-
lée, à ce qu’on conjefture , d’un baldaquin ou dais
fous lequel le roi y étoit repréfenté. Elle étoit en
ufage au commencement du quatorzième fiecle.
* BAUDET, fub. m. c’eft ainfi que les feieurs de
planches appellent les tréteaux ou chevalets fur lef-
quels ils placent leurs pièces élevées pour travailler.
BAUD IR les chiens, ( Chajfe. ) c’eft les exciter du
cor 6 c de la voix. On baudit aufli les oifeaux.
* BAUDOSE,f. f. efpece d’inftrument de Mufi-
que à plufieurs cordes , dont Aimery du Peyrat, ab-;
bé de Moifac, fait mention dans une vie de Charlemagne,
manuferite. Voyt{ nQ 1343 de la bibliothèque
du ro i, quidam baudojàm concordabant.
BAUDRIER , f. m. c’eft chér ies C.einturiersune
bande de cuir large de quatre ou cinq doigts, le plus
fouvent enjolivée , qui prend depuis l’épaule droite
6 c fe vient rendre au côté gauche, 6 c qui eft compo-
fee de la bande 6 c de deux pendans, au travers desquels
on paffe l’épée.
Le Baudrier ( Hiß. anc. ) eft une partie de l’habillement
des gens de guerre, qui fert à porter leur
épée- Les militaires qui étoient admis aux feftins de
B A U
l’empereur ou des généraux d’armées , avoient fcou-
tume de quitter leurs baudriers ou ceinturons avant
que de fe mettre à table. Trebellius Pollion rapporte
que dans un repas que l’empereur Gallien donnoit à
plufieurs officiers, le jeune Salonin, fils de ce prince,
leur enleva leurs baudriers dorés &C conftellés, auratos
conßellatofque balteos. M. Baudelot, dans les Mémoires
de l'Académie des Belles-Lettres, croit que ces baudriers
confiellés étoient des ceinturons chargés de pierres
précieufes&de lames d’or & d’argent, fur lefquellés
étoient gravées quelques figures myftérieufes de lignes
céleftes , fuivant les idées fuperftitièufes de la
théologie payenne , ou qui avoient été fabriquées
fous l’afpeft de quelques conftellations. Tertullien
en décrivant quelques ceintures , femble vouloir
parler de ces talifmans ; latentin cingulisfmaragdi. Or
Pline 6c Marcellus Empiricus attribuent beaucoup de
vertus aux figures d’aigles & de fearabées qu’on gra-
voit fur ces pierres, fmaragdi. Les gens de guerre
auffi fuperftitieux que d’autres , pouvoient avoir
d’autant plus de foi à ces pierres conftellées , dont
leurs baudriers étoient enrichis, qu’on croyoit communément
que c’étoit par la vertu d’un femblable
amulete queMilon &Crotone avoient été invincibles
dans les combats ; & que l’hématite, autre efpecède
pierre précieufe, n’étoit pas moins falutaire pour repouffer
les ennemis & les vainére ; recherches que
cet académicien appuie des témoignages de plufieurs
anciens auteurs. Sans prétendre diminuer le mérite
de toutes ces découvertes ingénieufes, j’hafarderài
que comme dans le paffage de Trebellius Pollion ,
auratos balteos lignifie des baudriers ornés ou enrichis
de dorures , conßellatos y lignifie fout Amplement
qu’ils étoient parfemés d’étoiles en broderie , 6c
qu’apparemment Cafaubon qui n’y a point entendu
de myftere, a crû que ce fens fe préfentoit de lui-
même , 6c n’avoit pas befoin d’explication. (G) -
B A U D R O IE , rana pafeatrix , f. f. ( Hiß. nat.
Zoolog. ) poiffon de mer ainfi nommé, parce que
bouche eft fi grande qu’on l’a comparée à un baudrier
: on lui a donné le nom de rana , parçè qu’il
reffemble au têtard; & on aàjoûté celui de pifeatrix,
parce qu’il eft bon pêcheur. La baudroie eft plate, &
de couleur brune ou enfumée ; fa tête eft groffe ,
ronde , applatie ,6c garnie de plufieurs aiguillons';
l ’ouverture de la bouche eft au-devant de là tête ; &
non pas en-deffous ; la mâchoire inférieure & la langue
font plus longue que la mâchoire fupérieure,
c’eft pourquoi la bouche eft toûjôurs ouverte : chaque
mâchoire a dés dents longues, pointues , & recourbées
en-dedans ; il s’en trouve fur le palais &
fur-la langue. Les yeux font plaeésfur le deffus de la
fête, dirigés de côté, & environnés d’aiguillons. II y
a au-dèvant des yeux deux barbillons , qui font fort
menus à leur naiffance , 6c plus-gros à leur extrémité
: on prétend que par le moyen .de ces barbillons ,
la baudroie eft avertie de l’approche des petits poif-
fons lorfqu’elle eft dans le'fable ou dans l’eau trouble.
Elle a deux nageoires au milieu ducôrps,une
de chaque côté, & une ouvertuf epourles duies auffi
-de chaque côté ,-recouverte par une peau. La queiie
eft épaiffe, charnue , 6c terminée par une feule nageoire
; il s’en trouve une autre fur le déffus de la
queue II y a de petits prolongemens charnus qui pendent
des deux côtés de la tête & ;dê la queue ; & qifi
font placés à'quelque diftance'lesuns des autres. Ce
poiffon fait des oeufs ; fa chair eft de mauvàis goût &
de mauvaife odeur. Lorfqu’on a tiré les entrailles
par la Souche 6c qu’on a étendu le corps , on voit le
jour au-travers ; 6c fi on met une chandelle au-dé-
dans, il paroît fort hideux ; c’eft pourquoi lès Italiens
l’ont nommée diavolo di mare. Rondelet: Voyeç P o i s s
o n . ( '/ )
B A U D R O Y E R v . att. vieux terme fynonymè
B A U
à courroytr ou préparer les cuirs, colorés feulement.
BAUDROYEUR, f. m. ouvrier cjui courroyoit les
cuirs de couleur. La communauté des Baudroyeurs
eft unie à celle des Courroyeurs , quife qualifient maîtres
Baudroyeurs-Courroyeurs.
BAUDRUCHE, f. m. en terme de Batteur d'or ; c ’ eft
lin e p e llicu le d ’un b o y a u d e b oe u f a p p r ê t é e , d o n t ils
fo n t les feu ille ts d e le u r s o u t ils . Voye^ B a t t r e l'or.
BAVER, v. neut. ( Jardinage. ) le dit d’une eau
qui vient en décharge, ou d’un jet qui ne s’élève pas
haut. (A)/
BAVETTE, f. f. che^ les Boyaudiers , eft un uften-
cile qui dépend en quelque façon du tablier, quoiqu’il
en foitféparé ; c’eft une efpece de plaftron com-
pofé de vieux chiffons que ces ouvriers mettent devant
eux pour garantir leur poitrine, & empêcher
que leurs habits ne foient gâtés. Les Boyaudiers fuf-
pendent la bavette à leur cou, Ôtfe l’attachent derrière
eux avec des cordons.
B a v e t t e , terme de Plombier; c’eft ainfi qu’on appelle
une forte de plate-bande de plomb qui couvre
les bords des cheneaux.
B a v e t t e , fe dit auffi des plaques de plomb, qui
fe mettent au-deffous des bourfeaux qui fervent d’ornement
fur les couvertures d’ardoife.
BAVEUSE, bavofa,{. f. (Hijl. nat. Zoolog. ) poiffon
de mer ainfi appellé à Antibes, parce qu’il eft
toûjours couvert d’une bave gluante : il n’a point
d’écailles ; il êft liffe 6c moucheté, le dos eft brun 6c
le ventre de couleur blanchâtre. Il a deux nageoires
près des oüies , & deux au-deffous, une fur le dos,
qui s’étend depuis la tête jufqu’à la queue, 6c une autre
qui va depuis l’anus jufqu’à la queue. Ce poiffon
reffemble beaucoup à celui que l’on nomme perce-
pierre & coquillade. Rondelet, Voye^ P e r c e p i e r r e ,
C o q u i l l a d e , P o i s s o n . ( ƒ )
* BAVEY, ( Géog. ) petite ville de France, dans
le Haynault.
* BAUGE, f. f. ( Commerce. ) efpece de droguet
d’une demi-aune de large au fortir du foulon, qui fe
fabrique en Bourgogne,fur des rats ou peignes de trois
quarts, avec de la laine groffiere, 6c du fil filé gros.
* BaUGE , f. f. ( (Economie rujlique. ) c’eft de la
terre franche mêlée avec de la paille & du foin hachés.
On pétrit ce mélange, on le corroie, 6c l’on
s’en fert où le plâtre 6c la pierre font rares. Les murs
font ou de bauge, ou de cailloux liés de bauge. Ces
derniers ne s’en appellent pas moins murs de bauge.
La plupart des chaumières ne font pas conftruites
d’autre chofe. Quand la bauge eft foûtenue par de la
charpente, comme dans les granges, les étables 6c
d’autres bâtimens, cela s’appelle torchis ; parce que
cette charpente n’étant pour l’ordinaire qu’un affem-
blage de perches 6c de pieux lattés, pour remplir &
confolider cette efpece de grillage, on fe fert de bâtons
fourchus 6c de branches d’arbres qu’on enduit
de bauge, & qui reffemblent affez alors à une torche ;
on inféré ces torches dans les entailles 6c ouvertures
de la charpente : quand le mur eft plein, on le
crépit du haut en bas avec de la bauge pure & bien
corroyée ; on l’unit avec la truelle, & l’on blanchit le
tout, fi l’on veut, avec du lait de chaux ; ce cloifon-
nage eft de peu de dépenfe, 6c il eft d’autant plus fo-
lide que les paliffons ou palats ( c’eft ainfi qu’on appelle
les bâtons ou rameaux qu’on enduit de bauge )
font plus courts, & par conléquent les perches 6c
pieux qui forment la charpente plus ferrés : il ne faut
point employer de bois verd dans cette maniéré de
bâtir ; car il fe déjette, 6c donne lieu à des crevaffes
& à la chûte des murs. Que les paliffons ou palats
foient de chênes ; que la terre foit bien délayée, 6c
qu’elle foit en une pâte ni molle ni dure : voilà les
conditions principales à obferver dans la maniéré de faire & d’employer la baugt%
Tome II,
B A U 163
* BAUGE , f. f. ( Chajfe. ) c’eft le lieu où la bête
noire, comme le fanglier, fe couche tout le jour :
c’eft ordinairement un endroit bourbeux 6c touffu de
la forêt.
* B AUGÉ, ( Géog. ) ville de France, en Anjou
fur le Coefnon, à quatre lieues de la Fléché.
Ba u g é , ( Géog. ) ville de France, dans la Breffe,
dont elle étoit autrefois la capitale, à une lieue de
Mâcon.
* BAUGENCI, (Géog. ) ville de France, dans
l’Orléanois proprement dit, avec titre de comté.
BAUHINE, bauhinia, genre de plante dont le nom
a été dérivé de celui de Jean 6c Gafpar Bauhin ; la
fleur des plantes de ce genre eft polypétale irrégulière
, compofée pour l’ordinaire de cinq pétales tous
rangés du même côté ; il s’élève du fond du calice un
piftil recourbé 6c entouré d’étamines auffi recourbées
; il devient dans la fuite une filique remplie de
femences qui ont la forme d’un rein. Plumier, nova
plant. Americ. gen. Voyeç P l a n t e . ( / )
* BAVIERE , ( Géog. ) état confidérable d’Allemagne
, avec titre de duché, borné au feptentrion
par la Bohème & le haut Palatinat ; à l’orient par
l’Autriche, l’archevêché deSaltzbourg, & l’évêché
de Paffau ; au midi par l’évêché de Brixen 6c le T i-
rol ; à l’occident par le Lech. Il a environ 50 lieues
d’occident en orient ,6c 3 5 du midi au feptentrion :
fes principales rivières font le Danube, l’Inn, l’ifer,
& le Lech. La Bavière fe divife en haute, où eft la
régence de Munich, capitale de Bavière ; 6c en
baffe, où font les trois régences de Burckhaufen ,
Landshut, 6c Straubingen.
Bavière , ( cercle de} partie de l’Allemagne beaucoup
plus étendue que la Bhviere ; comprenant outre
la Bavière, le haut Palatinat, l’archevêché de Saltzbourg,
les évêchés de Frizingue, de Paffaw, 6c de
Ratisbonne, avec le duché de Neubourg. Elle eft
bornée à l’orient 6c au midi par le cercle d’Autriche
, & à l’occident & au feptentrion par les cercles
de Franconie 6c de Suabe, & par la Bohème.
B a v i è r e , ( Palatinat de) partie du Nortgaw
dont la capitale eft Amberg.
Il ne faut pas confondre, comme on vo it, la^Bavière
, foit avec le cercle, foit avec le Palatinat de
même nom.
* BAUMANN, ( Caverne de } elle eft proche de
Goflar, dans le comté de Blanckenburg, fous un rocher.
On dit qu’on y trouve des pierres auxquelles
la nature a donné la figure d’os d’animaux, & d’autres
formes bifarrgs ; il y a fix grottes qui communiquent
les unes aux autres, 6c s’étendent fous terre à
une très-grande profondeur; on ajoute fur ces grottes
beaucoup de chofes fabuleufes, qu’il eft inutile de
rapporter ici.
* BAUMARIS, ( Géog. ) ville fituée dans l’île'
d’Anglefcey.
BAUME,plante. Voyet^M e n t e . ( / )
B a u m e , proprement dénote une fubftance hui-'
Ieufe, réfineufe, odoriférente, provenant des inci-
fions de certaines plantes, d’une vertu fouveraine
pour la bure des plaies 6c de divers autres maux.
Nous l’appelions quelquefois par maniéré de difi
tin&ion, baume naturel. Nous difons baume de la Mé-
que, baume du Pérou , de Tolu , de Copahu , d’ambre
liquide, à quoi peut être ajoûté le baume de Car-
pathie.
B a u m e de Giléad, eft des plus eftimés, quoiqu’il
y ait des auteurs qui veulent que celui du Pérou
nç lui foit point inférieur en vertu. On le tire
par incifion d’un arbre du même nom, qui croît en
Egypte 6ç dans la Judée, mais principalement dans
l’Arabie Heureufe, 6c qui eft d’une fi grande valeur,
qu’il fait partie du revenu particulier du grand-fei-
gneur, fans la permiffion duquel il n’eft^oint permis