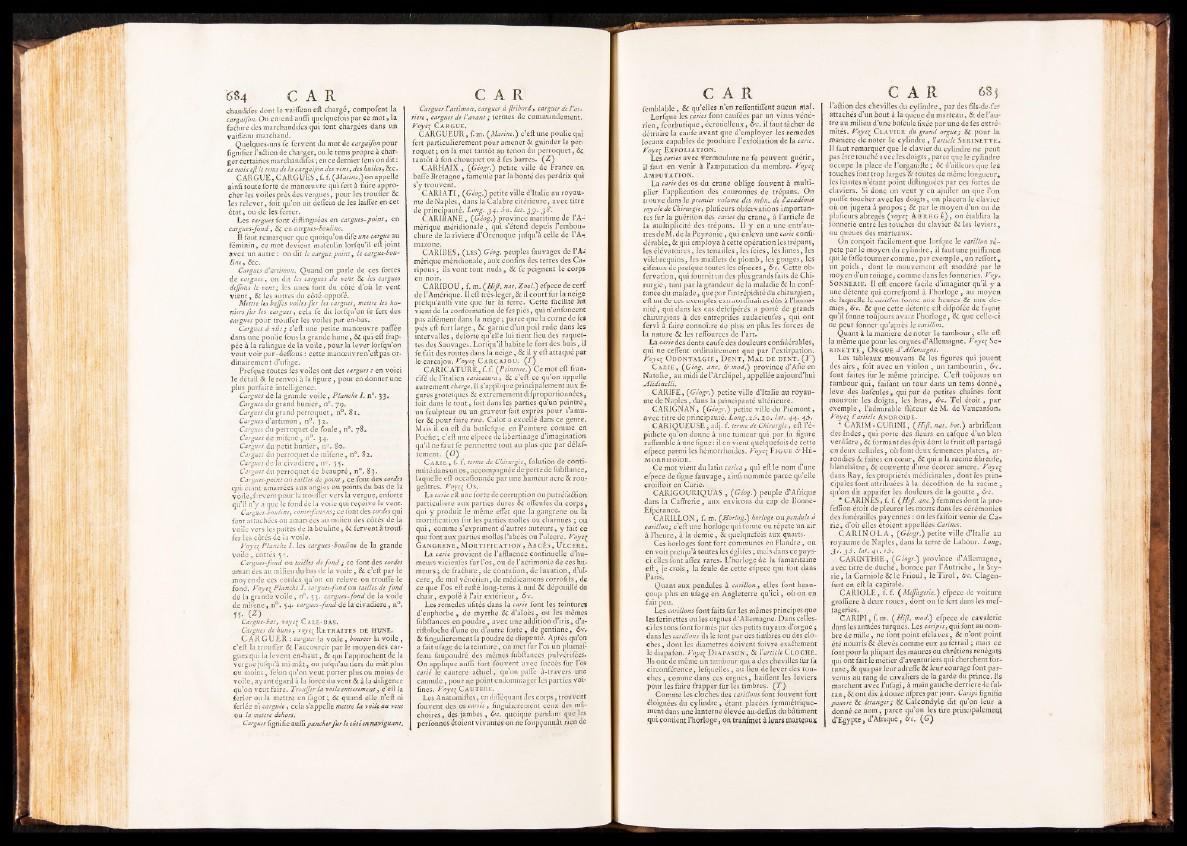
chandifes dont le vaiffeaueft chargé, compofent la 1
caroaifon. On entend aufli quelquefois par ee mot, la
faûure des marchandifes qui font chargées dans un
vaiffeau marchand.
Quelques-uns fe fervent du mot de cargo fon pour
lignifier l’aôion de charger, ouïe tems propre à charger
certaines marchandifes ; en ce dernier fens on dit :
ce mois eß le unis de la cargaijon des vins, des huiles, &c.
C ARGUE, C ARGUES, f. fi (Marine.) on appelle
ainfi toute forte de manoeuvre qui fert à taire approcher
les-voiles près des vergues, pour les trouffer ôc
les relever, foit qu’on ait deffein de les laiffer en cet
état, ou de les ferrer.
Les cargues font diftinguées en cargues~ point, en
car gués-fond , ÔC en cargues-bouline.
Il faut remarquer que quoiqu’on dife une cargue au
féminin, ce mot devient mafeulin lorfqu’il eft joint
avec un autre : on dit le carguepoint, le cargue-bou-
line, ôcc.
Cargues d'artimon. Quand on parle de ces fortes
de cargues y on dit les cargues du vent ÔC les cargues
deffous le vent; les unes font du côté d’où le vent
vient, ôc les autres du côté oppofé.
Mettre Us baffes voiles fur les cargues, mettre les huniers
fur les cargues, cela fe dit lorfqu’on fe fert des
cargues pour trouffer les voiles par en-bas.
Cargues à vue ; c’eft une petite manoeuvre paffée
dans une poulie fous la grande hune, ôc qui eft frappée
à la ralingue de la voile, pour la lever lorfqu’on
veut voir par-deffous : cette manoeuvren’eft pas ordinairement
d’ufage.
Prefque toutes les voiles ont des cargues : en voici
le détail & le renvoi à la figure, pour en donner une
plus parfaite intelligence.
Cargues de la grande voile, Planche I. n°. 33,
Cargues du grand hunier, n°. 79.
Cargues du grand perroquet, n°. 81.
Cargues d’artimon, n°. 32.
Cargues du perroquet de foule, n®. 78.
Cargues de mifene, n°. 34.
Cargues du petit hunier, n°. 80.
Cargues du perroquet de mifene, n°. 82.
Cargues de la civadiere, n°. 35.
Cargues du perroquet de beaupré, n°. 83.
Cargues-point ou tailles de point, ce font des cordes
qui étant amarrées aux angles ou points du bas de la
voile, fervent pour la trouffer vers la vergue, enforte
qu’il n’y a que le fond de la voile qui reçoive le venr.
Cargues-bouline, contrefinons; ce font des cordes qui
font attachées ou amarrées au milieu des côtés de la
voile vers les partes de la bouline, ôc fervent à trouffer
les côtés de la voile.
Foyei Planche I. les cargues-bouline de la grande
voile , cottes 5 1.
Cargues-fond ou tailles de fond ; ce font des cordes
amarrées au milieu du bas de la voile, ôc c’eft par le
moyen de ces cordes qu’on en releve ou trouffe le
fond. Voyc? Planche I. cargues-fond on tailles de fond
de la grande v o ile, n°. 53. cargues-fond de la voile
de mifene, n°. 54. cargues-fond de la civadiere, n°.
H H I , ■ Cargue-baSy voyeç C ale-B AS.
Cargues de hune , voye^ RETRAITES DE HUNE.
C A R G U E R : carguer la voile , bourcer la voile ,
c’eft la trouffer ÔC raccourcir par le moyen des cargues
qui la lèvent en-haut, & qui l’approchent de la
vergue jufqu’à mi-mât, ou jufqu’au tiers du mât plus
ou moins, félon qu’on veut porter plus ou moins de
voile, ayant égard à la force du vent & à la diligence
qu’on veut faire. Trouffer la voile entièrement y c’eft la
ferler ou la mettre en fagot ; ÔC quand elle n’eft ni
ferlée ni carguée, cela s’appelle mettre la voile au vent
ou la mettre dehors.
Carguer fignifie aulîi pancherfur le côte en naviguant.
Carguer l'artimon, carguer à flribordy carguer de Tar^
riere, carguer de l'avant ; termes de commandement.
Foyei Cargue.
CARGUEUR, f. m. (Marine.) c’eft une poulie qui
fert particulièrement pour amener & guinder le perroquet
; on la met tantôt au tenon du perroquet, ôc.
tantôt à fon chouquet ou à fes barres. {Z)
CARHAIX , {Géogr.) petite ville de France en
baffe Bretagne, fameufe par la bonté des perdrix qui
s’y trouvent.
C ARIATI, {Géog.) petite ville d’Italie au royaume
de Naples, dans la Calabre citérieure, avec titre
de principauté. Long. 3 4 .5o. lat. 35). g8.
CARIBANE, {Géog.) province maritime de l’Amérique
méridionale , qui s’étend depuis l’embouchure
de la rivière d’Orenoque jufqu’à celle de l’Amazone.
CARIBES, (les) Géog. peuples fauvages de l’A«
mérique méridionale, aux confins des terres des Ca-
ripous ; ils vont tout nuds, ôc fe peignent le corps
en noir.
CARIBOU, f. m. {Hifl. nat. Zool.) efpece de cerf
de l’Amérique. II eft très-leger, & il court fur la neige
prefqu’auffi vite que fur la terre. Cette facilité lui
vient de la conformation de fes piés, qui n’enfoncent
pas aifément dans la neige ; parce que la corne de fes
piés eft fort large, ÔC garnie d’un poil rude dans les
intervalles, deforte qu’elle lui tient lieu des raquettes
des Sauvages. Lorlqu’il habite le fort des bois, il
fe fait des rputes dans la neige, & il y eft attaqué par
le carcajou. Voye%_ Carcajou. (/ )
CARICATURE, f. fi {Peinture.) Ce mot eft fran-
cifé de l’italien caricatura, ôc c’eft ce qu’on appelle
autrement, charge. Il s’applique principalement aux fit
guresgrotelques ôc extrêmement difproportionnées,
foit dans le tout, foit dans les parties qu’un peintre,
un fculpteur ou un graveur fait exprès pour s’amu-
fer ôc pour faire rire. Calot a excellé dans ce genre.
Mais il en eft du burlefque en Peinture comme en
Poéfie ; c’eft une efpece de libertinage d’imagination
qu’il ne faut fe permettre tout au plus que par délaf-,
lèment. (O)
Carie , f. fi terme de Chirurgie y folution de continuité
dans un os, accompagnée de perte de fubftance,
laquelle eft occafionnée par une humeur acre & rougeâtres.
Voye{ Os.
La carie eft une forte de corruption ou putréfaûion.
particulière aux parties dures ôc offeufes du corps
qui y produit le même effet que la gangrené ou la
mortification fur les parties molles ou charnues ; ou
qui, comme s’expriment d’autres auteurs, y fait ce
que font aux parties molles l’abcès ou l’ulcere. Voye%
Gangrené, Mortification, Abcès, Ulcéré.
La carie provient de l’affluence continuelle d’humeurs
vicieufes fur l’os,, ou de l’acrimonie de ces humeurs
; de fraûure, de contufion, de luxation, d’ul-
cere, de mal vénérien, de médicamens corrofifs, de
ce que l’os eft refté long-tems à nud ôc dépouillé de
chair, expofé à l’air extérieur, &c.
Les remedes ufités dans la carie font les teintures
d’euphorbe , de myrrhe ÔC d’aloès, ou les mêmes
fubftances en poudre, avec une addition d’iris, d’a-
riftoloche d’une ou d’autre forte * de gentiane, &c,
& fingulierement la poudre de diapente. Après qu’on
a fait ufage de la teinture, on met fur l’os un plumaf-
feau faupoudré des mêmes fubftances pulvérifées.
On applique aufli fort fouvent avec fuccçs fur l’os
carié le cautere aftuel, qu’on paffe à-travers une
cannule, pour ne point endommager les parties voi-
fines. Foye^ Cautere.
. Les Anatomiftes, en diflequant des corps, trouvent
fouvent des os cariés y fingulierement ceux des mâchoires,
des jambes , &c. quoique pendant que le.s
perfohnes étoient vivanteson ne foupçonnât riende
femblable, Ôc qu’elles n’en reffentiffeiit aucun «tal.
Lorfque les caries font caufées par un virus vénérien
, feorbutique, écroûelleux * &c. il faut tâcher de
détruire la caufe avant que d’employer les remedes
locaux capables de produire l’exfoliation de la carie.
Voye{ Exfoliation.
Les caries avec Vermoulure ne fe peuvent guérir,
il faut en venir à l’amputation du membre. Voyeç
Amputation.
La carie des os du crâne oblige fouvent à multiplier
l ’application des couronnes de trépans. On
trouve dans le premier volume des mém. de l'academie
royale de Chirurgity plufieurs obfervations importantes
fur la guérifon des caries du crâne, à l’article de
la multiplicité des trépans. Il y en a une entr’au-
tres deM. de la Peyronie, qui enleva une carie eonfi-
dérable, & qui employa à cette opération les trépans,
les élévatoires, les tenailles, les foies * les limes, les
vilebrequins, les maillets de plomb, les gouges, les
cifeaux de prefque toutes les efpeces, &c. Cette ob-
fervation, qui fournit un des plus grands faits de Chirurgie
* tant par la grandeur de la maladie ôc la confiance
du malade, que par l’intrépidité du chirurgien,
eft un de ces exemples extraordinaires dûs à l’humanité
, qui dans les cas defefpérés a porté de grands
chirurgiens à des entreprifes audacieufes , qui ont
fervi à faire connoîire de plus en plus les forces de
la nature ôc les reffources de l’art.
La carie des dents caufe des douleurs confidérables,
qui ne ceffent ordinairement que par l’extirpation.
Voye^ Odontalgie, Dent, Mal de dent. (T)
C arie, {Géog. anc. & mod.) province d’Afie en
Natoiie, au midi de l’Archipel, appellée aujourd’hui
Alidinelli.
CARIFE, {Géogr.) petite ville d’Italie au royaume
de Naples, dans la principauté ultérieure.
CAR1GNAN, {Géogr.) petite ville du Piémont ,
avec titre de principauté. Long. x5. zo. lat. 44. 46.
CARIQUEUSE, adj. fi terme de Chirurgie, eft l’é-
pithete qu’on donne à une tumeur qui par fa figure
reffemble à une figue : il en vient quelquefois de cette
efpece parmi les hémorrhoïdes. Voye%_ Figue & HÉ-
MORRHOÏDE.
Ce mot vient du latin carica , qui eft le nom d’une
efpece de figue fauvage, ainfi nommée parce qu’elle
croiffoit en Carie..-'
CARIGOURIQÜAS , {Géog.) peuple d’Afrique
dans la Caffrerie , aux environs du cap de Bonne-
Efpérance.
CARILLON, f. m. {fforlog.) horloge on pendule à
carillon; c’eft une horloge qui fonne. ou répété un air
à l’heure, à la demie, & quelquefois aux quarts.
Ces horloges font fort communes en Flandre, on
en voit prefqu’à toutes les églifes ; mais dans ce pays-
ci elles font affez rares. L’horloge de la famaritaine
eft, je crois, la feule de cette efpece qui foit dans
Paris.
Quant aux pendules à carillon, elles font beaucoup
plus en ufage en Angleterre qu’ic i, où on en
fait peu.
Les carillons font faits fur les mêmes principes que
les ferinettes ou les orgues d’Allemagne. Dans celles-
ci les tons font formés p;ar des petits tuyaux d’orgue ;
dans les carillons ils le lont par des timbres ou des cloches
, dont les diamètres doivent fuivre exaôement
lediapafon. Voyc^ Diapason, & Varticle Cloche.
Ils ont de même un tambour qui a des chevilles fur fa
circonférence, lefquelles, au lieu de lever des touches
, comme dans ces orgues, baiffent les leviers
pour les faire frapper fur les timbres. {T )
Comme les cloches des carillons font fouvent fort
éloignées du cylindre, étant placées fymmétrique-
ment dans une lanterne élevée au-deffus du bâtiment
qui contient, l’horloge, on tranfmet à leurs marteaux
l’àdion des chevilles du cylindre, par des fils-de-fer
attachés d’un bout à la queue du marteau t & de l’autre
au milieu d’une bafoule fixée par une de fes extrémités.
Vtye^ Clavier du grand orgue; Ôc pour la
maniéré de noter le cylindre, l’article Serinette*
Il faut remarquer que le clavier du cylindre ne peut
pas être touché avec les doigts, parce que le cylindre
occupe la place de l ’organifte ; ôc d’ailleurs que le£
touches font trop larges & toutes de même longueur*
les feintes n’étant point diftingiiées par ces fortes de
claviers. Si donc on veut y en ajufter un que l’oii
puiffe toucher avec les doigts, on placera le clavier
où on jugera à propos ; ôc par le moyen d’un ou de
plufieurs abrégés {voye[ Ab r égé) , on établira la
lonnerie entre les touches du clavier ôc les leviers,
ou queues des marteaux.
On conçoit facilement que lorfqite le carillon répété
par le moyen du cylindre, il faut unepuiffance
qui le faffe tourner comme, par exemple, un reffort*
un poids, dont le mouvement eft modéré par lé
moyen d’un rôüage* comme dans les fonneries. Voy. Sonnerie. Il eft encore facile d’imaginer qu’il y a
une détente qui correfpond à l’horloge , au moyen
de laquelle le carillon fonne aux heures & aux demies,
&c. ôc que cette détente eft difpofée de façon
qu’il fonne toûjOurs avant l’horloge, ôc que celle-ci
ne peut fonner qu’après le carillon.
. Quant à la maniéré de noter le tambour, elle eft
la même que pour les orgues d’AUemagnc. Voye{ Se-
RINETTE , O RGUE d'Allemagne.
Les tableaux mouvans ôc les figures qui jouent
des âirs, foit avec un violon , un tambourin, &c,
font faites fur le même principe. Ç ’eft toujours un
tambour qui, faifant un tour dans un tems donné ,
lève des bafcules, qui par de petites chaînes font
mouvoir les doigts, les bras, &c. Tel é to it, par
exemple., l’admirable fluteur deM. deVaucanfon*
V oye^ l'article ANDROÏDE.
* CARIM-CURINI, {Hifl. nat. bot.) arbriffeau
des Indes, qui porte des fleurs en cafque d’un bleu
verdâtre, ôc formant des épis dont le fruit eft partagé
en deux cellules, où font deux femences plates, arrondies
ôc faites en coeur, ôc qui a la racine fibreufe*
blanchâtre, ôc couverte d’une écorce amere. Poye^
dans Ray, fes propriétés médicinales, dont les principales
font attribuées à la déeo&ion de la racine ,
qu’on dit appaifer les douleurs de la goutte, &c.
* CARINES, f. f. {Hifl, anc.) femmes dont la pro-
feflïon étoit de pleurer les morts dans les cérémonies
des funérailles payennes : on les faifoit venir de Carie,
d’où elles étoient appellées Carines.
C A R IN O L A , {Géogr.) petite ville d’Italie au
royaume de Naples, dans la terre de Labour. Long.
lat- >3‘
. CARINTHIE, {Géogr.) province d’Allemagne*
avec titre de duché, bornée par l’Autriche, la Sty-
rie, la Carniole ôc le Frioul, le Tiro l, &c. Clagen-
furt en eft la capitale.
CARI OLE, fi f. ( Meffagerie.) efpece de voiture
grofîiere à deux roues, dont on fe fert dans Us mef-
lageries.
CARIPI, f. m. {Hifi. mod.) efpece de cavalerie
dans les armées turques. Les caripis, qui font au nombre,
de mille, ne font point efolaves, ôc n’ont point
été nourris ôc élevés comme eux au ferrail ; mais ce
font pour la plûpart des maures ou chrétiens renégats
qui ont fait le métier d’aventuriers qui cherchent fortune
, Ôc qui par leur adreffe Ôc leur courage font parvenus
au rang de cavaliers de la garde du prince. Ils
marchent avec l’ufagi, à main gauche derrière 4e ful-
jtan, ÔC ont dix à douze afpres par jour. Caripi fignifie
pauvre ôc étranger; ÔC Calcondyle dit qu’on leur a
donné ce, nom, parce qu’on les tire principalement
d’Égypte, d’Afrique, &c, (G)