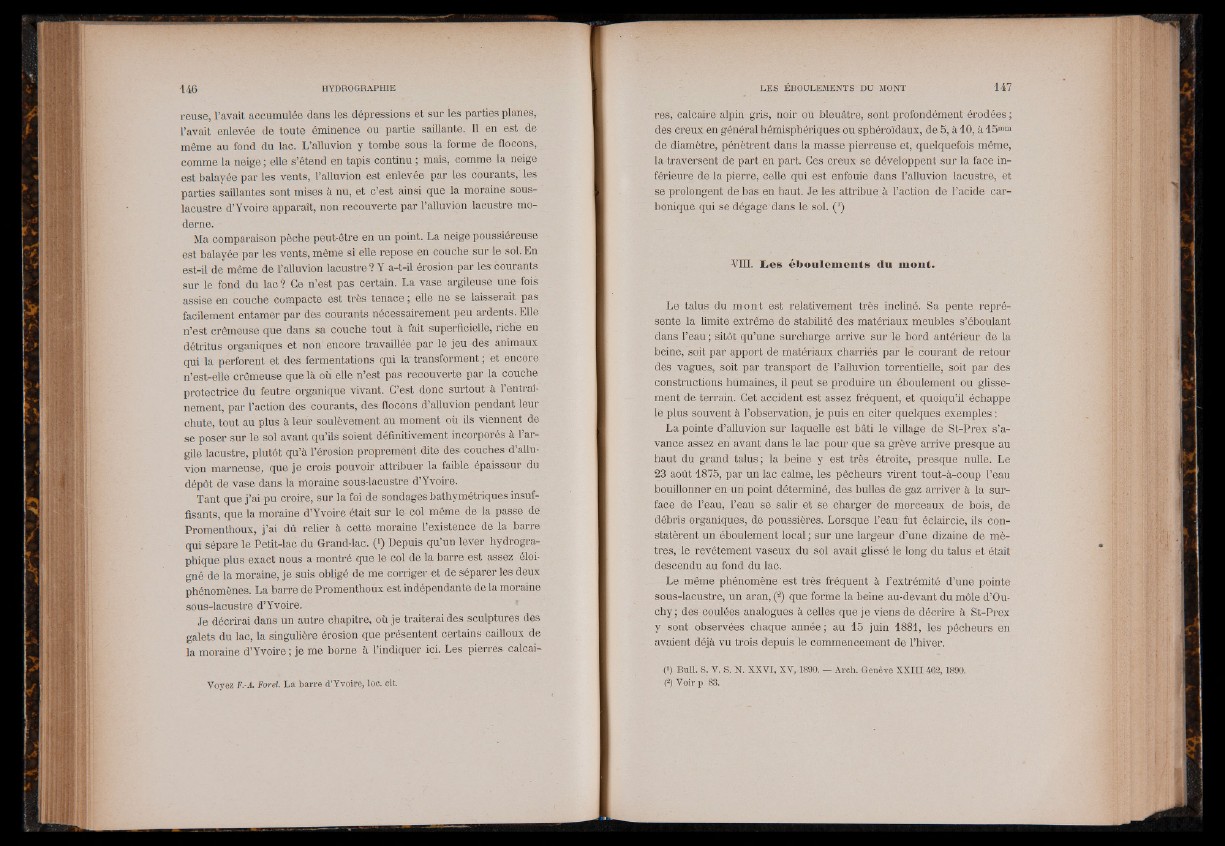
reuse, l’avait accumulée dans les dépressions et sur les parties planes,
l’avait enlevée de toute éminence ou partie saillante. Il en est de
même au fond du lac. L’alluvion y tombe sous la forme de flocons,
comme la neige ; elle s’étend en tapis continu ; mais, comme la neige
est balayée par les vents, l’alluvion est enlevée par les courants, les
parties saillantes sont mises à nu, e t c’est ainsi que la moraine sous-
lacustre d’Yvoire apparaît, non recouverte par l’alluvion lacustre moderne.
Ma comparaison pèche peut-être en un point. La neige poussiéreuse
est balayée par les vents, même si elle repose en couche sur le sol. En
est-il de même de l’alluvion lacustre ? Y a-t-il érosion par les' èourants
sur le fond du lac ? Ce n’est pas certain. La vase argileuse une fois
assise en couche compacte est très tenace ; elle ne se laisserait pas
facilement entamer par des courants nécessairement peu ardents. Elle
n’est crémeuse que dans sa couche tout à fait superficielle, riche en
détritus organiques et non encore travaillée par le jeu des animaux
qui la perforent et des. fermentations qui la'transforment ; et encore
n’est-elle crémeuse que là oü elle n’est pas recouverte par la couche
protectrice du feutre organique vivant. C’est donc surtout à l’entraînement,
par l’action dés courants, des flocons d ’alluvion pendant leur
chute, tout au plus à leur soulèvement au moment où ils viennent de
se poser sur le sol avant qu’ils soient définitivement incorporés à l’argile
lacustre, plutôt qu’à l’érosion propremént dite des couches d’alluvion
marneuse, que je crois pouvoir attribuer la faible épaisseur du
dépôt de vase dans la moraine sous-lacustre d’Yvoire.
Tant que j’ai pu croire, sur la foi de sondages bathymétriques insuffisants,
que la moraine d’Yvoire était sur le col même de la passe de
Promenthoux, j’ai dû relier à cette moraine l’existence de la barre
qui sépare le Petit-lac du Grand-lac. Q) Depuis qu’un lever hydrographique
plus exact nous a montré que le col de la barre est assez éloigné
de la moraine, je suis obligé de me corriger et de séparer les deux
phénomènes. La barre de Promenthoux est indépendante d e là moraine
sous-lacustre d’Yvoire.
Je décrirai dans un autre chapitre, où je traiterai des sculptures des
galets du lac, la singulière érosion que présentent certains cailloux de
la moraine d’Yvoire ; je me borne à l’indiquer ici. Les pierres calcai-
Voyez F.-A. Forel. La barre d’Yvoire, loc. cit.
res, calcaire alpin gris, noir où bleuâtre, sont profondément érodées ;
des creux en général hémisphériques ou sphéroïdaux, de 5, à 40, à 15mm
de diamètre, pénètrent dans la masse pierreuse et, quelquefois même,
la traversent de part en part. Ces creux se développent sur la face inférieure
de la pierre, cellè qui est enfouie dans l’alluvion lacustre, et
se prolongent de bas en haut. Je les attribue à l’action de l’acide carbonique
qui se dégage dans le sol. (1)
VJ.I1. lies éfooulements du mont.
Le talus du m o n t est relativement très incliné. Sa pente représente
la limite extrême de stabilité des matériaux meubles s ’éboulant
dans l’eau ; sitôt qu’une surcharge arrive sur le bord antérieur de la
beine, soit par apport de matériaux charriés par le courant de retour
des vagues, soit par transport de l’alluvion torrentielle, soit par des
constructions humaines, il peut se produire un éboulement ou glissement
de terrain. Cet accident est assez fréquent, et quoiqu’il échappe
le plus souvent à l’observation, je puis en citer quelques exemples :
La pointe d’alluvion sur laquelle est bâti le village de St-Prex s ’avance
assez èn avant dans le lac pour que sa grève arrive presque au
haut du grand talus; la beine y est très étroite, presque nulle. Le
23 août 1875, par un lac calme, les pêcheurs virent tout-à-coup l’eau
bouillonner en un point déterminé, des bulles de gaz arriver à la surface
de l’eau, l’eau se salir et se charger de morceaux de bois, de
débris organiques, de poussières. Lorsque l’eau fut éclaircie, ils constatèrent
un éboulement local ; sur une largeur d’une dizaine de mètres,
le revêtement vaseux du sol avait glissé le long du talus et était
descendu au fond du lac.
Le même phénomène est très fréquent à l’extrémité d’une pointe
sous-lacustre, un aran, (2) que forme la beine au-devant du môle d’Ou-
chy ; des coulées analogues à celles que je viens de décrire à St-Prex
y sont observées chaque année ; au 45 juin 1884, les pêcheurs en
avaient déjà vu trois depuis le commencement de l’hiver.
(fi Bull. S. V. S. N. XXVI, XV, 1890. — Arch. Genève XXIII 462,1890.
P) Voir p 83.