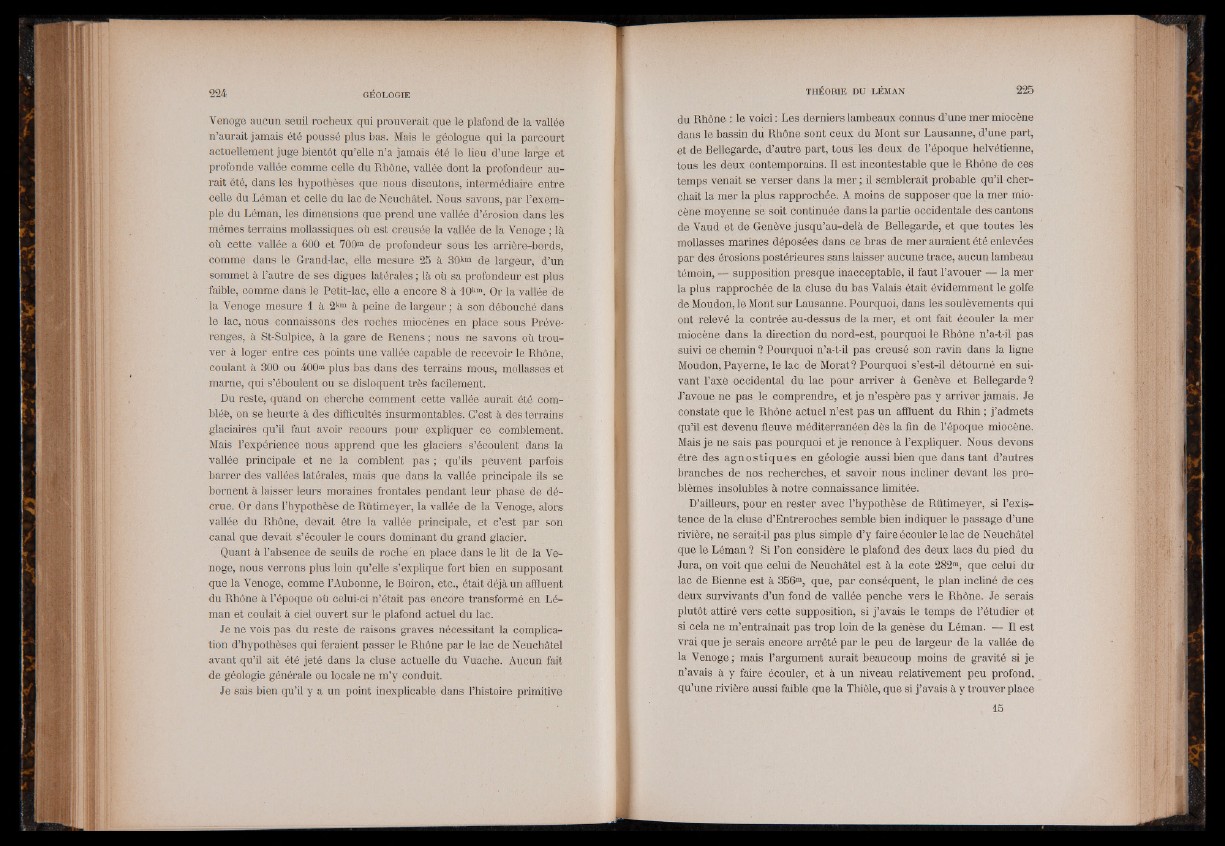
Venoge aucun seuil rocheux qui prouverait que le plafond de la vallée
n ’aurait jamais été poussé plus bas. Mais le géologue qui la parcourt
actuellement juge bientôt qu’elle n’a jamais été le lieu d’une large et
profonde vallée comme celle du Rhône, vallée dont la profondeur aurait
été, dans les hypothèses que nous discutons, intermédiaire entre
celle du Léman et celle du lac de Neuchâtel. Nous savons, par l’exemple
du Léman, les dimensions que prend une vallée d’érosion dans les
mômes terrains mollassiques où est creusée la vallée de la Venoge ; là
où cette vallée a 600 et 700m de profondeur sous les arrière-bords,
comme dans le Grand-lac, elle mesure 25 à 30km de largeur, d’un
sommet à l’autre de ses digues latérales ; là où sa profondeur est plus
faible, comme dans le Petit-lac, elle a encore 8 à 10ltm. Or la vallée de
la Venoge mesure 1 à 2km à peine de largeur ; à son débouché dans
le lac, nous connaissons des roches miocènes en place sous Préve-
renges, à St-Sulpice, à la gare de Renens ; nous ne savons où trouver
à loger entre ces points une vallée capable de recevoir le Rhône,
coulant à 300 ou 400m plus bas dans des terrains mous, mollasses et
marne, qui s’éboulent ou se disloquent très facilement.
Du reste, quand on cherche comment cette vallée aurait été com-
bléfe, on se heurte à des difficultés insurmontables. C’est à des terrains
glaciairés qu’il faut avoir recours pour expliquer ce comblement.
Mais l’expérience nous apprend que les glaciers s ’écoulent dans la
vallée principale et ne la comblent pas ; qu’ils peuvent parfois
barrer des vallées latérales, mais que dans la vallée principale ils se
bornent à laisser leurs moraines frontales pendant leur phase de décrue.
Or dans l’hypothèse de Rütimeyer, la vallée de la Venoge, alors
vallée du Rhône, devait être la vallée principale, et c’est p a r son
canal que devait s’écouler le cours dominant du grand glacier.
Quant à l’absence de seuils de roche en place dans le lit de la Venoge,
nous verrons plus loin qu’elle s’explique fort bien en supposant
que la Venoge, comme l’Aubonne, le Boiron, etc., était déjà un affluent
du Rhône à l’époque où celui-ci n’était pas encore transformé en Léman
et coulait à ciel ouvert sur le plafond actuel du lac.
Je ne vois pas du reste de raisons graves nécessitant la complication
d’hypothèses qui feraient passer le Rhône par le lac de Neuchâtel
avant qu’il ait été jeté dans la cluse actuelle du Vuache. Aucun fait
de géologie générale ou locale ne m’y conduit.
Je sais bien qu’il y a un point inexplicable dans l’histoire primitive
du Rhône : le voici : Les derniers lambeaux connus d’une m er miocène
dans le bassin du Rhône sont ceux du Mont sur Lausanne, d’une part,
et de Bellegarde, d’autre part, tous les deux de l’époque helvétienne,
tous les deux contemporains. Il est incontestable que le Rhône de ces
temps venait se verser dans la mer ; il semblerait probable qu’il cherchait
la mer la plus rapprochée. A moins de supposer que la mer miocène
moyenne se soit continuée dans la partie occidentale des cantons
de Vaud et de Genève jusqu’au-delà de Bellegarde, et que toutes les
mollasses marines déposées dans ce bras de mer auraient été enlevées
par des érosions postérieures sans laisser aucune trace, aucun lambeau
témoin, — supposition presque inacceptable, il faut l’avouer — la mer
la plus rapprochée de la cluse du bas Valais était évidemment le golfe
de Moudon, le Mont sur Lausanne. Pourquoi, dans les soulèvements qui
ont relevé la contrée au-dessus de la mer, et ont fait écouler la mer
miocène dans la direction du nord-est, pourquoi le Rhône n’a-t-il pas
suivi ce chemin ? Pourquoi n ’a-t-il pas creusé son ravin dans la ligne
Moudon, Payerne, le lac de Morat? Pourquoi s’est-il détourné en suivant
l’axè occidental du lac pour arriver à Genève et Bellegarde?
J ’avoue ne pas le comprendre, et je n’espère pas y arriver jamais. Je
constate que le Rhône actuel n’est pas un affluent du Rhin ; j ’admets
qu’il est devenu fleuve méditerranéen dès la fin de l’époque miocène.
Mais je ne sais pas pourquoi et je renonce à l’expliquer. Nous devons
être des a g n o s t iq u e s en géologie aussi bien que dans tant d’autres
branches de nos recherches, et savoir nous incliner devant les problèmes
insolubles à notre connaissance limitée.
D’ailleurs, pour en rester avec l’hypothèse de Rütimeyer, si l’existence
de la cluse d’Entreroches semble bien indiquer le passage d’une
rivière, ne serait-il pas plus simple d’y faire écouler le lac de Neuchâtel
que le Léman ? Si l’on considère le plafond des deux lacs du pied du
Jura, on voit que celui de Neuchâtel est à la cote 282m, que celui du
lac de Bienne est à 356m, que, par conséquent, le plan incliné der.ces
deux survivants d’un fond de vallée penche vers le Rhône. Je serais
plutôt attiré vers cette supposition, si j’avais le temps de l’étudier et
si cela ne m’entraînait pas trop loin de la genèse du Léman. iM jn est
vrai que je serais encore arrêté par le peu de largeur de la vallée de
la Venoge ; mais l’argument aurait beaucoup moins de gravité si je
n’avais à y faire écouler, et à un niveau relativement peu profond,
qu’une rivière aussi faible que la Thièle, que si j ’avais à y trouver place