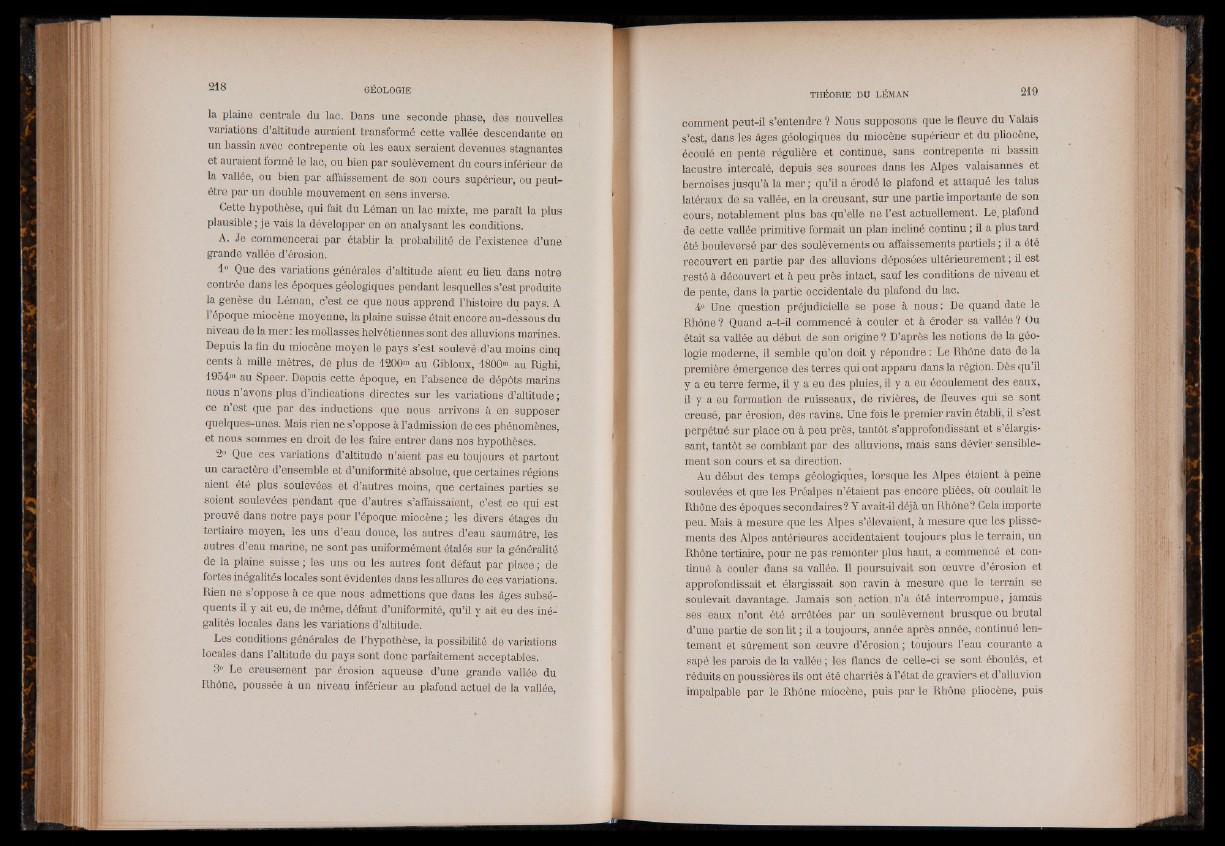
la plaine centrale du lac. Dans une seconde phase, des nouvelles
variations d’altitude auraient transformé cette vallée descendante en
un bassin avec contrepente où les eaux seraient devenues stagnantes
et auraient formé le lac, ou bien p ar soulèvement du cours inférieur de
la vallée, ou bien par affaissement de son cours supérieur, ou peut-
être par un double mouvement en sens inverse.
Cette hypothèse, qui fait du Léman un lac mixte, me paraît la plus
plausible ; je vais la développer en en analysant les conditions.
A. Je commencerai par établir la probabilité de l’éxistence d’une
grande vallée d’érosion.
I o Que des variations générales d’altitude aient eu beu dans notre
contrée dans les époques géologiques pendant lesquelles s’est produite
la genèse du Léman, c’est ce que nous apprend l’histoire du pays. A
l’époque miocène moyenne, la plaine suisse était encore au-dessous du
niveau de la mer : les mollasses helvétiennes sont des allu vions marines.
Depuis la fin du miocène moyen le pays s’est soulevé d’au moins cinq
cents à mille mètres, de plus de 1200“ au Gibloux, 1800“ au Righi,
1954“ au Speer. Depuis cette époque, en l’absence de dépôts marins
nous n’avons plus d’indications directes sur les variations d’altitude;
ce n est que par des inductions que nous arrivons à en supposer
quelques-unes. Mais rien ne s’oppose à l’admission de ces phénomènes,
et nous sommes en droit de les faire entrer dans nos hypothèses.
2° Que ces variations d’altitude n’aient pas eu toujours et partout
un caractère d’ensemble et d’uniforihité absolue, que certaines régions
aient été plus soulevées et d’autres moins, que certaines parties se
soient soulevées pendant que d’autres s’affaissaient, c’est ce qui est
prouvé dans notre pays pour l’époque miocène ; les divers étages du
tertiaire moyen, les uns d’eau douce, les autres d’eau saumâtre, les
autres d’eau marine, ne sont pas uniformément étalés sur la généralité
de la plaine suisse ; les uns ou lés autres font défaut par place ; de
fortes inégalités locales sont évidentes dans les allures de ces variations.
Rien ne s’oppose à ce que nous admettions que dans les âges subséquents
il y ait eu, de même, défaut d’uniformité, qu’il y ait eu des inégalités
locales dans les variations d’altitude.
Les conditions générales de l’hypothèse, la possibilité de variations
locales dans l’altitude du pays sont donc parfaitement acceptables.
3° Le creusement par érosion aqueuse d’une grande vallée du
Rhône, poussée à un niveau inférieur au plafond actuel de la vallée,
comment peut-il s’entendre? Nous supposons que le fleuve du Valais
s’est, dans les âges géologiques du miocène supérieur et du pliocène,
écoulé en pente régulière et continue, sans contrepente ni bassin
lacustre intercalé, depuis ses sources dans les Alpes valaisannes et
bernoises jusqu’à la mer ; qu’il a érodé le plafond et attaqué les talus
latéraux de sa vallée, en la creusant, sur une partie importante de son
cours, notablement plus bas qu’elle ne l’est actuellement. Le. plafond
de cette vallée primitive formait un plan incliné continu ; il a plus tard
été bouleversé par des soulèvements ou affaissements partiels ; il a été
recouvert en partie par des alluvions déposées ultérieurement ; il est
resté à découvert et à peu près intact, sauf les conditions de niveau et
de pente, dans la partie occidentale du plafond du lac.
4° Une question préjudicielle se pose à nous : De quand date le
Rhône ? Quand a-t-il commencé à couler et à éroder sa vallée ? Ou
était sa vallée au début de son origine ? D’après les notions de la géologie
moderne, il semble qù’on doit y répondre : Le Rhône date de la
première émergence des terres qui ont apparu dans la région. Dès qu’il
y a eu terre ferme,, il y a eu des pluies, il y a eu écoulement des eaux,
il y a eu formation de ruisseaux, de rivières, de fleuves qui se sont
creusé, par érosion, des ravins. Une fois le premier ravin établi, il s’est
perpétué sur place ou à peu près, tantôt s’approfondissant et s’élargissant,
tantôt se comblant par des alluvions, mais sans dévier sensiblement
son cours et sa direction.
Au début des temps géologiques, lorsque les Alpes étaient à peine
soulevées et que les Préalpes n’étaient pas encore pliées, où coulait le
Rhône des époques secondaires? Y avait-il déjà un Rhône? Cela importe
peu. Mais à mesure que les Alpes s’élevaient, à mesure que les plissements
dés Alpes antérieures accidentaient toujours plus le terrain, un
Rhône tertiaire, pour ne pâs remonter plus haut, a commencé et continué
à couler dans sa vallée. Il poursuivait son oeuvre d’érosion et
approfondissait et élargissait son ravin à mesure que le terrain se
soulevait davantage. Jamais son action.n’a été interrompue, jamais
ses eaux n’ont été arrêtées par un soulèvement brusque ou brutal
d’une partie de son lit ; il a toujours, année après année, continué lentement
et sûrement son oeuvre d’érosion; toujours l’eau courante a
sapé les parois de la vallée ; les flancs de celle-ci se sont éboulés, et
réduits en poussières ils ont été charriés à l’état de graviers et d’alluvion
impalpable par le Rhône miocène, puis par le Rhône pliocène, puis