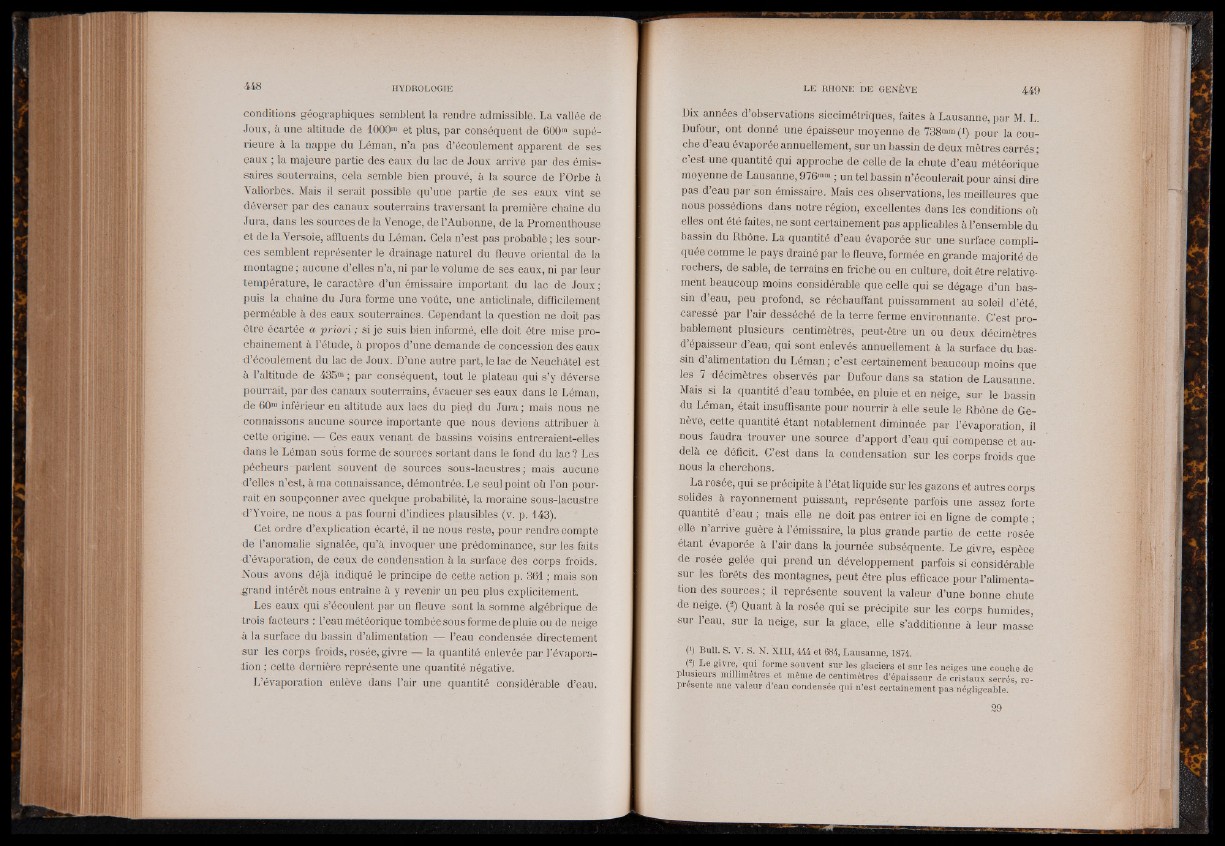
conditions géographiques semblent la rendre admissible. La vallée de
Joux, à une altitude de 1000™ et plus, par conséquent de 600™ supérieure
à la nappe du Léman, n’a pas d’écoulement apparent de ses
eaux ; la majeure partie des eaux du lac de Joux arrive par des émissaires
souterrains, cela semble bien prouvé, à la source de l’Orbe à
Vallorbes. Mais il serait possible qu’une partie .de ses eaux vînt se
déverser par des canaux souterrains traversant la première chaîne du
Jura, dans les sources de la Venoge, d e l’Aubonne, de la Promenthouse
e t de la Versoie, affluents du Léman. Cela n’est pas probable; les sources
semblent représenter le drainage naturel du fleuve oriental de la
montagne ; aucune d’elles n ’a, ni par le volume de ses eaux, ni par leur
température, le caractère d’un émissaire important du lac de Joux ;
puis la chaîne du Jura forme une voûte, une anticlinale, difficilement
perméable à des eaux souterraines. Cependant la questiôn ne doit pas
ê tre écartée a p r io r i; si je suis bien informé, elle doit être mise prochainement
à l’étude, à propos d’une demande de concession des eaux
d ’écoulement du lac de Joux. D’une autre part, le lac de Neuchâtel est
à l’altitude de 435™ ; par conséquent, tout le piateau qui s’y déverse
pourrait, par des canaux souterrains, évacuer ses eaux dans le Léman,
de 60™ inférieur en altitude aux lacs du pied du Jura ; mais nous ne
'connaissons aucune source importante que nous devions attribuer à
c e tte o r ig in e .-C e s eaux venant de bassins voisins entreraient-elles
dans le Léman soùs forme de sources sortant dans le fond du lac ? Les
pêcheurs parlent souvent de sources sous-lacustres ; mais aucune
d ’elles n’est, à ma connaissance, démontrée. Le seul point où l’on pourrait
en soupçonner avec quelque probabilité, la moraine sous-lacustre
d ’Yvoire, ne nous a pas fourni d’indices plausibles (v. p. 143).
Cet ordre d’explication écarté, il ne nous reste, pour rendre compte
de l’anomalie signalée, qu’à invoquer une prédominance, sur les faits
d’évaporation, de ceux de condensation à la surface des corps froids.
Nous avons déjà indiqué le principe de cette action p. 361 ; mais son
.grand intérêt nous entraîne à y revenir un peu plus explicitement.
Les eaux qui s ’écoulent par un fleuve sont la somme algébrique de
trois facteurs : l’eau météorique tombée sous forme de pluie ou de neige
■à la surface du bassin d’alimentation J j l’eau condensée directement
su r les corps froids, rosée, givre -S la quantité enlevée par l’évaporation
; cette dernière représente une quantité négative.
L’évaporation enlève dans l’air une quantité Considérable d’eau.
Dix années d’observations siccimétriquës, faites à Lausanne, par M. L.
Dufour, ont donné une épaisseur moyenne de 738mm(!) pour la couche
d’eau évaporée annuellement, sur un bassin de deux m ètres carrés ;
c ’est une quantité qui approche de celle de la chute d’eau météorique
moyenne de Lausanne, 976™™ ; un tel bassin n ’écoulerait pour ainsi dire
pas d’eau par son émissaire. Mais ces observations, les meilleures que
nous possédions dans notre région, excellentes dans les conditions où
elles ont été faites, ne sont certainement pas applicables à l’ensemble du
bassin du Rhône. La quantité d’eau évaporée sur une surface compliquée
comme le pays drainé par le fleuve, formée en grande majorité de
rochers, de sable, de terrains en friche ou en culture, doit être relativement
beaucoup moins considérable que celle qui se dégage d’un bassin
d’eau, peu profond, se réchauffant puissamment au soleil d’été,
caressé par l’air desséché de la te rre ferme environnante. C’est probablement
plusieurs centimètres, peut-être un ou deux décimètres
d ’épaisseur d’eau, qui sont enlevés annuellement à la surface du bassin
d’alimentation du Léman ; c’est certainement beaucoup moins que
les 7 décimètres observés par Dufour dans sa station de Lausanne.
Mais si la quantité d’eau tombée, en pluie et en neige, sur le bassin
du Léman, était insuffisante pour nourrir à elle seule le Rhône de Genève,
cette quantité étant notablement diminuée par l’évaporation, il
nous faudra trouver une source d’apport d’eau qui compense et au-
delà ce déficit. C’est dans la condensation sur les corps froids que
nous la cherchons.
La rosée, qui se précipite à l’état liquide sur les gazons et autres corps
solides à rayonnement puissant, représente parfois une assez forte
quantité d eau ; mais elle ne doit pas entrer ici en ligne de compte ;
elle n’arrive guère à l’émissaire, la plus grande partie de cette rosée
étant évaporée à l’air dans la journée subséquente. Le givre, espèce
de rosée gelée qui prend un développement parfois si considérable
su r les forêts des montagnes, peut être plus efficace pour l’alimentation
des sources ; il représente souvent la valeur d’une bonne chute
de neige. (2) Quant à la rosée qui se précipite sur les corps humides,
su r l’eau, sur la neige, sur la glace, elle s’additionne à leur masse
(*) Bull. S. Y. S. N. XIII, 444 et 684, Lausanne, 1874. -
(») Le givre,’ qui forme souvent sur les glaciers et sur les neiges une couche de
plusieurs millimètres et même de centimètres d’épaisseur de cristaux serrés représente
une valeur d’eau condensée qui n’est certainement pas négligeable.