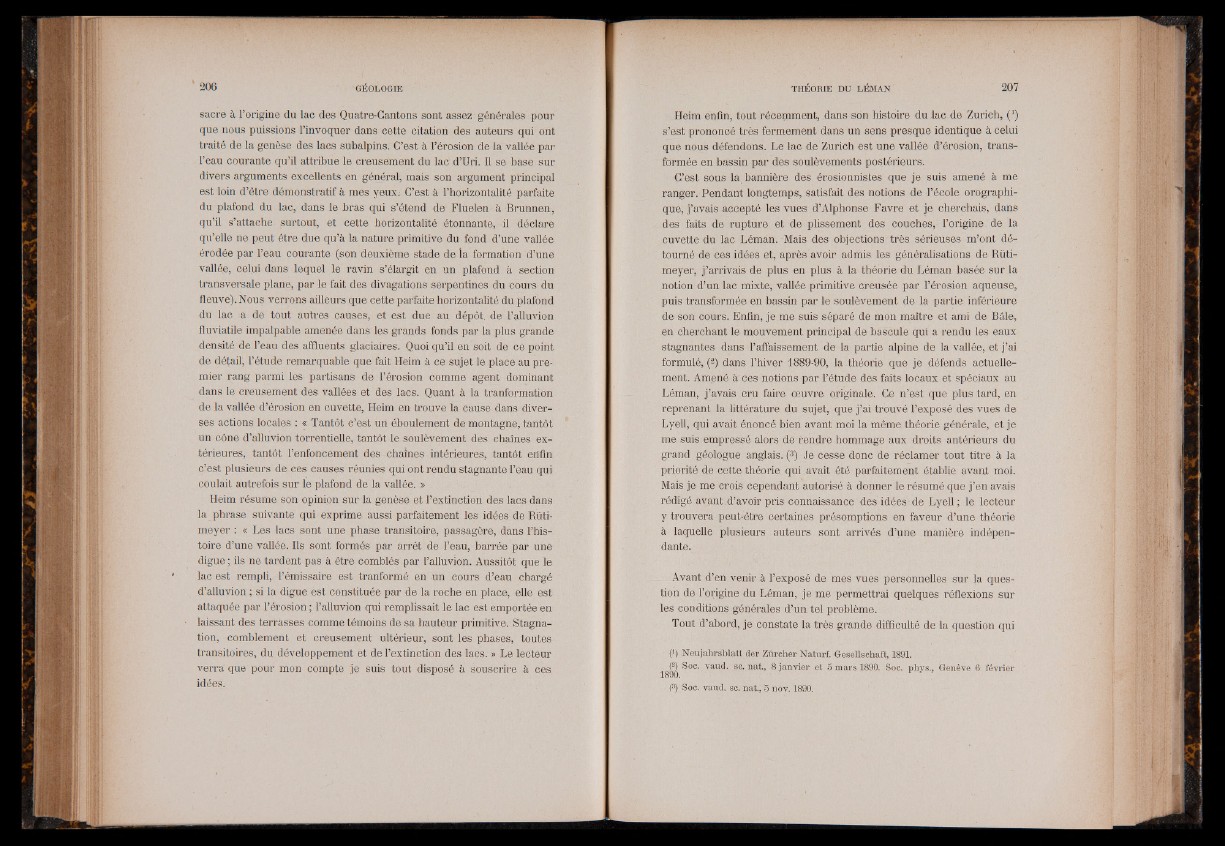
sacre à l’origine du lac des Quatre-Cantons sont assez générales pour
que nous puissions l’invoquer dans cette citation des auteurs qui ont
traité de la genèse des lacs subalpins. C’est à l’érosion de la vallée par
l’eau courante qu’il attribue le creusement du lac d’Uri. Il se base sur
divers arguments excellents en général; mais son argument principal
est loin d’être démonstratif à mes yeux.- C’est à l’horizontalité parfaite
du plafond du lac, dans le bras qui s’étend de Fluelen à Brunnen,
qu’il s’attache surtout, et cette horizontalité étonnante, il déclare
qu’elle ne peut être due qu’à la nature primitive du fond d’une vallée
érodée par l’eau courante (son deuxième stade de la formation d’une
vallée, cel.ui dans lequel le ravin s’élargit en un plafond à section
transversale plane, par le fait des divagations serpentines du cours du
fleuve). Nous verrons ailleurs que cette parfaite horizontalité du plafond
du lac a de tout autres causes, et est due au dépôt de l’alluvion
fluviatile impalpable amenée dans les grands fonds par la plus grande
densité de l’eau des affluents glaciaires. Quoi qu’il en soit de ce point
de détail, l’étude remarquable que fait Heim à ce sujet le place au premier
rang parmi les partisans de l’érosion comme agent dominant
dans le creusement des vallées et des lacs. Quant à la tranformation
de la vallée d’érosion en cuvette, Heim en trouve la cause dans diverses
actions locales : « Tantôt c’est un éboulement de montagne, tantôt
un cône d’alluvion torrentielle, tantôt le soulèvement des chaînes extérieures,
tantôt l’enfoncement des chaînes intérieures, tantôt enfin
c’est plusieurs de ces causes réunies qui ont rendu stagnante l’eau qui
coulait autrefois sur le plafond de la vallée. »
Heim résume son opinion sur la genèse et l’extinction des lacs dans
la phrase suivante qui exprime aussi parfaitement les idées de Rüti-
meyer : « Les lacs sont une phase transitoire, passagère, dans l’histoire
d’une vallée. Ils sont formés par arrêt de l’eau, barrée par une
digue ; ils ne tardent pas à être comblés par l’alluvion. Aussitôt que le
lac est rempli, l’émissaire est tranformé en un cours d’eau chargé
d’alluvion ; si la digue est constituée par de la roche en place, elle est
attaquée par l’érosion ; l’alluvion qui remplissait le lac est emportée en
laissant des terrasses comme témoins de sa hauteur primitive. Stagnation,
comblement et creusement ultérieur, sont les phases, toutes
transitoires, du développement et de l’extinction des lacs. » Le lecteur
verra que pour mon compte je suis tout disposé à souscrire à ces
idées.
Heim enfin, tout récemment, dans son histoire du lac de Zurich, (’)
s’est prononcé très fermement dans un sens presque identique à celui
que nous défendons. Le lac de Zurich est une vallée d’érosion, transformée
en bassin par des soulèvements postérieurs.
C’est sous la, bannière des érosionnistes que je suis amené à me
ranger. Pendant longtemps, satisfait des notions de l’école orographique,
j’avais accepté les vues d’Alphonse Favre et je cherchais, dans
des faits de rupture, et de plissement des couches, l’origine de la
cuvette du lac Léman. Mais des objections très sérieuses m’ont détourné
de ces idées et, après avoir admis les généralisations de Rüti—
rneyer, j’arrivais de plus en plus à la théorie du Léman basée sur la
notion d’un lac mixte, vallée primitive creusée par l’érosion aqueuse,
puis transformée en bassin par le soulèvement de la partie inférieure
de son cours. Enfin, je me suis séparé de mon maître et ami de Bâle,
en cherchant le mouvement principal de bascule qui a rendu leg eaux
stagnantes dans l’affaissement de la partie alpine de la vallée, et j’ai
formulé, (2) dans l’hiver 1889-90, la théorie que je défends actuellement.
Amené à ces notions par l’étude des faits locaux et spéciaux au
Léman, j'avais cru faire oeuvre originale. Ce n’est que plus tard, en
reprenant la littérature du sujet, que j ’ai trouvé l’exposé des vues de
Lyell, qui avait énoncé bien avant moi la même théorie générale, et je
me suis empressé alors de rendre hommage aux droits antérieurs du
grand géologue anglais. (3) Je cesse donc de réclamer tout titre à la
priorité de cette théorie qui avait été parfaitement établie avant moi.
Mais je me crois cependant autorisé à donner le résumé que j ’en avais
rédigé avant d’avoir pris connaissance des idées de Lyell; le lecteur
y trouvera peut-être certaines présomptions en faveur d’un e théorie
à laquelle plusieurs auteurs sont arrivés d’une manière indépendante.
Avant d’en venir à l’exposé de mes vues personnelles sur la question
de l’origine du Léman, je me permettrai quelques réflexions sur
les conditions générales d’un, tel problème.
Tout d’abord, je constate la très grande difficulté de la question qui
(1) ,NeujahrsFlatt der Zürcher Naturf. Gesellschaft, 1891.
(2) Soc. vaud., sc. nat., 8 janvier et 5 mars 1890. Soc. phys., Genève 6 février
1890. .
. (3) Soc. vaud. sc. nat., 5 nov. 1890.