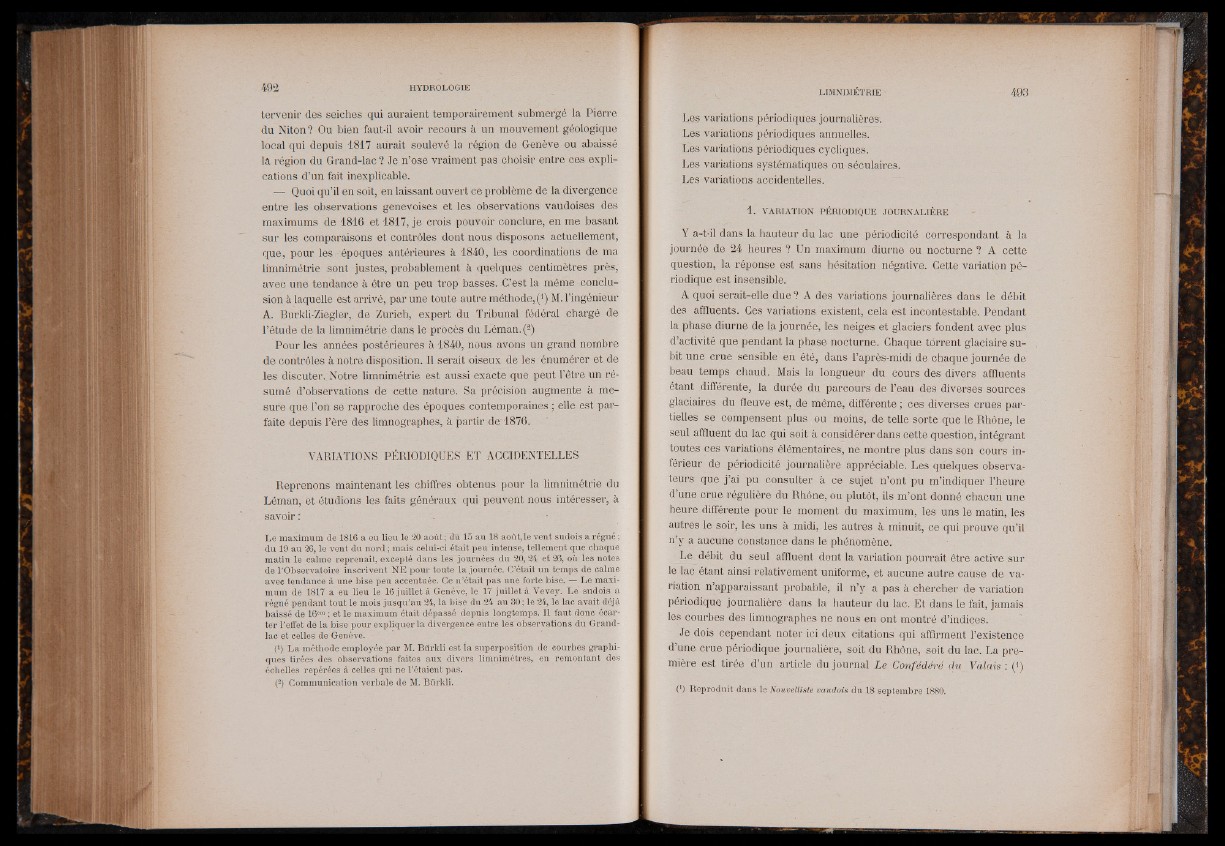
tervenir des seiches qui auraient temporairement submergé la Pierre
du Niton? Ou bien faut-il avoir recours à un mouvement géologique
local qui depuis 1817 aurait soulevé la région de Genève ou abaissé
la région du Grand-lac ? Je n’ose vraiment pas choisir entre ces explications
d’un fait inexplicable.
— Quoi qu’il en soit, en laissant ouvert ce problème de la divergence
entre les observations genevoises et les observations vaudoises des
maximums de 1816 et 1817, je crois pouvoir conclure, en me basant
sur les comparaisons et contrôles dont nous disposons actuellement,
que, pour les époques antérieures à 1840, les coordinations de ma
limnimétrie sont justes, probablement à quelques centimètres près,
avec une tendance à être un peu trop basses. -C’est la même conclusion
à laquelle est arrivé, par une toute autre méthode, (4) M. l’ingénieur
A. Burkli-Ziegler, de Zurich, expert du Tribunal fédéral chargé de
l’étude de la limnimétrie dans le procès du Léman. (2)
Pour les années postérieures à 1840, nous avons un grand nombre
de contrôles à notre disposition. Il serait oiseux de les énumérer et de
les discuter. Notre limnimétrie est aussi exacte que peut l'être un résumé
d’observations de cette nature. Sa précision augmente à mesure
que l’on se rapproche des époques contemporaines ; elle est parfaite
depuis l’ère des limnographes, à partir de'1876.
VARIATIONS PÉRIODIQUES. ET ACCIDENTELLES
Reprenons maintenant les chiffres obtenus pour la limnimétrie du
Léman, et étudions les faits généraux qui peuvent nous intéresser, à
savoir :
Le maximum de 1816 a eu lieu le 20 aoûtfdu 15 au 18 août,le vent sudois a régné;
du 19 au 26, le vent du nord ; mais celui-ci était peu intense, tellement que chaque
matin le calme reprenait, excepté dans lésTjournées du 20, 24 et 26, où les notes
de l’Observatoire inscrivent NE pour toute la journée. C’était un temps de calme
avec tendance à une bise peu accentuée. Ce n’était pas une forte bise.’ — Le maximum
de 1817 a eu lieu le 16 juilletà Genève, le 17 juillet à Vevey. Le sudois a
régné pendant tout le mois jusqu’au 24, la bise du 24 au 80 ; le 24, lé lac avait déjà
baissé de 16cm ; et le maximum était dépassé depuis longtemps. Il faut donc écarter
l ’effet dé la bise pour expliquer la divergence entre lès observations du Grand-
lac et celles de Genève.
(>) La méthode employée par M. Bürkli eét la superposition de courbes graphiques
tirées dos observations faites aux divers limnimètres, en remontant des
échelles repérées à celles qui ne l’étaient pas.
(2) Communication verbale de M. Bürkli.
Les variations périodiques journalières.
Les variations périodiques annuelles.
Les variations périodiques cycliques.
Les variations systématiques ou séculaires.
Les variations accidentelles.
1. VARIATION PÉRIODIQUE JOURNALIÈRE
Y a-t-il dans la hauteur du lac une périodicité correspondant à la
journée de 24 heures ? Un maximum diurne ou nocturne ? A cette
question, la réponse est sans hésitation négative. Cette variation périodique
est insensible.
A quoi serait-elle d u e? A des variations journalières dans le débit
des affluents. Ces variations existent, cela est incontestable. Pendant
la phase diurne de la journée, les neiges et glaciers fondent avec plus
d’activité que pendant la phase nocturne. Chaque torrent glaciaire subit
une crue sensible en été, dans l’après-midi de chaque journée de
beau temps chaud. Mais la longueur du cours des divers affluents
étant différente, la durée du parcours de l’eau des diverses sources
glaciaires du fleuve est, de même, différente ; ces diverses crues partielles
se compensent plus ou moins, de telle sorte que le Rhône, le
seul affluent du lac qui soit à considérer dans cette question, intégrant
toutes ces variations élémentaires, ne montre plus dans son cours inférieur
de périodicité journalière appréciable. Les quelques observateurs
que j ’ai pu consulter à ce sujet n ’ont pu m’indiquer l’heure
d’une crije régulière du Rhône, ou plutôt, ils m’ont donné chacun une
heure différente pour le moment du maximum, les uns le matin, les
autres le soir, les uns à midi, les autres à minuit, ce qui prouve qu’il
n’y a aucune constance dans le phénomène.
Le débit du seul affluent dont la variation pourrait être active sur
le lac étant ainsi relativement uniforme, et aucune autre cause de variation
n’apparaissant probable, il n’y a p as à chercher de variation
périodique journalière dans la hauteur du lac. Et dans le fait, jamais
les courbes des limnographes ne nous en ont montré d’indices.
Je dois cependant noter ici deux citations qui affirment l’existence
d’une crue périodique journalière, soit du Rhône, soit du lac. La première
est tirée d’un article du journal Le Confédéré du Valais : (*)
(*) Reproduit dans le Nouvelliste vaudois du 18 septembre 1880.