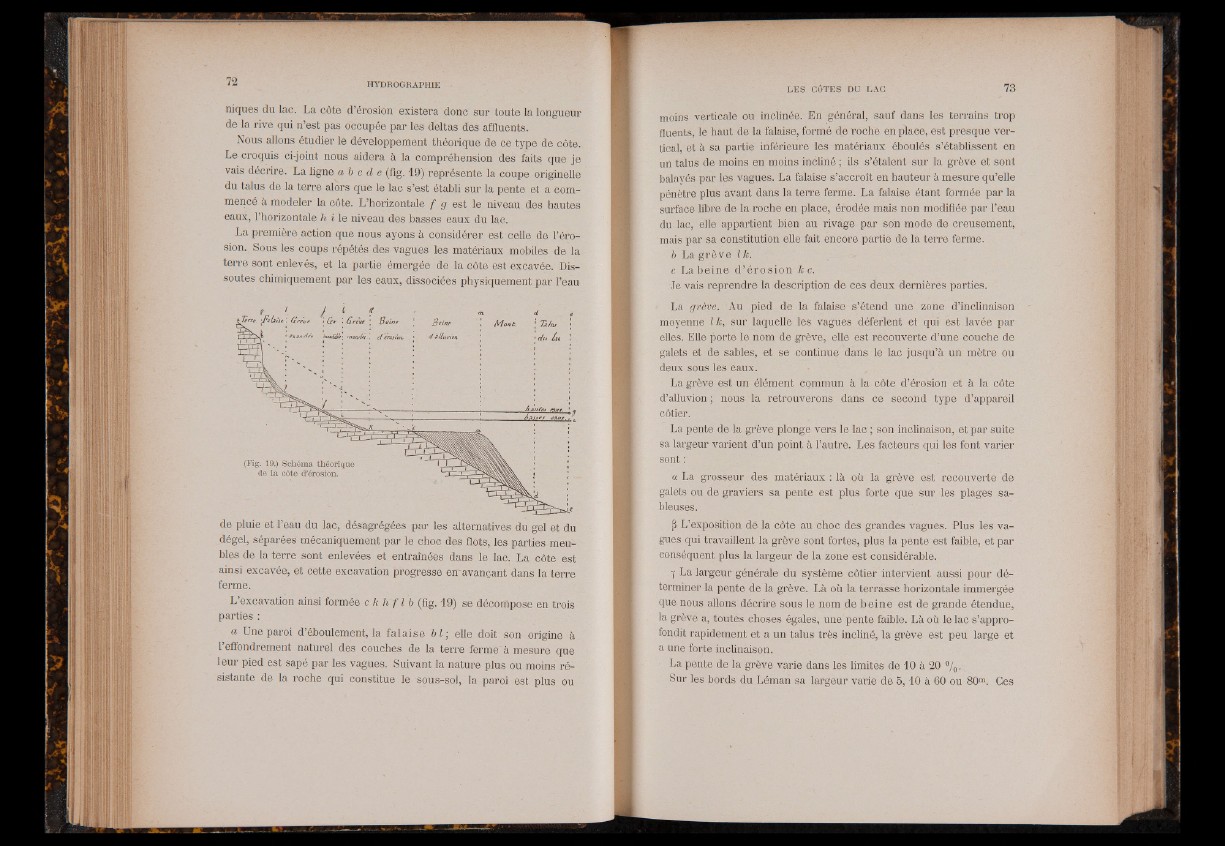
niques du lac. La côte d’érosion existera donc sur toute la longueur
de la rive qui n’est pas occupée par les deltas des affluents.
Nous allons étudier le développement théorique de ce type de côte.
Le croquis ci-joint nous aidera à la compréhension des faits que je
vais décrire. La ligne a b e d e (fig. 19) représente la coupe originelle
du talus de la terre alors que le lac s ’est établi sur la pente et a commencé
à modeler la côte. L’horizontale f g est le niveau des hautes
eaux, l’horizontale h i le niveau des basses eaux du lac.
La première action que nous ayons à considérer est celle de l’érosion.
Sous les coups répétés des vagues les matériaux mobiles de la
te rre sont enlevés, et la partie émergée de la côte est excavée. Dissoutes
chimiquement par les eaux, dissociées physiquement par l’eau
de pluie et l’eau du lac, désagrégées par les alternatives du gel et du
dégel, séparées mécaniquement par le choc des flots, les parties meubles
de la te rre sont enlevées et entraînées dans le lac. La côte est
ainsi excavée, et cette excavation progresse en'avançant dans la terre
ferme.
L’excavation ainsi formée c k h f l b (fig. 19) se décompose en trois
parties :
a Une paroi d’éboulement, la f a la is e b l; elle doit son origine à
l’effondrement naturel des couches de la te rre ferme à mesure que
leur pied est sapé par les vagues. Suivant la nature plus ou moins résistante
de la roche qui constitue le sous-sol, la paroi est plus ou
moins verticale ou inclinée. En général, sauf dans les terrains trop
fluents, le haut de la falaise, formé de roche en place, est presque vertical,
et à sa partie inférieure les matériaux éboulés s’établissent en
un talus de moins en moins incliné ; ils s ’étalent sur Ja grève et sont
balayés par les vagues. La falaise s’accroît en hauteur à mesure qu’elle
pénètre plus avant dans la te rre ferme. La falaise étant formée par la
surface libre de la roche en place, érodée mais non modifiée par l’eau
du lac, elle appartient bien au rivage par son mode de creusement,
mais par sa constitution elle fait encore partie de la te rre ferme.
b La g r è v e Ik.
c L a b e in e d ’é r o s io n k c.
Je vais reprendre la description de ces deux dernières parties.
La grève. Au pied de la falaise s’étend une zone d’inclinaison
moyenne Ik , sur laquelle les vagues déferlent et qui est lavée par
elles. Elle porte le nom de grève, elle est recouverte d’une couche de
galets et de sables, et se continue dans le lac jusqu’à un mètre ou
deux soùs les eaux.
La grève est un élément commun à la côte d’érosion et à la côte
d’alluvion ; nous la retrouverons dans ce second type d’appareil
côtier.
La pente de la grève plonge vers le lac ; son inclinaison, et par suite
sa largeur varient d’un point à l’autre. Les facteurs qui les font varier
sont :
a La grosseur des matériaux : là où la grève est recouverte de
galets ou de graviers sa pente est plus forte que sur les plages sableuses.
p L’exposition dé la côte au choc des grandes vagues. Plus les vagues
qui travaillent la grève sont fortes,_plus la pénté est faible, et par
conséquent plus la largeur de la zone est considérable.
f La largeur générale du système côtier intervient aussi pour déterminer
la pente de la grève. Là où la terrasse horizontale immergée
que nous allons décrire sous le nom de b e in e est de grande étendue,
la grève a, toutes choses égales, une pente faible. Là où le lac s’approfondit
rapidement et a un talus très incliné, la grève est peu large et
a une forte inclinaison.
La pente de la grève varie dans les limites de 10 à 20 °/0. ;
Sur les bords du Léman sa largeur varie de 5 ,1 0 à 60 ou 80m. Ces