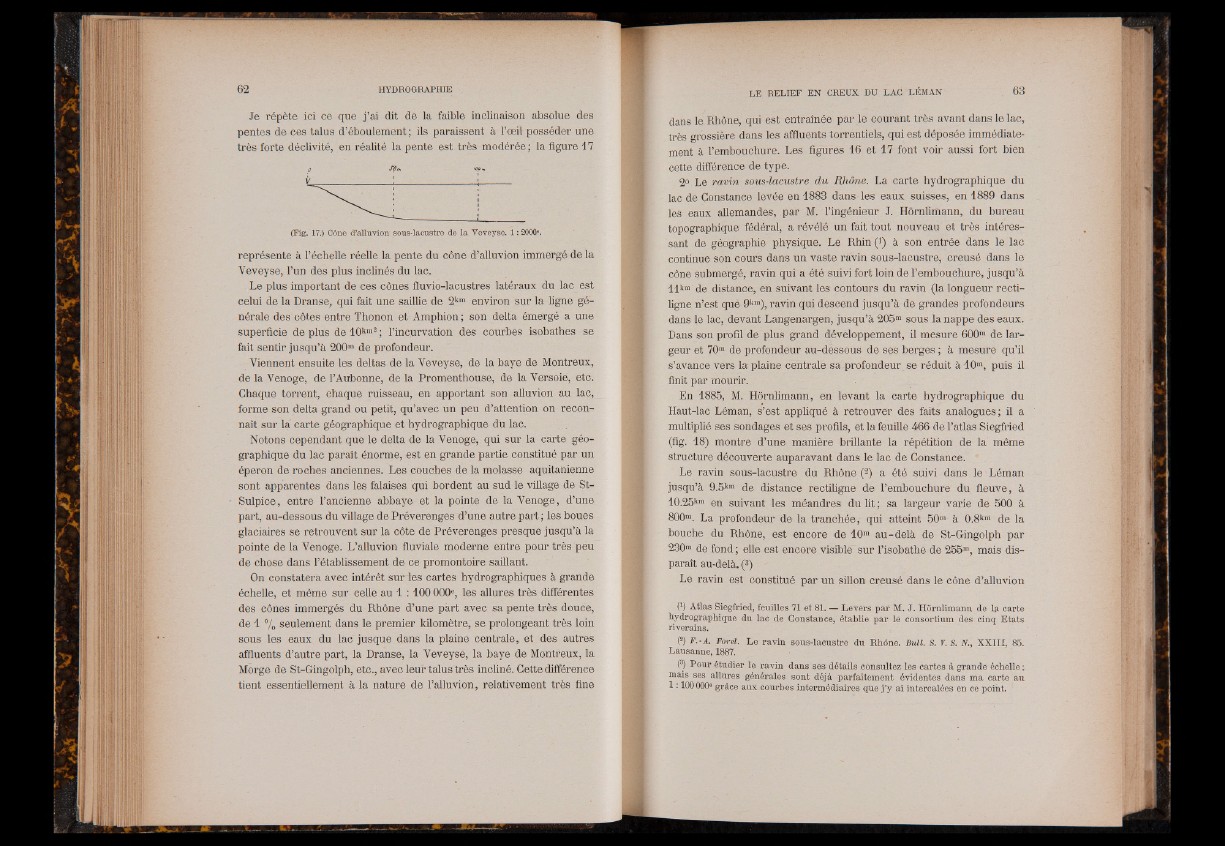
Je répète ici ce que j’ai dit de la faible inclinaison absolue des
pentes de ces talus d’éboulement ; ils paraissent à l’oeil posséder une
très forte déclivité, en réalité la pente est très modérée; la figure 17
représente à l’échelle réelle la pente du cône d’alluvion immergé de la
Veveyse, l’un des plus inclinés du lac.
Le plus important de ces cônes fluvio-lacustres latéraux du lac est
celui de la Dranse, qui fait une saillie de 2km environ sur la ligne générale
des côtes entre Thonon et Amphion; son delta émergé a une
superficie de plus de 10km2 ; l’incurvation des courbes isobathes se
fait sentir jusqu’à 200™ de profondeur.
Viennent ensuite les deltas de la Veveyse, de la baye de Montreux,
de la Venoge, de l’Aubonne, de la Promenthouse, de la Versoie, etc.
Chaque torrent, chaque ruisseau, en apportant son alluvion au lac,
forme son delta grand ou petit, qu’avec un peu d’attention on reconnaît
sur la carte géographique et hydrographique du lac.
Notons cependant que le delta de la Venoge, qui sur la carte géographique
du lac paraît énorme, est en grande partie constitué par un
éperon de roches anciennes. Les couches de la molasse aquitanienne
sont apparentes dans les falaises qui bordent au sud le village de St-
Sulpice, entre l’ancienne abbaye et la pointe de la Venoge, d’une
part, au-dessous du village de Préverenges d’une autre part ; les boues
glaciaires se retrouvent sur la côte de Préverenges presque jusqu’à la
pointe de la Venoge. L’alluvion fluviale moderne entre pour très peu
de chose dans l’établissement de ce promontoire saillant.
On constatera avec intérêt sur les cartes hydrographiques à grande
échelle, et même sur celle au 1 :100 000e, les allures très différentes
des cônes immergés du Rhône d’une part avec sa pente très douce,
de 1 % seulement dans le premier kilomètre, se prolongeant très loin
sous les eaux du lac jusque dans la plaine centrale, et des autres
affluents d’autre part, la Dranse, la Veveyse, la baye de Montreux, la
Morge de St-Gingolph, etc., avec leur talus très incliné. Cette différence
tient essentiellement à la nature de l’alluvion, relativement très fine
dans le Rhône, qui est entraînée par le courant très avant dans le lac,
très grossière dans les affluents torrentiels, qui est déposée immédiatement
à l’embouchure. Les figures 16 et 17 font voir aussi fort bien
cette différence de type.
2° Le ravin sous-lacustre du Rhône. La carte hydrographique du
lac de Constance levée en 1883 dans les eaux suisses, en 1889 dans
les eaux allemandes, par M. l’ingénieur J. Hôrnlimann, du bureau
topographique fédéral, a révélé un fait tout nouveau et très intéressant
de géographie physique. Le Rhin (*) à son entrée dans le lac
continue son cours dans un vaste ravin sous-lacustre, creusé dans le
cône submergé, ravin qui a été suivi fort loin de l’embouchure, jusqu’à
l l km de distance, en suivant les contours du ravin (la longueur recti-
ligne n’est que 9km), ravin qui descend jusqu’à de grandes profondeurs
dans le lac, devant Langenargen, jusqu’à 205m sous la nappe des eaux.
Dans son profil de plus grand développement, il mesure 600m de largeur
et 70m de profondeur au-dessous de ses berges ; à mesure qu’il
s’avance vers la plaine centrale sa profondeur se réduit à 40m, puis il
finit par mourir.
En 1885, M. Hôrnlimann, en levant la carte hydrographique du
Haut-lac Léman, s ’est appliqué à retrouver des faits analogues; il a
multiplié ses sondages et ses profils, et la feuille 466 de l’atlas Siegfried
(fig. 18) montre d’une manière brillante la répétition de la même
structure découverte auparavant dans le lac de Constance.
Le ravin sous-lacustre du Rhône (2) a été suivi dans le Léman
jusqu’à 9.5km de distance rectiligne de l’embouchure du fleuve, à
10.25km en suivant les méandres du lit ; sa largeur varie de 500 à
800m. La profondeur de la tranchée, qui atteint 50m à 0.8km de la
bouche du Rhône, est encore de 10m au -d e là de St-Gingolph par
230m de fond ; elle est encore visible sur l’isobathe de 255m, mais disparaît
au-delà. (3)
Le ravin est constitué par un sillon creusé dans le cône d’alluvion
(*) Atlas Siegfried, feuilles 71 et 81. — Levers par M. J. Hôrnlimann de la carte
hydrographique du lac de Constance, établie par le consortium des cinq Etats
riverains.
(2) F.-A. Forel. Le ravin sous-lacustre du Rhône. Bull. S. V. S. N., XXIII, 85.
Lausanne, 1887.
(3) Pour étudier le ravin dans ses détails consultez les cartes à grande échelle ;
mais ses allures générales sont déjà parfaitement évidentes dans ma carte au
1:100000® grâce aux courbes intermédiaires que j’y ai intercalées en ce point.