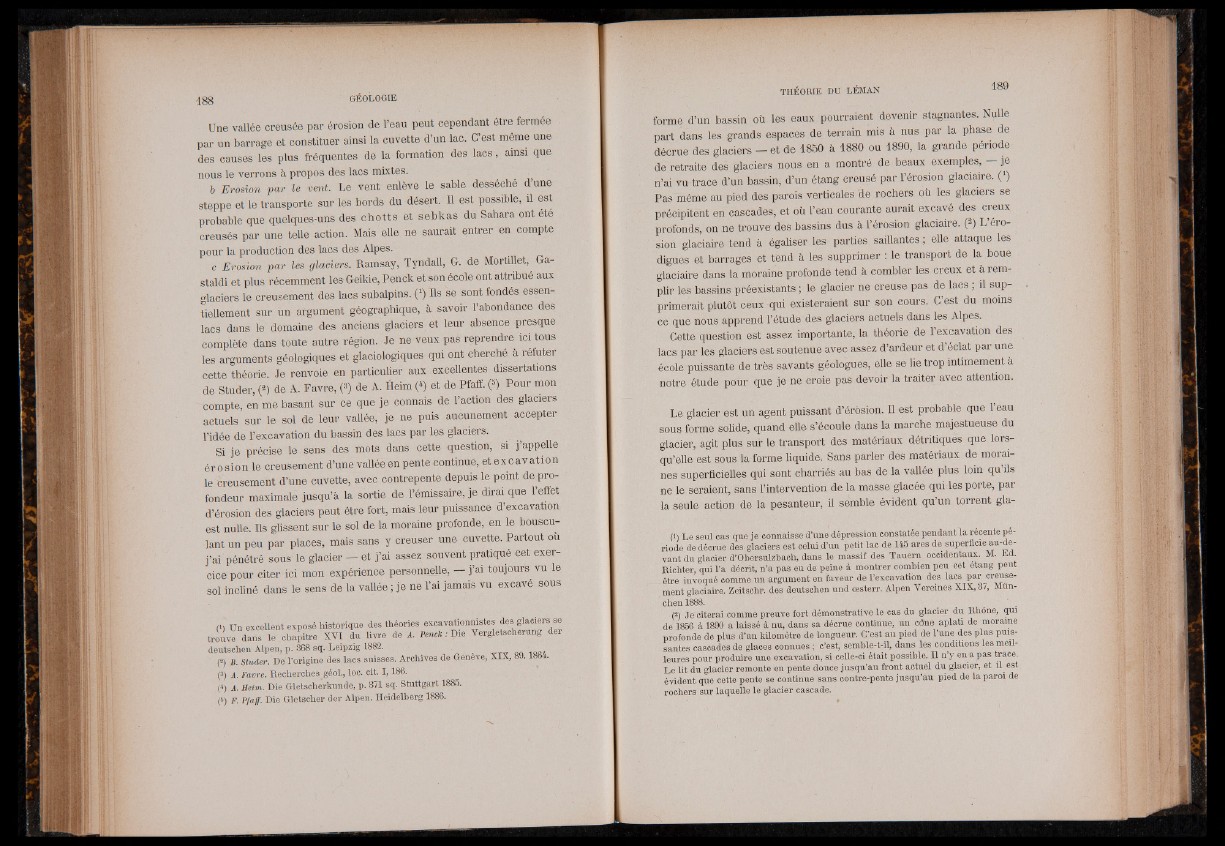
Une vallée creusée p ar érosion de l’eau peut cependant être fermée
par un barrage et constituer ainsi la cuvette d’un lac. C’est même une
des causes les plus fréquentes de la formation des la c s , ainsi que
nous le verrons à propos des lacs mixtes. ^
b Erosion p a r le vent. Le vent enlève le sable desséché d’une
steppe et le transporte sur les bords du désert. 11 est possible, il est
probable que quelques-uns des c h o t t s et s e b k a s du Sahara ont été
creusés par une telle action. Mais elle ne saurait entrer en compte
pour la production des lacs des Alpes.
c Erosion p a r les glaciers. Ramsay, Tyndall, G. de Mortillet, Ga-
staldi et plus récemment les Geikie, Penck et son école ont attribué aux
glaciers le creusement des lacs subalpins. (L) Ils se sont fondés essentiellement
sur un argument géographique, à savoir l’abondance des
lacs dans le domaine des anciens glaciers et leur absence presque
complète dans toute autre région. Je ne veux pas reprendre ici tous
les arguments géologiques et glaciologiques qui ont cherché à réfuter
cette théorie. Je renvoie en particulier aux excellentes dissertations
de Studer, (2) de A. Favre, (3) de A. Heim (4) et de Pfaff. (5) Pour mon
compte, en me basant sur ce que je connais de l’action des glaciers
actuels sur le sol de leur vallée, je ne puis aucunement accepter
l’idée de l’excavation du bassin des lacs par les glaciers.
Si je précise le sens des mots dans cette question, si j’appelle
é r o s io n le creusement d’une vallée en pente continue, et e x c a v a tio n
le creusement d’une cuvette, avec contrepente depuis le point de profondeur
maximale jusqu’à la sortie de l’émissaire, je dirai que l’effet
d’érosion des glaciers peut être fort, mais leur puissance d’excavation
est nulle. Ils glissent sur le sol de la moraine profonde, en le bousculant
un peu par places, mais sans y creuser une cuvette. Partout où
j ’ai pénétré sous le glacier - et j’ai assez souvent pratiqué cet exercice
pour citer ici mon expérience personnelle, — j’ai toujours vu le
sol incliné dans le sens de la vallée ; je ne l’ai jamais vu excavé sous
(1) Un excellent exposé historique des théories excavationnistes de*, glaciers; se
trouve dans le.chapitre XVI du livre de A. Penck : Die Vergletseherung der
deutschen Alpen, p. 368 sq. Leipzig 1882. '. V # '. , oa/
(2) B. Studer. De' l’origine des.lacs suisses. Archives de Genève, XIX, 89.1864.
(3) A. Favre. Recherches ^géol., loc. cit. 1 ,186.
(4) A. Heim. Die Gletscherkunde, p. 371 sq. Stuttgart 1885.
/si p venir Die Gletscher der Alpen. Heidelherg 1886.
forme d’un bassin où les eaux pourraient devenir stagnantes. Nulle
part dans les grands espaces de terrain mis à nus par la phase de
décrue des glaciers - et de 1850 à 1880 ou 1890, la grande période
de retraite des glaciers nous en a montré de beaux exemples, — je
n’ai vu trace d’un bassin, d’un étang creusé par l’érosion glaciaire. (')
Pas même au pied des parois verticales de rochers où les glaciers se
précipitent en cascades, et où l’eau courante aurait excavé des creux
profonds, on ne trouve des bassins dus à l’érosion glaciaire. (2) L’érosion
glaciaire tend à égaliser les parties saillantes ; elle attaque les
digues et barrages et tend à les supprimer : le transport de la boue
glaciaire dans la moraine profonde tend à combler les creux et à remplir
les bassins préexistants ; le glacier ne creuse pas de lacs ; il supprimerait
plutôt ceux qui existeraient sur son cours. C e st du moins
cè que nous apprend l’étude des glaciers actuels dans les Alpes.
Cette question est assez importante, la théorie de l’excavation des
lacs par les glaciers est soutenue avec assez d’ardeur et d’éclat par une
école puissante de très savants géologues, elle se lie trop intimement à
notre étude pour que je ne croie pas devoir la traiter avec attention.
Le glacier est un agent puissant d’érosion. Il est probable que 1 eau
sous forme solide, quand elle s’écoule dans la marche majestueuse du
glacier, agit plus sur le transport des matériaux détritiques que lorsqu’elle
est sous la forme liquide. Sans parler des matériaux de moraines
superficielles qui sont charriés au bas de la vallée plus loin qu ils
ne le seraient, sans l’intervention de la masse glacée qui les porte, par
la seule action de la pesanteur, il semble évident qu’un torrent gla-
(*) Le seul cas que je connaisse d’une dépression constatée pendant la récente période
de décrue des-glaciers est celui d’un petit lac de 145 ares de superficie au-devant
du glacier d’Obersulzbach, dans le massif des Tauern occidentaux. M. Ed.
Richter, qui l ’a décrit, n’a pas eu de peine à montrer combien peu cet étang peut
être invoqué comme un argument en faveur de l’excavation des lacs par creusement
glaciaire. Zeitschr. des deutschen und oesterr. Alpen Vereines XIX, 37, Mun-
chenl888.
(2) Je citerai comme preuve fort démonstrative le cas du glacier du Rhône, qui
de 1856 à 1890 a laissé à nu, dans sa décrue continue, un cône aplati de moraine
profonde de plus d’un kilomètre de longueur. C’est au pied de l ’une des plus puissantes
cascades de glaces connues ; c’est, semble-t-il, dans les conditions les meilleures
pour produire une excavation, si celle-ci était possible. Il n’y en a pas trace.
Le lit du glacier remonte en pente douce jusqu’au front actuel du glacier, et il est
évident que cette pente se continue sans contre-pente jusqu’au pied de la paroi de
rochers sur laquelle le glacier cascade.